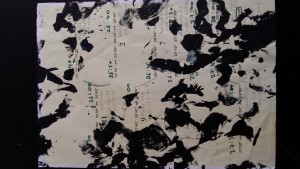Access to the English translations: Encounter with Giacomo Spica Capobianco
Entretien avec Giacomo Spica Capobianco
Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff
Mai 2019
Sommaire
Introduction
I. L’Orchestre National Urbain
II. Actions menées à la Duchère 2015-2019
a. Le Projet
b. L’origine du projet
c. Instruments construits spécialement : Le spicaphone
d. Les résidences
e. Les ateliers d’écriture
f. L’organisation de la première résidence
III. Cra.p, Centre d’art
IV. Politique politicienne et politique citoyenne
Liste des institutions mentionnées dans cet entretien (et liens)
Introduction
Giacomo Spica Capobianco travaille depuis plus de trente ans à enfoncer les cloisons, combler les fossés, ouvrir des fenêtres dans les murs pour voir ce qu’il y a derrière, construire des ponts pour que les antagonismes puissent se rencontrer, se rendre visite, se confronter pacifiquement. En 1989, il a créé le Cra.p, « Centre d’art – musiques urbaines/musiques électroniques » dont l’objectif est
d’échanger des savoirs et savoirs-faire dans le domaine des musiques urbaines électro, croiser les esthétiques et les pratiques, susciter les rencontres, inventer des nouvelles formes, créer des chocs artistiques, donner les moyens de s’exprimer. [accueil du site Cra.p]
C’est à travers des actes tangibles de développement de pratiques artistiques que son action a pris forme dans une variété de contextes difficiles à définir par des étiquettes hâtivement déterminées, mais avec un souci particulier pour les personnes qui bien souvent « n’ont accès à rien ». L’effacement des frontières, dans la réalité de son action, ne correspond jamais à l’imposition d’une esthétique sur une autre ou au détriment d’une autre. Bien au contraire, son action est fondée sur la présence de dispositifs conçus pour aider les individus à développer leur propre production artistique, ceci de manière collective, en compagnie d’autres personnes, quelles que soient leurs différences.
I. L’Orchestre National Urbain
Jean-Charles F. :
Peux-tu nous donner quelques précisions sur l’Orchestre National Urbain. Qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?
Giacomo S. C. :
L’Orchestre National Urbain a été créé suite à une réflexion que j’ai eue il y a très, très longtemps. En 2006, au Forum des musiques actuelles à Nancy, j’avais répondu à quelqu’un qui me demandait ce que je faisais, « Ouais, j’ai monté l’ONU » en rigolant. Alors il a dit : « C’est quoi ? » Je lui avais dit : « C’est l’Orchestre National Urbain. » Bon, c’était en 2006. En 2012 ça a commencé à me chatouiller et en 2013 je me suis décidé à créer l’Orchestre National Urbain.
L’Orchestre National Urbain, ce n’est pas l’ONU, il ne faut pas qu’on se trompe, c’est un peu un pied de nez. Le casting de cet orchestre est composé à la fois de musiciennes et de musiciens, il y a une parité femmes-hommes. Il y a des gens qui viennent du classique, du jazz, du hip hop, de l’électro, de tous les côtés, ce n’est pas pour faire un melting pot de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce n’est absolument pas ça. C’est travailler ensemble pour produire de la musique, tout le monde ayant aussi un propos pédagogique assez fort. C’est aussi faire travailler plein de gens dans les quartiers, mais pas que des gens de quartier.
Donc, j’ai demandé dans mon entourage qui serait intéressé à se joindre à un orchestre avec moi. Lucien16S (Sébastien) le premier s’est dit intéressé. Thècle aussi qui fait du beat-box ici, de l’électro, une fille très intéressante qui a suivi notre formation. Je lui ai proposé et elle a dit oui. Après, une autre personne est venue se joindre, et ainsi de suite. Le nombre de personnes a bougé depuis, parce qu’il y en a qui sont partis. Cela fait déjà un petit moment que cela s’est stabilisé à huit personnes. Le but du jeu, c’est d’avoir un répertoire écrit, tout est écrit. On fait tout de même de l’impro, on peut faire de l’impro, mais c’est vraiment une musique très construite au départ, que j’ai composée. Les textes sont partagés, cela veut dire que je ne suis pas le seul à écrire les textes, j’en écris très peu, c’est plutôt les autres qui les font. Et le but du jeu, j’ai voulu tout composer en enregistrant directement avec un spicaphone (mon bâton à une corde) et l’utilisation de mon looper, puis de travailler de façon orale avec les gens. Cette démarche évite d’avoir des partitions et tout ce que cela suppose. Sauf pour les cuivres, parce que parfois ils disaient : « Partitions ! ».
Après, il a fallu trouver des gens qui avaient envie de se retrouver dans cette dynamique-là. L’idée était aussi de venir partager leur savoir avec n’importe quel public et d’avoir de la patience en plus. J’ai rencontré récemment une fille à la batterie qui était candidate. On en a discuté, elle m’a dit : « De toutes façons, moi, pas de pédagogie, pas d’impro. » Je lui ai dit : « Pas d’ONU ! Ciao ! » J’ai pensé qu’on ne pouvait pas s’entendre si la pédagogie et l’improvisation étaient contre sa nature. Il fallait créer une équipe qui avait envie de faire ce genre de choses. Cela a été un travail très long, parce qu’il a fallu mettre en place un répertoire d’un peu plus d’une heure. Tout de suite s’est posée la question de la raison d’être de l’Orchestre National Urbain, qu’est-ce que cela représente politiquement, et qu’est-ce que cela veut dire ? C’est non seulement un projet artistique mais c’est aussi pour revenir dans les quartiers les plus éloignés de tout et de mettre un coup pour que les choses se relancent. À partir de là, j’ai écrit un projet que j’ai présenté à la Ville de Lyon, à la Préfecture, à la DRAC et à la Métropole de Lyoni. Tout le monde a accepté. Donc ils ont commencé à nous aider un peu avec de petites subventions pour démarrer. On a pu commencer les projets que nous avions annoncés. Je ne dis pas qu’on a aujourd’hui des mille et des cents, mais on reçoit un soutien plus important que celui qu’on a eu au départ.
Avec l’Orchestre National Urbain, l’idée est de se poser dans une ville et de demander une salle de concert. On se pose pendant une semaine, cela ne leur coûte rien parce qu’on est financé pour que tous les intervenants, musiciennes et musiciens soient payés, et pendant une semaine on fait travailler tous les mômes qui sont dans le coin.
Aujourd’hui la réflexion ne se limite pas avec l’Orchestre National Urbain à partager nos pratiques avec les gens des quartiers les plus reculés, mais aussi de le faire avec les gens qui bossent dans l’enseignement supérieur. C’est-à-dire leur mettre le nez dans nos pratiques. Là, on commence avec le CNSMi, moi j’ai envie de voir comment on peut prendre des jeunes musiciens et musiciennes pour travailler d’abord sur l’artistique, puis sur les manières d’envisager la pédagogie. Voilà le but du jeu. Un socle s’est institué avec l’Orchestre National Urbain. Mais c’est un socle qui bouge, qui n’est pas figé. C’est-à-dire, il y a un socle et puis il y a autour des projets ponctuels et satellites. Je rentre juste du Maroc, j’ai découvert qu’au Maroc ils sont très intéressés par ce projet. J’ai fait travailler des berbères, des tribus berbères, surtout des femmes, c’était très intéressant. Si tout va bien, on nous invite à aller jouer au Maroc au mois de septembre [2019], et je ne veux pas simplement aller jouer au Maroc pour faire la star. On va y aller pour rencontrer les berbères et faire un travail avec eux à la fois artistique et pédagogique. C’est pour cette raison que j’ai été là-bas : j’ai joué et j’ai fait de la pédagogie. Et j’ai envie de développer cela de plus en plus. Mon souhait c’est que l’Orchestre National Urbain fasse des petits dans d’autres régions, dans d’autres pays et que cette réflexion puisse s’inscrire dans un réseau, parce nous pensons que cela fonctionne bien. Aujourd’hui on a un résultat, c’est-à-dire qu’on est assez contents de ce qui se passe et surtout de la relation qu’on est capable d’établir avec les gens qu’on rencontre.
Pour moi, c’est un peu le bilan de trente ans de Cra.p où j’ai fait plein de projets, de musique, et où j’ai eu la chance de rencontrer plein de personnes différentes et de travailler avec elles. Il y a un moment où je me suis dit qu’il fallait créer un truc très, très cadré, mais axé sur la rencontre, et de voir comment on développe des choses et des réflexions à partir de ce projet. En plus avec un pied-de-nez énorme : pour l’Orchestre National Urbain, s’appeler l’ONU, cela représente plein de choses pour moi – et il s’agit bien là d’un acte politique et culturel. En ce qui concerne ce qui se passe à Cra.p, je suis super content. On a quand même trente ans d’existence, avec des gens qu’on a pu amener aujourd’hui à obtenir un Diplôme d’État et qui maintenant travaillent ici, d’autres vont suivre le même parcours, tout cela fonctionne bien. Et j’aimerais que cela puisse faire école ailleurs et dans d’autres villes, dans d’autres régions, mais c’est très fragile car on n’est peut-être que les seuls à avoir développé cette idée.
Une préfecture désigne les services de l’administration préfectorale à la tête desquels est placé un préfet, ainsi que le bâtiment qui les héberge.
Les DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) sont des organismes représentant l’Etat en région, chargé de conduire la politique culturelle.
La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale regroupant 59 communes qui composent le territoire du « Grand Lyon ».
CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse) : enseignement supérieur spécialisé en musique et en danse. Il y a deux CNSMD en France, Paris et Lyon.
Jean-Charles F. :
Donc, à l’intérieur de l’ONU, la façon dont je comprends les choses, c’est à la fois un ensemble musical, un commando quelque part, un groupe de réflexion et une équipe pédagogique. Donc c’est une structure à entrées multiples. Et d’autre part, à l’intérieur même il y a une diversité. Pourrais-tu parler de cette diversité ? Et aussi comment ceux qui sont issus de cette diversité se rencontrent ?
Giacomo S. C. :
La diversité est réalisée par le choix des membres de l’orchestre. Je ne voulais pas avoir uniquement des gens par exemple branchés musiques actuelles amplifiées (en plus ils sont dans un réseau dont je fais moi-même partie). Par ailleurs la diversité ne s’est pas faite par un calcul, mais par affinité. Cela veut dire, que j’ai eu la chance de rencontrer des gens d’univers différents, je n’ai pas des œillères. On me propose souvent d’aller vers les autres qui ne font pas partie soi-disant de mon domaine musical, pourtant je ne vois pas ce que cela veut dire : aller vers l’autre n’implique pas forcément d’abandonner sa propre façon de voir les choses. Mais lorsqu’une chanteuse lyrique vient nous voir, je trouve qu’il est très intéressant de se demander comment on va faire pour travailler ensemble. Elle a appris des choses de son côté, on a construit des choses du notre, comment est-ce que cela peut se rejoindre ? Est-ce que le public va pouvoir s’impliquer lui aussi dans cette démarche ? Car fatalement, quand on a huit personnes qui viennent toutes d’endroits complètement différents, et qui se présentent devant un public qui lui aussi est différent, on se demande comment il va considérer ce travail, comment il va réagir. C’est cela qui m’intéresse. Cela veut dire qu’il faut se demander comment on va pouvoir bousculer un petit peu les œillères de ceux qui sont séparés par les cloisons qu’ils ont construites, on est au cœur du sujet de votre édition « Faire tomber les murs ». Depuis plus de vingt ans on se disait avec beaucoup d’ambition (et d’utopie) qu’on allait être capable de changer les choses pour faire travailler ensemble les départements de jazz, de rock, de musiques traditionnelles, ou d’autres départements « machins ». Je trouve que les choses n’ont pas tellement changé.
Le fait de faire un casting avec des gens qui viennent d’horizons très différents, de cette manière, remet cette ambition au premier plan, et nous démontrons que sa réalisation est possible. Et là je viens d’inviter tout bêtement un violoncelliste, Selim Penarañda, parce qu’on avait une saxophoniste qui ne pouvait pratiquement jamais être là. Je connaissais Selim et je l’ai appelé. Il a un parcours extrêmement intéressant, c’est très rare : il est d’origine arabe andalouse, d’une mère algérienne et d’un père espagnol. Il est né à la Croix-Rousse. Il n’était absolument pas destiné à être musicien classique violoncelliste. Selim s’est retrouvé à faire de la musique classique, parce qu’il a eu une prof géniale quand il était à l’école : pendant la dernière demi-heure, tous les jours, elle leur faisait écouter de la musique classique. À 12 ans, il lui a dit : « C’est quoi ça ? ». Elle a dit : « C’est du violoncelle », alors il a dit : « Je veux faire du violoncelle ». Ses parents ont tant bien que mal essayé de lui procurer un violoncelle et il est arrivé à avoir des cours et tout a suivi. Maintenant il est violoncelliste et il est prof. Il est prof et musicien. Il vient du classique, et tout d’un coup, on amplifie son violoncelle, et tout se met à jouer, et il est ravi. Il dit : « Enfin, je trouve un projet où je me sens bien ». Et à côté de cela, il fait de la musique de chambre. Et moi c’est ce genre de situations qui m’intéresse.
Nicolas S. :
Comment tu le rencontres, lui par exemple ?
Giacomo S. C. :
Lui, il est venu s’inscrire ici, et il nous a dit : « Je fais du violoncelle et de la musique de chambre ; j’ai envie de travailler sur la nouvelle technologie ». On discute et il fait un parcours de trois mois chez nous. Mais il joue tellement qu’il ne peut pas continuer. Il n’avait pas le temps de continuer la formation qu’il avait envie de faire ici, donc il disparaît. On avait alors Caroline Silvestre au trombone, on a essayé de travailler avec elle pendant un moment et ça n’a pas marché parce qu’il y a eu deux résidences où elle ne pouvait pas venir. Alors Sébastien m’a dit qu’il avait des contacts avec Sélim et qu’on pourrait essayer de travailler avec lui. J’ai tout de suite accepté, ça s’est fait comme ça. Et Selim est ravi, il a des outils directs dans la rencontre, il fait des choses qui fonctionnent directement, il passe son violoncelle, etc.
Ensuite, c’est le tromboniste Joël Castaingts qui est rentré à l’ONU il y a un an à peu près, parce que Caroline Sylvestre n’a pas pu continuer. C’est quelqu’un hyper intéressant, ce qui m’a vraiment séduit chez ce mec-là, c’est qu’il n’était pas le genre de gars qui refusait de passer son trombone à ceux ou celles qui participaient aux ateliers. Par exemple il joue quelque chose et ensuite il passe son trombone à un des jeunes et lui dit « Vas-y joue ». C’est un signe pour moi ça, car il faut quand même faire gaffe quand tu fais ça, parce que tu peux te prendre une bactérie, tu ne sais pas ce que les gamins font. C’est un signe de confiance, pour moi ça veut dire beaucoup de choses.
C’est très positif, mais ce choix-là est fait aussi parce que, quand on va en résidence, on est face à un public à qui il faut faire part de ces différentes manières de faire de la musique. Il faut prendre en compte comment ils voient une chanteuse lyrique, comment ils voient un violoncelliste classique, comment ils voient un dingue avec des instruments construits à partir de simples matériaux, comment ils voient quelqu’un qui fait du rap. Et ils s’aperçoivent qu’en fait ces gens-là peuvent travailler ensemble. Comment ils voient une danseuse qui ne fait ni du hip-hop, ni du contemporain, ni du classique, mais qui fait du mouvement et que, tout d’un coup, elle donne sens à son corps et comment eux peuvent donner sens à leur corps aussi. Cet axe-là, je l’ai pratiqué tellement et depuis si longtemps, que c’est devenu presque un acte inconscient de ma part et que cela ne pouvait pas se faire autrement. Voilà à peu près l’histoire de la diversité et de la rencontre. Justement, cette rencontre des diversités est difficile et prend du temps. Ce n’est pas si simple que ça, puisque l’équipe actuelle n’est pas celle d’il y a deux ou trois ans. Parce qu’il y a des personnes qui n’ont pas tenu le coup, face à des logiques qui les bousculaient tellement. Récemment, j’ai vu des personnes quitter l’orchestre en disant : « Non, ma logique ce n’est pas de faire de la musique comme cela. » Tout d’un coup, c’est des gens qui n’étaient pas prêts à suivre cette démarche, qui tentaient d’installer une espèce de chose très personnelle à l’intérieur du projet et cela faisait un projet dans le projet. Et je trouve aussi que ce type de rencontres est intéressant au niveau de la recherche, c’est ce qu’on aimerait voir un petit peu plus dans les lieux de formation, où malheureusement, je le dis, c’est de pire en pire. C’est pour ça que je parle de la régression inférieure par rapport à l’enseignement supérieur. Je pense qu’il y a une régression même plus inquiétante que celle qu’on a vécu pendant les années 1960-70 : cette époque était peut-être plus intéressante que celle qu’on vit aujourd’hui. On peut aller dans n’importe quel endroit où l’on pratique de la musique, on n’en trouve que très peu avec des choses intéressantes qui se passent entre les différentes castes musicales en présence. Il y a des cloisonnements qui me rendent fou.
Voilà comment on a conçu l’Orchestre National Urbain. Mais cela va plus loin que cela : on est en train de roder un répertoire. Mon ambition, c’est aussi de rencontrer d’autres formations. J’en parlais, il y a quelque temps, avec Camel Zekri qui me disait : « Avec les musiques traditionnelles, il faudrait vraiment qu’on monte un truc ensemble ». Avec Karine Hahn, il n’y a pas longtemps, j’ai parlé de Gaël Rassaert avec sa Camerata du Rhône, un ensemble de cordes, pourquoi ne pas organiser une rencontre avec eux ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire ensemble ? Moi j’ai un réseau de rappeurs, alors on va inviter des rappeurs sur scène pour que les pratiques se confrontent. Ce qui m’intéresse, c’est d’organiser une plateforme avec un orchestre où ça bouge. Comment envisager que ce ne soit pas tout et n’importe quoi ? Quelle cohérence peut-on trouver avec les musiques traditionnelles de n’importe quelle ethnie, de n’importe quel endroit ? Comment se rencontrer avec la musique contemporaine, avec la musique classique, avec n’importe qui ? Il ne s’agit pas simplement de se rencontrer, c’est aussi de savoir comment on réfléchit ensemble aux problèmes que cela pose, comment on travaille réellement en commun. Voilà à peu près l’idée de ce projet-là.
II. Actions menées à la Duchère 2015-2019
a. Le Projet
Jean-Charles F. :
Est-ce que tu pourrais décrire une action particulière dans le détail ? Un projet que tu as fait récemment ou moins récemment. Quelque chose dont on aurait tous les éléments.
Giacomo S. C. :
Une action toute récente, c’est le travail réalisé à la Duchère, un quartier de Lyon (dans le 9ème arrondissement). Donc la Duchère, cela a trois ou quatre ans d’existence, de travail, pour arriver à créer un groupe de jeunes ; il y a quatre ans ils avaient 12/13 ans, ils en ont 16/17 maintenant. Ce travail, pour moi, a donné le résultat aujourd’hui le plus intéressant, certainement dans la recherche sur les comportements de ce groupe et de son entourage. On a fait trois résidences là-bas, la dernière a eu lieu au mois d’avril 2019, toujours avec les mêmes jeunes, ce qui a permis de voir comment ils avaient évolué. Du point de vue des jeunes, c’est quelque chose qui a très bien fonctionné. Cela a mis en route beaucoup d’ouvertures possibles. Après, c’est plus difficile quand on a des gens qui participent au projet et qui sont embauchés par un Centre social, une MJCi, une École de musique, ou un Conservatoire, et qui, parce que tout à coup leurs directions baissent les bras, ne peuvent plus travailler avec nous. C’est qu’on ne peut plus alors travailler avec des personnes qui sont en lien constant avec les mômes. Justement à la Duchère il y a eu des changements imprévus. Le projet se déroulait au sein de la bibliothèque/médiathèque de la Duchère et le Conservatoire de Lyon [un CRRi] était partenaire. Tout d’un coup, ce lieu a brûlé par un acte criminel. Tout le matos qui permettait de faire de la musique a brûlé. C’est ainsi que la MJC de la Duchère a ouvert ses portes pour accueillir ces mômes-là.
L’objectif de l’Orchestre National Urbaini, c’est de repérer des jeunes, surtout pour les amener jusqu’à une formation diplômante. On s’aperçoit d’une dérive que j’ai déjà décrite en 2005 dans Enseigner la musique, il va falloir qu’on travaille beaucoup là-dessus : des animateurs en poste dans un endroit, qui au départ font un peu de musique, mais n’ont pas cette fonction-là, qui cherchent, malgré le fait qu’ils ont déjà un métier, à prendre la place des intervenants de l’Orchestre National Urbain, tout en demandant à être formés. Et donc, là où ça pose un problème, c’est que ces personnes-là font écran devant les jeunes sans s’en rendre compte ou s’en rendant trop bien compte. Le pire ici c’est de donner des illusions à des mômes, en leur disant qu’ils vont devenir des stars, qu’ils vont jouer partout et qu’ils vont se faire du fric. C’est contre cela que Cra.p s’est battu pendant trente ans, c’est carrément pourquoi on est là, je pense. On a beaucoup de demandes pour former les animateurs de MJC, et lors des réunions je me bats très fortement contre cette attitude qui consiste à pousser les mômes dans une illusion qui de toute façon se cassera la gueule s’ils continuent comme ça. Je n’ai rien contre les animateurs de MJC, ce n’est pas un sous-métier. Et puisqu’ils veulent absolument se former pour aider les jeunes, on ne dit pas non. On peut accueillir ces animateurs en formation à une condition : il faut qu’il y ait une charte qui stipule que le but de la formation c’est de les amener jusqu’à un DEM et après à un Diplôme d’Étati. Voilà concrètement où on en est, là, maintenant.
ONU (Orchestre National Urbain), ensemble créé en 2012 par Giacomo Spica Capobianco (voir la première partie de cet entretien).
Les MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) sont des structures associatives qui lient jeunesse et culture dans une perspective d’éducation populaire.
pour Conservatoire à Rayonnement Régional.
Un DEM (Diplôme d’Études Musicales) s’obtient à la fin d’un enseignement initial dans un établissement d’enseignement spécialisé de la musique. Un DE (Diplôme d’État) de « professeur de musique » est un diplôme d’enseignement supérieur, équivalent à une Licence 3.
Jean-Charles F. :
Je reviens en arrière : à la Duchère, tu as dit que cela avait bien fonctionné, mais qu’est-ce qui a bien fonctionné ?
Giacomo S. C. :
Ce qui a bien fonctionné, c’est qu’au cours des quatre années, tu as un public qui reste stable, un groupe de douze enfants qui ont grandi, qui ont continué à s’impliquer dans le projet et qui continuent à faire de la musique. Au départ c’est des mômes qui n’avaient jamais touché un instrument, ni écrit de textes. Là, ça y est, la machine est lancée. Ils commencent aussi, eux-mêmes, à faire travailler les plus petits. C’est là que ça fonctionne. Le projet en question, c’est de dire :
- On va prendre des mômes dans les quartiers qui de toutes façons n’ont pas d’avenir, parce que même s’ils vont à l’école, il n’y aura pas de boulot quand ils vont arriver au bout.
- Pour ceux qui sont intéressés, on va leur donner les moyens d’aller jusqu’au bout.
Et là où je suis content que ça marche, c’est que, malgré que les décideurs et les animateurs changent, les mômes restent. Je trouve que la réussite, elle se fait là. Cela veut dire qu’on est arrivé à les surprendre et les encourager. La sauce a pris et ils continuent, pour moi ce sont les futurs formateurs avec qui on va pouvoir travailler, et qui vont être en relais avec le travail qu’on est en train de faire dans le 8ème arrondissement de Lyon. Ça va devenir un réseau : le 8ème avec le 3ème, le 7ème et le 9ème. Et ces mômes là on va les former pour pouvoir les récupérer pour être un lien avec le quartier, qu’ils développent des choses et qu’ils aient un poste au même titre qu’un professeur de violon au conservatoire. La Duchère est l’exemple le plus intéressant pour le moment, parce que cela perdure, ce n’est pas tombé, ce sont les mêmes personnes depuis le début. En plus ce qui est super intéressant pour nous, c’est qu’il y a plus de filles que de garçons, en sachant que dans les quartiers la position des filles est quand même assez restreinte culturellement.
Jean-Charles F. :
Faire de la musique, dans le contexte « Duchère », cela veut dire quoi en termes par exemple d’apprentissage par l’oralité, d’utilisation d’instruments et de technologies, de styles de musique ?
Giacomo S. C. :
C’est la réflexion qui m’a beaucoup animé : comment j’allais monter un projet pédagogique justement pour ne pas tomber dans les travers d’une esthétique particulière ? Quand tu arrives dans un quartier, on a tendance à ne parler que du rap, de la R’n’B, de plein de courants de trap, de plein de choses qui arrivent maintenant. Ce n’est pas ça qui m’intéresse. Bien sûr ce n’est pas que cela ne m’intéresse pas de leur faire faire du rap ou quoi que ce soit d’autre, mais ce n’est pas là mon propos. Il s’agit plutôt d’arriver à créer un groupe qui produit une création collective, et nous n’avons pas à leur dicter quelles esthétiques ils doivent choisir. Il y a aussi des ateliers d’écriture, on ne va pas non plus leur dire quels thèmes ils doivent aborder. Ils doivent simplement éviter de parler de sexe, de politique et de religion, parce que, étant tenu par le Ministère de l’Intérieur, on n’a pas le droit de faire ça avec des mineurs. À partir d’un atelier d’écriture collégial ou collectif, c’est eux qui choisissent leurs propres thèmes.
Après cela, il y a des travaux toujours d’oralité musicale, rapidement, avec des loopers, avec des instruments électroniques, avec une batterie et avec pleins d’autres choses. Parce que dans l’Orchestre National Urbain, il y a des musiciens de l’électronique, mais il y a aussi un tromboniste, il y a un violoncelliste, il y a une batterie. Le truc, c’est de leur donner un peu des billes, et de les laisser construire eux-mêmes leurs projets et leurs propres esthétiques. Et on ne peut pas dire, demain par exemple, que le groupe de la Duchère va faire de la chanson, du rap ou autre chose : on s’en fout. Ils créent quelque chose et au bout d’un moment ils en feront, eux, ce qu’ils veulent en faire. Le but c’est cela. Mais ce n’est surtout pas d’arriver et de dire : on fait un atelier de telle ou telle musique. On ne sait pas, puisqu’on met aussi les jeunes en contact avec des gens de la musique classique, des types de musiciens qu’ils n’ont pas l’habitude de rencontrer. En ce moment, je suis en train de préparer un diaporama pour le festival où l’on voit le violoncelliste, Selim Peñaranda, qui fait bosser des gens, il a un violoncelle électrique – dans l’Orchestre National Urbain c’est plus approprié de jouer avec un violoncelle électrique qu’avec un acoustique. Quand il fait bosser des mômes avec un violoncelle, tout à coup il se crée un contact. Sa démarche est très intéressante, mais cela ne veut pas dire que, tout d’un coup, il va en faire des musiciens classiques ou des musiciens de rock. Il s’agit plutôt de dire : « Vous faîtes de la musique ». L’idée est de faire simplement de la musique. Mais ce n’est pas ma seule préoccupation. Il s’agit aussi de prendre en compte tous les métiers du spectacle vivant. Cela veut dire que pendant un moment, on a quelqu’un au son qui leur explique ce qu’est une table de mixage et tout ce que cela implique. Parce qu’il y en a, dans la masse, qui ne vont pas faire de musique, mais qui peuvent s’intéresser à d’autres aspects du spectacle vivant. Par exemple, l’un d’entre eux va s’intéresser aux lumières, ou un autre va s’intéresser aux décors (on ne fait pas de décors). En montrant qu’il y a aussi du travail dans le monde du spectacle vivant, on ouvre un champ de possibilités pour tout le monde. Il y a bien trop peu de public issu des minorités qui travaille dans ce monde-là. Et puis ces gens ne sont même pas au courant de ce qui se passe, ils ne savent même pas qu’il y a des centres de formation pour cela.
L’exemple pour le moment, le labo si on veut dire, le plus intéressant, c’est la Duchère. Ce n’est pas simple du tout, car je suis en train de me prendre la tête avec plusieurs personnes, parce qu’ils ne comprennent pas qu’ils doivent assurer simplement l’interface. Il faut le leur répéter tout le temps, que ce n’est pas à eux que cela s’adresse. Mais ils le savent autant que moi : quand on amène quelque chose d’intéressant, il faut assurer l’interface, sans vouloir récupérer au passage le rôle principal, comme dans un système un peu maffieux (l’animateur qui voudrait prendre la place des jeunes en formation pour le Diplôme d’État des Musiques Actuelles Amplifiées)i.
b. L’origine du projet
Nicolas S. :
Ce qui nous intéresse c’est de savoir comment on commence : quel a été le début, l’impulsion de départ ?
Giacomo S. C. :
Dans l’histoire de la Duchère, il faut souligner une dimension : pour pouvoir attirer des jeunes, pour qu’ils rentrent dans ce processus, cela ne s’est pas fait en un claquement de doigt, et eux ne seraient pas venus sans qu’il y ait eu une accroche. À la bibliothèque médiathèque de la Duchère où le projet a commencé, on nous a demandé : « Qu’est-ce que vous pouvez nous proposer pour attirer des mômes ? » Moi, j’ai proposé un truc très simple : une « ronde des loopers ». Cela veut dire :
a) on est à plusieurs ;
b) on allume des loopers ;
c) chacun prend un micro ;
d) on produit des onomatopées dans le micro telles que clac, plac, plouc, plic, clic, etc. ;
e) on les met en boucle avec les loopers et ça tourne ;
f) et après on s’amuse librement.
On a mis trois postes en plein après-midi dans la bibliothèque, sans obliger les gens à s’inscrire. On a commencé à faire du son et les mômes sont arrivés. Et là on les a aguichés : « Tu veux ? Oui ? Bien ! Paf ! Pouf ! ». Cela s’est mis en route. À un moment, ils sont partis : « Tu vas où ? » – « Je reviens ». Ils sont revenus avec 15 de leurs amis, ça va vite. Parce que, pour eux, ce serait le bonheur absolu d’avoir une machine comme ça en leur possession. Donc on a fait la ronde des loopers et l’objectif était de travailler avec Lucas Villon qui est dumiste au CRRi de Lyon. Il était en formation au Cra.p tout en s’occupant des mômes là-bas. Il a été le relais, et on a dit à tous ces mômes, « Voilà, vous avez la possibilité de venir tous les mardis soirs de 18h à 19h30 ou 20h, avec Lucas ». Nous on allait les voir de temps en temps, on y a été trois fois dans l’année. Et un an après, on a organisé la résidence, et là on les a tous revus. Donc, la résidence s’est aussi développée à partir du travail que Lucas avait fait, c’est ce qui a créé ce groupe-là. Pendant trois ans, on a fait chaque année une résidence avec ce groupe, et on vient d’en faire une. Voilà comment ces mômes se sont fidélisés. Mais au départ ils ne venaient pas à la MJC de la Duchère, ni à la bibliothèque. Peut-être qu’ils y passaient pour y chercher un bouquin, mais il n’y avait pas d’activité culturelle organisée pour eux. Après, comme la bibliothèque a brûlé, on a vu avec la MJC si c’était possible d’ouvrir quelque chose et c’est eux qui ont pris le relais. Voilà comment cela s’est passé.
Nicolas S. :
Je suis de plus en plus convaincu que les gens expérimentent des choses et construisent progressivement une expérience en tentant des trucs sans bien savoir ce qu’ils sont en train de construire. Dix ans après, cela produit un truc plus ou moins intéressant mais qui fonctionne et qui a répondu aux questions qui se posaient au départ. Et après dix ans d’expérimentation, on parle toujours de l’endroit où on est arrivé. Et il manque souvent le récit pour enfin comprendre l’intelligence de l’expérimentation, ce qui fait que tu peux permettre aux autres de commencer à faire quelque chose.
Ce qui est intéressant pour moi, c’est toute la démarche qui a eu lieu pour inventer ce système-là, à cet endroit précis, ce qui pourrait être tout à fait différent ailleurs. À la Duchère, tu viens de parler de la ronde des
loopers à la bibliothèque. Qu’est-ce qui fait que à un moment donné, étant données les circonstances, les rencontres et les situations, cette ronde des
loopers est rendue possible. Qu’est-ce qui fait que vous avez trouvé intéressant d’aller faire cette expérience à cet endroit-là ?
Giacomo S. C. :
En fait cette expérience a été rendue possible au départ par la préoccupation des élus d’une ville, de ses acteurs sociaux et acteurs culturels. C’est cette préoccupation de leur part qui a donné du sens à la ronde des loopers. Sinon on vient, on fait une ronde des loopers et c’est de la consommation directe par les individus qui passent : ils ont consommé un truc et puis on n’en parle plus. S’il n’y a pas une sensibilisation assez globale des citoyens qui sont sur place, entourés par tous ces gens qui décident un peu à leur place, ou qui pensent pour eux, s’il n’y a pas une réflexion commune, on ne peut pas travailler. La pertinence de la ronde des loopers est que, quand elle arrive, elle correspond à comment on va pouvoir amener très rapidement des personnes à un acte artistique, et comment tout de suite les accrocher pour que, après cela, ils puissent travailler à long terme et que tout d’un coup cela prenne sens dans une ville. En l’occurrence, ce projet s’est tenu sur le plateau de la Duchère où la culture a été mise complètement de côté pour des raisons religieuses, politiques, sociales et financières. Le problème était de : comment arriver à remettre un vivier en place. Je pense que la ronde des loopers est un argument comme un autre. On aurait pu tout aussi bien les faire travailler avec des instruments que je construis là [ici au Cra.p], les mettre dans la bibliothèque et puis les faire taper sur des bidons. Cela aurait été pour moi la même chose. L’importance est de réfléchir au meilleur moyen pour pouvoir impliquer les gens dans un processus à long terme, pour qu’on arrive à créer une équipe de gens qui vont sensibiliser ces jeunes qui vont grandir.
Nicolas S. :
Avant d’arriver à la ronde, comment tu sensibilises l’équipe de gens qui les entourent et qui décident, comment entres-tu en contact avec eux ? Qu’est-ce qui fait que à un moment, ce sont eux qui viennent te chercher en disant : « Giacomo (ou le Cra.p) on a besoin de vous » ? Quelles relations tu construis, parce qu’il y a là aussi une histoire à long terme ?
Giacomo S. C. :
La plupart du temps on fait un peu de pub, enfin peu de pub, les mairies ont été peu sollicitées. Alors il n’y a pas de hasard, il y a des moments comme ça où on est venu nous chercher au moment où des choses étaient en train de se mettre en place. Il y a quelques années, dans le cadre de l’Orchestre National Urbain, j’ai rencontré un musicien intervenant – Lucas Villon – qui est dumiste au CRR de Lyon, que j’avais eu au CFMIi quelques années auparavant et qui m’avait dit : « Oui, j’aimerais bien travailler avec toi ». C’est le seul en vingt ans de CFMI – j’y suis intervenu pendant vingt ans, à raison de quatre jours par an – c’est le seul qui est venu me voir et qui m’a dit : « Je veux monter un atelier avec les mômes dans un quartier, pour faire du hip-hop, si cela correspond à leurs souhaits ». À ce moment-là je travaillais à fond sur l’Orchestre National Urbaini et sur ces questions-là. Je lui ai proposé d’entrer en formation au Cra.p. Le conservatoire lui a payé deux ans de formation ici, parce qu’il n’était pas pointu sur les pratiques dans les quartiers et sur les ateliers d’écriture. Donc il est venu me voir car il avait le projet de monter un atelier hip-hop à la Duchère et il m’a dit : « Je viens te voir parce que j’ai besoin de toi, est-ce que tu peux m’aider ? » Donc cela s’est fait comme ça, et il y a plein d’endroits où on nous a appelé pour tenter de régler de gros problèmes. Comme par exemple il y a pas mal de temps au collège Morel, place Morel à la Croix-Rousse. La documentaliste nous avait appelés, pour trouver des solutions parce qu’il y avait une scission sociale assez délicate dans ce collège : tu avais les blancs d’un côté et les arabes et les noirs de l’autre et ça se foutait sur la gueule du matin au soir. Elle a eu l’intelligence de se dire qu’elle allait trouver des gens pour monter un atelier hip-hop en musique rap et en danse aussi, et donc on a travaillé pendant plus d’un an là-bas. Ce sont des demandes comme ça qui nous permettent de mener une réflexion après coup, de se dire, voilà, on a vécu ça, qu’est-ce que ça donne, même sur un plan sociologique, comment ça évolue ? La plupart du temps, sur toutes les actions qu’on a mené, on a été appelé, ce n’est pas nous qui avons sollicité les institutions.
CFMI pour Centre de Formation des Musiciens Intervenants à l’école, qui propose différentes formations permettant de travailler dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle, et de l’action artistique auprès de différents publics, notamment dans les champs social et sanitaire.
Nicolas S. :
À la Duchère, c’est Lucas qui vient te voir, mais as-tu aussi une analyse des gens qui l’entourent pour décider que cela vaut le coup d’y mener une action ?
Giacomo S. C. :
En fait, nous avons reçu un appel de la ville de Lyon qui nous a dit qu’il y avait de gros problèmes à la MJC Vergoin du 9ème arrondissement à Saint-Rambert. Ce sont carrément les politiques qui nous appellent aujourd’hui, qui nous disent qu’ils ont besoin de nous pour éteindre le feu là-bas, ils nous demandent de mettre en place des choses. En l’occurrence, pour l’histoire de la Duchère, c’est Lucas qui a fait le premier pas. On a rencontré une des responsables de la médiathèque-bibliothèque du 9ème, très engagée aussi là-dedans et il y a eu un tour de table avec d’autres responsables de la ville, avant d’entamer le travail. Pour moi, quand il y a un tour de table, s’il n’y a pas derrière le projet des réflexions politiques assez fortes, je ne marche pas. Cela veut dire que je ne veux absolument pas faire ce qu’on nous a fait faire il y a plus de 25 ans quand ça brûlait de partout, des actions ponctuelles pour calmer, pour éviter que les gens brûlent des bagnoles. Cela c’est fini. Quand on a rencontré les gens à la Duchère, nous avons exigé qu’on travaille sur le long terme : non pas sur un an, mais sur 3, 6, 9, 12, 15 ans. Même si ce n’est pas nous qui allons porter le projet, il faut qu’on puisse créer une équipe pour qu’elle se saisisse de ce qu’on a mis en place et pour qu’elle puisse continuer. Ce sont des décisions qui sont prises avant même d’arriver sur la ronde des loopers, c’est bien avant, c’est vraiment la préparation, avec les élus et avec tout le monde. En fait, j’hésitais un peu à contacter ces gens-là, mais c’est simple de le faire, tu les appelles et puis tu exiges qu’il y ait tout le monde autour de la table. Et ils se bougent quand même, et après c’est bien, parce que, il y en a qui adhèrent, il y en a qui n’adhèrent pas, mais au moins on peut discuter avec eux. Voilà comment s’est passée la préparation avant le commencement du projet. Il y a toujours une réflexion qui doit être menée avant d’entamer quelque chose par rapport au problème qui est posé. Ce n’est pas comme dans le cas d’une master class où on vient, on fait un truc super et on repart aussi sec, sans aucune réflexion ni avant ni après, c’est de la consommation directe, pour moi ce n’est pas intéressant. La réflexion que nous menons avant tout projet, porte sur la question de qu’est-ce qu’on pourrait mettre en place avec un public déterminé, qui la plupart du temps a été empêché. Rarement on est arrivé dans un lieu où tout était confortable. Si les personnes du lieu ne comprenaient pas ce qu’on amenait, le lien ne s’établissait pas avec elles. Je crois aussi que ce qui nous donne de plus en plus de travail aujourd’hui c’est qu’il y a moins de confort partout. Il faut trouver un équilibre pour arriver justement à fédérer. Quand on arrive à la ronde des loopers, en fait c’est très simple : on est arrivé.
Nicolas S. :
Et le temps entre le moment où Lucas te dit « J’ai envie de faire ça » et le moment de la ronde des loopers c’est quoi, c’est un an, un an et demi ?
Giacomo S. C. :
Non, c’est plus vite que ça, c’est très vite, on est quand même sur de l’émergence rapide là, il faut faire vite.
Nicolas S. :
Il faut faire vite mais il faut prendre contact avec la bibliothécaire qui est intéressée, et que vous arriviez à faire en sorte qu’il y ait le tour de table dont tu as parlé ?
Giacomo S. C. :
C’est trois ou quatre mois. Il y a cette première réunion avec deux ou trois personnes, et puis après ils comprennent et donc ils peuvent faire l’interface avec les autres. Parce que c’est des histoires d’interfaces, tu n’appelles pas directement un élu en disant qu’il faut qu’on se voie, cela ne marche pas comme ça. En fait, tu as besoin des interfaces qui conseillent aux gens et disent qu’il faut qu’ils nous rencontrent, parce qu’il y a un projet intéressant qu’on veut monter avec eux. On voit bien que c’est comme cela que ça marche. Aujourd’hui on a dépassé un peu ce stade, parce que on est labellisé par le Grand Lyoni, c’est-à-dire qu’on a une étiquette de reconnaissance qui a mis trente ans à s’établir. La pertinence d’un projet ne dépend pas simplement du fait que je vienne faire jouer et puis faire une ou deux master classes, mais c’est : quelles continuités, quels processus on met en place pour que les gens s’emparent du projet. Le projet à la Duchère est l’exemple pour nous le plus intéressant, on le voit à la manière avec laquelle ces jeunes-là s’en emparent et surtout quelle place on leur laisse. Parce que la plus grosse bataille quand tu es sur un site comme ça, c’est d’arriver à faire comprendre à ceux qui y travaillent et qui sont en poste qu’ils laissent de la place aux jeunes qui viennent y faire des choses.
Le « Grand Lyon » est le nom de la Métrople de Lyon, collectivité territoriale créée le 1er janvier 2015 en fusionnant la Communauté urbaine de Lyon et une partie du Conseil général du Rhône (59 communes, env. 1,4 million d’habitants).
Jean-Charles F. :
Peux-tu développer cette idée de création collective, démocratique. Comment cela se passe-t-il réellement ? Quels sont les dispositifs ?
Giacomo S. C. :
C’est très simple : on est huit, parfois dix, avec chacune et chacun une discipline bien précise, avec un projet. Alors une concertation est nécessaire pour que ce ne soit pas une simple consommation, avec chacun ou chacune faisant ses trucs dans son coin, il faut établir des liens entre toutes les disciplines.
c. Instruments construits spécialement. Le spicaphone.
Giacomo S. C. :
En arrivant sur les sites, on constate qu’acheter un instrument c’est quelque chose d’impossible. Beaucoup refusent de faire de la musique parce qu’ils pensent ne pas pouvoir le faire pour des raisons financières. Dans mon atelier, je peux avoir un quart d’heure avec des mômes à travailler avec les instruments présents : on est dans une phase d’éveil, de rencontre ; on n’est pas vraiment dans un apprentissage de la musique, il ne s’agit pas de cours de musique, c’est seulement la possibilité d’être avec un instrument, avec un micro, avec un looper, de rentrer une boucle et avec tout cela de faire son propre truc. Je leur fais voir ce qu’on peut développer avec plusieurs instruments que j’ai moi-même construits. Si j’ai cinq participants ou participantes en face de moi dans un espace-temps, chacune ou chacun va pouvoir créer quelque chose. Je leur dis : « Voilà cet instrument je l’ai construit comme ça, ça marche comme ça, ça a cette fonction là, vous pouvez vous en servir comme ça. » Je les fais jouer sur ces instruments et à partir de là on crée quelque chose.
Par exemple, j’ai construit un spicaphone, c’est un instrument très simple à une corde. J’adore jouer avec ce genre de choses, parce que de toute façon je ne me considère pas comme un guitariste. C’est une posture d’être guitariste, tu fais partie d’une famille, et si tu ne te branles pas à 150 000 km à l’heure sur le manche, tu n’es pas guitariste. Je n’aime pas le côté « héros » de la guitare. Donc je me suis dit que j’allais mettre une seule corde, ainsi je ne serais pas comme les autres et avec un bout de bois encore moins. Et puis ce bout de bois, c’est une cuillère à polenta c’est encore pire. Les gens se demandent qu’est-ce que c’est que ce truc-là, je leur démontre que, en fait ça marche. Et quand ils me disent qu’ils ne peuvent pas s’acheter de guitare, je leur dis « non » : on peut prendre n’importe quelle branche en bois pour s’en fabriquer une. Il est question que je retourne au Maroc pour fabriquer plein de ce genre d’instruments. J’ai l’intention de monter des orchestres à six cordes par exemple Mi La Ré Sol Si Mi, comme celles de la guitare, avec six personnes, chacune jouant une seule corde.
Quand tu prends une batterie, tu la démontes et six personnes peuvent jouer. Cela permet de revenir à des choses plus intéressantes liées à la création collective et au jeu ensemble. C’est surtout de se dire que si je mets un môme avec un truc comme ça dans les mains, il joue tout de suite. Si je lui mets une guitare à six cordes, il ne joue pas, il faut que je la trafique, il faut que je la lui mette sur les genoux et qu’il prenne des baguettes pour taper dessus, parce qu’il n’y a que comme ça qu’il se sent à l’aise, parce qu’il y a trop de cordes. Avec le spicaphone il n’y a qu’une corde : « Regardes tu peux faire toum toum toum rien que ça, ou Tooum Tooum Tooum tout bêtement sur les temps ». Et ça y est, ça démarre. Cet instrument ne coûte que sept euros. Ces types d’instruments, on dit entre nous qu’ils sont « crados », en retournant le sens de ce mot !
Je joue avec cet instrument en trafiquant plein de trucs, par exemple, je joue avec un archet de violoncelle. Je leur fais aussi voir qu’en fait, avec un instrument comme ça à une corde, tu peux aussi créer de la matière sonore. On peut aller jusqu’à créer des choses avec des moyens électroniques différents de ceux de la synthèse. Ils sont très attirés par ça, ils se demandent d’où sortent les sons quand ils me voient jouer. C’est ce qui les intéresse parce que d’un coup ils se disent que c’est possible de le faire. Et à partir du moment où c’est possible, ils adhèrent et ils viennent. C’est une pédagogie qui ne consiste pas à faire tes gammes pendant des heures avant d’être capable d’envisager un projet artistique. C’est une attitude différente : aborder tout de suite la musique, sans passer par cette obligation absolue d’apprendre ses gammes. Après, je ne parle pas de gamme mais de dextérité des doigts : pour être à l’aise, je les fais bosser sur la rapidité d’exécution, pour sentir les doigts sur les notes. Mais je ne leur parle ni de notes ni de gammes, ni de choses comme cela. En fait, ils se construisent eux-mêmes à partir de cette situation. Et après, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas la présence d’un plan théorique très pointu, puisqu’on les amène jusqu’à l’écriture de textes, parce que tout le monde écrit, sur des carrures rythmiques très précises, c’est du solfège rythmique en fin de compte. On les amène là-dedans, mais pour cela on est obligé de passer par toute une pratique avant. C’est-à-dire qu’on en revient à comment nous-mêmes on a appris à faire de la musique : c’était très punk, tu prenais un instrument que tu ne sais pas jouer, tu t’enfermais dans un truc, tu jouais, et ensuite, après coup, tu abordais la théorie. L’inverse pour moi fonctionne moins bien.
Nicolas S. :
Il n’y a pas que pour toi [rires].
Giacomo S. C. :
Oui je prends l’exemple de ce qu’on a perdu. La pédagogie académique me gêne aujourd’hui, on la trouve même dans le rock. Je suis plus que déçu de voir tous ces jeunes qu’on a diplômés – des jeunes et des moins jeunes – qui refont exactement ce qu’ils ont critiqué pendant des années, je trouve ça absurde. Je me souviens d’avoir rencontré les inspecteurs qui étaient venus récemment au Cefedemi pour une espèce d’audit pour savoir ce que faisaient les musiques actuelles dans un lieu comme ça. Et la première chose qu’ils m’ont dit, c’est qu’ils faisaient un peu le tour de la France parce qu’ils ne supportaient pas de voir les musiques actuelles se comporter comme les musiques classiques avec des partitions dans les groupes de rock. J’avais trouvé ça assez intéressant. Pourtant je ne suis pas contre les partitions…
J’ai construit un spicaphone pour une jeune Kosovar, Aïcha, qui n’avait jamais fait de musique. Je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas, au début elle ne parlait pas, elle était là, elle nous adressait à peine la parole. Je lui ai dit : « Tu peux faire toum toum toum toum toum toum toum [mélodie], tu peux faire ce que tu veux, ou tu peux faire toum toum toum toum [régulier et sur une seule hauteur] et rester sur les temps ». Je lui ai expliqué : « On va faire tourner quelque chose et puis tu joues ; et puis tu verras bien ». Très timidement, elle m’a demandé comment faire : je lui ai dit de prendre l’instrument, de taper un rythme, d’essayer de placer une ou deux notes et de voir comment ça pouvait marcher. Tout de suite ça a pris, il y avait un contact direct. Elle a commencé à jouer de cette manière, elle a craqué sur cet instrument, elle a voulu absolument que j’en construise un pour elle, et maintenant elle joue avec. On lui a mis un ampli à portée de main et elle a dit que cela ne produisait plus le même son. Mais elle s’est mise à jouer avec ça, avec l’idée de varier la sonorité. Et plus tard, tout d’un coup on est venu me dire qu’elle s’était mise en plus à chanter alors qu’elle ne savait pas le faire, et que jusqu’ici elle ne parlait même pas. En quatre ans, on l’a vu évoluer et maintenant c’est une leadeuse ! On ne savait pas où elle allait se positionner. Elle a pris position.
J’ai essayé avec d’autres instruments et cela marche moins bien. C’est pour cela que je ne suis pas du genre à construire des maracas avec des boîtes de Coca-Cola en mettant du riz dedans.
Le Cefedem (Centre de formation des enseignants de la musique) AuRA (Auvergne-Rhône-Alpes) a été créé en 1990 par le Ministère de la Culture, c’est un centre de ressources professionnelles et d’enseignement supérieur artistique de la musique. Il forme au DE (Diplôme d’État) de « professeur de musique », équivalent Licence 3.
Jean-Charles F. :
Ce qui me paraît intéressant c’est que le spicaphone est un vrai instrument.
Giacomo S. C. :
Oui c’est un vrai instrument, ce n’est pas que de la bidouille.
d. Les résidences
Nicolas S. :
Les résidences se passent pendant les vacances scolaires ?
Giacomo S. C. :
Pratiquement tout le temps. Pour le moment on n’a pas fait de résidence en dehors des vacances scolaires. Le premier jour, quand on arrive, il faut un temps pour s’installer. Comme il y a une personne à la danse, Sabrina Boukhenous, elle va prendre tout le groupe, pendant qu’on installe tout, pour ne pas perdre de temps. À la fin du premier jour, il y a la restitution d’une partie de la danse : le groupe vient présenter ce qu’ils ont fait, et nous, on se présente.
Une fois qu’on est installé, le deuxième jour, on va commencer à réunir les équipes, on va mettre l’accent pendant le deuxième jour sur l’atelier d’écriture, parce que s’ils sont quinze, vingt, on peut faire un atelier d’écriture avec quinze, vingt personnes et faire des sous-groupes à l’intérieur. On peut faire cinq groupes de quatre, avec quatre thèmes différents. Une fois qu’on a quelque chose de solide dans l’atelier d’écriture, on les met tout de suite sur scène, pour qu’il se dégage quelque chose : même s’ils n’ont écrit que vingt phrases, il faut qu’ils nous les sortent. Dès la fin de l’atelier d’écriture on garde de 20 à 30 minutes, pour qu’ils viennent un peu nous présenter ce qu’ils ont fait. Les choses évoluent très vite, du jour au lendemain tu t’aperçois qu’il s’est passé quelque chose.
Et puis après, le troisième jour, commencent les ateliers de musique sur les instruments. On fait une division du nombre de personnes par division du temps et on les fait tourner dans les ateliers. On leur fait découvrir tous les instruments. Ils font le tour complet des différents instruments pour qu’ils puissent tout de suite les toucher et les jouer, comme ça cela les met dans une optique de faire, parce qu’autrement si nous faisons nous-mêmes les extra-terrestres avec nos instruments, ils ne vont pas accrocher, cela ne va pas marcher.
Ensuite ils vont voir le tromboniste, Joël Castaing, il leur fait carrément essayer son instrument. Après, ils vont vers Selim, le violoncelliste, il se passe la même chose, ils jouent et créent quelque chose. En électro, on va faire la même chose en se servant d’un ordinateur pour produire des sons. En batterie, elle va les faire jouer, la plupart du temps elle les fait d’abord jouer librement, et puis après elle leur dit : « Ben voilà, tu peux aussi faire ça, tu peux ajouter ça, ta grosse caisse elle peut être là, et vous pouvez jouer à deux. » Et puis d’un coup, comme on a cet instrument à une corde, le spicaphone, avec un son de basse, alors on peut faire un lien entre la basse (le spicaphone) et la batterie. Il y a aussi un atelier de techniques vocales, avec Thècle, une chanteuse lyrique, beat-boxeuse, qui fait aussi de l’électro. Finalement, Sébastien Leborgne (plus connu sous le nom de Lucien 16S) les prend en atelier d’écriture. Pendant une semaine, on leur fait voir un petit peu tout ce qu’il est possible de faire.
Voilà comment cela fonctionne. C’est la façon de procéder quand on les reçoit pour la première fois.
Tous les ateliers se rejoignent à la fin de la période, on essaie à chaque fois d’avoir entre 3/4 d’heure et 1 heure sur le dernier moment, au moins, disons, sur une semaine, au bout du troisième jour. On les fait monter sur scène, par petits groupes et on leur dit : « Eh bien, voilà ! Jouez ! » On les laisse jouer. Au départ c’est un beau bordel, mais le bordel c’est important, parce que tout d’un coup cela se structure. Après, on leur dit : « Si par exemple on parle d’une mesure à quatre temps, à cinq temps, à sept temps. Vous êtes sept, on fait du sept temps. Vous prenez un temps chacun ». Ils ont chacun un instrument, c’est très simple, cela crée une structure et puis deux personnes se rajoutent avec des textes, c’est ainsi que cela se met en route. Tout se met en place, c’est alors que tout à coup on leur dit : « Paf ! Moment d’improvisation ! » Ils improvisent librement et ensuite on définit un cadre pour leur improvisation. C’est ce que je fais depuis des années, des choses très simples. Mais ces choses très simples sont le moyen de structurer le groupe ; tout d’un coup ils jouent et y trouvent un intérêt. Tous les jours on les fait jouer et à la fin de la semaine, il y a un concert. Ils jouent avec un parterre plein, à la Duchère, sans prétention. Par exemple, je me rappelle, il y avait une salle pleine avec le délégué du préfet et d’autres mômes issus de quartiers très perturbés. Ce qu’on fait avec l’Orchestre National Urbaini, ce n’est pas toujours simple pour eux, je pensais qu’ils allaient nous brûler ! Eh bien, non, ça c’est très bien passé. Les mômes qu’on fait jouer, on ne leur en met pas plein la tête, en leur disant « Ça y est, vous êtes des stars », ce n’est absolument pas le cas. On leur explique plutôt que c’est un métier. On parle beaucoup avec eux, on les accompagne, on les amène à se mettre en situation, on les implique, et c’est pour cela qu’après on les revoit. Et donc, à la Duchère, cela fait la quatrième année qu’on les voit. Tout cela se fait avec très peu de matos qu’on leur laisse pour qu’ils l’utilisent entre nos interventions. On fait aussi en sorte que les responsables de la MJC se débrouillent pour avoir du matos aussi pour les gamins, pour que toute l’année ils puissent disposer d’un local et venir y travailler. Et là, il y a des animateurs qui commencent à les aider. Alors, c’est bien qu’ils les aident, à condition de ne pas trop les aider et de ne pas les détourner de leur développement personnel. C’est pour cette raison que les animateurs qui en font la demande, peuvent venir ici, pour se former, ou plutôt pour se déformer, pour ne pas qu’ils formatent une fois de plus des mômes qui ont des choses à dire et qui, eux, sont la musique de demain.
e. Les ateliers d’écriture
Jean-Charles F. :
Et il y a des ateliers d’écriture de texte. Peux-tu parler de leur importance dans le dispositif ?
Giacomo S. C. :
Eh bien, l’importance, elle est à plein de niveaux. Cela veut dire déjà « écrire ». Dans les nombreux ateliers d’écriture qu’on organise, on s’aperçoit de plus en plus que les gens ne maîtrisent pas le simple acte d’écrire. Les mômes encore moins. Les textes n’ont pas forcément à être rythmés, ils font ce qu’ils veulent. S’ils veulent lire leur texte sur une voix parlée, c’est possible. Je ne parle pas de rap, ni de slam, mais de spoken words, mots parlés, un point c’est tout. Après, si cela devient rythmique, c’est un choix qui leur appartient. Mais pour ceux qui le souhaitent, on leur apprend aussi comment on peut mettre en boucle un texte : si par exemple, quelqu’un dit : « Mes phrases j’aimerais qu’elles sonnent comme ça », alors, on détermine le nombre d’espace-temps, et si c’est du quatre temps (ou du cinq ou d’autres nombres), comment on travaille sur du quatre temps (ou d’autres nombres de base). La fonction de l’écriture, pour moi, va plus loin que ça. Ce sont des ateliers d’écriture collective, donc, du coup, il y a une réflexion commune à travers les discussions sur un thème choisi par les participants. Et là, il y a forcément des gens qui ne sont pas d’accord entre eux et c’est ça qui est intéressant. C’est par la discussion que l’atelier commence : on se met à parler de quelque chose, on essaie de déterminer quelles sont les raisons pour en parler, cela peut partir en vrille, puis cela se calme, il y a des échanges d’idées et puis tout d’un coup il y a une réflexion commune. Mais nous, on ne fait rien là-dedans. C’est dire que la réflexion doit se passer entre eux. Nous on est simplement là pour être les garants du temps : après avoir assez débattu, à un moment donné il faut se mettre à l’écriture. On leur donne des techniques d’écriture, on voit comment cela se passe au niveau de la syntaxe et de la recherche du vocabulaire. On sent très bien que l’écriture permet de développer chez la personne une structuration sociale. On le sent surtout dans ce type d’écriture, parce qu’on n’est pas dans une représentation de l’écriture détachée des réalités sociales. Pour moi, l’effet bénéfique de cette activité est de 100%. Et après, se pose le problème de comment dire le texte sur la scène – je vais plutôt appeler cela de la poésie sonore avec de la déclamation de texte. Qu’est-ce qu’ils en font ? Rythme ou pas rythme, cela n’a aucune importance. Il faut simplement qu’ils ou elles puissent s’engager dans un projet, dans un espace-temps. On leur dit : « Voilà, vous nous présentez quelque chose ». Et c’est à eux de faire leur propre montage, la relation entre ce que le texte raconte, le contenu de la réflexion, le choix de la musique, etc.
f. L’organisation de la première résidence
Nicolas S. :
Pourrais-tu décrire le premier moment du premier atelier ? Il me semble qu’il y a presque trois profils de personnes extérieures, avec les huit ateliers. Du coup, c’est quoi le parcours possible pour une de ces personnes ? Qu’est-ce qui fait qu’à un moment elle entre dans le lieu et qu’est-ce qu’elle y fait quand elle arrive ? Et après il y aurait la même description vis-à-vis du coup de l’un de vos huit membres de l’Orchestre National Urbaini : qu’est-ce que vous faites, vous, avant, pendant et après ? Est-ce qu’il y a les huit ateliers en même temps ou pas ? Et puis après, pourrais-tu décrire ce que fait une personne travaillant dans la structure d’accueil, mais qui n’est pas un de vos huit ou de ce que fait le public qui vient participer ?
Giacomo S. C. :
Tu te rappelles ce que tu viens de me dire là ?
Nicolas S. :
Ouais. [rires] Du coup, peut-être le plus facile : est-ce que les huit ateliers ont lieu en même temps, par exemple ? Comment cela se passe au début ? Vous êtes là les huit, là, tout le temps ?
Giacomo S. C. :
Il faut toujours s’adapter au contexte, c’est-à-dire qu’on ne peut jamais prévoir que de telle heure à telle heure tout le monde va intervenir au même moment. On est tout le temps là en tant que groupe. On ne prend les enfants que deux heures par jour, mais nous, après on travaille à temps plein de 9 heures à 18 heures. À l’intérieur de ce temps-là, on prend deux heures pleines pour les enfants, et après c’est selon leur famille à eux. Parce qu’il faut prendre en compte le fait qu’ils ont peut-être une animation : s’ils ont une animation foot l’après-midi, eh bien on les prend le matin, ou bien l’inverse – je dis foot ou autre chose. Tout le monde est là tout le temps, parce que ce qui est important c’est que le tromboniste ne soit pas simplement centré sur son biniou et qu’après il ne comprenne pas ce qui se passe. Il y a une relation constante entre les membres de l’encadrement, cela veut dire que tout le monde tourne tout le temps. Mais il y a un moment où il faut fixer les choses aussi. Il faut qu’ils passent vraiment partout, même s’ils ne sont pas attirés par un endroit. On leur fait comprendre l’importance que peut avoir cet instrument particulier, par exemple, dans un groupe comme l’Orchestre National Urbain et quel rôle il y joue. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il faut en passer par là. C’est comme les enfants qui viennent et qui disent : « Mais moi je ne veux être que derrière un ordinateur pour faire des instrusi. » On dit : « OK, mais il faut que tu comprennes comment un texte se met en place, pour que tu puisses composer de la musique pour des gens qui font du texte », et là tout d’un coup ça fonctionne. J’ai un exemple récent, à la Duchère, d’un jeune garçon qui avait du mal à faire son texte sur scène : on a beaucoup discuté, on l’a mis en confiance, la deuxième fois c’était déjà mieux. Mais après il s’est retrouvé derrière les machines sur un pad à envoyer du son, et là il était super à l’aise ; quand il est revenu au texte, ça l’a complètement libéré. Ils ont tous cette polyvalence-là. C’est-à-dire, on veut qu’ils tournent. Parce que dans les rapports entre le texte et les autres sons, on parle d’interaction, on ne parle jamais d’accompagnement. Parce qu’on n’accompagne pas le texte, on interagit avec lui, c’est de l’impro. Donc, avec celui ou celle qui est au texte, il y en a quatre ou cinq qui font l’interaction. Après avoir laissé passer un ou deux textes, il ou elle se retrouve à la musique. L’un est au service de l’autre tout le temps, et je pense que ça c’est très important, pour ne pas commencer à dire qu’on a un groupe de chanteuses/chanteurs ou de musiciens/musiciennes. Non, tous doivent avoir une polyvalence assez forte.
On va dire que la plupart du temps, ils sont partants. Rarement on a eu des mômes qui n’avaient pas envie de faire un truc. Mais il y a aussi ceux qui ne savent pas au départ ce qu’ils veulent faire. Par exemple, Aïcha, dont j’ai déjà parlé, qui ne parlait pas au début. Et puis certains d’entre eux ne veulent faire qu’une seule chose et d’autres au contraire veulent tout faire.
Sons électroniques qui accompagnent un texte comme dans le rap.
Nicolas S. :
Pendant les ateliers, est-ce que vous travaillez dans des salles différentes, ou bien êtes-vous toujours dans le même lieu dans lequel le son se mélange ? Quand vous travaillez sur de l’électronique, et toi avec le spicaphone, vous êtes dans des salles différentes ?
Giacomo S. C. :
Oui. Ou alors quand ce n’est pas trop sonore, il est possible de travailler dans le même espace. Il y a aussi des ateliers qui peuvent se rejoindre. Par exemple, dans l’atelier de danse il peut être intéressant d’avoir la présence des musiciens qui participent à l’atelier rythmique, il peut y avoir cette relation-là. C’est que tout dépend de l’espace, parce que si tu vas dans un lieu où tu as assez d’espace, tu vas pouvoir organiser les choses à ta guise, et si tu n’as que deux pièces, il va falloir que tu combines avec. Cela veut dire que le montage des ateliers se fait en fonction de l’espace. Selon le lieu, il n’est pas toujours possible d’avoir les huit intervenants en même temps.
Nicolas S. :
Et vous, vous êtes sur scène avec eux pour les accompagner ?
Giacomo S. C. :
Non, non, on ne joue pas, on ne les accompagne pas, ce n’est pas le but, c’est eux qui jouent. On me dit tout le temps : « Ah mais cela serait bien que vous jouiez avec eux. » Je réponds : « Non, c’est eux qui jouent ». C’est le plus important pour eux. C’est à eux de prendre l’initiative. Voilà, on sait faire, mais c’est à eux de faire, ce n’est pas à nous. Je tiens vraiment, et je le dis toujours à tout le monde, « Vous ne jouez pas pour eux, vous les laissez, c’est à eux de prendre des billes ». Après il y a une négociation aussi avec les gens que j’embauche dans l’Orchestre National Urbain, c’est de savoir s’ils sont prêts à partager leur biniou. Mais ça, c’est une autre histoire.
Nicolas S. :
Tu considères que sur les deux heures dans une journée, il y a une heure d’atelier et une heure de travail en grand groupe ?
Giacomo S. C. :
Oui, on les prépare surtout à jouer. Pour moi, je fragmente le truc : le premier jour, après l’atelier de danse, c’est une réunion du grand groupe, on leur fait voir qui on est et ce qu’on fait ; le deuxième jour ils commencent à nous présenter quelque chose par rapport à l’atelier d’écriture et le troisième jour, eh bien, ils commencent à jouer vraiment, c’est-à-dire ils sont vraiment tous en situation réelle. À partir de là, quand on en a beaucoup, on ne va pas avoir un groupe de 8-10 sur scène, ça ne sert à rien dans un premier temps, mais on va former des groupes, des trios, des quartets, et ensuite cela se mélange. Le vendredi, on les prépare vraiment à présenter quelque chose sur scène, on leur parle d’une balance aussi. Il ne s’agit pas seulement de jouer, de créer un morceau, c’est aussi comment on réalise une balance, comment travailler avec une personne qui est à la sonorisation, comment travailler avec une personne qui est aux lumières. On ne parle pas de coach scénique, genre « je me mets comme ça ». Nous sommes absolument contre cette idée. Ils sont très libres de leurs postures. Et c’est pareil pour la danse : on ne leur fait pas faire de la danse pour qu’ils dansent, mais pour qu’ils prennent conscience de la réalité de leur corps, parce que on leur fait bien comprendre que c’est le corps qui produit la musique, que quand ils jouent, il faut avoir conscience du corps. Mais ce n’est pas pour en faire des danseuses et des danseurs, absolument pas. Ce n’est pas ça. C’est : surtout le corps à cet âge-là, qu’est-ce qu’on en fait ? Pour libérer vraiment un tas de stress. Et puis il s’agit aussi de la conscience du rythme, parce qu’on est sur des musiques très rythmiques.
Nicolas S. :
Du coup tu décrivais deux heures, mais je suppose que le vendredi, ils ne sont pas là que deux heures ?
Giacomo S. C. :
Non, ils viennent plus tôt. Mais ils sont tout le temps là, hein ! Quand nous on est là, ils sont dans d’autres pièces, ils travaillent de partout. À la Duchère par exemple ils passent autant de temps dans d’autres pièces où ils bossent. Parce que maintenant le truc est en route, et nous on les prend deux heures.
Nicolas S. :
Pendant la résidence, ils faisaient quoi les gamins quand ils n’étaient pas avec vous pendant ces deux heures ?
Giacomo S. C. :
Ils bossaient dans plein d’autres pièces, ils répétaient ce qu’ils avaient commencé à travailler avec nous. Ils ne sont pas tous là de 9 heures à 18 heures, parce que tu en as qui avaient des activités sportives ou d’autres choses. Mais il y avait tout de même un petit noyau qui était tout le temps là sans qu’il y ait d’obligation. Ils sont libres. Pour cela, il faut tomber sur des directeurs de lieux qui ont une ouverture d’esprit, et de dire qu’on ne va pas compartimenter nos activités culturelles en disant aux jeunes de ne venir que de telle heure à telle heure. La porte reste ouverte et puis si les salles ne sont pas occupées – de toutes façons ce sont des espaces tellement grands à la Duchère – ils peuvent travailler tranquillement. Et puis, en fin de compte, il n’y a pas tellement d’activités pendant la journée. Parce que tu as un espace de théâtre et des choses comme ça, où cela s’adresse à des adultes qui ne viennent que le soir.
Nicolas S. :
Et tu parlais des moments où l’on discute beaucoup avec eux. Pour ces conversations, comment ça se désorganise et ça s’organise ?
Giacomo S. C. :
On va s’asseoir avec eux. J’ai le souvenir d’un jeune garçon qui est arrivé qui avait un texte très virulent qui n’était pas de lui en fait. Il était dans une représentation de ce qu’il voulait faire. Un peu hardcore, mais rap hardcore, mais dans tout ce qu’il disait, on sentait que cela ne venait pas de lui. Donc, je lui ai rentré dedans. C’était un clash assez dur. Le lendemain il est venu et il m’a remercié, parce qu’il a dit : « Oui, en fin de compte, j’ai compris… » Parce que je lui avais dit : « Là ce n’est pas toi, il faut que tu écrives ce que tu es toi ; là tu te caches derrière une personne, donc on ne te verra jamais ; si tu veux être toi-même, il faut être toi-même. » Voilà une discussion intéressante, parce que, quand on arrive et qu’ils sont bourrés d’illusions sur « c’est quoi la musique, c’est quoi faire de la musique… » C’est la fausse idée que la réussite est obligatoire. Ce n’est pas vrai. Une fois de plus on est en face d’un fossé entre les réalités du métier et l’idée qu’ils ont du star système, de la « star académie » et j’en passe, toutes ces conneries-là qui ne nous font pas du bien. Quand on arrive, on leur dit : « Ben non, ça ne se passe pas comme cela ». Quand j’arrive avec un bout de bois pour jouer avec, eh bien, ils éclatent de rire, ou des boîtes de conserve, ils sont morts de rire. Après quand je joue, ils rigolent moins. Ces discussions sont là pour donner du sens aux actions. Et si toute l’équipe est là, c’est pour les aider et pour les élever dans un truc un peu plus intéressant que ce que les médias leur font croire. Enfin, surtout ceux qu’ils regardent et qu’ils écoutent. Heureusement ce n’est pas le cas de tous les médias. Ce sont des discussions qui sont longues et intéressantes, et cela nourrit complètement la réflexion, sans avoir recours à une espèce de diktat guru et de dire que les choses doivent être absolument comme ceci ou cela. Il s’agit plutôt de dire : « Si tu veux être toi-même, ce n’est pas comme cela que ça se passe. » Voilà, cela fait partie des discussions. Et aussi il y a des discussions sur des attitudes, comme par exemple les relations entre les garçons et les filles. On parle même sur l’homosexualité. Quand on dit qu’on ne parle pas de sexe, on va tout de même pouvoir dire que l’homosexualité existe et que ce n’est pas un crime. Il y a des petites choses comme ça sur lesquelles on doit parler. On parle aussi de drogues. Cela veut dire qu’on est dans un paysage où partout il y a de la drogue et puis ce n’est pas de la bonne drogue, c’est de la merde, quoi ! Parce que maintenant il commence à y avoir du crack dans tous les coins. Et puis, pire que ça, il y a une autre merde de crack qui est en train d’arriver et c’est eux qui vont en être les victimes. Donc nous faisons aussi de la prévention. Moi je bosse beaucoup là-dessus. Et ce sont des discussions qui me semblent autant importantes que de faire de la musique. Et là on assume ce rôle-là. Mais si tu ne prends pas ce rôle-là, qu’est-ce que tu vas obtenir ? On ne va pas en faire des bêtes à faire de la musique et puis ensuite tu leur enlèves la partition, et c’est : plus rien ne marche. Il faut aller plus loin. Moi je n’ai pas de partition, je n’en ai pas, il n’y en a pas [rires]. La discussion ne se prépare pas, elle se fait au fur et à mesure des besoins, comme quand, tout d’un coup, on a un enfant qui va arriver perturbé pour X raisons. Ou bien au contraire, parce qu’ils ne sont pas que perturbés, tu as un gamin qui peut arriver avec une pêche pas possible, il a réussi quelque chose, eh bien on va en discuter, on va en faire part à tout le monde. Et puis tu as une ou un autre qui a un gros problème, un gros souci, alors on va en parler. De toutes façons on ne dit pas : « Non, non, attendez, on n’est pas animateur social ». Je ne sais pas ce que cela veut dire, ça. Donc, il faut être un petit peu à l’écoute et au service aussi des gens qui sont en face de soi. Je pense qu’on n’est pas dans une situation de donner un cours. On ne va pas faire une demi-heure de cours et puis on rentre chez nous, ce n’est pas comme cela qu’on voit les choses.
Nicolas S. :
On reprend l’historique. Donc, la ronde des loopers, les ateliers le mardi après-midi avec Lucas, l’intervenant extérieur rémunéré par le CRRi de Lyon. Lucas, qui ne fait pas partie de l’Orchestre National Urbain, quel est son rôle ?
Giacomo S. C. :
Il est là pendant la résidence parce que, lui, il encadre tous ces enfants. Il fait l’intermédiaire et il assure la continuité – parce que si on les a une fois par an dans une résidence on ne les verra pas tout le temps – en développant des choses avec eux. Entre la première et la deuxième résidence, une période d’un an, ils évoluent, ils continuent. C’est-à-dire qu’on a invité les enfants à venir ici au Cra.p, c’est Lucas qui les a amenés, à faire un travail avec d’autres groupes de leur âge ici pour les programmer dans le « festival Crapul au Kraspek » (Carrefour des Rencontres Artistiques Pluriculturelles Urbaines de Lyon), c’était la première fois qu’ils allaient jouer, ils descendaient de la Duchère. Alors ce qui était fabuleux, c’était – là j’aurais aimé avoir tous les politiques présents – c’était d’avoir des femmes voilées, leurs parents qui sont venus au Kraspek, c’est quand même pas mal. Et là ils ont joué. Mais ils ont joué un vrai projet, cela n’a pas été : « Ah ! entre les petits arabes de notre quartier et puis des violets, des oranges, de toutes les couleurs, on fait un truc ». Non, ce n’est pas cela. C’est : ils se sont pris la tête pour faire une création ensemble, d’accord, et après ils se sont retrouvés sur scène à flipper et à dire : « Eh bien, on est dans un lieu, on comprend pas trop c’te boîte à sardines ce que c’est… » C’était noir de monde devant, et tout d’un coup ils ont joué. Et là ça été frrrrt, le truc… Et le rôle de Lucas a été de réfléchir à comment se passe l’interaction avec les jeunes d’ici et les siens, comment nous, de notre côté, on fait travailler les nôtres ; et comment lui de son côté fait travailler les siens pour que cela se rejoigne. Et donc, voilà comment cette recherche est menée. Pour moi, c’était complètement réussi. Et cette année, pendant le festival Crapul au Kraspek cette semaine, ceux qu’on a eus de la Duchère vont jouer le dernier jour. Ils vont jouer avec des têtes d’affiche d’anciens étudiants, par exemple Balir qui a trente-sept ou trente-huit ans, qui est arrivé à Cra.p, quand il avait quinze ans, et qui a un parcours maintenant, donc je l’ai appelé et il a accepté de jouer. L’idée de faire venir un mec comme ça, qui est connu dans ce milieu-là au niveau des jeunes, c’est aussi ne pas leur donner d’illusions, mais de faire voir qu’en fait on peut y arriver. Ce lien-là me paraît important pour que dans le temps, cela ne s’épuise pas. Ce qui m’intéresse, c’est de faire venir l’année prochaine ici par exemple Aïcha et toutes ces jeunes filles qui ont grandi, pour qu’on leur offre une formation (elles n’ont pas les moyens d’en payer une) : 1er, 2ème, 3ème cycles, comme on fait avec tout le monde, après les faire entrer en DEMi – s’il n’y a plus de DEM tant mieux, parce que ça, cela commence à me fatiguer – de voir à quel niveau elles vont arriver avec un vrai groupe dans lequel elles vont jouer et pourquoi pas entrer au Cefedem, se présenter pour avoir une formation diplômante et sortir avec un DEi. Ceci afin qu’à leur tour dans le quartier, elles puissent redévelopper des choses en lien avec le conservatoire. Ainsi, enfin, on va pouvoir faire travailler des jeunes issus d’une cité. Une cité comme la Duchère où aujourd’hui – je le rappelle et vous pouvez garder l’enregistrement et le dire très fort – les musiques actuelles amplifiées sont une catastrophe, parce que des gens ont mis un monopole sur un lieu, et personne ne va dedans et aucun citoyen de la Duchère n’y va. Voilà, c’est un peu cette lutte-là que je mène… si j’arrive à le faire avant de me faire tuer…
Le DEM (Diplôme d’Études Musicales) s’obtient à la fin d’un enseignement initial dans un établissement d’enseignement spécialisé de la musique.
Le DE (Diplôme d’État) de « professeur de musique » dans l’enseignement spécialisé (les conservatoires mais pas uniquement). Il est équivalent à une Licence 3., pour enseigner dans un établissement.
III. Cra.p, Centre d’art
Giacomo S. C. :
Le Cra.p est devenu maintenant un centre d’art parce que la façon de travailler y est complètement différente par rapport à ce qu’on faisait avant. Ce n’est plus simplement un centre de formation. Il y a des ateliers dans lesquels les étudiants, les gens et les groupes ont beaucoup d’autonomie. Et puis on a signé des conventions avec des partenaires de diffusion. Donc, tout le monde joue beaucoup, parce que c’est ça qui me manquait le plus jusqu’à maintenant.
Jean-Charles F. :
Faire jouer les gens, pour toi, ce n’est pas de la formation ?
Giacomo S. C. :
C’est peut-être de l’information, ou de la déformation, je ne sais pas, mais on n’est plus uniquement sur des ateliers, même s’ils continuent à être des moments très forts sur une ou deux journées. Ensuite nous mettons à disposition des espaces où chacun doit pouvoir travailler en autonomie. On sent déjà un changement considérable, après trois mois, sur l’engagement. C’est vraiment mieux et puis du coup cela permet aussi de prendre plus de monde.
Jean-Charles F. :
Je pense que tous les enseignements devraient prendre de plus en plus cette forme.
Giacomo S. C. :
Je crois que c’est une évidence maintenant, on voit bien que le reste ne marche pas bien. Enfin ça marche un temps, jusqu’à un certain âge on va dire, des enfants jusqu’à un certain âge, et après ça, ça ne fonctionne plus donc les gens s’en vont et disparaissent.
Nicolas S. :
Tu dis que le Cra.p n’est plus un centre de formation mais un centre d’art. Du coup la pédagogie, la formation, c’est quoi pour toi ?
Giacomo S. C. :
En fait, il y a pour moi deux choses :
- Déjà, si on remet les choses en place, moi je ne suis pas prof, je n’ai aucun statut de professeur, je n’ai pas suivi une formation de professeur, de formation de maître ou de quoi que ce soit de ce genre. Il y a plutôt une reconnaissance du travail de partage que j’ai mené. La pédagogie je ne sais pas si c’est ce que je fais. On m’a dit tu fais de la pédagogie mais moi je ne le savais même pas. Il s’agit plutôt de faire de la musique, de faire des choses et de les partager. En fait j’ai perdu cela un petit peu pendant quelques années, en me masquant derrière une espèce d’intitulé, ce n’est même pas moi qui l’ai trouvé. Mais on me disait que j’étais un pédagogue machin et tout ça, et ça devenait un truc un peu trop institutionnel et trop cadré pour moi. Je pense que pour moi et l’équipe avec qui je travaille, cela a perdu du sens dans les actions qu’on a pu mener.
- Tout d’un coup, je me considère plus comme un artiste-musicien, mais sans prétention. Cela veut dire que c’est mon boulot de partager des choses, une passion et un travail que je fais plutôt que de mener une pédagogie académique certifiée. Il n’y a pas de certificat de ce qu’on fait, et c’est cela qui m’intéresse, parce que la certification me fait de plus en plus peur quand je vois ce qui se passe dans mon entourage de la pédagogie. Parce que, pendant des années j’ai fait partie des gens qui ont travaillé dans l’effervescence à la naissance des musiques actuelles amplifiées jusqu’à l’ouverture de la formation diplômante et j’ai vu des dérives qui m’inquiètent beaucoup plus aujourd’hui qu’elles ne me confortent. C’est pourquoi je n’ai pas envie de continuer à alimenter ce genre de réflexion ou ce genre de travail. Et là, chaque fois que je vais quelque part (je reviens par exemple du Maroc) et que je rencontre des gens, je joue aussi, donc je fais voir quelque chose de ce que je fais, et je fais jouer beaucoup. L’idée, en fait, c’est de les amener tout de suite dans un projet artistique plutôt que d’un projet où la pédagogie est plus importante que l’artistique. Il s’agit de mettre en situation les personnes mêmes si elles ne sont pas artistes et donc ça change un peu l’approche qu’on a avec les gens, on les perçoit de façon différente.
Il y a deux semaines, j’ai vécu des choses assez étonnantes, j’ai quand même mis tous les gens avec qui je travaillais sur scène, il s’est passé des choses inattendues, pour moi, mais alors encore plus pour eux. Il y avait des gens avec des problèmes psychologiques qui étaient incapables de parler, et le fait de les mettre dans un processus de projet artistique, ça a débloqué plein de choses. Je pense que c’est plus intéressant de le faire comme ça. Si je leur avais parlé de pédagogie, je les aurais enfermés encore plus dans leur problème. Voilà, la réflexion philosophique, elle va plutôt dans ce sens, c’est de dire que ce n’est pas une mutation, mais un retour à quand j’étais bien plus jeune que ça : on était plus, en tant que groupe, à partager des choses, plutôt qu’en tant que pseudo-profs qui font faire des choses. Revenir à ces sources-là, cela me passionne complètement. C’est pourquoi je dis aujourd’hui que Cra.p n’est pas un centre de formation – d’ailleurs cela n’a jamais été le cas, ce ne sont que des intitulés qui se sont imposés à un certain moment, mais en fait c’est faux, ce n’était pas ce qu’il fallait dire – mais c’est un centre d’art, un lieu de rencontre des carrefours artistiques pluriculturels. C’est un endroit ouvert à beaucoup de choses qui ne s’enferme pas sur une spécialisation unique. Je me souviens quand, Jean-Charles, tu disais que Giacomo c’est un mec qui fait travailler des gens en rap mais qui ne fait pas du rap lui-même, et c’est un peu ça, revenir à cette idée qu’on n’est pas dans une spécialisation absolue de la pédagogie, c’est ouvert à plein de choses. De toute façon, on voit bien qu’il y a un recyclage permanent de l’art, et donc il faut éviter de s’enfermer.
Jean-Charles F. :
Juste un point, d’une façon ironique…
Giacomo S. C. :
Jean-Charles F. :
Tout ce que tu dis, cela ne concerne-t-il pas la pédagogie ?
Giacomo S. C. :
Peut-être, oui, peut-être que c’est le mot.
Jean-Charles F. :
Ce que tu dis est basé sur une longue expérience qui a été d’une manière passionnée consacrée dans une très grande mesure à la pédagogie. En plus je souscris à 100% avec ce que tu dis.
Nicolas S. :
Giacomo S. C. :
Oui, mais alors c’est peut-être la déviance du jargon.
Jean-Charles F. :
Eh bien, le jargon, tout le monde en a ! Mais c’est aussi peut-être une question d’institutionnalisation, de l’influence de ceux qui contrôlent les institutions.
Giacomo S. C. :
Mais justement, là, où sont les freins ? Quelle est l’attitude des personnes que tu as en face quand tu leur dis qu’on va les faire travailler sur un projet pédagogique ? Et comment vont-ils réagir quand on leur dit qu’au contraire on va les mettre en situation de se lancer dans un projet artistique ? Quel sera leur ressenti ? Toi, tu as une expérience assez forte là-dedans, donc tu as la rhétorique et la compréhension rapide de la réactivité. Je ne suis pas sûr que des gens lambda, plus jeunes, qui ont moins d’expérience, et qui ne sont pas complètement dans le milieu, aient la même réaction, moi c’est plutôt ceux-là que je touche.
Jean-Charles F. :
C’est évident. Tu ne vas pas commencer par voir les gens et leur dire qu’on va les emmerder pendant six mois avec des ateliers.
Giacomo S. C. :
Oui, mais tu peux aller les emmerder en leur disant d’entrée de jeu que voilà, ils vont d’abord apprendre des choses et seulement après ils vont pouvoir réaliser leurs rêves artistiques.
Jean-Charles F. :
Giacomo S. C. :
Oui, il y a de la pédagogie. Mais moi je n’ai jamais dit que j’étais pédagogue, c’est les autres qui l’ont dit à ma place. Au départ je ne savais même pas ce que ça voulait dire, pour te dire que j’étais quand même assez ignare. Le truc c’est de partager des choses, mais comme je l’ai vécu quand j’étais ouvrier : il y avait des vieux qui m’ont appris le métier, j’étais apprenti ; eh bien je n’avais pas de bouquin et on me disait « Tiens on va fabriquer tel truc, on va te faire voir et tu vas mettre les mains dedans ». C’était très manuel, et j’ai compris plein de choses grâce aux anciens parce qu’autrement je n’aurais pas pu en faire mon métier.
Jean-Charles F. :
Dans les conservatoires on trouve le cas de personnes qui se méfient de la pédagogie et qui mettent l’accent sur le projet artistique à long terme, mais qui disent à leurs élèves qu’en attendant il faut faire des gammes. Il ne suffit pas de dire qu’on va faire d’emblée un projet artistique sans qu’il y ait des dispositifs pour y parvenir.
Giacomo S. C. :
Je dirais plutôt qu’on est là pour aider avec l’expérience qu’on a, parce que l’idée de « former » ça me gêne aussi beaucoup. Il faut aider à faire naître un projet artistique chez une personne, et venant de ce qu’elle est elle-même. Moi, je ne sais pas faire des gammes, parce que je n’ai pas appris cela. Je sais bien qu’il y a des gens qui font ça très bien mais nous, on ne le fera jamais. On ne fait pas de reprise, on ne reprend pas un morceau pour apprendre la musique, moi je n’y crois absolument pas.
Jean-Charles F. :
Je n’ai pas dit tout cela pour impliquer que c’est ce que tu fais, mais pour essayer de pousser plus loin la réflexion sur ce que tu nous racontes et provoquer un débat avec toi.
Giacomo S. C. :
Ma démarche est surtout basée sur le miroir de ce que me renvoie les gens et de ce qu’ils me demandent, et à partir de là de prendre en considération où ils en sont. Cela veut dire que c’est impossible de se construire tout seul, je n’y crois absolument pas, de toute façon ça n’existe pas. Et si aujourd’hui j’ai des outils, et j’ai du boulot beaucoup de boulot dans ce domaine-là et j’en suis assez content, satisfait de ce qui se passe – satisfait je ne le serais jamais assez – c’est grâce à tous les gens que j’ai rencontrés depuis trente ans, c’est eux qui m’ont construit, ce n’est pas moi qui les ai construits, c’est évident. En fait, quand on veut essayer de garder cela, c’est moins confortable, parce que tout d’un coup, quand on fait ce choix, on s’écarte de plein de choses : par exemple on quitte une École Nationale de Musique parce qu’on n’est pas d’accord avec le comportement pédagogique en vigueur, on ne travaille pas avec n’importe qui, on se marginalise complètement, on devient un électron complètement externe au monde culturel. Cela peut aller très loin, cela va jusqu’à ne pas être programmé à certains endroits parce qu’on est contre. C’est une façon de voir les choses. Mais là où je suis assez satisfait, enfin assez content aujourd’hui, c’est que je vois qu’en fait il y a une population bien plus jeune qui pense de plus en plus de cette manière, et que tout le reste devient bien « has been ». C’est un peu ma façon de penser au début qui est remise en cause : je me suis fait un peu happer dans la souricière, maintenant il faut en sortir [rires].
Jean-Charles F. :
Giacomo S. C. :
Non, ce n’est pas le cas. Mais tu n’étais pas tout seul, je vais donner des noms : Gérard Authelain et Camille Roy.
Nicolas S. :
Vous étiez toute une bande. Ce qui est intéressant, si je reprends ce que tu dis, c’est que tu as une manière de nommer les choses qui est hyper située à l’endroit et à l’époque où tu es, ceci en interaction avec les gens avec qui tu parles. Et c’est justement parce qu’on arrive à avoir des descriptions de dispositifs assez précis comme tu viens de le faire sur la Duchère, que tu peux développer un discours en rapport avec des actes. Je dirais que ce que tu fais, c’est de la recherche, en rapport avec ce que je suis en train de travailler. Alors, les gens du Cefedem pourront dire que c’est de la pédagogie parce que c’est leur mot, et d’autres dirons que c’est bien une pratique artistique, chaque groupe de personnes peut utiliser ses propres mots-clés.
Giacomo S. C. :
Évidemment. Moi, je laisse les gens donner le soin de l’intitulé. Quand Eddy Schepens me dit que je ne suis pas un artiste, mais un artisan, je lui réponds : « si tu veux ». Je ne conteste pas sa propre manière d’envisager les choses.
Nicolas S. :
Et puis est-ce que après tu prends en compte les propositions pour essayer de voir ce que ça permet de dire et de faire ?
Giacomo S. C. :
Oui évidemment. Je pense que si je peux mener une réflexion aujourd’hui, et voir les choses sous différents aspects, c’est parce que j’ai vécu toutes ces choses-là à travers des actes. Sinon je ne serai pas aussi à l’aise – d’ailleurs je ne le suis pas encore tout à fait – je vois bien qu’il y a une transformation à accomplir, on ne peut pas se séparer de la mouvance de la population, de ce qu’elle vit politiquement, de ce qu’elle vit socialement. Je pense qu’on ne peut pas séparer la culture de cela, ce qui fait qu’il est nécessaire de renouveler perpétuellement la pensée en connexion avec ce qui se passe. Ce qui me gêne dans le côté pédagogique du mot « pédagogique », là où il a son poids, c’est que c’est une méthode : il y en a qui adoptent des méthodes qui ont 150 ans d’existence, c’est très bien, mais il y a 150 ans on ne vivait pas comme aujourd’hui. Tous ces passéistes m’ennuient profondément parce que c’est pour cela que ça ne marche pas, et c’est pour cela que ce mot de pédagogie s’est malheureusement un peu transformé. Le mot de pédagogie me gêne beaucoup aujourd’hui, et c’est pour ça que je l’écarte complètement. C’est une solution assez facile de prétendre faire de la pédagogie, en vue de se mettre soi-même sur un piédestal. Être pédagogue, cela devrait vouloir dire que c’est gérer les autres, et quand même ce n’est pas rien. Cela donne un pouvoir sur les autres, c’est un peu cela qui m’inquiète dans l’utilisation de ce mot aujourd’hui.
Je me passionne pour beaucoup de choses, que ce soit en musique, en peinture ou dans tous les autres arts. Mais c’est surtout quand il s’agit de la rencontre des arts que je vois des trucs qui m’insupportent complètement. Je me dis qu’on va dans le mur : il n’y a rien, ou bien peu de choses intéressantes qui sortent. On voit bien que c’est récupéré par une vision de l’artiste plein de paillettes et de bling-bling. C’est trop propre pour moi tout cela, et puis il n’y a rien d’autre autour, cela ne correspond pas à la réalité. Si on prend en l’occurrence la musique, c’est vraiment une catastrophe aujourd’hui, et donc quel devenir envisager ? Récemment, j’étais au Maroc et j’ai filmé un groupe qui jouait sur la place de la Médina à Meknès, avec du matos pourri. C’était entouré de gens, c’était plein à craquer, avec des femmes voilées, tout le monde dansait, ça jouait, c’était très « roots ». Je me suis dit alors, voilà où est la vérité de la communication artistique. C’était le jour de l’islamophobie, donc je l’ai filmé et je l’ai envoyé au monde entier, en France de partout, et tout le monde a répondu que c’était génial. Je me suis dit que oui, c’était génial, sauf que quand vous voyez quelqu’un de voilé cela vous emmerde aussi. Il faut juste se rappeler qu’en fait, on vit des décalages culturels qui sont quand même assez intéressants. Aujourd’hui, je fais attention aux intitulés qui peuvent nous enfermer dans une caste. Quand on me dit « Tu es prof », je réponds « Non », que je ne suis pas prof, parce que je n’ai pas un statut de prof. Les intitulés, les titres, les étiquettes, c’est ce qui cache un petit peu tout le problème. C’est trop facile à manipuler. Les titres qu’on donne aux gens, cela m’inquiète beaucoup.
IV. Politique politicienne et politique citoyenne
Jean-Charles F. :
Comment est-ce que tu vois le contexte de Cra.p, aujourd’hui, par rapport au contexte politique en général ?
Giacomo S. C. :
Je pourrais dire que juste là j’ai une position, et dimanche j’en aurai peut-être une autre [Le dimanche en question était le jour des élections européennes] [rires]. Je suis doublement emmerdé, parce que, j’aurais pu m’échapper en Italie, mais c’est pire. Donc je suis pris dans un étau.
Si je fais le bilan des trente ans, eh bien, il y a des moments très chaotiques politiquement, parce que ce qu’il y a d’assez intéressant sociologiquement sur ce passage-là, c’est qu’en fait on a eu plein de changements : on a eu plusieurs gouvernements, plusieurs attitudes, des gens qui dirigeaient des collectivités locales, des subventions qui ont changé, cela a été en dents de scie et là, ça commence à se stabiliser. Mais cela se stabilise parce que, depuis que j’ai fait la proposition avec l’Orchestre National Urbaini de ce travail, tout d’un coup les choses s’ouvrent vraiment, et je trouve que les politiques se penchent sérieusement sur les problèmes. Mais c’est lié à un contexte, pour moi, beaucoup plus inquiétant, c’est-à-dire qu’il y a une forme de radicalisation globale des pensées, et pas simplement des religieux. Je parle de pensées globales, je ne parle pas seulement de l’Islam ou de quoi que ce soit, ou mêmes des chrétiens ou des juifs. Je ne parle pas de religion, je parle d’un contexte des mentalités qui sont en train de changer. En fait c’est tout de même bien le bordel : la proposition que j’ai faite avec l’Orchestre National Urbain remettait en cause les façons de faire, surtout les nôtres, par rapport aux gens qu’on touche – ce sont des gens qui bien souvent n’ont accès à rien. Mais, tout d’un coup, les politiques se saisissent de ce genre de proposition, même aujourd’hui, ils en sont très friands. Donc, dans le cadre de ce que j’appelle la politique politicienne, il est en train de se passer un échange, les dirigeants commencent enfin à penser et à comprendre des choses. Parce que pendant les trente ans qu’on s’est battu, ils ne comprenaient pas tout le temps. Ils commencent à comprendre, mais pas tous. C’est je pense une évolution intéressante, mais c’est aussi parce qu’on a de quoi argumenter aujourd’hui. Cela veut dire qu’on est parti d’un constat où l’on n’avait rien. La DRACi ne savait pas où nous mettre, il a fallu créer une nouvelle case qui consiste à dire que les esthétiques liées aux musiques urbaines ont une importance vitale, et cette case a enfin été prise en compte par les politiques. Mais il a fallu plus de vingt-cinq ans de combat pour qu’aujourd’hui – on va dire depuis il y a à peu près cinq ou six ans – on soit plus tranquille et plus serein pour travailler. Pour moi, il y a la politique politicienne, c’est-à-dire les hommes politiques et puis il y a ce que je vais appeler la politique citoyenne : c’est celle-ci qui m’intéresse, parce que ce sont ceux qui font la rue qui font de la politique, ce n’est pas ceux qui disent « Il faut faire comme ça ». De toutes façons ils ne font rien. Et là, j’ai plein de doutes sur la politique citoyenne, en ce moment. J’ai plein de doutes, parce que j’ai la chance de travailler à la fois avec des gens de l’enseignement supérieur et des gens de la régression inférieure. Quand on va dans un quartier où il n’y a plus rien, c’est un no man’s land, il n’y a plus que des zones de non-droit, même les flics n’y vont pas. Tu vas essayer d’y installer des choses culturellement, mais il y a un fossé qui s’est tellement creusé, une fracture tellement grande, qui fait que certains se demandent pourquoi on vient, ils n’en voient pas l’intérêt, et c’est cela qui m’inquiète le plus. En fait ils ne comprennent plus l’intérêt culturel qu’on leur apporte et quel développement de socialisation cela va produire. Mais ceux qui ne comprennent pas ne sont pas les gens du quartier mais bien ceux qui dirigent autour de ça. Par exemple, certains animateurs sociaux ont créé un vrai fossé. Et puis il y a un autre fossé qui m’inquiète de plus en plus : en fait, j’essaie de faire un travail régulier avec des gens de l’enseignement supérieur, qui sont dans les centres de formation, mais il n’y a pas moyen de tisser des liens. C’est-à-dire, on essaie de mettre des choses en place en lien avec ces populations des quartiers, mais les gens n’en n’ont pas envie, ils ne veulent pas le faire. Ce sont ces aspects de la politique citoyenne qui m’inquiètent beaucoup, en fait, on est en train d’aller tout droit dans le mur. Je crains que dans peu de temps cela va produire des résultats inintéressants, parce qu’il y a une fracture tellement forte. Dans les centres de formations, il y a une absence de réflexion autour des questions concernant les pratiques culturelles dans les quartiers, les liens qu’on essaie de développer entre le Cra.p et ces institutions ne fonctionnent pas bien. Il y a des formes de refus qui s’expriment, où tout à coup on sent qu’on montre un public du doigt en disant « Bon, c’est bon ça, ce n’est pas une culture qui m’intéresse » et cela se sent physiquement.
Et je trouve qu’on a eu une bosse dans les années 1990 : en 1989 exactement, à la naissance de l’association Cra.p, il y avait un fossé tellement grand entre les esthétiques ! En 1992 ou 93 il se passait des choses, et on allait vers un terrain assez intéressant. Par exemple, il y a eu cette fameuse rencontre en 1998 entre des rappeurs et des musiciens classiques du Cefedem, on avait vraiment monté une marche. Pour moi, maintenant, on va dans l’autre sens, c’est complètement retombé. Déjà la gangrène a bien pris sa place. Pour ressortir de ce trou, cela va prendre beaucoup de temps. Et là, je pense que si on ne réunit pas plus de forces pour réfléchir là-dessus on va vers des temps difficiles ; mais cela fait trente ans que je parle de ce problème. Donc là, du point de vue de la politique politicienne, tout d’un coup, les politiques eux sont friands de toute proposition allant dans ce sens : on est maintenant très soutenu par rapport au projet de l’Orchestre National Urbain. On a même signé une convention avec le Grand Lyoni, une espèce de labélisation. La préfecture nous soutient beaucoup, la ville de Lyon aussi.
Si on prend la politique culturelle de Cra.p depuis le début, cela a été de dire : « On va ouvrir nos portes à des gens qui sont nulle part, et voir comment on va pouvoir les amener grâce à des rencontres diverses et variées à entrer dans l’enseignement supérieur ». À un moment donné, on a réfléchi à comment ces mômes-là, un jour, pourraient venir au Cefedem ou au CNSMi, etc. Je continue à me battre là-dessus, mais pour moi, cela n’est pas encore gagné. Avec l’Orchestre National Urbain on a remis ça en route, on a remis ce pavé dans la mare qui consiste à dire : « Qu’est-ce qu’on fait, on y va ou on n’y va pas ? » On commence à avoir des résultats intéressants, puisque le fait de travailler sur plein de quartiers, d’arrondissements de la région et sur toute l’Agglomération, nous a permis d’inviter des jeunes personnes qui font de la musique et de l’animation à entrer en formation ici au Cra.p. C’est ainsi que plusieurs d’entre elles sont venues travailler chez nous cette année en vue de les amener jusqu’au Diplôme d’Étati, ce fameux diplôme qui leur permettrait de travailler et d’être considérées au même titre que les autres. Ça marche bien. Mais cela va plus loin que cela : c’est aussi comment ces personnes se rencontrent avec les autres. Je prends un exemple d’un jeune qu’on a repéré il y a un peu plus d’un an lors d’une masterclass dans le 8ème arrondissement. En discutant, on a senti qu’il avait des choses à dire et qu’il vivait déjà des choses de son côté. Il nous a dit : « Comment s’occupe-t-on de tous ces gens qui ont des boulots d’animation avec des espèces de Bafa ou de Beatep, parce que, comme ils ne font pas une musique sacrée, comme leur pratique est considérée comme une musique de sous-classe, on ne peut pas leur donner un diplôme ». C’est ce genre d’états de fait qui me révolte. Je lui ai dit de venir travailler avec nous, cela fait un an qu’il est là et ça marche super bien. On va l’amener jusqu’à la formation diplômante, dans l’espoir qu’il obtienne un diplôme, à travers une formation en relais avec le travail qu’il fait le 8ème (Centre social du Quartier des États-Unis). Quand je dis que cela va plus loin que ça, c’est qu’il fait lui-même la rencontre de plein d’autres gens ici, et pas seulement avec ceux qui font partie de la culture qu’il pratique. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment il peut bosser avec des gens qui viennent du classique, du contemporain, du jazz, etc. Quand je rapporte cela sur les indicateurs de résultat, cela ne peut être que bénéfique en ce moment vis-à-vis des décideurs politiques qui nous aident.
Pour revenir sur la question de l’histoire de la politique actuelle – la politique citoyenne et la politique politicienne – ce qui s’est inversé maintenant, c’est moins d’inquiétude envers les décideurs, parce qu’ils ont compris, mais c’est plus d’inquiétude sur le public même. Puisqu’on est en relais directement avec la préfecture, on est content de pouvoir rencontrer le délégué. Donc, tout d’un coup ça les intéresse : il y a un résultat.
Ce n’est pas qu’il n’y ait pas d’expression de la part de ceux qui vivent dans les quartiers, c’est qu’il n’y a rien. S’ils le font ils le font dans leur coin. On vient de faire une semaine de résidence à la MJC de Rilleux-la-Pape. Bizarrement, on a eu peu d’enfants, et tous ceux qu’on a essayé d’accrocher, pour venir répéter ce qu’ils avaient envie de faire par eux-mêmes, restaient à l’extérieur de la MJC, mais ne rentraient pas dedans. Mais cela, ce n’est pas du fait de notre présence, c’est quelque chose qui existait déjà avant. Il y a une fracture entre tous les lieux culturels dans les quartiers et les populations qui y habitent. Et depuis quand cette fracture existe ? Depuis la naissance des SMACi, et je ne crache pas sur la naissance des SMAC, j’ai moi-même connu ce qu’il y avait avant les SMAC. J’ai fait partie des gens qui ont fait tout un travail dans toutes les MJC de la région : je partais avec un fly, avec un sampler, avec une boîte à rythme, etc., et avec un collègue, on faisait des ateliers un peu dans toutes les MJC, on avait un réseau assez large. En ce temps-là, les mômes venaient volontiers participer. Quand il y a eu tout d’un coup la labélisation des Scènes des Musiques Actuelles Amplifiées, ces fameuses SMAC, il y a eu une espèce d’appel d’air pour un public venant de l’extérieur du quartier. Évidemment, c’est beaucoup plus intéressant d’aller dans une SMAC maintenant, parce que quand on fait du rock ou n’importe quelle musique, on a intérêt à y aller. Avant ce public n’y allait pas, parce que c’était les MJC. Il y avait alors dans les MJC un aspect beaucoup plus populaire de la culture et, tout d’un coup, une espèce d’élitisme s’est installée, même dans le rock, qui m’inquiète beaucoup, et cela écarte toutes les minorités. Alors on prend des exemples très simples : il y a plein de gars qui faisaient des ateliers de danse hip-hop dans les MJC et qui se sont fait virés. Cela veut dire que, quand on vire une personne, c’est toute la population qui va avec qui est virée. C’est un phénomène qui remonte aux années 1960-70 où on remet toutes les minorités à leur place, parce qu’on a prévu des cages à poules pour eux, on les remet dedans, on les coince bien là-dedans, on construit de superbes équipements dans la cité où ils habitent et eux n’y en ont pas accès. C’est toute une autre population autre qui vient de l’extérieur qui utilise les lieux. Voilà où est la fracture. C’est un constat. C’est plus qu’honteux quand je vois ça ! C’est pour cette raison que, quand j’arrive avec l’Orchestre National Urbain, je ne suis pas accepté partout ! C’est la guerre ! Quand j’arrive je dis : « Ces mômes, il faut qu’on les prenne, faut qu’on les ramène, et puis il faut qu’ils aient du boulot ; parce qu’ils sont de là (ce n’est pas uniquement parce qu’ils sont de là), ils ont le droit comme les autres, ce sont des contribuables. » Et là, pour faire comprendre cela, eh bien, c’est un boulot de fou ! C’est un boulot de dingue ! Et quand je parle de cette fracture-là à de jeunes personnes qui n’ont pas de problèmes financiers, qui vivent normalement et plus aisément pour certains, et quand on leur demande de faire un effort pour que les choses changent, il y en a très peu qui viennent. Donc, c’est pour cela que je dis qu’on est dans une régression. Enfin c’est une boucle, on a un vrai trouble obsessionnel compulsif. J’ai l’impression d’avoir de nouveau quatorze ans quand, dans la MJC de salle des Rancy, on m’avait dit à l’époque : « Viens nous aider à poncer les canoës-kayaks ». Avec tous les potes, les paumés du coin, on avait poncé les canoës-kayaks. Et quand il a fallu partir au mois de juin en Ardèche, c’est tous les petits bourgeois du coin qui sont partis et nous, on est resté ici. C’est l’effet canoës-kayaks. Et donc on est en train de revenir à cette situation. C’est ça qui m’inquiète aujourd’hui. Voilà pourquoi c’est en train de dysfonctionner un peu de partout. En fait c’est très simple, ça ne date pas d’aujourd’hui, c’est pour cette raison qu’il y a des mômes qui tombent sous la coupe des intégristes de n’importe quelle communauté religieuse ou politique, ou avec la drogue et les extrêmes et qui les amènent à se dire : « Ben voilà, j’ai une tâche ; là-bas je n’en ai pas de tâche. Du boulot on en n’a pas. » Car il n’y a pas de boulot non plus. Moi-même, je ne suis pas loin aussi d’arrêter, cela fait plus de trente ans que je fais ça. Ce n’est pas que j’ai envie de faire autre chose mais quand je serai à la retraite je vais faire quoi ? Je vais laisser tout tomber Je vais m’en aller en courant ? Non. J’ai envie de développer encore des choses, mais j’ai aussi envie qu’il y ait plus de gens qui s’inquiètent un peu. Il y a quand même une fracture, qu’on le veuille ou non. Et c’est pour ça que là-haut, tout le monde dit : « Mais non, il faut que les mômes des quartiers aillent dans l’enseignement supérieur. » C’est la mode actuellement. Mais ce n’est pas qu’un effet de mode, il faut réfléchir plus longuement à cela.
La DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) est un organisme représentant l’Etat en région, chargé de conduire la politique culturelle.
Le « Grand Lyon » est le nom de la Métrople de Lyon, collectivité territoriale créée le 1er janvier 2015 en remplacement de la communauté urbaine de Lyon (59 communes, env. 1,4 million d’habitants).
Le label SMAC (Scène de Musiques Actuelles) correspond au programme du Ministère de la Culture pour la valorisation et la diffusion des musiques actuelles depuis 1998. Un lieu avec un tel label a trois missions : la création-production-diffusion de concerts, l’accompagnement des pratiques musicales (professionnelles et amateures) et l’action culturelle.
Jean-Charles F. :
Oui, parce que du côté du gouvernement au sujet de l’enseignement supérieur et des grandes écoles on entend le discours contraire : il faut que la méritocratie prime sur cet aspect que tu décris.
Nicolas S. :
Dans ce que tu as développé, il y a l’idée de fossé, de fracture. Notre prétexte à notre rencontre était l’idée de « Faire tomber les murs ». Dans le fossé, il y a une sorte de profondeur et de largeur, et tu utilises aussi le terme de fracture. Est-ce que cela change des trucs, un peu, cette formulation-là ou pas ?
Giacomo S. C. :
Avec le mur, tu ne vois pas ce qu’il y a de l’autre côté. Pour moi la fracture il y a un trou, mais tu vois quand même ce qui se passe de l’autre côté. C’est comme cela que je le vois. Si je reviens un peu à notre histoire, en mai 1989 on crée Cra.p, et en novembre c’est la chute du mur de Berlin. Tout d’un coup cela nous a donné un coup de pied au cul, et je pense que cela a fortement renforcé nos motivations. C’est qu’on était contesté en plus. Alors que tous nos murs étaient graphés et qu’une symbolique s’était mise en route. Et l’histoire du mur, les murs qu’il y a maintenant, l’idée de les faire tomber oui, je suis pour, mais en même temps il y a quoi derrière ? La fracture, elle, est plutôt visible et comment on met un pont pour que ça passe quoi, sur ce trou-là ? Quel pont ? Quelle passerelle ? Et il n’y en a pas. Ici [l’interview a eu lieu au siège du Cra.p, dans le quartier de la Guillotière à Lyon], on est dans un quartier qui est, je vous le rappelle, l’autre côté du pont [de la Guillotière, en traversant le pont sur le Rhône, on arrive à ce qu’on appelle à Lyon la « presqu’île »]. Il y a d’ailleurs un café qui s’appelle « L’autre côté du pont ». Ce n’est pas pour rien qu’on s’appelle « l’autre côté du pont ». Moi je suis né là. Ce qu’il faut savoir, c’est que de l’autre côté du pont, donc, la presqu’île, là c’était le confort absolu, dans tous les sens du terme, et ici, c’était la merde absolue dans tous les sens du terme. Parce qu’ici, c’était l’un des quartiers des plus pourris : il y avait des bidonvilles de partout. Mon père quand il est arrivé, il vivait dans une pièce, dans un bidonville pourri qui allait jusqu’à la Part-Dieu. Quand j’étais gamin, il y avait encore la caserne d’infanterie militaire, de cavalerie même, à la place de la Part-Dieu, et tout autour tu avais des petites baraques avec des petites usines, c’était crado à mourir. Il n’y avait que des émigrés italiens, dans un premier temps, parce qu’il y en a un qui est venu et il a fait venir tout le monde. Après 1962, les algériens sont arrivés, et ainsi de suite. Mais on est de l’autre côté du pont. Encore une fois de plus, c’est le pont qui fait ce lien. Et nous on regardait toujours de ce côté-là. Et quand tu arrivais à un certain âge tu pouvais passer de l’autre côté du pont. Mais quand tu allais là-bas, c’était pour te foutre sur la gueule avec d’autres bandes, et souvent le 8 décembre. Parce que là-bas, c’était un monde à part. Voilà, ces fractures-là m’intéressent plus que l’histoire du mur, parce que le mur, pour moi, il cache quelque chose. En fait c’est bien de pouvoir voir si ce qui est en face est atteignable et de pouvoir envisager de faire quelque chose. Voilà, j’ai plutôt ces concepts de fracture et de pont dans ma vision.
La fracture vient de ce que j’ai dit avant : il y a un moment où on est arrivé à faire des choses. On est monté, et puis paf ! Cela s’est re-fissuré encore une fois. Et pourquoi ? Je ne suis pas sociologue, mais je pense qu’il y aurait certainement à chercher comment se fait-il que tout d’un coup on se retrouve devant un phénomène de descente, et que c’est toujours une minorité qui se retrouve à la rue ! Comme on a tous les mômes de l’Ecole Painlevé près de nous toute l’année [les locaux du Cra.p sont dans cette école primaire] – nous, on étudie ça un peu – on voit des réactions quand même extrêmement intéressantes : c’est une école où ils accueillent tout le monde, même les Roms, ils n’ont pas de discriminations, même des gens de CLIS (Classe pour Inclusion Scolaire), des déficients mentaux qui sont avec les autres enfants. C’est le comportement des enfants, qui nous intéresse, et c’est là que le problème commence : quand tu vois par exemple une petite Rom qui est assise, elle se lève, il n’y en a plus jamais un qui va s’asseoir à sa place. Pourtant ce sont des enfants de première, deuxième et troisième générations, des gens de couleur. Ils ne s’assoient pas là où la Rom s’est assise parce qu’elle est pestiférée. Il y a plein d’attitudes comme ça, alors, qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on fait avec ces mômes ? Parce que le problème qu’on a par exemple dans certains quartiers, c’est qu’il y a de l’homophobie et du racisme. Si on leur rappelait ce que leurs parents ont vécu en termes de racisme, je ne sais pas s’ils comprendraient. Il y a une radicalisation qui est quand même très, très, inquiétante, il y a un fascisme proche du nazisme dans les quartiers. Parce que on a créé tout cela : si tu laisses les gens entre eux et tu ne leur donnes plus rien, qu’est-ce qu’ils font ? Ils deviennent dingues ! Et je crois que c’est ça, on a un peu laissé tomber l’échange culturel à tous les niveaux. Jacques Moreau [directeur du Cefedem AuRAi], l’année dernière, est venu ici, à Cra.p, avec des colombiens : ils parlaient des problèmes qu’ils avaient, eux, avec le public en Colombie, qui n’est pas la même échelle qu’ici évidemment, on n’est pas le même pays. Mais je leur ai dit : « Vous avez certainement un problème, mais qui n’est pas le même que le nôtre, quoi. » Nous, on a un passé colonial tellement fort en France, qu’en fait, aujourd’hui, il faut faire avec toutes les communautés qui arrivent, et avec celles qui sont déjà là. Alors c’est à la fois une richesse et un casse-tête chinois qui n’est pas si simple à mettre en route. Mais ça il faut le faire, et si on ne le fait pas on est mort. Et c’est ce qui est en train de se passer. On ne le fait pas. L’Éducation Nationale a baissé les bras, complètement, à l’école il ne se passe plus rien. Moi j’ai des mômes qui vont à l’école, quand je vois ce qu’ils me rapportent, je me dis qu’ils sont fous. Comme je l’ai déjà dit, dans le cercle des centres sociaux, c’est mort. Qu’est-ce qu’on fait ? On fait de l’éducation pour certaines personnes dans les centres sociaux. Et aujourd’hui tu as des milliers d’écoles de musique dans les centres sociaux. Et de l’autre côté on a les MJC. On a une strate, comme ça, des cases pour y mettre la population. Moi je dis que c’est pas mal, mais quel est le lien ? D’accord, on travaille comme ça parce que de toutes façons on ne peut pas mettre les gens tous au même endroit. Mais est-ce qu’il y a un lien entre ces institutions ? Est-ce qu’il y a une concertation entre elles ? C’est là où se trouve le cœur de la question politique : c’est qu’aujourd’hui ces liens n’existent pas. Je n’arrête pas de me battre et de le leur dire. On a fait tout un travail pendant deux ans à Pôle Neuf, dans le neuvième arrondissement de Lyon, on travaille beaucoup avec le neuvième, sur toute la Duchère, et Pôle Neuf c’est la MJC Saint-Rambert. Saint-Rambert est un quartier où c’est la zone peut-être la plus friquée de Lyon, où tous les grands footballeurs ont leurs maisons, et tout ça… Il y a à côté la cité ouvrière du Vergoin complètement démunie. Une étude a été menée où par exemple – ce n’est pas moi qui l’ai faite, c’est les gens qui nous ont rapporté ça – on a montré qu’il y avait des familles avec un ou deux enfants qui déclaraient 3000/4000€ par an d’impôts. Par an. Alors tu imagines un peu le problème : ils ont 3000 balles pour faire l’année, quoi ! C’est pas mal ! Et là on a mené un travail, justement, pour essayer de réunir des populations, pour qu’elles se rencontrent, toujours sur le projet artistique, c’est-à-dire avec l’Orchestre National Urbain. On a essayé de créer des synergies entre les gens et les genres, toutes esthétiques confondues et toutes populations confondues, pour créer un grand orchestre au même titre que l’Orchestre National Urbain, pour faire des choses et pour continuer. On est assez frustré, parce qu’on n’est pas arrivé à le faire. Impossible. On a du chemin à faire ! Parce que là il y a un écart qui est tellement violent : ni le Centre Social ni la MJC n’ont eu – par leur autorité – un engagement assez intéressant pour que quelque chose puisse exister. Et à partir de là ça a été la guerre entre le Centre Social et la MJC, et ils sont dans le même bâtiment ! Bon, quand je parle des liens, moi je deviens fou de rage. Récemment à une réunion avec des politiques, des élus, j’ai dit qu’on avait en Auvergne-Rhône-Alpes un pôle culturel parmi les plus intéressants. Il y a un Cefedem, il y a un CFMI, il y a un CNSMi, il y a des grandes écoles, il y a plein d’associations qui font des choses… Quel est le lien entre tout le monde, il n’y en a pas ! Moi j’ai signé une convention avec tout le monde, je suis un peu le mercenaire. Donc, il y en a un qui me dit : « Ah ! tu travailles avec eux ? Ah ! Tu ne dois pas travailler avec celui-là. Il faut travailler avec celui-là. » Mais moi je m’en fous. La réponse que je fais, c’est : « Quel est le parcours d’un citoyen qui vient, un jeune, citoyen, ou même moins jeune, qui vient s’inscrire ? » Comment on fait ? Et puis après certains politiques m’ont dit ce genre de conneries : « Oui, mais vous ne pouvez pas prendre des gens de tel endroit, parce que nous on finance cet endroit-là. » Eh bien, ils nous parlent de ne pas faire du communautarisme, mais ils en font un, une segmentation de l’espace. Concernant le Cra.p, j’ai entendu des choses inacceptables, qu’il fallait 100% de gens du coin, autrement on ne t’aide pas. Il y a des fractures comme ça. Pour ma part, je refuse d’aller m’implanter dans un quartier complètement à l’écart de tout, pour ne travailler qu’avec les gens du quartier. Ce serait pour moi une grossière erreur. Je préfère être ici dans ce quartier populaire et que les gens puissent venir de tous les côtés, parce qu’ils se déplacent, ils se rencontrent, et cela suscite des choses beaucoup plus intéressantes.
Cefedem pour Centre de Formation des Enseignants de la Musique (Cefedem Auvergne Rhône-Alpes, centre de ressources professionnelles et d’enseignement supérieur artistique de la musique).
CFMI pour Centre de Formation des Musiciens Intervenants à l’école.
CNSM(D) pour Conservatoire national supérieur de musique (et de danse).
Jean-Charles F. :
Merci Giacomo de tous ces échanges très fructueux.
Nicolas S. :
Et merci d’être autant entré dans les détails sur des activités et des réflexions qui restent la plupart du temps invisibles. C’est très intéressant et utile de les expliciter.
Listes des institutions mentionnées dans cet entretien
Cefedem AuRA, Centre de Formation des Enseignants de la Musique Auvergne Rhône-Alpes : Créé en 1990 par le Ministère de la Culture, le Cefedem AuRA est un centre de ressources professionnelles et d’enseignement supérieur artistique de la musique. Il forme au DE (Diplôme d’État) de « professeur de musique » dans les établissements d’enseignement spécialisé. Ce diplôme est équivalent à une Licence 3.
CFMI, Centre de Formation des Musiciens Intervenants à l’école : Rattaché à l’Université Lyon II, le CFMI de Lyon « accueille en formation des musicien·nes confirmé·es, aux parcours diversifiés, il leur propose différentes formations leur permettant ensuite de travailler dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle, et de l’action artistique auprès de différents publics, notamment dans les champs social et sanitaire ».
CNSMD, Conservatoire national supérieur de musique et de danse : enseignement supérieur spécialisé en musique et en danse. Il y a deux CNSMD en France, Paris et Lyon.
Cra.p, « Centre d’art – musiques urbaines/musiques électroniques » : centre basé à Lyon, créé en 1989 par Giacomo Spica Capobianco.
CRR, Conservatoire à Rayonnement Régional : voir par exemple celui de Lyon.
DRAC, Direction régionale des affaires culturelles : organisme représentant l’Etat en région, chargé de conduire la politique culturelle.
ENM de Villeurbanne : Fondée en 1980 par le compositeur Antoine Duhamel, l’École Nationale de Musique, Danse et Art Dramatique de Villeurbanne est réputée pour la diversité de son offre en musique (classique, contemporain, baroque, traditionnelles, jazz,chanson, rock et musiques amplifiées), en danse (africaine, baroque, contemporaine, hip-hop et orientale), et en théâtre. L’ENM de Villeurbanne est un Conservatoire à rayonnement départemental et est habilité à délivrer un DEM, Diplôme d’études musicales.
Grand Lyon : « La Métropole de Lyon est née le 1er janvier 2015 : c’est une collectivité territoriale unique en France créée par la fusion de la Communauté urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône sur les 59 communes qui composent le territoire du Grand Lyon. ». Elle compte environ 1,4 million d’habitants.
MJC, Maison des Jeunes et de la Culture : structure associative qui lie jeunesse et culture dans une perspective d’éducation populaire <fr.wikipedia>.
ONU, Orchestre National Urbain : ensemble créé en 2012 par Giacomo Spica Capobianco.
Préfecture : ce mot désigne les services de l’administration préfectorale à la tête desquels est placé un préfet, ainsi que le bâtiment qui les héberge. Voir par la Préfecture du Rhône.
SMAC : Le label SMAC « Scène de Musiques Actuelles » correspond, depuis 1998, au programme du Ministère de la Culture pour la valorisation et la diffusion des musiques actuelles. Un lieu avec un tel label a trois missions : la création-production-diffusion de concerts, l’accompagnement des pratiques musicales (professionnelles et amateures) et l’action culturelle.
Ville de Lyon : la municipalité de Lyon.