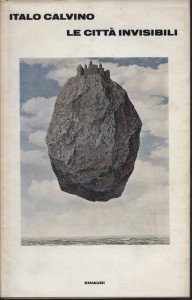Nomadic Collective Creation
As part of the “Biennale Hors Norme”, Lyon
September 15-23
At the Grandes Voisines,
Lyon Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse,
and Lyon II « Lumière » University,
Review of observations from workshops organized by
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
Texts by Joris Cintéro, Jean-Charles François
and
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne for Cra.p
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
and
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne for Cra.p
Translation from French by Jean-Charles François.
Summary :
Part I: The Projet of the Orchestre National Urbain « Nomadic Collective Creation »
1.1 The project of the Orchestre National Urbain
1.2 Period of Preparation of the Project
Part II : The Grandes Voisines
2.1 Workshops at the Grandes Voisines
2.2 The Collective Workshop « Sound Laboratory » at the Grandes Voisines
2.3 Cello/Painting Workshop at the Grandes Voisines
2.4 Trombone Workshop at the Grandes Voisines
Part III : The Project at the Lyon CNSMD
3.1 Meetings during the Project
3.2 The « Sound Laboratory » Workshop at the CNSMDL
3.3 The Human Beat-Box Workshop
3.4 Public Presentation of the Work in the Conservatorium Court yard.
3.5 Reviewing the project on October 10, 2023 at the Lyon CNSMD
Part IV : The Projet at Lyon II « Lumière » University
4.1 Morning of September 31 at Lyon II University
4.2 The Workshops at Lyon II University
4.3 The Workshop « Sound Laboratory » in the Lyon II University Amphitheatre
4.4 The Public Presentation of the Work at Lyon II « Lumière » University
Part V : The Aesthetic Framework of the Idea of Collective Creation
Conclusion
Part I : The projet of the Orchestre National Urbain,
“Nomadic Collective Creation”
In the following article, we describe in a deliberately personal account of how we perceived the process during the workshops organized by the “Orchestre National Urbain/Cra.p as part of the “Nomadic Collective Creation” project. This project took place on September 15-21, 2023, as part of the “Biennale Hors Norme” at the Grandes Voisines in Francheville near Lyon, the Lyon Conservatoire National Sipérieur de Musique et de Danse (CNSMD) and the Lyon II « Lumière » University. The Biennale Hors Norme takes place in Lyon every 2 years. The philosophy of that event is “to do with the other”.
Joris Cintéro’s account covers the period of preparation for the project and the day of September 15 at the Grandes Voisines. He describes his way of proceeding in this way:
As I took hardly any note that day (I attended explicitly in the spirit of participating), the following report is based essentially on my memories. Writing in this way allowed me to dig up these memories, alongside the photos and videos I took during the day – which also helped me to ‘recover’ my memory. This report therefore alternates between descriptions, contextualisation and snippets of analysis that need to be explored in greater depth.
Jean-Charles François’ report is based on a day spent at the Lyon CNSMD, on September 19 and two days at the Lyon II University, on September 21 and 22. It was compiled from observations (without participation in the activities) and note-taking.
In both cases, the reports alternate descriptions, contextualizations and analytical fragments that need to be explored in greater depth.
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne, members of the Orchestre National Urbain/Cra.p, provide some essential background information for understanding their approach.
Interspersed with the texts are extracts from a video realized by the Orchestre National Urbain/Cra.p team, featuring interviews with diverse participants and segments of the workshop proceedings.
1.1 The project of the Orchestre National Urbain
Jean-Charles François :
The “Nomadic Collective Creation” project was developed by Giacomo Spica Capobianco, for the Hors Norme 2023 Biennial. Giacomo is the artistic director of Centre d’art – Musiques urbaines – Musiques électroniques (Cra.p) [Art center – Urban Music – Electronic Music], which he founded over thirty years ago. According to its website “The CRA.P team aims to exchange knowledge and know-how in the domain of urban and electro music, to cross aesthetics and practices, to generate encounters, to invent new forms, to create artistic clashes, and to give people means to express themselves.” (Cra.p). The project has been developed in collaboration with the members of the Orchestre National Urbain, the FEM team directed by Karine Hahn, “Formation à l’Enseignement de la Musique” (Music teachers training) as part of the Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL – FEM), and with visual artist Guy Dallevet for the Hors Norme Biennial.(BHN).
The description of the project by its organizers can be summarized in several elements regrouped in a scheme aimed in a general way at getting very different groups of people to work collectively to produce music, dance and painting:
- Three axes of mediation are here combined: a) invite in the same space very different social groups; b) invite in the same space people who can be qualified to call themselves “artists” (conservatory students) with people who, a priori, have no recognized skills in this domain; c) invite in the same space practices in different artistic domains (music, dance, theatre, visual arts, poetry).
- The encounters are based on immediate artistic practices, making music, making dance, making painting. To ensure that this common practice does not give one group an advantage over another, the encounters are organized in such a way that everyone will have to be confronted with tasks that are completely new to them, as for example playing trombone for the first time in your life, or dancing if you’re a musician.
- The project is structured in a series of workshops led by members of the Orchestre National Urbain:
Sébastien Leborgne (Lucien 16’s), beat box and spoken voice.
Rudy Badstuber Rodriguez, MAO and percussion elements.
Selim Penaranda, cello.
Odenson Laurent, trombone.
Sabrina Boukhenous, body movements.
Clément Bres, drums.
Giacomo Spica Capobianco, Sound Laboratoire, a workshop regrouping after the other workshops all their activities, in the perspectives of collective creation.
The painting workshop are led by Guy Dallevet for the Hors Norme Biennial.
The common thread running through these very different workshops (except painting) in terms of material manipulations, is made of a series of color codes defining playing modes:
a) orange = strong wind ;
b) white = gradual slowing down ;
c) red = repeated rhythm (three quarter notes and a rest);
d) brown = 8 regular pulsations;
e) black = freeze, silence;
f) blue = fear, shivering, energy;
g) green = free improvisation.
The various effective practices in different workshops are all based on the exploration of these color codes.
- Another important activity initiated by the Orchestre National Urbain, is the writing of personal texts to be spoken (in precise rhythms or freely) when all the elements from the workshops meet on stage.
- All participants follow all the workshops one after another, and then everybody meet in a general ensemble with the following stations: trombone, cello, amplified voice, drum set, various suspended sounding objects, 2 electronic stations (loops, playing with fingers on a pad), a “spicaphone” (a kind of electric guitar with a single string built by Giacomo Spica), an instrument with strings stretched on a metal frame (called « sound mirror »), an electric guitar set up horizontally to be played like a percussion instrument, a space for dance. A conductor is chosen among the participants to organize the performance, showing along the way color-coded cards. In Giacomo’s mind, this is not the equivalent of “sound painting”, the conductor must only show the color without imposing any particular energy. Experience with the set-up has shown that, in practice, the people conducting (members of the Orchestre National Urbain as well as any other participants) often exert a “particular energy” – bending down to embody a soft intensity, to play at changing the color-code cartons very quickly, ensuring that only one part of the ensemble be concerned with a color-code, etc.)
- At a given moment, in the institution where the workshops take place, a general restitution of the work accomplished is presented to an outside audience (this happened at the CNSMDL at the end of two days of work, and at the Lyon II University also after two days of work). At the university, this restitution was followed by a concert by the Orchestre National Urbain.
The specific project linked to the Hors Norme Biennial took place at three different sites:
- September 15-16, 2023, at the Grandes Voisines, in Francheville near Lyon. This institution described itself on its website as “a social, interactive and solidarity-based place where you can sleep, eat, work, paint, discover an art exhibition, take part in a choir… and experience encounters.” (Les Grandes Voisines). This accommodation facility is a place where refugees can stay awaiting regularization. It’s this particular group of people that was targeted during these two days of practice.
- September 18-19, 2023, at the Lyon CNSMD, department of the music teachers training program [FEM: Formation à l’Enseignement de la Musique]. Two days of workshops designed as encounters through practices between the Conservatory students and the refugees staying at Grandes Voisines, with a public presentation of the work at the end of the second day.
- September 20-21, 2003, at University Lumière Lyon II, workshops with refugees, and students from the university and the conservatory (on a voluntary basis), with a public presentation of the work at the end of the second day, followed by a concert by the Orchestre National Urbain.
1.2 Period of Preparation of the Project
Joris Cintéro :
As I write these lines, I can’t quite remember clearly the circumstances in which I was first introduced to the device. All I remember is a few snippets of discussion with Karine Hahn describing a « project we’re involved in with the CRA.P », the first stage of which is taking place « in Francheville [a suburb of Lyon], in a refugee home center », and that « the students have been kept informed » for a long time. I have memories of the objectives that were set for students through a device like this, particularly at Grandes-Voisines.
I remember the objectives that were set for the students through such a device, particularly at Les Grandes-Voisines: meeting with an otherness that we assume is not common in the ordinary course of their work as teacher-musicians, creating musical moments designed to invite an audience unfamiliar with the traditions of so-called Western art music, adapting to circumstances that are hardly conducive to artistic education, and, of course, taking a step back from social and political issues involved in artistic education.
A few days before the first session at Les Grandes Voisines [GV], Karine reminded the students of the Education Department about the project. After a group discussion in class with the students, we asked them about the possibility of going to Les Grandes Voisines on Friday and/or Saturday, we realised that very few of them were available/motivated to come with us on those days. Only one first-year student (Grégoire) was available, whom we didn’t know very well at the time – the course had only been running for a week. Almost all of the other students told us that they were busy or that they would have liked to come but hadn’t received the information in time.
We also stressed the need for students wishing to come to bring instruments that could be handled by children – I remember awkwardly insisting on this, suggesting that it was only a question of working with children and that they would be particularly careless. The students’ answers led us to discover that very few of them had several musical instruments.
Part II : The Nomadic Collective Creation at the Grandes Voisines
2.1 Workshops at the Grandes Voisines
Joris Cintéro :
On Saturday September 16, 2023, after collecting an old classical guitar at home and Karine’s electric harp from Villeurbanne School of Music, we both drove to the Grandes Voisines, arriving mid-afternoon, around 3.30 pm. Karine parked in the entrance car park, a stone’s throw from a sort of faded (empty?) gatehouse used to monitor comings and goings at the home centre. It’s a bit far from where the workshops are taking place (it has to be said that the signage wasn’t very clear and there’s nothing on the outside to announce the Biennale Hors-Normes). After a short phone call, Giacomo beckons us to approach from afar and welcomed us.
I meet the various members of the Orchestre National Urbain for the first time, as they emerge from a room housing various instruments. Giacomo takes us on a quick ‘critical’ tour of the premises. We discover a maze of rooms, doors and corridors, and are quickly briefed on the organization of the premises. Indeed, Giacomo is already familiar with the place (the Orchestre National Urbain has already been involved in the premises) and has experienced tensions with some of the people working there. During the visit, I quickly understand that there are communication difficulties between the protagonists (and their respective institutions) regarding the management of the site, and that some of the artists present at the Biennale Hors-Normes [BHN] are not ‘on the same wavelength’ as Giacomo.
I have the impression of a labyrinthine place that struggles to hide the stigma of its former use (as a hospital for the elderly). Although some corridors are lined with paintings and works of art of all kinds, and some exterior points suggest artistic activity (sculptures etc.), the place exudes a certain coldness (neon lights, false ceilings, greyish paint, cracked tiles etc.) typical of administrative buildings, retirement homes or even hospitals. Some rooms appear a little gloomy and smell of damp – such as the concert hall on the building’s first floor, which stands in place of the building’s former chapel. To add to this impression, Giacomo will add during the visit that autopsy tables are still present in the building’s basements. In the distance, we see a soccer stadium, the use of which in a geriatric hospital is hard to understand, and posters showing an installation to be held there. I’m struck at this point by the ‘waltz’ of keys that accompanies this visit, a sensation probably due to Giacomo’s annoyance at the need to lock up behind oneself “just in case”, “because some refugees don’t hesitate to help themselves”, or because the equipment cannot be supervised in our absence (and that of the Orchestre National Urbain members running the workshops).
After a good fifteen minutes’ walk around the site to find out where the various workshops were taking place, we’re back to where we started, under the sort of Barnum where the Orchestre National Urbain team had welcomed us earlier. It was quite warm, and Grégoire, the only student from the CNSMDL that day, had just arrived.
Once the visit was over, in the middle of a sentence, Giacomo mentioned the major difficulty of the afternoon, which we soon noticed: no one had signed up to take part in the workshops. According to him, this was due to the fact that the social workers working at the venue had not passed on the information to the venue’s users (we didn’t see any posters during the visit and we met people working at the venue who weren’t aware that music workshops were being held), a lack of communication that could itself be explained by a falling out between the BHN’s project leaders and the venue’s organisation – the details of which we would later learn. So the day began without any children or adults, apart from Omet – a user of the venue who was not initially presented/categorised as a beneficiary of the device but rather as a full member of the activity.
In the absence of an audience, the members of the Orchestre National Urbain don’t give up and invited Karine, Grégoire, Omet and myself to start playing with them in the collective sound workshop.
2.2 The Collective Workshop « Sound Laboratory » at the Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Giacomo presents a collective musical workshop similar to the group workshops later offered at the CNSMDL and the Lyon II “Lumière” University. It consists of a collective improvisation directed by a conductor, officiating only through a set of coloured cards indicating particular musical intentions to guide the improvising group.
The instruments are as follow:
– ‘Urban lutherie’ instruments : Spicaphone / Mirror-Harp [amplified]
– Electronic Instruments: (Korg monotribe/Kaosspad/Roland SP 404SX/MicroKorg)
– Effect pedals (Whammy with Spicaphone)
– Microphone [amplified]
– Acoustic instruments (Snare drum, electric guitar, “Chinese chopsticks” as drumsticks)
The console and the various cables used to amplify the instruments are not used as playing aids in the system.
The set of cards includes 7 colours associated with the conventions already mentioned above: In addition to this ‘colour coding’, the sound volume of the improvising group can be varied by means of a signal.
On this day, the instruments are arranged around the conductor (he or she). The workshop took place in a large room with green linoleum and several bay windows (some blacked out with curtains), giving direct access to the outside – allowing passers-by to see (and incidentally hear) what was going on. Although it is not, so to speak, central to the architecture of the home centre, this room is nevertheless in the path of pedestrians and cars and overlooks several other buildings – which will be important for the rest of the day.
The workshop began with an explanation from Giacomo, who presented the various aspects, emphasising the colour code and the objectives (working on the sound, freeing up any inhibitions, creating a space of equality between musicians and non-musicians, etc.). As I was involved throughout, I don’t know exactly how long each improvisation lasted. The only thing I do know is that the improvisation rounds stopped once everyone had conducted at least once – some repeating the exercise several times.
The workshop begins. Everyone seemed to enjoy playing the game. The comments made by those attending related mainly to the difficulty of remembering in the moment the conventions associated with the coloured cards (I had to wait until the 4th or 5th round to align myself ‘correctly’ with the cards), the nuances suggested by the conductor and the pleasure of playing on ‘exotic’ instruments (the mirror harp and the spicaphone in particular). Almost every workshop ‘round’ ended with a discussion of what had just taken place, mainly on musical issues (the conductor’s intention, nuances, etc.). The first few workshops went ‘very well’ insofar as it seemed to me that most of the participants were used to the exercise.
During the improvisations, we can see some groups of adults, children and parents, sometimes pass by, some discreetly approaching the auditorium – most pretending not to be seen. It was amid this flow of passers-by that a man in his early forties joined us, accompanied by his 5-year-old daughter. Rather reserved, he said from the start that he had come ‘for his daughter’, who seemed particularly happy and cheerful when the members of the Orchestre National Urbain invited him to join in the collective improvisation. The child took part in several ‘rounds’ of the workshop accompanied by various participants (who sat her on a chair so that she could play on the Microkorg, for example, or reframed her game in relation to the coloured cards) and the father took on the role of leader once – as well as taking part in a few rounds of the workshop himself. Initially reluctant to take part (he was only going to watch his daughter), he joined us at Giacomo’s request and gradually ‘relaxed’, without showing however any sign of letting go (which I interpreted as the fact that the participants were fully committed to the game and were sometimes overwhelmed by it). Both left the room after several rounds of workshops, clearly happy to have been there.
Once the auditorium was closed, we moved on to the adjacent room, where a cello improvisation and painting workshop was being held.
2.3 Cello/Painting Workshop at the Grandes Voisines
Karine Hahn, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (11’19”- 11’44”)
Joris Cintéro :
The cello-painting workshop was run by Selim Penaranda (cello) and a person (painting) whose name I have forgotten (I would later learn that she was replacing Guy Dallevet, who was absent that day). It takes place in a room that is large but rather cluttered with cardboard boxes, paintings, sculptures and various objects.
The workshop was organized quite simply. On one side we have Selim with 3 cellos (1 acoustic and two amplified electric) and on the other the painter with a set of sheets of paper, acrylic paint, cardboard boxes to spread it out on and protective clothing that is visibly worn – the room seems to be used very often for activities of this kind, as can be seen from the numerous paintings on the walls and the paint stains in the sink. In the same spirit as the productions that would follow for the rest of the week, this device involved interaction between the groups who were painting and the groups who were playing the cello. The workshop ends with individual cello improvisations based on a support painted by the performer.
Lucien 16’s (Sébastien Leborgne) on the relationships between music and painting, extract from video “Biennale Hors Normes” (3’48”-4’48”)
The cello activity led by Selim is always organised in the same way.
1. Presentation of the instrument and the device.
2. Experimenting with the instrument.
3. Directed improvisation with color code. This activity requires at least two people
to play (sometimes including Selim) and one to conduct.
Selim first introduces the cello by playing a few notes and repeatedly stressing that there is no one right position for playing it, that the most important thing is to feel at ease while playing. In this sense, he does not hesitate to show positions that could be described as heterodox in relation to the common representation of cello playing, which is associated with a so-called ‘classical’ position (the instrument is held between the legs, the feet on the ground, the neck of the instrument resting on the shoulder). He deliberately places his feet on the edges of the cello, showing that it is possible to play it in this way. The same goes for the bow, which he suggests holding in several different ways, emphasizing, as he would later do at the CNSMDL, that “it can be held like a doorknob”. He did not, however, prevent participants from holding the instrument and the bow in the ‘conventional’ way. Once this introductory ‘ritual’ has been completed, he lets the participants explore on the cello while introducing the rest of the workshop, which consists of an improvisation with another participant.
The person ‘conducting’ during the workshop changes as the workshop progresses. The code used is the same as in the previous workshop.
On the other side of the studio, the painting is organised in an equally recurring fashion. The supervisor presents the task in hand, i.e. to paint a canvas while soaking up the sounds created by the cellists, using a piece of cardboard to create, as the supervisor shows, multi-colored circular shapes. Basically, you pour a few drops of paint (one or more colors) onto the canvas and use the cardboard support to spread the paint over a sheet of paper, creating spirals of some kind.
The link between the two parts of the workshop doesn’t seem to be obvious to everyone, as evidenced by the fact that during a break in the cello when I was looking at the other part of the studio, some of the painters paid no attention to the music (which isn’t always true, since overly long silences sometimes lead painters to grumble gently about the absence of music for painting). I take a few photos of the studio.
The workshop ends with a series of individual improvisations on the cello, based on a visual support, i.e. the painting created earlier in the workshop. None of the local residents will be joining us during the workshop. We decided to take a break after a short hour of collective work.
Cello and painting workshop at the Grandes Voisines, extract from video “Biennale Hors Normes” (5’45”-12’28”)
2.4 Trombone Workshop at the Grandes Voisines
Joris Cintéro :
The break offers an opportunity for some of us to light up a cigarette, drink a little water and have a general discussion about the facilities on offer and the lack of an audience. Although the atmosphere is very friendly, I can still feel some disappointment among some Orchestre National Urbain members. I also said to myself at the time that mobilizing so many people over two days for such a small audience was a considerable waste of time and money. We talked a bit about the venue, its shortcomings (the inhabitants are said to be housed by ‘ethnic group’) and the fact that, apart from its hospitable aesthetic, they don’t seem to be all that badly received. Mention was made of the existence of a building dedicated to single women, a group that, according to Giacomo, is difficult to invite to activities because they have been through traumatic migratory experiences. Everyone had their own little anecdote, especially those who already knew the place.
As the afternoon wore on, Odenson Laurent, a young member of the Orchestre National Urbain, played a few notes on his trombone. These notes had the effect of a call. Several children approached us, shyly at first and then more directly. They want to play and let us know. Giacomo and Sébastien rush to retrieve the trombones they had stored in a room in the building. The scene gives the impression that we’ve been taken by surprise, that the ‘public’ is finally pouring in, and that we mustn’t miss the boat.
The trombone cases arrive and are hastily placed on the floor. It’s an interesting moment in that we all (the participants from the previous workshops) gradually begin to ‘frame’ the workshop as it takes shape. Here we disinfect the trombone mouthpieces with alcohol, there we show a child how to grab and hold a trombone, and next door we keep those waiting for their turn waiting.
Trombone workshop at the Grandes Voisines, extract from video « Biennale Hors Normes » (0’23”-0’56”)
Odenson takes control of the workshop, spoke loudly (it had to be said that the children were numerous and in a hurry to play) and showed them how to blow into the mouthpiece of the trombone. Most of the children succeed. He suggested a series of exercises/games where the first thing to do was to blow hard once. The children did this successfully, laughing and trying again without waiting for Odenson’s invitation. The volume increased rapidly, and the children seemed to enjoy the activity. Odenson then suggested playing with the slide. Some of the children dropped the slide (it must be said that in some cases the trombones were as big as those playing them), which led to laughter from the others and impatience from those waiting their turn – some then came to the aid of their friends by holding the slide. The children clearly seem very happy with the experience they have just had. New faces appear: several women start to arrive, some leaning over the balconies to see what’s going on.
Same again, the mouthpieces are cleaned, the children are given a few pointers on how to hold the trombone (each one offers a bit of advice), those who will be coming next are made to wait, and the women who have just arrived are invited to try out the experiment. Karine, for example, was asked to convince a local woman to join in the exercise, which she managed to do.
It’s interesting to note that although, apart from Odenson, no one ‘plays’ the trombone (or at least no one categorizes themselves as a ‘trombonist’), everyone takes the liberty of showing the children how to blow into the mouthpiece, how to make the lip movement that allows them to do so, or how to hold the instrument – for example in the interval to those who are waiting or directly to those who are taking part in the workshop.
After several rounds, the workshop stops, and the Orchestre National Urbain members talk to the women and children present to tell them about the next day and the continuation of the workshops.
Photos of Grandes Voisines, extract from video “Biennale Hors Normes” (2’37”-3’33”)
Part III : The Project at the Lyon CNSMD
3.1 Meetings during the Project
Jean-Charles François :
The staff of the Orchestre National Urbain usually meets in the morning before the start of the workshops in order to (re-)define the content of the day, taking into account precedent actions.
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne :
First phase, “Team meeting”:
The artistic director (Giacomo Spica Capobianco) reviews the current project with all the artists working with the Orchestre National Urbain. These meetings are an opportunity to evaluate the workshops as a group, in order to ensure that the project continues to evolve. These moments of discussion allow us to exchange on evolutions, constraints and difficulties encountered.
Preliminary to a program proposition for the day, a discussion takes place to enable us to adapt to situations encountered on a day-to-day basis.
Second phase: “Meeting of the team with workshop participants”:
Each morning, a time is scheduled for discussion with all workshop participants.
Obviously, this moment is important, given that no prior selection level is required, both technically and socially, the participants are expected to work collectively.
It’s important that the ones go towards the others for a more constructive encounter leading to elaborating an improbable creation.
The point is to convey to participants that they are at the service of the project within of a collective creation.
All the workshops are filmed.
It’s important to have a video support of each workshop so that all members of the Orchestre national Urbain team can discover each other’s work. This allows the project to evolve.
Jean-Charles François :
For example, here’s the description of such a meeting, which took place on the second day of workshops at the CNSMDL, the morning of September 19, 2023. This meeting brought together the Orchestre National Urbain team, and the CNSMDL-FEM team.
Giacomo Spica Capobianco reports on problems encountered at the Grandes Voisines. The venue of the Orchestre National Urbain had not been properly prepared by the supervising staff of the center. It seems that no information reached the intended public, therefore it was necessary for the members of the orchestra to start playing in the courtyard, to welcome the people passing by and invite them to participate. During this process, it was mainly children and mothers of these children who participated. As a result, only one refugee was allowed to come to encounter the CNSMD students. Giacomo sums up the objectives of the day, which are to give the students the opportunity to take charge on their own with working elements that are new to them. This is why they are not allowed to use their own instruments. For Giacomo, we’re not there to dictate behavior, but to create situations of collegial research with a view to projecting ourselves in practices accessible to any audience.
3.2 The « Sound Laboratory » Workshop at the CNSMDLL
Jean-Charles François :
The morning session (September 19) takes place in a large chamber music space with a stage. The stage is organized with a series of instrumental stations (standard instruments, simple built instruments, electronic instruments, amplified voice) as describe above. A floor space outside the stage is devoted to dance. Students are divided in three groups. The people who don’t participate to the performance of a group, are sitting on the floor or on chairs outside the two performance spaces.
The session starts by a 10-minute body warm-up led by Sabrina Boukhenous. She is a member of the Orchestre National Urbain, an actress, stage director, and sound and lighting technician. Her role in the Orchestre is to take charge of body movement and spoken word. The warm-up takes place for everyone in an atmosphere of good humor and pleasure of doing: rubbing hands, breathing exercises, activating different parts of the body, jumping, etc.
Concerning Sabrina Boukhenous’s “Body and movements” workshops, here is an extract taken during a similar project of the Orchestre National Urbain that tool place at the University Lyon III in 2024: valid.
Sound Laboratory at the CNSMDL, extract from video “Biennale Hors Normes” (17’25”-18’42”)
One of the specific aspects of the setup is the presence of texts written during the workshops and read aloud by each student through a microphone placed on stage. According to the instructions given by Giacomo, the voice doesn’t have to follow the color codes, but unfolds its flow as a solo, according to the choice made by the person who speaks. The main difficulty is for the audience to be able to hear the spoken voice clearly, whether the protagonists are unfamiliar with the microphone, lack confidence or energy, or whether the sound level of the ensemble is too loud, since looking at the code-colored cards may not allow immediate listening of what others are doing. Giacomo, fairly early during the session, demonstrated with the microphone how the voice can be used more effectively. During the performance period of the third group, at one point, it was decided not to use the code-colored cards, but to rely solely on the solo voice with the need to be able to understand the text: the voice here replaces the conductor. After trying out this idea, a short discussion took place on improvisation notions: the necessity of listening to others, the question of reacting to ongoing energies and to other proposals, the idea to let others be at the forefront, especially in case of the presence of a text. At the end of this first part of the morning, a situation was experimented involving three vocalists reading their text.
The presence of texts give raise several times (notably on the part of Giacomo) the question of physical commitment and the meaning you have to convey reading the text. Of course, it’s difficult to make an immediate engagement in an activity you’re doing for the first time, when you don’t know where it’s going to lead. But the difficulty of commitment on the part of the students also stems from the fact that they don’t automatically (yet) subscribe to something too far removed from the aesthetic values that are promoted on a daily basis at the conservatory. The behaviors induced by European high art music written on scores imply on the one hand, a deep commitment on the part of the composers in their aesthetic projects, and on the other hand, an assumed detachment on the part of the performers who should be ready to play a diversity of aesthetics. We could say that, in this context, the performer’s engagement is only manifest when playing in public, in an attitude close to the theatre actor where the proper commitment is “played”. In this context, you are not accustomed to throwing yourselves heart and soul into any type of activity, without taking time to reflect on the matter, the aesthetic content is therefore not a commitment but a play. The commitment of the performers of the so-called “classical” sector is turned above all towards the manner to approach sound production, and in this way their principal identity is focused on their own instrument or voice. The body of the Western human being tends to be disconnected from meaning, having to construct meaning according to contexts, with the risk therefore of missing out on a more fundamental state in which the body assumes and believes in its own production of meaning. As it happens, there exist a great deal of musical (and dance) practices where the performers’ commitment is not separated from conditions of production, and where meaning is fundamental from the outset, that is at every level of ability. This is particularly the case with the musical practices of the Orchestre National Urbain and within the actions that it carries out in underprivileged neighborhoods.
Some students have decided to be present to the sessions, but not to take part in the proposed practices, and to be there as observers. This is a tiny minority, 2 or 3 among the 50 or so persons present. Giacomo had made it clear that this attitude was possible, that there was no obligation to participate in the action. Yet, one of them decided suddenly to join the active group, when improvisations without conductor and coded colors were tried, with the text or the dance now the elements to be followed. He took the electric guitar (that was set-up horizontally), tuned it in the standard way, and played it with the usual guitar-playing position.
For dance, the term of “body movements” is often used to emphasize that on the one hand, these are free movements in space, and, on the other hand, that there is no artistic ambition with technical implications that could prevent the immediate participation of any person present. At the beginning of the group 1 performance, there is no dance, then gradually it takes greater importance. It soon became clear that the conductor needed to see the dance (as well as listen to the instruments) to influence the decisions on color changes. With the group 3 (after the experimentation to follow the text) it was decided that the musicians should be influenced by the dance rather than following the color codes. As in the case of the text, this trial provoked a discussion on the relationships between dance and music, raising questions on mirror imitation, on the conditions for the musicians to follow collectively the dance, on the risk of of one artistic domain dominating another, and on the need for communication to circulate. An idea is proposed: an improvisation in which all these working axes are mingled.
Concerning the presence of a conductor with the color-coded cards, the reality of actual practice raises a number of questions. One important aspect is that, for each new sequence of play, there is a new conductor, therefore there is no danger of developing conducting “specialists”, and there is a democratic distribution of the different roles. But it is precisely this particular set-up that tends to reinforce the general representation that the people present have of the dominating power of the orchestra conductor. Therefore, the who assume this role have a tendency to over-invest the power that is given to them: it’s not just a question of showing color-coded cards, and indicating loudness levels, but it involves exaggerated body attitudes to pass on information to the instrumentalists to ensure that they are respected, and we soon find ourselves in a situation similar to “sound painting”. This over-investment on and of the conductor results in the domination of the eye over the ear: having to look constantly at the conductor prevents the focus on listening to both one’s own sound production and that of the others.
The oral-written duality is a very important element at play in the context of the CNSMD and the musical forms that define its contours. But what is at stake in this context is very different when it comes to immediate access to musical artistic practices for anyone (whatever their skill level and social background). In this case, very precise mechanisms need to be invented in order to achieve convincing results. Towards the end of the first part of the morning, Giacomo reminded us the pedagogical nature of the work in progress: the difficulty lies in doing things in depressed cultural contexts or when people of different cultures meet. How to build activities that from the beginning offer the possibility of confronting fundamental issues, but in accessible manner, how allowing people to construct their own meaningful situations. Accessing active participation comes first at the outset takes precedence over any consideration of artistic quality or of standardized behavior. The coded-color cards and the presence of a conductor that manipulate them to give form to the performance ensure in all contexts a rapid access to an effective practice, in which the artistic stakes are not at all resolved yet are already inscribed in the content of the action.
3.3 The Human Beat-Box Workshop
Joris Cintéro :
The day of September 16 (at the Grades Voisines) ends with the workshop let by Sebastien Leborgne (Lucien 16), which focuses on « Human Beatbox ». Sébastien is a member of the Orchestre National Urbain, and a rap, spoken word artist.
The workshop takes place in a room inside the building. The room is particularly small and is in the passageway of a corridor, opposite several lifts: there is quite a bit of traffic.
The workshop requires very little equipment: a few sheets of paper, a console, a looper, a microphone and a loudspeaker to amplify it all.
Sébastien describes his workshop. He begins by explaining the principle of Human Beatbox. To do this, he draws several instruments on a sheet of paper. We see a bass drum, a snare drum and a hi-hat cymbal. He directly demonstrates the sound that can be associated with each of the elements drawn on the sheet. He then puts his words into practice by recording a beatbox loop.
He then asked the workshop participants (who were mainly members of the Orchestre National Urbain and the CNSMDL) to make a loop themselves. During the workshops, a group of 3 children stopped to listen to what was going on. Sébastien invites them to give a try themselves at producing a loop with the looper. The children laughed, seemed embarrassed, but went ahead nonetheless. He took the opportunity to ask them if they were available the next day to take part in the workshop. This workshop took place in a particularly limited amount of time compared to the preceding ones. It shows the versatility of the system put together by the members of the Orchestre National Urbain – as well as explicitly the difficulties to which the collective has to face on a regular basis.
Jean-Charles François :
During the second part of the morning of September 19 (at the CNSMDL), I attended a “Human Beatbox” workshop led by Sébastien Leborgne (Lucien 16’s).
The technical set-up of the CNSMD studio consists in a microphone to amplify the soloist’s voice, with a sampling machine for making loops of vocal sounds, to create repetitive rhythms with the possibility of superimposing vocal sound samples. Several microphones are available to record several voices at the same time.
The introduction by Sébastien defines the context of rhythm production through vocal imitation of drum set sounds (beat box) over which a text can be spoken.
The first experimentation concerns the imitation of bass drum sounds, of charley, of snare drum with the voice, and to record them to form a loop. A loop is created over which the participants can add another vocal production to form a new composite loop.
The following situation, as defined by Sébastien, involves a) creating a rhythmic loop with 4 vocalists; b) then the soloist places the text on this rhythmic structure. Sébastien says that the students should do this task on their own autonomous way, he is only there to answer questions they might have. Creating the loop is quite easy, without much time at hand to try several examples. Adding a text to the invented loop poses more of a problem, as the participants read their text without any rhythmic inflections, independently to the content of the rhythmic loop. Sébastien suggests that the loop accompanying the Human Beat box should fit the text and not the other way round: “since this text is a dream,” the loop should reflect this mood.
A new attempt to create a beat box loop with five superimposed voices is made. A student speaks her text over the loop. She tries to connect her text to the rhythm character of the beat box. Sébastien remarks that what is principally at stake is not for the spoken voice to correspond to the rhythm of the loop, but to “impose yourself on the rhythm of the loop”. The spoken word doesn’t have to comply to the basic rhythm but should be guided by the right and true emotion. The student tries again to read her text over the loop but stops fairly quickly.
Someone asks if it’s possible to sing the text. Sébastien answers: “you can do what you want.” A student tries then to speak her text and to sing part of it.
Observing this workshop, it appears clearly that the main challenge that the students of the CNSMD have to face in this project lies in this very new activity for them of having to write a text and, above all, speak it with a rhythmic accompaniment.
Human beat box workshop at the CNSMDL, extract from video “Biennale Hors Normes” (13’25”-14’29”)
3.4 Public Presentation of the Work in the Conservatorium Courtyard.
Jean-Charles François :
In the afternoon of September 19, a public presentation of what had been done in the workshops was proposed to the CNSMD community at large in the courtyard next to the main concert hall. An amplification system had been installed and the space was organized in the same way as in the Chamber Music space, a combination of instruments grouped around a solo voice, a space for the dance, and the paintings exhibited on the floor. The public (sparse, apart from the participants themselves) was sitting on the steps leading to the concert hall building.
The three groups of the workshops present performances in which there are musicians and dancers, often with a change of role in the middle. In the attitude of the performers, there’s a compensatory effect, since the production, still too experimental doesn’t correspond to the criteria of artistic excellence prevailing at the CNSMD. Seemingly, they have to show, a) the pleasure of doing an unconventional activity; b) stressing the energetic aspect of the experience; c) showing that it’s an entertainment situation in which one can be content to be only half committed; and d) sometimes bringing out the ironic character in relation to an uncomfortable situation. However, there is no aggressivity in these attitudes towards what has been proposed, but rather a problem of positioning towards the community in which the public presentation is offered.
In the Group 2, a conductor, very much like a “composer”, develops a form that stages elements in a sort of narrative that allows the text to emerge. Thanks to this “in house” know-how, we’re closer to what might eventually be accepted by the institution as artistically valid.
Public presentation in the CNSMDL courtyard, extract from video “Biennale Hors Normes” (20’35”-22’46”)
At one point during the performance, a CNSMD professor came in the courtyard to demonstrate her vehement disagreement with what was going on, and in particular with the sound level of the amplification, which prevented her from teaching.
Outside the FEM staff as partners of the project, no representatives of the CNSMD directorate were present during this presentation. Yet, the director is very much in favor of the development of this type of projects.
3.5 Reviewing the project on October 10, 2023 at the Lyon CNSMD
Jean-Charles François :
Une journée de bilan du projet a été organisée au CNSMD de Lyon avec les personnes qui ont participé en tant qu’encadrants du projet et les étudiants de la FEM.
A) Réunion de bilan des encadrants de l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et du CNSMD de Lyon
The morning started with a meeting of the Cra.p and CNSMD staff, during which the students met separately in small groups of 4 or 5 to prepare what they wanted to convey at the general assessment session that followed. Were present at the staff meeting: for the Cra.p, Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne; for the FEM (CNSMDL), Karine Hahn, Joris Cintero and Guillaume Le Dréau; and myself, Jean-Charles François as outside observer.
Here are some of the ideas expressed at the meeting:
- What are the formative aspects for the students and through what issues?
- What is at stake in this project?
- Thinking the aftermath of the project: other types of collaborations between the orchestre National Urbain/Cra.p and the FEM?
The students had to confront musical issues in a practical way, thought out in continuity with social and political contexts. They had to manipulate and fabricate sounds in transversal and transdisciplinary situations, that is confront unknown musical materials, consider practices involving simultaneously several artistic domains, and encounter cultures different from their social and artistic environment. Their aesthetic concepts were challenged by these various approaches. The pedagogical aspects of the project emphasized on experimentating with musical practices open to all whatever their skill level, and on the inventing ways designed to encounter otherness. The two essential questions were: how to make music together with any public? And what is exactly involved in developing projects in specific places and circumstances?
Two critical reflections emerge during the meeting:
- The problem of the plethora of labels prevalent in each cultural milieu, which classify any practices once and for all, either to acclaim them, or more often to consider them as unworthy of interest, or else to rationalize them in order to better control them in the dominant order of things. How in transversal and trans-aesthetics encounters can we envision situations in which a certain indeterminacy of materials will enable new aesthetic grounds to emerge, common to the diversities present?
- The problem of the intellectual and artistic tourism is prevalent today in many higher education programs in the name of access to the world’s diversity. Experiences giving access to this diversity are multiplying in study programs with not enough time at hand to go in-depth into each of them. Cultural enrichment often goes hand in hand with a misunderstanding of the major issues at stake in the various practices. How within the limited time allotted to face this difficulty?
The Orchestre National Urbain offers the permanent possibility for anyone to follow a “tutoring program”, open to particular requests for training and project development.
B) Assessment with the CNSMD students
Each group of students presents their conclusions in turn. The group of students who also attended the Lyon II University sessions will speak last. In general, the feedback is for a large majority very positive: the artistic, social, and political objectives of this kind of action are well understood and the practices have been experienced in meaningful ways. Here are the different elements that were expressed:
- The idea of desacralizing the musical instrument. The instrument is no longer considered as a specialized entity, but rather as an object like any other capable of producing sounds. The fact that everyone has immediate access of to sound production means that all the issues at stake in musical practice can be put into practice, whether in terms of technical modes of production or of artistic issues. The need to make music with materials that are not mastered at first, enables to break away from the logic of expertise and puts all participants at the same level of competency. For one of the students, this approach is close to the Art Brut and Fluxus. This should enable effective encounters between participants of different cultural backgrounds. The tinkered instruments (or tinkering instruments) opens up a different way of considering sound matter, timbre, and the use of sounds generally considered as outside the musical realm.
- The declamation of a text accompanied by instruments. This aspect is certainly the most difficult to achieve for specialists of instrumental music. The “Human Beatbox” workshop was experienced as the activity that best opened the way to inventing sound materials through the realization of simple rhythms.
- Improvisation stemming from guidelines easy to follow. This is what makes it possible to become master of one’s own production. It’s an effective way to approach improvisation in an uninhibited manner. It opens the way to a dynamic of immediate sound production separated from preoccupations with playing only what is completely mastered.
- The realm of amplification is what the CNSMDL students are least familiar with. This first approach is much appreciated.
- The role of conductor: you have to dare to assume this role in order to control the general form of an improvisation, from the perspective of building an instant composition. For some students the presence of a conductor is an obstacle to improvisation, which implies individual responsibility and requires a less urgent temporality for dialogs to take place, without relying on the authority of a conductor.
- The idea of doing things immediately before any reflection is an important element of the practices proposed. There’s an urgency to do things without asking questions, to do what is not yet mastered before considering the means to achieve it.
- An important aspect of the project is to encourage audience participation, as happened at the end of the concert by the Orchestre National Urbain when everyone started dancing in the University amphitheater.
Among the problems raised by the project, some students noted a time organization that sometimes seemed too slow, and at other times too short. Boredom or frustration are at the root of a certain fatigue. There is a concern about the notion of “work”, induced by immediacy of doing, which may imply a strong devaluation of the notion of art. One of the students expressed her frustration at the excessive amplification levels and absence of consonant sounds, which made her very tired. Several people noted the absence of relationships between the painting workshop and the musical ones.
The issue of the public presentation of the work in the Conservatory courtyard was the subject of a lively debate. The situation ran completely counter to the dominant culture of an institution requiring a high level of excellence in any performance. In addition, the public presentation used means of musical production rarely in use in the institution, in a undefined style in relation to the prevailing contexts. The amplification levels made it impossible to ignore this event in every corner of the Conservatory. The students were therefore obliged to do something that was in direct conflict with the surrounding community and that puts them at risk to be disqualified. Many wondered whether this idea of presentation of the work was really necessary to the overall conduct of the project. The students had to face numerous ironic comments from their colleagues present at the performance. One particular phrase stuck out: “the slobs in the courtyard!” Other expletives were used, such as “degenerates” with more disturbing historical connotations. Perhaps the audience needed to be better informed about the situation and its pedagogical context before the event.
Joris Cintéro, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (22’50”-23’44”)
In the answers to this debate by the members of the project teaching team, the need to make public an activity that is unusual in Conservatory practices remains of great importance. It’s not just a general question that could be swept under the carpet of anonymity, but something that needs to be put “on the table” of today’s reflections on art and its transmission to all.
For Giacomo the public performance at the CNSMDL was not initially planned, but the impossibility of having all the students present at the Lyon II University for the general public performance of the project changed the situation. He understands the frustration of people present concerning “art”, but the issue should be shifted to the legitimacy of the proposed activities. For him, the issue is how music teaching institutions are going to put in place some mechanisms to open up their activities to people who have no access to practices. He points out that the most obvious problem in his work with the various institutions in which he develops his projects, is the often negative attitude of the leadership staff, teachers, animators, social workers, and so on. They defend their territory, and often feel that those under their authority must conform to their own way of thinking. If they are not directly involved in the project, its course is seriously jeopardized. Effective knowledge of a project by the host institution as a whole is an essential element in getting the idea off the ground.
When the cultural animators are favorably inclined towards the Orchestre National Urbain’s projects, things happen in a very positive way. Here is an example of a commentary by Khadra Hamyani, an educational helper at the “Forum Réfugié”, during another project developed by Cra.p at the Lyon III University in 2024, involving young refugees, « From Body to Movements, From Gesture to Sounds”:
Khadra Hamyani, extract from video « Du corps aux mots, du geste aux sons » (2’37”-5’34”).
Karine Hahn reminds the students that on the one hand, Giacomo came one year before to present the detail of his project, its outlines and challenges, and on the other hand, a text of presentation of the project and its objectives was distributed to all shortly before its realization. In a context where often the people involved don’t have the same understanding of the terms of a project or may even understand exactly the opposite of what is proposed, any mediation seems of little use in avoiding conflictual expression. What counts however is the affirmation of legitimacy through action.
Joris Cintero underlines the difficulty that the institutions have in using surveys to question their own ways of operating, especially on the subject of recruitment of people present. The last formal enquiry on the social makeup of the student population at the Lyon CNSMD was done in 1983, [1] it showed that only 1% of farmers children were present, and only 2.8% of blue collar workers chidren, and so on.
The issue of the public performance must stems from the various difficulties encountered with the general administration of the institutions and the people who work in them. One student who was present at the Lyon II University noted that, at the beginning of the first day, no one was present ready to work with the Orchestre National Urbain, no advertisement had been made by the host institution, no support provided. Immense efforts had to be done to get 5 people willing to get involved. For Giacomo, the resistance of the University towards this project is obvious, there are no professors involved, nothing had been done to facilitate things. The feeling is that because it didn’t cost any money, it would have to fall apart. At the end of the first day, the question arose as to whether to continue on the following day. The answer is definitely that you have to keep going, you have to persist and play with the situation. For Joris 5 or 6 participants out of 29500 students, it’s a long way to go in the cultural domain.
Sébastien Leborgne describes in detail what happened at the Grandes Voisines, with the presence of 415 refugees accommodated, many of them women and children. Karine describes the start-up at the Grande Voisines: everything is ready to go at 10 in the morning, the technical setup is in place, the teaching team is ready to work, but nobody is there to participate. But this preparation is a guarantee to be taken seriously, the team is there in front of no one, with the same seriousness as if there were people present. Little by little people pass nearby, it’s on the move, it exists, it works no matter what.
At a certain point in the afternoon, a 11-minute video shows in fragmented form what happened at the Grandes Voisines. One of the most striking segments is a trombone quartet made up of three children and a mother, all playing together accompanied by body movements of great collective coherence.
In the diverse answers to the students’ preoccupations by the teaching staff, the following could be noted:
- Concerning the question of the need to do thing in an immediate manner at the cost of quality control, Giacomo points out that most of the time, the projects he leads in different contexts take place within very limited timeframes, the passage of the group is often ephemeral. Here, doing must absolutely precede theory.
- The question of long-time involvement is addressed by emphasizing on the role of Cra.p as a center of practices, as a place for continuing education, with also the objective to allow people living in deprived neighborhood to access higher education degree programs.
- The choice of instruments works on two levels: on the one hand, you have to enable a first practical approach to playing instruments well-known to require years of work; playing trombone or cello immediately can arouse the desire to learn to play these instruments seriously. On the other hand, you have also to give access to sound materials that are easy to handle at first. Giacomo gives the example of the six-string electric guitar that requires demonstrating how to play it, whereas the “spicaphone”, an instrument he built with just a single string gives a more immediate access to actual practice.
On the subject of the access for all to musical practices, Giacomo tells of a story of a mother, following a performance given by her son, who is crying while saying: “I didn’t know that my son could have the right to make music.” In many quarters, people think that the access to musical practices is completely forbidden to them. The issue of cultural rights is essential. Karine remarks on the lack of places open to practices: where are the spaces existing outside the limited access specialized “schools”? Outside the Cra.p, there’s a crucial lack.
Photos of the project at the CNSMDL, extract from video “Biennale Hors Normes” (13’08-13’56”)
Part IV : The Projet at Lyon II « Lumière » University
4.1 Morning of September 21 at the University “Lumière”, Lyon II
Jean-Charles François :
The morning session of September 21, 2023, takes place at the University “Lumière”, Lyon II (on the banks of the Rhône), in the space where art works are exhibited as part of the Hors Norme Biennial, and in the large amphitheater.
Given the difficulties encountered at the Grandes Voisines, at the last minute 20 teenage refugees (all male) of the “Centre d’hébergement” of the Lyon 1st arrondissement were able to come and to take part in this morning session and to the next day’s public presentation at the end of the afternoon. They could only be there during the morning of September 21 for one hour and a half (10:00-11:30 am) because the Center that housed them strict rules on meals. Four students from the CNSMD were present on a voluntary basis. Lyon II University students, and visitors to the BHN exhibition could take part in the workshops, but this was a very marginal phenomenon. Giacomo told me what had happened on the previous day (September 20) when a small number of students of the Lyon II University participated in the workshops as they passed through the exhibition hall. This happened although no advertisement of the event had been provided by the University towards the student population. Their participation depended only on their passing through the space where the activity took place, and their eventual interest in what was being proposed.
This is a frequent aspect of the actions carried out by Giacomo and the Orchestre National Urbain: although they are often officially invited to develop their projects in an institution, obstacles are bound to arise on the part of the staff of the institution. The reasons for this lack of cooperation can be found either because what is proposed comes to encroaches established prerogatives, or by the presence of people from outside the institution (or its usual audience) is not viewed favorably. In all cases, the attitude of the Orchestre National Urbain is to settle into a given space, and to raise the interest of persons lingering there or passing by.
Here are some comments from a Lyon CNSMD student who participated to a similar project by the Orchestre National Urbain at Lyon III University in 2024, “From Body to Movements, From Gesture to Sounds”:
Marie Le Guern, FEM student at the Lyon CNSMD, extract from video “Du corps aux mouvements, du geste aux sons” (8’47”-9’07”)
4.2 The Workshops in Lyon II University
Jean-Charles François:
Given the limited time available due to the presence of the young refugees, the organization of the workshops was limited to 15 minutes. This allowed 5 groups to participate in 5 workshops one after another, followed by a session regrouping all five groups for 15 minutes in the large amphitheater. This schedule was not completely realized within the allotted time, with each group actually taking part in only 4 workshops (out of the 6 proposed) before the session in the amphitheater.
The proposed 6 workshops were (as in the CNSMD):
a. Dance.
b. Cello.
c. Trombone.
d. Human beatbox.
e. MAO.
f. Sound laboratory
g. Painting.
Workshops at Lyon II University (MAO, Human beat box, cello, trombone), extract from video “Biennale Hors Normes” (23’58”-26’10”)
The workshops were held in the large exhibition space of the Hors Norme Biennial, and in two adjacent rooms. The principles were exactly the same as the ones described above, with immediate practice on sound materials, and the use of colored-code cards. The situations were the same as in the CNSMD, so, there’s no need to describe them in detail.
Because of the limited time, and the imbalance in numbers between the refugees and the other participants, few interactions between the different publics could really take place during that morning. Some of the groups were made up entirely of members from the refugee group. In the case of the painting workshop, I observed a situation with two large sheets of paper side by side, on which two completely separate groups were drawing: the first group was made up solely of black African male refugees, the second one only of white French female students.
The limited availability of the refugee group meant that the morning had to be focused primarily on welcoming them and organizing their activities, while the other participants had other opportunities to take part to all the workshops and performing situations. From this point of view, what was proposed to this particular audience was extremely successful: the refugees demonstrated a total commitment of their energy in the proposed practices and showed great interest in all the various aspects of the workshops. One of the strengths of the Orchestre National Urbain/Cra.p team is its capacity to adapt in an immediate way to all possible situations, to cope with all the hazards of technical, institutional, and human realities, to overcome any obstacles without getting people in the position of not abiding by the rules clearly established by the institutions and without compromising the manner in which they envision their own practices.
Trombone workshop at Lyon II University, extract from video “Biennale Hors Normes” (26’52”-27’54”)
4.3 The Workshop « Sound Laboratory » in the Lyon II University Amphitheatre
Jean-Charles François :
The last workshop of the morning, “Sound Laboratory”, led by Giacomo Spica Capobianco, bringing everyone together in the performing space of the amphitheater, in a situation quite similar to that described on the CNSMDL day, provided an opportunity to observe several new phenomena. While the system of color-coded cards worked very well as a common element in all workshops, its use in the large group performance regrouping all the activities in the amphitheater was less obvious. One is dealing here with differences of cultural conceptions: in the case of the young Africans, one can imagine that contrary to the CNSMD students, they rarely had the experience of working with a conductor. Most of them were playing without taking notice of the indications given by the conductor, the pleasure of a very new activity meant that they were more focused on their own sound production. On the other hand, some of them took great pleasure in assuming the role of conductor, with the idea of being in power to sculpt the sound matter. In the case of a very young refugee who conducted on two occasion (during the two days), we could observe a real progress in his way of determining the performance. The visual practices of respecting written organizations are not necessarily present in the conceptions that one can have of musical practices. How can we resolve the meeting of a diversity of conceptions of oral (aural) communication and their eventual structuration by visual representations?
Sound laboratory at Lyon II University, extract from video “Biennale Hors Normes” (34’55”-35’15”)
At the end of the morning, Giacomo invites the refugees to come back the next day for playing in the public presentation at 5 pm (they won’t be able to stay for the concert by the Orchestre National Urbain, as they must imperatively be back at the Refugee Accommodation Center before 8 pm). Giacomo, seeing the positive aspects of the morning, expressed in private the idea to propose to the Accommodation Center to continue to work with young residents on a regular basis, even if the stay for anyone in these centers is only for a very short time.
Guy Dallevet, visual artist, « La Sauce Singulière », Biennale Hors Normes, extract from video “Biennale Hors Normes” (26’11”-26’50”)
4.4 The Public Presentation of the Work at Lyon II « Lumière » University
Jean-Charles François :
This public presentation of the work of the various workshops took place on September 22 at 5 pm, in the large amphitheater of the Lyon II University.
Most of the refugees from the Lyon 1 Center have returned, but they have imperatively to be back there before 8 pm. The same four CNSMDL students are actively present. An indeterminate number of other Lyon University students, visitors or observers are also there, not necessarily as participants in the performance. The members of the Orchestre National Urbain are also there: Giacomo Spica Capobianco, Lucien 16s, Sabrina Boukhenous, Selim Penaranda, Odenson Laurent, and David Marduel. Karine Hahn, Joris Cintero, Noémi Lefebvre, and Guillaume Le Dréau are present representing the FEM at the CNSMD. Some of these members of the project team also take part in the performance from time to time. Guy Dallevet is present as he led the painting workshops, as representing the Hors Norme Biennial, and as president of the organizing association La Sauce Singulière.
8 different groups present 8 performances based on the same organization of instrumental stations representing the various workshops, the conductors change each time and use the color-coded cards principle.
Several questions come to mind when observing this public presentation taking place. One wonders whether there is any point in staging such an event in front of an audience. It’s the same questions that were raised in the CNSMD courtyard, presenting imperfect things in progress, and at odds with the requirements of professional performing arts. Yet there are important reasons for publishing, for reporting on what is being done: not only the main objective of the workshops is directly linked to a practice that only make sense in a public presentation, but the act of making a given activity public determines that it is not let in the secrecy of the workshop spaces, that it is offered to the critical scrutiny of all, it’s a question of laying the cards on the table. This is what differentiates the ethical idea of public education from the possible sectarian tendencies of the private sector.
The public presentation is not the simple repetition of the workshop situation. Other issues come to the fore on this occasion:
- The perspectives of a public presentation refocus the performers’ attention on the need for personal commitment and for particular presence on stage.
- To repeat the same but in a different context with additional challenges, changes the performance conditions and enriches it considerably..
- This situation also in a subtle way encourages encounters and exchanges between the diverse groups present, because the performers pay less attention to the material contingencies and have more freedom of expression.
Two questions remain in relation to the color-coded cards:
- Is the situation of an ensemble or orchestra that follows the instruction given by a conductor encouraging personal commitment, or on the contrary gives way to the possibility to hide within the mass.
- The color-coded cards can prevent the search for other temporal and organizational solutions, particularly in trying out textures and micro-variations.
These questions are important but may not automatically apply to a kind of project that is so limited in duration and involving such radically different groups.
Here are comments from a young refugee, Bouhé Adama Traoré, who participated to the Orchestre National Urbain’s project in 2024 at the Lyon III University:
Bouhé Adama Traoré, extract from video “Du corps aux mouvements, du geste aux sons” (21’31”-22’12”)
After this public performance and before the concert by the Orchestre National Urbain, refreshments were served in the BHN exhibition hall, unfortunately without the presence of the young Africans.
Part V : The Aesthetic Framework of the Idea of Collective Creation
Karine Hahn, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (18’43”-20’07”)
Jean-Charles François :
The idea of collective creation is at the core of the Orchestre national Urbain project: for collective creation to become a reality in groups that are heterogeneous in terms of geographical, social, and cultural origins, it is absolutely essential to avoid one particular group dictating its own rules and aesthetic conceptions to others. For example, accomplished musicians (as is the case with CNSMDL students) should not use their own instruments, in order to put themselves in a position of equality with those who never practiced music. And to give another example, people coming from other extra-European geographical spheres should not use songs or playing techniques issued from their own tradition.
Joris Cintéro, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (28’50”-30’28”)
Joris Cintéro :
Several observations can be formulated concerning these issues. The first one relates to the many ‘holds’[2] offered by the device (or set-up, or agencement)[dispositif][3] to the participants, particularly when they are not musicians. In the context of an intervention like that of the Orchestre National Urbain and in these circumstances, we can consider that what is initially planned, in particular the workshops, is constantly put to the test[4] of what happens (unsuitable venues, reluctant protagonists already present and, of course, people wanting to participate when they feel like it). In this respect, this brief moment shows the extent to which this device manages to overcome the ‘test’ of its audience. In fact, the nature of the instrumentarium (which has little to do with previous ‘familiarity’ and the symbolic effects it can convey), the absence of prior aesthetic codes (which presupposes knowledge and/or mastery), of prescribed ways of doing things (holding the instrument in such and such a way) and the simplicity of a colour code that is accessible to all sighted people means that participants can expand their numbers as much as possible, along the way and simply by presenting the colour code. In the circumstances of a place where the passage of people seems to be the norm (apart from children, few people seem to stand outside), the plasticity of the system is its main strength.
Another comment concerns the ‘framing’ of the dispositif by les Orchestre National Urbain members. I hypothesise here that one of the conditions for the success of the members of this ensemble success is that it has a major role to play in distinguishing itself from the other protagonists involved. This seems to be an important issue insofar as, if there really are tensions between the residents of the Grandes Voisines and the social workers working there (as we will learn on several occasions during the day), it is in the Orchestre National Urbain’s interest to mark its distance from the latter, and to do so in several ways. It seemed to me, at least in the speeches and in the way they acted, that there was a desire to set themselves apart through the type of ‘culture’ they were promoting (which was opposed to the French chanson promoted by the Grandes Voisines representatives), in the way they took over the premises (without much success), and in the way they addressed others (by showing a form of friendliness, which, without being overdone, was a way of doing things for all the members of the Orchestre National Urbain that I was able to observe).
Jean-Charles François :
An interesting event took place in the BHN exhibition space, at a certain informal point in the morning:
A sound sculpture was exhibited in the space made of percussion instruments and various metal objects, driven by an automatic mechanical system. The sculpture was capable of developing highly rhythmic music for 45 minutes without any repeating sequences. A group of 5 or 6 refugees stood in front of this sound sculpture, and as the music of the machine was playing, they started to sing and dance music that they knew, for about ten minutes.
This situation leads to me to make three comments relating to the idea of avoiding one’s own cultural habits in the perspectives of being able to work with anyone else in constructing a collective artistic act:
- This is a spontaneous situation that must not be prevented.
- The situation involves the confrontation in equal terms between two different aesthetical practices (music produced by a machine and traditional music of African refugees) to produce a new aesthetic object proceeding from the two and combining them.
- The principle of situations that avoid institutionalized practices in different groups to create a context of equality in the face of the discomfort of the unknown applies to initial encounters between heterogeneous groups, but it doesn’t necessarily exclude other practical situations that may develop in the long run.
Jean-Charles François, percussionist, extract from video “Biennale Hors Normes” (31’10”-34’54”)
Conclusion
Jean-Charles François :
In a society increasingly fragmented into microgroups that affirm strongly their identities, often through the disqualification of others, any attempt to find mediations between seemingly incompatible universes faces considerable difficulties. Yet the key to social peace lies in actions that bring together in the same place, same time and same task, groups whose differences are radically opposed. In this kind of situation, it’s not a question of denying identities, but of opening them up to the possibility of welcoming outsiders by recognizing the terms of their mode of existence and finding work situations that bring differences together. Nor is it about creating all-purpose artistic forms, keys in hand, that would satisfy the demands of any audience, in a Olympic universal bliss. On the contrary, it’s about confronting fundamental conflicts in rituals to make them explicit and to deal with them in shared practices that don’t pretend to resolve them, but rather peacefully bring them into play (into interplay).
The actions carried out during autumn 2023 jointly by Cra.p and the Orchestre National Urbain, the FEM department within the CNSMD, and the Lyon II University within the framework of the Hors Norme Biennial correspond perfectly to this ideal of bringing different worlds together. The ways imagined to achieve this are based on three conditions that combine together: firstly, a way of structuring practices that enable the immediate functioning common to all present: instruments, materials, fields of action, color-coded cards; secondly, this structuring allows for the opening up of individual freedom: improvisation, texts; and thirdly, the practices are conceived to put everyone on an equal footing: situations designed outside specialized roles, with the impossibility of using acquired technical know-how.
Giacomo Spica Capobianco, musician, artistic director of Cra.p, extract from video “Biennale Hors Normes” (36’48”-41’10”)
Those who brazenly dare to embark on the adventure of establishing encounters between human groups who meticulously avoid rubbing shoulders with one another are being foolhardy. They have to invent ways means of implementing practices involving consideration of others, avoiding any violence, but without watering down the reality of the tensions that are in play. So often, they have often to contend with the inertia of established professionals and sometimes with intolerable refusals. Their admirable presence in the cultural and artistic landscape, too rarely recognized, is of the utmost importance.
Public presentation at the University Lyon II, extract of video (41’11”-46’10”)
1.Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
2. This concept, borrowed from the sociologists Christian Bessy and Francis Chateauraynaud, describes ‘the encounter between a set of categories and material properties, that can be identified by the (supposedly) common senses or by instruments of objectification’ (1992, p.105). It was initially used to study the valuation work of auctioneers, whose task can be reduced to looking for clues that make it possible to articulate the perception of the material properties of objects and the evaluation of their qualities by reference to a space of circulation – in this case, the second-hand market. Applied to the situation at stake here, it enables us to understand how certain material properties of the set-up (instrumentarium, colour code, layout of the room, quality of the materials, etc.) encourage the participants’ involvement in the sense that they do not hinder their physical and perceptive dispositions – and this helps to explain, at least initially, the difficulties encountered by the “musicians” with regard to these same material properties.
3. Considering the device as a ‘composed-object’ (concept expressed by Didier and Stavrianakis in their book Les objets composés. Agencements, dispositifs, assemblages, EHESS edition, 2018), the term here describes not only the material arrangement of the device but also the network of individuals, norms and social roles attached to it (the participants are thus an integral part of the device).
4. While the use of the term ‘test’ may well refer to the common usage we make of it, I use it here in the sense invested in it by so-called pragmatic sociology (Lemieux, 2018), which defines it as ‘a moment during which people demonstrate their skills either to act, or to designate, qualify, judge or justify something or someone’ (Nachi, 2015, p.57). Here, I consider that what is engaged by the device (the credibility of the Orchestre National Urbain, the artistic and social stakes carried by the workshops etc…) is put to the test of its realization, even if we can just as well consider the device as a test allowing to (re-) qualify the individuals who participate in it.
Quoted references:
Bessy, C., & Chateauraynaud, F. (1992). Le savoir-prendre. Enquête sur l’estimation des objets. Techniques & Culture, 20, 105 134. https://doi.org/10.4000/tc.5029
Dodier, N., & Stavrianakis, A. (Éds.). (2018). Les objets composés : Agencements, dispositifs, assemblages. Éditions de l’EHESS.
Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
Nachi, M (2015). Introduction à la sociologie pragmatique. Dunod.
Création collective nomade
Création collective nomade
Dans le cadre de la Biennale Hors Norme, Lyon.
15-23 septembre 2023
Aux Grandes voisines,
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
et Université Lumière Lyon II
Bilan sur les observations des ateliers organisés par
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
Comptes-rendus de Joris Cintéro, Jean-Charles François
et
de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et
de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p
Sommaire :
Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain « Création collective nomade »
1.1 Le projet de l’Orchestre National Urbain
1.2 Période de préparation du projet
Partie II : Les Grandes Voisines
2.1 Ateliers aux Grandes Voisines
2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines
2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines
2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines
Partie III : Le projet au CNSMD de Lyon
3.1 Les réunions dans le cadre du projet
3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMD
3.3 L’atelier Human Beat-Box
3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.
3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon
Partie IV : Le projet à l’Université « Lumière » Lyon II
4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II
4.2 Les ateliers à L’Université Lyon II
4.3 L’atelier Laboratoire sonore dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II
4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II
Partie V : Le cadre esthétique de l’idée de création collective
Conclusion
Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain,
« Création collective nomade »
Dans cet article, nous racontons sur un mode volontairement personnel la manière dont nous avons perçu le déroulement des ateliers organisés par l’Orchestre National Urbain/Cra.p dans le cadre du projet de Création Collective Nomade. Ce projet s’est déroulé du 15 au 21 septembre 2023 dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023, aux Grandes Voisines à Francheville, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) et à l’Université Lumière Lyon II.
Le compte-rendu de Joris Cintéro porte sur la période de préparation du projet et la journée du 15 septembre aux Grandes Voisines. Il décrit sa façon de procéder de la manière suivante :
N’ayant quasiment pas pris de notes ce jour-là (j’y allais explicitement dans l’esprit de participer), le CR suivant s’appuie essentiellement sur mes souvenirs. Ce mode d’écriture m’a justement permis de creuser ces souvenirs, à côté de photos et de vidéos que j’ai pris durant la journée – et qui m’ont également permis de « retrouver » la mémoire.
Celui de Jean-Charles François est basé sur une journée passée au CNSMD de Lyon, le 19 septembre et de deux journées à l’Université Lyon II, les 21 et 22 septembre. Il a été élaboré à partir d’observations (sans participation) et de prises de note.
Dans les deux cas, les comptes-rendus alternent descriptions, contextualisations et bribes d’analyse qui demandent à être approfondies.
Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne, membres de l’Orchestre National Urbain/Cra.p, apportent quelques éléments d’information essentiels à la compréhension de leur démarche.
Les textes sont entrecoupés d’extrait d’une vidéo réalisée par l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p qui contient des interviews de divers participants et des segments du déroulé des ateliers.
1.1 Le Projet de l’Orchestre National Urbain – Cra.p
Jean-Charles François :
Le projet de Création Collective Nomade a été élaboré par Giacomo Spica Capobianco dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023. Giacomo est directeur artistique de l’Orchestre National Urbain et de CRA.P qu’il a créé il y a plus de trente ans. Selon son site « L’équipe du Cra.p a pour objectif d’échanger des savoirs et savoirs-faire dans le domaine des musiques urbaines électro, croiser les esthétiques et les pratiques, susciter les rencontres, inventer des nouvelles formes, créer des chocs artistiques, donner les moyens de s’exprimer » (Cra.p). Le projet a été développé avec les membres de l’Orchestre National Urbain, l’équipe de la FEM [Formation à l’Enseignement de la Musique] du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL – FEM), autour de Karine Hahn, et avec l’artiste plasticien Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme (BHN).
La description du projet par ses organisateurs peut se résumer à plusieurs éléments dans un dispositif visant d’une manière générale à amener des publics très diversifiés à travailler ensemble pour produire collectivement de la musique, de la danse et de la peinture :
- Trois axes de médiation se combinent ici : a) mettre en présence des groupes sociaux très différents ; b) mettre en présence des personnes qualifiées à se nommer « artistes » (étudiants, étudiantes du CNSMD) avec des personnes a priori sans compétences reconnues dans ce domaine ; c) mettre en présence des pratiques dans des domaines artistiques différents (musique, danse, théâtre, arts plastiques, poésie).
- Les rencontres se basent sur des pratiques artistiques immédiates, faire de la musique, faire de la danse, faire de la peinture. Pour que cette mise en pratique commune n’avantage pas un groupe sur un autre elles sont organisées en sorte que toutes les personnes présentes soient mises devant des tâches qui sont nouvelles pour elles, comme par exemple jouer du trombone alors qu’on n’en a jamais fait l’expérience ou se mettre à danser si on est musicien.
- Le dispositif est structuré dans une série d’ateliers animés par les membres de l’Orchestre National Urbain :
Sébastien Leborgne (Lucien 16’s), beat box and spoken voice.
Rudy Badstuber Rodriguez, MAO et éléments de percussion.
Selim Penaranda, violoncelle.
Odenson Laurent, trombone.
Sabrina Boukhenous, mouvements corporels.
Clément Bres, batterie.
Giacomo Spica Capobianco, Laboratoire sonore, un atelier regroupant après coup toutes les activités des autres ateliers, dans des perspectives de création collective.
Les ateliers peinture sont animés par Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme.
Le point commun à ces ateliers (sauf pour la peinture) très différents en termes de manipulation de matériaux, est constitué d’une série de codes couleurs définissant des modes de jeu :
a) orange = vent soutenu ;
b) blanc = ralenti graduel ;
c) rouge = rythme répété (trois noires et un soupir) ;
d) marron = 8 pulsations régulières ;
e) noir = arrêt au sol, silence ;
f) bleu = peur, tremblement, énergie ;
g) vert = improvisation libre.
Les diverses mises en pratique des différents ateliers sont toutes basées sur l’exploration de ces codes couleurs.
- Une autre activité importante initiée par les membres de l’Orchestre National Urbain, c’est l’élaboration personnelle de textes appelés à être parlés (en rythmes précis ou librement) lors de la rencontre sur la scène de tous les éléments des ateliers.
- Les personnes présentes suivent chaque atelier l’un après l’autre dans des groupes d’une dizaine de personnes. À la suite de cela tout le monde se retrouve dans un ensemble général – Le Laboratoire Sonore – composé de diverses stations : trombone, violoncelle, voix (microphone), batterie, des objets divers suspendus à un portique, 2 stations « electro » (loops, jeu avec les doigts sur un pad), un spicaphone (genre de guitare électrique à une corde construite par Giacomo Spica), un instrument à cordes tendues sur un cadre en métal (dénommé miroir sonore), une guitare électrique posée horizontalement pour être jouée comme un instrument de percussion, un espace pour la danse. Un chef ou une cheffe est désignée parmi les participants pour organiser la performance en montrant au fur et à mesure les cartons de codes couleur. Dans l’esprit de Giacomo, il ne s’agit pas là de « sound painting », celui ou celle qui dirige doit seulement montrer des couleurs et indiquer un niveau sonore général, sans imposer une énergie particulière. L’expérience du dispositif a montré que dans la pratique les personnes qui participent au dispositif (dans et en dehors des membres de l’Orchestre National Urbain) mettent souvent une « énergie particulière » dans la direction – se baisser pour incarner une nuance, jouer à échanger rapidement les cartons, faire en sorte qu’une partie seulement de l’ensemble soit concernée par un carton, etc…).
- A un moment donné, dans l’institution où se passent les ateliers, une restitution générale du travail réalisé est présentée en présence d’un public extérieur (c’est ce qui s’est passé au CNSMDL à l’issue de deux jours de travail, et à l’Université Lyon II à l’issue de deux journées de travail). A l’université, cette restitution a été suivie d’un concert par l’Orchestre National Urbain.
Le projet lié à la Biennale Hors Norme s’est déroulé dans trois lieux différents :
- Les 15 et 16 septembre au Grandes Voisines, à Francheville près de Lyon, qui se décrivent dans leur site comme « un tiers-lieu social et solidaire où il est possible de dormir, manger, travailler, peindre, découvrir une exposition, participer à une chorale… et vivre des rencontres » (Les Grandes Voisines). Ce lieu d’hébergement accueille des réfugiés en attente de régulation. C’est ce public particulier qui a été visé pendant les deux journées de pratique.
- Les 18 et 19 septembre au CNSMD de Lyon, dans le cadre du programme de la Formation à l’Enseignement en Musique (FEM). Deux journées d’atelier, occasion d’une rencontre autour de pratiques entre les étudiants de la FEM et les réfugiés hébergés aux Grandes Voisines, avec une présentation publique du travail à la fin de la deuxième journée.
- Les 20 et 21 septembre, à l’Université Lumière, Lyon II, ateliers avec les réfugiés et les étudiants de l’université et du conservatoire (sur la base du volontariat) avec une restitution du travail en fin de journée du 21 septembre, suivie le soir d’un concert de l’Orchestre National Urbain.
1.2 Période de préparation du projet
Joris Cintéro :
Au moment où j’écris ces lignes, je ne me souviens pas tout à fait clairement des circonstances dans lesquelles on m’a présenté le dispositif pour la première fois. Je me souviens seulement de plusieurs bribes de discussion avec Karine me décrivant un « projet auquel on participe avec le Cra.p » dont la première étape se déroule « à Francheville, dans un centre d’accueil pour réfugiés », et que « les étudiants et les étudiantes ont été tenu·e·s au courant » de longue date. J’ai des souvenirs quant aux objectifs que l’on fixait pour les étudiantes et étudiants à travers un dispositif comme celui-ci, particulièrement aux Grandes-Voisines : rencontre avec une altérité dont nous supposons qu’elle n’est pas fréquente dans l’ordinaire de leur travail de pédagogues, création de moments musicaux pensés pour inviter un public non rompu aux traditions de ladite musique savante occidentale, adaptation dans des circonstances peu propices à l’enseignement artistique et bien entendu, prise de recul sur les enjeux sociaux et politiques de l’enseignement artistique.
Quelques jours avant la première séance aux Grandes Voisines [GV], Karine rappelle aux étudiants et aux étudiantes de la formation CA la teneur du projet. Après les avoir interrogés pendant un moment collectif sur la possibilité de se rendre aux Grandes Voisines le vendredi et/ou le samedi, nous nous rendons compte que très peu d’entre elles et eux se trouvent être disponibles pour venir avec nous ces jours-là. C’est le cas d’un seul étudiant en première année (Grégoire), que nous connaissons à ce moment-là, assez mal – la formation n’ayant démarré que depuis une semaine. Le groupe dans sa quasi-totalité nous a fait savoir de leur souhait de pouvoir venir, mais de leur impossibilité à participer à cause d’un manque de temps ou n’ayant pas reçu l’information à temps.
Nous soulignons également la nécessité, pour celles et ceux souhaitant venir, d’apporter des instruments qui soient susceptibles d’être manipulés par des enfants – je me souviens d’ailleurs avoir maladroitement insisté là-dessus, laissant penser qu’il ne s’agissait de travailler qu’avec des enfants et que ces derniers seraient particulièrement peu soigneux. Les réponses des étudiant et des étudiantes nous amènent à découvrir que très peu disposent de plusieurs instruments de musique.
Partie II. La Création collective nomade aux Grandes Voisines
2.1 Ateliers aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Le samedi 16 septembre 2023, après avoir récupéré une vieille guitare classique chez moi et la harpe électrique de Karine à Villeurbanne, nous nous rendons tous deux aux Grandes Voisines en voiture et arrivons en milieu d’après-midi, aux alentours de 15h30. Karine se gare sur le parking de l’entrée, à deux pas d’une sorte de guérite défraichie (vide ?) permettant de surveiller les allées et venues au centre d’accueil. C’est un peu loin du lieu où se déroulent les ateliers (il faut dire que la signalétique n’était pas très claire et que rien de l’extérieur n’annonce la Biennale Hors-Normes). Après un court appel téléphonique, Giacomo nous fait signe au loin de nous approcher et nous accueille.
Je rencontre pour la première fois les membres de l’Orchestre National Urbain, qui sortent alors d’une salle dans laquelle sont entreposés différents instruments. S’ensuit une visite « critique » rapide des lieux en compagnie de Giacomo. Nous découvrons un dédale de pièces, de portes, de couloirs et sommes informés rapidement de l’organisation du lieu. En effet, Giacomo connaît déjà bien l’endroit (l’Orchestre National Urbain est déjà intervenu dans les lieux) et a connu des tensions avec certains des acteurs et actrices qui y travaillent. Au cours de la visite, je comprends assez rapidement qu’il y a des difficultés de communication entre les acteurs (et leurs institutions respectives) quant à la gestion du lieu et qu’une partie des artistes présentes et présents dans le cadre de la Biennale Hors-Normes [BHN] ne sont pas « sur la même longueur d’ondes » que Giacomo.
J’ai l’impression d’un lieu labyrinthique qui peine à cacher les stigmates de son ancien usage (hôpital pour personnes âgées). Bien que certains couloirs soient bardés de peintures et d’œuvres en tous genres, que certains points extérieurs laissent percevoir une activité artistique (sculptures etc…), le lieu dégage une certaine froideur (néons, faux-plafond, peintures grisâtres, dalles fendues, etc…) typique des bâtiments administratifs, des maisons de retraite ou encore des hôpitaux. Certaines pièces paraissent un peu glauques et sentent l’humidité – c’est le cas de la salle de concert au rez-de-chaussée du bâtiment, qui se tient en lieu et place de l’ancienne chapelle du bâtiment. Pour ajouter à cette impression, Giacomo ajoutera durant la visite que les tables d’autopsie sont toujours présentes dans les sous-sols du bâtiment. On aperçoit au loin un stade de foot dont on peine à comprendre l’usage dans un hôpital gériatrique et des affiches présentant une installation qui doit s’y tenir. Je suis frappé à ce moment-là par la « valse » des clés qui accompagne cette visite, sensation probablement due à l’agacement dont fait part Giacomo vis-à-vis du fait qu’il soit nécessaire de fermer derrière soi « au cas où », « parce que certains réfugiés n’hésitent pas à se servir » ou parce que le matériel ne peut être surveillé en notre absence (et celle des membres de l’Orchestre National Urbain qui animent les ateliers).
Après un tour d’une bonne quinzaine de minutes où nous repérons où se déroulent les différents ateliers nous revenons au point de départ sous la sorte de barnum où l’équipe de l’Orchestre National Urbain nous avait accueilli un peu plus tôt. Il fait assez chaud, et Grégoire, le seul étudiant du CNSMDL ce jour-là, vient d’arriver.
Une fois la visite terminée, Giacomo souligne au détour d’une phrase la difficulté majeure de l’après-midi, difficulté que nous ne tardons pas à observer : personne ne s’est inscrit pour participer aux ateliers. Cette situation s’explique d’après lui du fait que les travailleuse et travailleurs sociaux intervenant sur le lieu n’ont pas relayé l’information aux usagers du lieu (en effet on n’a pas vu d’affiches pendant la visite et nous croisons des personnes travaillant sur le lieu qui ne sont pas au courant de la tenue d’ateliers musicaux), manque de communication s’expliquant lui-même par une brouille entre les porteurs de projet de la BHN et l’organisation du lieu – dont on apprendra un peu plus précisément, par la suite, la teneur. C’est donc sans aucun enfant/adulte, en dehors d’Omet – un usager du lieu qui n’est d’ailleurs pas initialement présenté/catégorisé comme un bénéficiaire du dispositif mais plutôt comme un membre à part entière de l’activité – que commence la journée.
En l’absence de public, les membres de l’Orchestre National Urbain ne se démontent pas et nous invitent à commencer à jouer, Karine, Grégoire, Omet et moi-même, en leur compagnie dans l’atelier sonore collectif (le laboratoire sonore de Giacomo).
2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Giacomo nous présente un atelier musical collectif similaire aux ateliers de groupe qui seront proposés par la suite au CNSMDL et à l’Université Lumière Lyon 2. Il s’agit d’une improvisation collective dirigée par un chef, officiant seulement par le biais d’un jeu de cartons colorés indiquant des intentions musicales particulières devant orienter le groupe improvisateur.
L’instrumentarium est le suivant :
– Instruments de « lutherie urbaine » : Spicaphone / Harpe-miroir [amplifiés]
– Instruments électroniques : (Korg monotribe/Kaosspad/Roland SP 404SX/MicroKorg)
– Pédales d’effet (Whammy avec Spicaphone)
– Microphone [amplifié]
– Instruments acoustiques (Caisse claire, guitare électrique, « baguettes chinoises » en guise de baguettes de batterie)
La console et les différents câbles qui permettent l’amplification des instruments ne sont pas utilisés comme moyens de jeu dans le dispositif.
Le jeu de cartons comprend 7 couleurs associées aux conventions décrites ci-dessus. À ce jeu de « code-couleur » s’ajoute la possibilité de faire varier le volume sonore du groupe improvisateur en signalant avec la main plus ou moins haute.
L’instrumentarium est ce jour-là disposé tout autour du chef ou de la cheffe. L’atelier se déroule dans une grande salle au lino vert, dotée de plusieurs baies vitrées (certaines occultées par des rideaux), donnant directement sur l’extérieur – permettant ainsi aux personnes qui passent de voir (et accessoirement d’entendre) ce qu’il s’y passe. Si elle n’est pas pour ainsi dire centrale dans l’architecture du centre d’accueil, cette salle se trouve néanmoins dans le passage des piétons et des voitures et donne sur plusieurs autres bâtiments – ce qui aura son importance pour la suite de la journée.
L’atelier démarre donc par le biais d’une explication de Giacomo qui en présente les différents aspects, mettant notamment l’accent sur le code couleur et les objectifs visés (travailler sur la matière sonore, libérer les éventuelles inhibitions de chacun, créer un espace d’égalité entre musicien·ne·s et non musicien·ne·s, etc…). Étant moi-même impliqué tout au long du dispositif, je ne sais pas tout à fait combien de temps chaque improvisation a duré. La seule chose que je sais c’est que les tours d’improvisation ont cessé une fois que tout le monde avait « cheffé » au moins une fois – certain·e·s répétant l’exercice plusieurs fois.
L’atelier débute. Tout le monde semble prendre beaucoup de plaisir à jouer de la sorte. Les remarques des personnes présentes tiennent essentiellement à la difficulté de se remémorer dans l’instant des conventions associées aux cartons colorés (j’ai dû attendre le 4ème ou 5ème tour pour m’aligner « correctement » sur les cartons), aux nuances proposées par le/la cheffe ainsi qu’au plaisir de jouer sur des instruments « exotiques » (la harpe-miroir et le spicaphone particulièrement). Presque chaque « tour » d’atelier se clôt par une discussion sur ce qui vient de se passer, discussion portant essentiellement sur des questions musicales (l’intention des chefs, les nuances etc…). Les premiers ateliers se passent « très bien » dans la mesure où il me semble que la majorité des personnes présentes sont rompues à l’exercice.
Durant les improvisations on voit parfois passer des groupes d’adultes, d’enfants, de parents qui pour certains s’approchent discrètement de la salle – feignant pour la plupart ne pas être vus. C’est au gré de ce flux qu’un homme d’une petite quarantaine d’années, accompagné de sa fille d’environ 5 ans se joignent à nous. Assez réservé, il déclare dès le début venir « pour sa fille », qui semble particulièrement heureuse et enjouée au moment où les membres de l’Orchestre National Urbain l’invitent à se joindre à l’improvisation collective. L’enfant participe à plusieurs « tours » d’atelier accompagnée par différentes personnes (qui la mettront sur un fauteuil pour qu’elle puisse jouer sur le Microkorg par exemple ou recadreront son jeu vis-à-vis des cartons colorés) et le père endossera le rôle du chef une fois – en plus de participer à quelques tours d’atelier lui-aussi. D’abord réticent au fait-même de participer (il comptait seulement regarder sa fille), il se joint à nous à la demande de Giacomo et se « détend » peu à peu, sans qu’il témoigne pour autant d’une forme de lâcher prise (que j’interprète par le fait que les participants se prêtent totalement au jeu et qu’ils se trouvent par moments dépassés par celui-ci). Le père et sa fille quittent la pièce après plusieurs tours d’ateliers, visiblement heureux d’y être passés.
Une fois la salle fermée nous passons dans la pièce adjacente dans laquelle se tient un atelier d’improvisation au violoncelle et de peinture.
2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines
Karine Hahn, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (11’19”- 11’44”)
Joris Cintéro :
L’atelier violoncelle-peinture est dirigé par Selim Penaranda (pour le violoncelle) et une personne (pour la peinture) dont j’ai oublié le nom (dont j’apprendrais par la suite qu’elle remplaçait Guy Dallevet, absent ce jour-là). Il se déroule dans une salle, grande mais assez encombrée de cartons, de peintures, de sculptures et d’objets divers.
L’organisation de l’atelier est assez simple. On a d’un côté Selim avec 3 violoncelles (un acoustique et deux électriques amplifiés) et de l’autre l’intervenante peinture avec un ensemble de feuilles, de peinture acrylique, de cartons pour l’étaler et de tenues de protection qui sont visiblement usées – la pièce semble utilisée très souvent pour réaliser des activités de ce genre, en témoignent les nombreuses peintures affichées aux murs et les tâches de peinture dans l’évier. Dans le même esprit que les productions qui suivront le reste de la semaine, ce dispositif consiste dans une interaction entre les groupes qui peignent et les groupes qui font du violoncelle. L’atelier se termine par des improvisations individuelles au violoncelle au départ d’un support peint par l’interprète.
Lucien 16’s (Sébastien Leborgne) sur les relations musique et peinture, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (3’48”-4’48”)
L’activité violoncelle dirigée par Selim s’organise toujours de la même manière.
1. Présentation de l’instrument et du dispositif.
2. « Tâtonnement » à l’instrument.
3. Improvisation dirigée avec code couleur. Cette activité nécessite au moins deux personnes
qui jouent, (dont Selim parfois) et une personne qui dirige.
Selim présente dans un premier temps le violoncelle en jouant quelques notes et soulignant de façon récurrente qu’il n’y a pas de bonne position pour en jouer, que l’essentiel c’est d’être à l’aise en jouant. Dans ce sens, il n’hésite pas à montrer des positions que l’on pourrait qualifier d’hétérodoxes vis-à-vis de la représentation commune du jeu au violoncelle qui est associée à une position dite « classique » (l’instrument se tient entre les jambes, les pieds à terre, le manche de l’instrument reposant sur l’épaule). Il met, à dessein, les pieds sur les bords du violoncelle, montrant qu’il est possible de procéder ainsi pour en jouer. Même chose du côté de l’archet qu’il propose de tenir de plusieurs manières différentes soulignant, comme il le fera plus tard au CNSMDL, que « ça peut se tenir comme une poignée de porte ». Il n’empêche pas, toutefois, les personnes présentes de tenir l’instrument et l’archet de façon « conventionnelle ». Une fois ce « rituel » de présentation accompli, il laisse les participants explorer sur le violoncelle tout en présentant la suite de l’atelier qui consiste en une improvisation avec une autre personne.
La personne qui « cheffe » durant l’atelier alterne au fur et à mesure de l’avancement de ce dernier. Le code utilisé est le même que dans l’atelier précédent.
De l’autre côté de l’atelier, on trouve la peinture, qui s’organise de façon tout aussi récurrente. L’encadrante présente la tâche à réaliser, c’est-à-dire peindre une toile en s’imprégnant de l’ambiance sonore créée du côté des violoncellistes et ceci à l’aide d’un bout de carton, permettant de réaliser, comme le montre l’encadrante, des formes circulaires pluri-colores. En somme il s’agit de verser quelques gouttes de peinture (une ou plusieurs couleurs) sur la toile, et d’étaler avec le support cartonné la peinture sur une feuille en réalisant des sortes de spirales.
Le lien entre les deux parties de l’atelier ne semble pas évident pour tout le monde, en témoignent, lors d’une pause dans le violoncelle où je jette un œil à l’autre partie de l’atelier, certain·e·s peintres ne prêtant aucun cas à la musique (ce qui n’est pas tout le temps vrai puisque les silences trop longs amènent les peintres à parfois gentiment râler de l’absence de musique pour peindre). Je prends quelques photos de l’atelier.
L’atelier se termine par une série d’improvisations individuelles sur le violoncelle, réalisées à partir d’un support visuel, c’est-à-dire la peinture réalisée plus tôt dans l’atelier. Personne parmi ceux et celles habitant le lieu ne viendra nous rejoindre durant le dispositif. Nous décidons de faire une pause après une petite heure de travail collectif.
Atelier violoncelle et peinture aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (5’45”-12’28”)
2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
La pause est l’occasion de s’allumer une cigarette, de boire un peu d’eau et de discuter plus généralement des dispositifs proposés et de l’absence de public. Si l’ambiance est très amicale, je sens tout de même une forme de déception chez les membres de l’Orchestre National Urbain. Je me dis aussi à ce moment-là qu’en effet, mobiliser autant de monde sur deux jours pour si peu de public constitue une perte de temps et d’argent considérable. On disserte un peu sur le lieu, ses défauts (on y serait logé par « ethnie ») et sur le fait qu’en dehors de son esthétique hospitalière, on n’y semble pas si mal accueilli que ça. On mentionne l’existence d’un bâtiment dédié aux femmes seules, public difficile à convier aux activités selon Giacomo, ces dernières ayant vécu des parcours migratoires traumatiques. Tout le monde y va de sa petite anecdote, surtout celles et ceux qui connaissent déjà le lieu.
L’après-midi avançant, Odenson Laurent, jeune membre de l’Orchestre National Urbain joue quelques notes au trombone. Ces notes ont l’effet d’un appel. Plusieurs enfants se rapprochent, timidement d’abord puis de façon plus directe ensuite. Ils et elles veulent jouer et nous le font savoir. Giacomo et Sébastien se précipitent pour récupérer les trombones qui avaient été entreposés dans une pièce du bâtiment. La scène donne l’impression qu’on est pris de court, le « public » afflue enfin, il s’agirait de ne pas louper le coche.
Les étuis des trombones arrivent et sont posés à la va-vite à terre. Le moment est assez intéressant dans la mesure où nous nous mettons toutes et tous (qui ont participé des ateliers précédents) progressivement à « cadrer » cet atelier qui prend forme. Ici on désinfecte les embouchures à l’alcool, là on montre à un enfant comment s’attrape et se tient le trombone, à côté on fait patienter celles et ceux qui attendent leur tour.
Atelier de trombone aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (0’23”-0’56”)
Odenson prend la main de l’atelier, parle fort (il faut dire que les enfants sont nombreux et pressés de jouer) et donne à voir comment on souffle dans l’embouchure du trombone. La majorité des enfants y arrivent. Il propose une série d’exercices/jeux où il s’agit d’abord de souffler fort une fois. Les enfants s’exécutent avec succès, rient et réessaient sans attendre l’invitation d’Odenson. Le volume sonore augmente rapidement, les enfants semblent emballés par l’activité. Odenson propose ensuite de jouer avec la coulisse. Certains enfants font tomber la coulisse (il faut dire que dans certains cas, les trombones sont aussi grands que celles et ceux qui les jouent), ce qui entraîne les rires des autres et l’impatience de ceux qui attendent leur tour – certains viennent alors en aide à leurs camarades en tenant la coulisse. Les enfants semblent visiblement très heureux de l’expérience qu’ils viennent de vivre. De nouvelles têtes qui font leur apparition : plusieurs femmes commencent à arriver et certaines se penchent aux balcons pour voir ce qu’il se passe.
Rebelote, on nettoie les embouchures, on donne quelques informations aux enfants sur la façon de tenir le trombone (chacun y va un peu de son conseil), on fait patienter celles et ceux qui passeront après, on invite les femmes qui viennent d’arriver à tenter l’expérience. On se partage les rôles pour y arriver : Karine est par exemple invitée à convaincre une habitante des lieux de se joindre à l’exercice, ce qu’elle parvient à faire.
Il est intéressant de noter que si en dehors d’Odenson, personne ne « joue » du trombone (du moins personne ne se catégorise comme étant « tromboniste ») tout le monde s’autorise le fait de montrer aux enfants comment on souffle dans l’embouchure, comment réaliser le mouvement des lèvres permettant d’y arriver ou de montrer comment se tient l’instrument – par exemple dans l’entre deux à celles et ceux qui attendent ou directement à celles et ceux qui sont en train de participer à l’atelier.
Après plusieurs passages, l’atelier s’arrête et les membres de l’Orchestre National Urbain échangent avec les femmes et les enfants présents pour les prévenir de la journée du lendemain et de la poursuite des ateliers.
Photos des Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (2’37”-3’33”)
Partie III : le projet de Création Collective Nomade au CNSMD de Lyon
3.1 Les réunions dans le cadre du projet
Jean-Charles François :
Avant de commencer les ateliers de chaque journée, l’équipe de L’Orcherstre National Urbain a l’habitude de se réunir afin de (re-)définir le contenu de la journée à venir, à partir d’un bilan des actions qui ont directement précédées.
Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne :
Premier temps, « Réunion d’équipe » :
Le directeur artistique (Giacomo Spica Capobianco) fait un point avec tous les artistes intervenants de l’Orchestre National Urbain. Ces réunions permettent d’évaluer les ateliers collégialement afin de faire évoluer le projet. Ces moments de discussion permettent d’échanger sur les évolutions, les contraintes, les difficultés rencontrées.
Afin de proposer le programme de la journée, un point préalable est prévu et permet de s’adapter aux situations vécues au jour le jour.
Deuxième temps, « Réunion d’équipe avec les stagiaires » :
Chaque matin un moment de discussion est programmé avec tous les stagiaires.
Ce moment et évidemment important étant donné qu’aucun niveau de sélection n’est requis au préalable, autant sur un plan technique que sur un plan social, les stagiaires vont être sujet à travailler collectivement.
Il est important que les uns aillent vers les autres pour une rencontre plus constructive vers une réflexion de création improbable.
L’intérêt est de faire comprendre au stagiaire qu’il est au service du projet au sein d’une création collective.
Tous les ateliers sont filmés.
Il est important d’avoir un support vidéo de chaque atelier afin que tous les membres de l’équipe de l’Orchestre National Urbain découvrent le travail de l’autre. Cela permet de faire évoluer le projet.
Jean-Charles François :
Par exemple, voici la description d’une telle réunion qui s’est déroulée lors de la deuxième journée d’ateliers au CNSMDL, le matin du 19 septembre 2023. Cette réunion regroupe l’équipe de l’Orchestre National Urbain et celle de la Formation à l’Enseignement de la Musique du CNSMDL.
Giacomo fait part des problèmes rencontrés au Centre d’accueil des Grandes Voisines. Il semble que les personnels encadrants du centre n’ont pas très bien organisé la venue du l’Orchestre National Urbain. Apparemment peu d’information a été donnée aux réfugiés, en conséquence il a fallu que les membres de l’orchestre se mettent à jouer dans la cour pour accueillir les personnes qui passaient et les inviter à participer. Ce sont surtout des enfants et les mères de ces enfants qui ont participé. En conséquence seulement un réfugié a pu venir participer aux journées de rencontre au CNSMDL. Giacomo résume les objectifs de la journée qui consiste à la possibilité de se prendre en main à partir d’éléments à travailler qui sont nouveaux pour les étudiants. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas le droit d’utiliser leur propre instrument. Pour Giacomo, on n’est pas là pour dicter des comportements mais pour se mettre en situation d’une recherche collégiale en vue de se projeter dans des pratiques à faire avec tout public.
3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMDL
Jean-Charles François :
La séance du matin du 19 septembre 2023 se déroule dans la salle de musique d’ensemble qui comporte une estrade. Un large espace sur la scène est organisé avec une série de stations instrumentales (instruments traditionnels, simples instruments construits, instruments électroniques, voix amplifiée) comme décrit ci-dessus. Un espace en dehors de cette estrade est réservé à la danse. Les étudiants sont partagés en trois groupes. Ceux ou celles qui ne participent pas à la performance d’un groupe sont assis par terre ou sur des chaises en dehors de ces deux espaces.
La séance commence par un échauffement du corps de 10 minutes animé par Sabrina Boukhenous. Elle est membre de l’Orchestre National Urbain, comédienne, directrice d’acteur et technicienne son-lumière. Son rôle dans l’Orchestre est de prendre en charge le corps en mouvement et le spoken word. L’échauffement se déroule dans la bonne humeur et le plaisir de faire : frottements de mains, exercices de respiration, mettre en action les différentes parties du corps, sauter, etc.
Concernant le travail d’atelier de Sabrina Boukhenous, voici un extrait d’un atelier qui s’est tenu dans le cadre d’un projet similaire à celui qui est décrit dans ce document: « Du corps aux mouvements, du geste aux sons », Université Lyon III, 2024 :
Atelier de Sabrina Boukhenous. Extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (9’30”-10’50”)
La première partie du matin (9h20-10h45) se déroule dans la salle d’ensemble, dans la configuration décrite ci-dessus. Les activités expérimentées lors des différents ateliers qui se sont tenus la veille (le 18 septembre) et qui ont été suivis par toutes et tous, sont maintenant regroupées dans un seul ensemble : jeu sur divers instruments, voix amplifiée et corps en mouvement. Il y a trois groupes d’une quinzaine de personnes qui se succèdent sur l’espace de l’estrade et utilisant aussi l’espace de la danse, pour expérimenter des situations avec une personne dirigeant à l’aide des cartons de couleur. Les temps de séquences de performance varient de 2 minutes à 4 minutes. Elles sont suivies à chaque fois d’une courte période (entre 4 et 10 minutes) pour exprimer des réactions, des sentiments ou proposer des actions, parfois soulever des questions importantes. À chaque fois la direction de l’ensemble et les différents rôles changent librement, les danseurs devenant instrumentistes, la voix parlée est assumée par quelqu’un d’autre, etc.
Laboratoire sonore au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (17’25”-18’42”)
Un des aspects spécifiques du dispositif est la présence des textes écrits lors des ateliers, lus à haute voix à travers le microphone placé sur scène à cet usage. Selon les consignes données par Giacomo, la voix n’a pas à suivre les codes couleur, mais déroule son débit en solo, selon le choix de celle ou celui qui le lit. La difficulté principale est de pouvoir entendre clairement la voix parlée, soit que les protagonistes n’ont pas l’habitude du micro, soit qu’ils manquent d’assurance ou d’énergie, soit encore que le niveau sonore des instruments reste trop fort, le regard porté sur les cartons de couleurs ne permettant peut-être pas une écoute immédiate de ce que font les autres. Giacomo assez tôt dans la séance montre au micro comment la voix doit s’engager plus franchement. Lors de la période de jeu du groupe 3, à un moment donné, il est décidé de ne pas utiliser les codes couleur, mais de se baser uniquement sur la voix avec la nécessité de pouvoir comprendre le texte, la voix devenant le chef d’orchestre. Après avoir essayé cette idée, un court débat a lieu sur des notions d’improvisation : la nécessité de l’écoute, la question des réactions par rapport aux énergies en présence, par rapport aux propositions, l’idée de laisser la place aux autres, notamment au texte. À la fin de cette première partie de matinée, une situation est expérimentée avec 3 personnes à la voix lisant leur texte.
La présence des textes, donne à plusieurs reprises l’occasion de soulever la question de l’engagement physique (notamment par Giacomo) et vis-à-vis du sens qu’on met dans le texte. Il est bien sûr très difficile de s’engager de manière immédiate dans une activité qu’on fait pour la première fois, lorsqu’on ne sait pas où cela va mener. Mais la difficulté de l’engagement chez les étudiants provient aussi du fait qu’on n’adhère pas (encore) à quelque chose trop éloigné des valeurs esthétiques qu’on défend au quotidien dans le conservatoire. Les comportements induits par la musique savante européenne écrite sur partition impliquent à la fois un engagement profond des compositeurs dans leurs projets esthétiques, et au contraire un détachement assumé des interprètes appelés à jouer une diversité d’esthétiques. On pourrait dire que dans ce contexte, l’engagement de l’interprète ne se fait qu’au moment de prestation en public, dans une posture où, comme chez les acteurs de théâtre, l’engagement approprié est « joué ». Dans ce contexte, on n’a pas l’habitude de se lancer corps et âme dans n’importe quelle activité sans auparavant avoir pu mener une réflexion à son sujet, l’esthétique n’est donc pas un engagement mais un jeu. L’engagement des interprètes du secteur qu’on appelle « classique » se manifeste surtout vis-à-vis de la manière d’envisager la production sonore et par là, leur identité principale est tournée vers leur instrument ou leur voix. Le corps de l’être humain occidental tend à être déconnecté de la signification, le corps doit construire la signification par le biais de contextes particuliers, avec le risque de ne pas accéder à un état plus fondamental dans lequel le corps assume et croit en sa propre production de signification. Or il existe beaucoup de pratiques musicales (et de danse) où l’engagement des performers n’est pas séparé des conditions de production et où la signification est fondamentale dès le départ, c’est-à-dire à tous les niveaux de compétence. C’est le cas notamment des pratiques musicales de l’Orchestre National Urbain et au sein des actions qu’il mène dans les quartiers défavorisés.
Certains étudiants ont décidé d’être présents aux séances, mais de ne pas participer aux pratiques proposées et d’être là en observateurs. C’est une infime minorité, 2 ou 3 parmi la cinquantaine de présents. Giacomo avait bien spécifié qu’il était permis d’avoir cette attitude, qu’il n’y avait pas d’obligation à participer à l’action. Pourtant l’un d’entre eux a rejoint le groupe actif au moment où ont été essayées des improvisations non basées sur les codes couleur et sans la présence d’un chef, en suivant les évolutions d’un texte ou en se laissant influencer par la danse. Il a pris la guitare électrique posée à l’horizontal, l’a accordée selon la norme et s’est mis à la jouer dans la position habituelle du jeu à la guitare.
Pour la danse, les termes de « mouvements du corps » sont souvent utilisés pour bien marquer qu’il s’agit d’une part de déplacements libres dans l’espace et d’autre part qu’il n’y a pas une ambition artistique à caractère technique qui empêcherait la participation immédiate de toute personne présente. La danse n’est pas utilisée pendant la première partie du groupe 1, puis petit à petit prend plus d’importance. Très vite on voit la nécessité pour le chef ou cheffe de voir la danse (autant que d’écouter les instruments) pour influencer les décisions de changement de couleur. Avec le groupe 3 (après l’expérimentation de suivre le texte) il est décidé que la musique soit influencée par la danse plutôt que de suivre les codes couleur. Comme dans le cas du texte, cet essai suscite un débat sur les rapports danse-musique : sont abordées les questions de l’imitation en miroir, des conditions de suivi collectif des musiciens, du risque de l’empire d’un domaine artistique sur un autre et de la nécessité d’une communication qui circule. Une idée est proposée : une improvisation où tous ces axes de travail se mélangent.
Concernant la présence d’une personne qui dirige avec les cartons de couleur, la pratique effective soulève au fur et à mesure plusieurs questions. Un des aspects importants est qu’à chaque séquence de jeu, il y a une nouvelle personne qui dirige, il n’y a donc pas l’écueil du développement de « spécialistes » de cette activité, et il y a une distribution démocratique des différents rôles. Mais ce dispositif précisément tend à renforcer la représentation générale qu’ont les personnes présentes du pouvoir dominateur du chef d’orchestre. Aussi, ceux et celles qui en assument le rôle, ont tendance à surinvestir le pouvoir qui leur est donné : il ne s’agit pas seulement de montrer des codes couleur et d’indiquer des niveaux d’intensité sonore, il s’agit par des attitudes corporelles exagérées de faire passer des informations aux instrumentistes pour qu’elles soient respectées, on est rapidement dans une situation similaire au « sound painting ». Ce surinvestissement de et sur la personne du chef, résulte dans la domination de l’œil sur l’oreille, avoir à regarder constamment le chef empêche de se concentrer à la fois sur sa propre production et sur l’écoute de la production des autres.
La dualité oralité-écriture est un élément très important qui se joue dans le contexte du CNSMD et des formes musicales qui en définissent les contours. Mais l’enjeu paraît tout à fait différent s’agissant de contextes dans lesquels toute personne (quel que soit son niveau de compétences et son origine sociale) peut accéder de manière quasiment immédiate à des pratiques musicales artistiques. Dans ce cas, il convient pour y parvenir de manière convaincante d’inventer des mécanismes très précis. Vers la fin de cette première partie de matinée, Giacomo rappelle le contexte pédagogique du travail en cours : la difficulté est de faire des choses dans des contextes de culture défavorisés, ou dans le cas de la rencontre entre différentes cultures. Comment construire des activités qui dès le début offrent la possibilité de se confronter à des enjeux fondamentaux mais de manière accessible, comment faire construire par celles et ceux qui participent leurs propres situations significatives. L’accès à des comportements actifs priment au début sur toute considération de qualité artistique ou de comportements normalisés. Les codes couleur et la présence d’une personne qui les manipule pour donner une forme à la performance assurent dans tous les contextes un accès rapide à une pratique effective, dans laquelle les enjeux artistiques ne sont pas du tout réglés, mais qui pourtant sont déjà inscrits dans le contenu de l’action.
3.3 L’atelier Human Beat-Box
Joris Cintéro :
La journée du 16 septembre (aux grandes Voisines) se clôt par le biais de l’atelier de Sébastien Leborgne (Lucien16), centré sur le Human beat-box. Sébastien est membre de l’Orchestre National Urbain et artiste rap, spoken word.
L’atelier se déroule dans une salle à l’intérieur du bâtiment. La salle est particulièrement petite et se trouve dans le passage d’un couloir, en face de plusieurs ascenseurs : il y a un peu de passage.
L’atelier mobilise assez peu de matériel : quelques feuilles de papier, une console, un looper, un micro ainsi qu’une enceinte permettant d’amplifier le tout.
Sébastien décrit le déroulement de son atelier. Il commence par expliquer le principe du Human beat-box. Pour ce faire, il dessine sur une feuille plusieurs instruments. On voit une grosse caisse, une caisse claire ainsi qu’une cymbale charleston. Il montre directement le son qui peut être associé à chacun des éléments dessinés sur la feuille en les pointant du doigt. Il met ensuite en pratique ce qu’il dit en enregistrant une boucle de beat-box.
Par la suite il demande aux participants de l’atelier (qui sont essentiellement des membres de l’Orchestre National Urbain et du CNSMDL) de réaliser une boucle eux-mêmes. Durant les ateliers un groupe de 3 enfants s’arrête pour écouter ce qu’il se passe. Sébastien les invite à essayer à leur tour de produire une boucle avec le looper. Les enfants rient semblent gênés mais s’exécutent néanmoins. Il en profite pour leur demander s’ils sont disponibles le lendemain pour participer à l’atelier. Cet atelier se déroule dans un temps particulièrement limité au regard des précédents, donnant à voir la plasticité du dispositif mis en œuvre par les membres de l’Orchestre National Urbain – ainsi que les difficultés, visiblement, régulières auxquelles se heurte le collectif.
Jean-Charles François :
Pendant la deuxième partie de la matinée du 19 septembre (au CNSMDL), j’ai assisté à un atelier de « Human beat-box » animé par Sébastien Leborgne (Lucien 16’s).
L’agencement technique du studio au CNSMDL consiste en un micro pour amplifier la voix du soliste, avec une machine qui permet l’échantillonnage des sons produits et la mise en boucle, pour créer des rythmes répétitifs, avec possibilité de superposer les échantillonnages de productions vocales. Plusieurs micros sont à disposition pour pouvoir enregistrer plusieurs voix en même temps.
L’introduction par Sébastien définit le contexte de production de rythmes par l’imitation vocale de sons de batterie (beat box) sur lesquels on va pouvoir parler un texte.
La première expérimentation concerne l’imitation à la voix de sons de grosse caisse, de charley, de caisse claire, et de les enregistrer pour les mettre en boucle. On crée une boucle sur laquelle les participants peuvent ajouter une autre production vocale pour former une nouvelle boucle.
La situation suivante décrite par Sébastien concerne a) l’élaboration d’une boucle rythmique avec 4 vocalistes ; b) puis le placement du texte sur cette structure rythmique. Sébastien dit que les étudiants doivent réaliser cette tâche en complète autonomie, il n’est là que pour répondre à des questions éventuelles. La réalisation de la boucle se fait assez facilement sans qu’il y ait beaucoup de temps pour essayer plusieurs exemples. L’ajout du texte sur la boucle inventée pose plus de problème, car les participants lisent leur texte sans inflexions rythmiques, indépendamment du contenu de la boucle. Sébastien suggère que la boucle qui accompagne le rythme du Human Beat box corresponde au caractère du texte et non l’inverse : « vu que ce texte est un rêve », la boucle doit refléter cette atmosphère.
Nouvel essai d’élaboration d’une boucle beat box à cinq voix superposées. Une étudiante dit son texte sur la boucle. Elle tente de faire corresponde son texte au caractère rythmique de la beat box. Sébastien fait remarquer que l’enjeux principal n’est pas de correspondre au rythme de la boucle, mais de « s’imposer sur le rythme ». Le spoken word consiste à ne pas se soumettre au rythme de base, mais d’être guidé par l’émotion juste et vraie. L’étudiante refait la lecture de son texte sur la boucle, mais s’arrête assez vite.
Quelqu’un demande s’il est possible de chanter le texte. Réponse de Sébastien : « tu peux faire ce que tu veux ». Une étudiante essaie alors de parler son texte et de le chanter en partie.
En observant cet atelier, il apparaît clairement que le problème principal des étudiants du CNSMDL dans ce projet se trouve dans cette activité très nouvelle pour eux et elles d’avoir à écrire un texte et surtout de le parler avec un accompagnement rythmique.
Atelier Human beat box au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes »(13’25”-14’29”)
3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.
Jean-Charles François :
Dans l’après-midi du 19 septembre, une restitution du travail réalisé dans les ateliers a été proposée à l’ensemble de la communauté du CNSMDL, dans la cour intérieure juxtaposant la salle de concert. Un dispositif de diffusion des sons amplifiés avait été installé et l’espace était organisé de manière similaire à ce qu’on avait eu dans la salle de musique d’ensemble, une combinaison regroupée d’instruments autour d’une voix, un espace pour les mouvements de danse et les productions de peinture exposées à même le sol. Le public (peu nombreux en dehors des participants eux-mêmes) était assis sur les marches devant le bâtiment de la salle de concert.
Les trois groupes proposent des performances dans lesquelles il y a des musiciens, des danseurs et des « déclameurs » de texte avec souvent un changement de rôle au milieu. Dans l’attitude des performers, il y a un effet de compensation du fait que la production encore trop expérimentale ne correspond pas aux critères d’excellence artistiques en usage au CNSMD. Il s’agit semble-t-il de montrer a) le plaisir de faire une activité non conventionnelle, b) d’accentuer le côté énergique de l’expérience, c) de montrer qu’on est dans une situation de divertissement dans laquelle on peut se contenter de n’être engagé qu’à moitié et d) parfois de faire ressortir le caractère ironique par rapport à cette situation d’inconfort. Il n’y a pourtant aucune agressivité dans ces attitudes vis-à-vis de ce qui a été proposé, mais plutôt un problème de positionnement vis-à-vis de la communauté dans laquelle la restitution est proposée.
Dans le groupe 2, un chef très « compositeur » développe une forme qui met en scène des éléments dans une sorte de narration qui permet au texte d’émerger. Grâce à ce savoir-faire « maison », on se rapproche plus de ce qui pourrait éventuellement être accepté par l’institution comme artistiquement valable.
Restitution dans la cour du CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (20’35”-22’46”)
Lors de cette restitution, à un moment donné, une professeure du CNSMD est venue dans la cour pour manifester avec véhémence son désaccord avec ce qui était proposé et notamment le niveau sonore de l’amplification qui l’empêchait de faire cours.
En dehors de l’équipe de la FEM, partenaire du projet, aucune représentation de la direction du CNSMD n’était présente lors de cette restitution. Le directeur est pourtant très favorable au développement de ce type de projet.
3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon
Jean-Charles François :
Une journée de bilan du projet a été organisée au CNSMD de Lyon avec les personnes qui ont participé en tant qu’encadrants du projet et les étudiants de la FEM.
A) Réunion de bilan des encadrants de l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et du CNSMD de Lyon
La matinée a commencé avec une réunion de l’équipe d’encadrants, pendant que les étudiants et étudiantes se sont réunies séparément dans des petits groupes 4 ou 5 pour préparer ce qu’ils allaient dire lors de la séance générale de retour d’expérience. Étaient présents à la réunion de l’équipe : pour le Cra.p, Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne ; pour le CNSMD Karine Hahn, Joris Cintéro, Guillaume Le Dréau ; et moi-même, Jean-Charles François en tant qu’observateur extérieur pour PaaLabRes.
Voici en vrac les questions posées lors de la réunion :
- Quels sont les aspects formatifs du projet pour les étudiants et à travers quelles problématiques ?
- Quels sont les enjeux du projet ?
- Penser l’après projet : d’autres partenariats avec l’Orchestre National Urbain ou d’autres cadres ?
Les étudiantes et étudiants ont eu à se confronter de manière pratique à des enjeux musicaux pensés dans une continuité avec des contextes sociaux et politiques. Ils et elles ont dû manipuler, fabriquer des sons dans des situations de transversalité et de transdisciplinarité, c’est-à-dire en se confrontant à des matériaux musicaux inconnus, à envisager des pratiques impliquant plusieurs domaines artistiques simultanément, et à rencontrer des cultures différentes de leur environnement social et artistique. Leurs représentations esthétiques ont été remises en question par ces diverses approches. Les aspects pédagogiques du projet étaient centrés sur l’expérimentation de pratiques musicales ouvertes à tous et toutes quelles que soient les capacités, sur l’invention de dispositifs en vue de la rencontre avec l’altérité. Les deux questions essentielles ont été : comment faire faire de la musique ensemble avec tout public ? Et qu’est-ce que c’est exactement de monter un projet dans des lieux et des circonstances déterminés ?
Deux réflexions critiques apparaissent dans le cours de cette réunion :
- Le problème de la valse des étiquettes prévalentes dans chaque milieu culturel qui classifient une fois pour toute les pratiques, soit pour les porter aux nues, soit plus souvent pour les considérer comme non digne d’intérêt, soit encore pour les rationnaliser pour mieux les contrôler dans l’ordre dominant des choses. Comment dans les rencontres transversales, trans-esthétiques, envisager des situations où une certaine indétermination des matériaux va pourvoir faire émerger des terrains esthétiques nouveaux et communs aux diversités en présence ?
- Le problème du tourisme intellectuel et artistique est prévalent aujourd’hui dans beaucoup de programmes d’enseignement supérieur au nom de l’accès à la diversité du monde. Les expériences de cette diversité se multiplient dans le cours d’une formation sans qu’il y ait assez de temps pour approfondir les contours d’une seule situation. L’enrichissement culturel va souvent de pair avec une incompréhension des enjeux majeurs des diverses pratiques. Comment dans des situations de temps limités sortir de cette difficulté ?
L’Orchestre National Urbain a comme cahier des charges le « tutorat », il est ouvert en permanence à des demandes de formation et de développement de projets ou de lieux.
B) Bilan avec les étudiantes et étudiants du CNSMD
Chaque groupe d’étudiants présente tour à tour les conclusions de leur réflexion. Le groupe d’étudiantes et étudiants ayant été présent aussi à l’Université Lyon II prendra la parole en dernier. Dans l’ensemble la tonalité des retours est en très grande majorité très positive, les objectifs artistiques, sociaux et politiques d’une telle action sont bien compris et les mises en pratiques ont été vécues de manière significative. Voici les différents éléments qui ont été exprimés :
- L’idée de désacraliser l’instrument de musique. L’instrument n’est plus considéré comme une entité spécialisée, mais plutôt comme un objet comme un autre susceptible de produire des sons. L’accès immédiat de tous à la production sonore permet une mise en situation de tous les enjeux présents dans la pratique musicale, que ce soit du côté des techniques de production que des questions artistiques. La nécessité de produire une musique à partir de matériaux qu’on ne maîtrise pas au premier abord permet de sortir des logiques d’expertise et met tous les participants à un niveau égal de compétences. Pour un des étudiants, on est proche des démarches de l’art brut et de Fluxus. Cela devrait permettre les rencontres effectives entre participants d’origine différente. Les instruments bricolés (ou le bricolage des instruments) permettent d’envisager une façon différente de considérer la matière sonore, le timbre, l’utilisation de sons généralement considérés comme étrangers au monde de la musique.
- Déclamer un texte avec les instruments. Cet aspect est sans doute l’élément le plus difficile à réaliser pour des spécialistes de musique instrumentale. Le « Human beat-box » est vécu comme l’activité qui suscite le plus l’invention de matières sonores par le biais de simples rythmes.
- L’improvisation à partir de consignes simples à réaliser. C’est ce qui rend possible d’être maître de sa propre production. C’est un moyen de s’approprier l’improvisation de manière décomplexée. Cela crée une dynamique de la production immédiate découplée des préoccupations de ne jouer que ce qui est complètement maîtrisé.
- Les logiques de l’amplification sont ce qui est le plus mal connu des étudiants du CNSMDL, cette première approche a été très appréciée.
- Le rôle de la direction d’orchestre : il faut oser assumer ce rôle pour contrôler la forme générale d’une improvisation, dans les perspectives de construire une composition instantanée. Pour une partie des étudiants/étudiantes, la présence du chef est un obstacle à l’improvisation qui implique une responsabilité individuelle et demande à être abordée de manière moins urgente pour permettre l’établissement de dialogues sans passer par l’autorité du chef ou de la cheffe.
- L’idée de faire des choses immédiatement avant toute réflexion est un élément important des pratiques qui ont été proposées. Il y a l’urgence de se mettre à faire des choses sans se poser de questions, de faire ce qu’on ne maîtrise pas encore avant d’envisager les moyens à employer pour y arriver.
- Un aspect important du projet est d’encourager la participation du public, comme ce qui s’est passé à la fin du concert de l’Orchestre National Urbain (à l’Université Lyon II) où tout le monde s’est mis à danser dans l’amphithéâtre de l’Université.
Parmi les problèmes soulevés par le projet, certains ont noté une organisation du temps qui a paru parfois trop lente et parfois trop courte. L’ennui ou la frustration est à l’origine d’une certaine fatigue. Il y a une inquiétude au sujet de la notion de « travail », induit par cette situation d’immédiateté du faire qui peut instiller l’idée d’une dévaluation très forte de la notion d’art. Une étudiante fait part de sa frustration devant les niveaux d’amplification trop forts et l’absence de sons consonants, qui résultent en une grande fatigue chez elle. Plusieurs personnes ont noté l’absence de relations entre l’atelier de peinture et la musique.
Le problème de la restitution dans la cour du Conservatoire a fait l’objet d’un vif débat. La situation allait complètement à l’encontre de la culture dominante de l’institution vis-à-vis d’une grande exigence d’excellence dans toute prestation. En plus la restitution utilisait des moyens de production musicale très peu en usage au sein de l’institution, dans un style indéfini par rapport aux contextes en vigueur. Les niveaux d’amplification rendaient impossible d’ignorer cet évènement dans les moindres contours du Conservatoire. Les étudiants étaient donc placés devant l’obligation de faire quelque chose qui allait entrer directement en conflit avec la communauté alentour et qui risquait de les disqualifier. Beaucoup des participants se demandent si cette idée de restitution était vraiment nécessaire à la conduite générale du projet. Les étudiants ont dû faire face aux nombreux commentaires ironiques de leurs collègues présents à la restitution. Une phrase a été retenue à ce sujet : « Les ploucs de la cour ! ». D’autre termes avaient été prononcés comme celui de « dégénérés » aux connotations historiques plus inquiétantes. Une médiation était peut-être nécessaire auprès du public avant la restitution en vue d’expliquer la situation et son contexte pédagogique.
Joris Cintéro, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (22’50”-23’44”)
Dans les réponses apportées par les membres de l’encadrement du projet la nécessité de rendre public une activité peu commune dans les pratiques du Conservatoire reste d’une importance capitale, ce n’est pas une question générale qu’il conviendrait de balayer sous les tapis de l’anonymat, mais quelque chose qui a besoin d’être mise « sur la table » des réflexions actuelles sur l’art et de sa transmission à tous les publics.
Pour Giacomo la restitution au CNSMD n’était pas prévue au départ, mais l’impossibilité d’avoir tous les étudiants présents à Lyon II pour la restitution générale du projet a changé la donne. Il comprend la frustration des personnes présentes au niveau « art », mais il convient de déplacer le problème du côté de la légitimité des activités proposées. Pour lui, la question est de savoir comment les institutions d’enseignement de la musique vont mettre en place des dispositifs en vue d’ouvrir leurs activités à des personnes n’ayant aucun accès aux pratiques. Il fait remarquer que le problème le plus évident dans son travail au sein des diverses institutions dans lesquelles il développe ses projets, c’est l’attitude souvent négative des personnels de l’encadrement, professeurs, animateurs, travailleurs sociaux, etc. Ceux-ci défendent leur pré carré et ont souvent une attitude qui consiste à penser que les personnes placées sous leur autorité doivent se plier à leur propre mode de pensée. S’ils ne sont pas impliqués directement dans le projet, le déroulement du projet est fortement menacé. La connaissance effective d’un projet par l’institution d’accueil dans sa totalité est un élément essentiel pour commencer à faire vivre une idée.
Lorsque les animateurs culturels sont bien disposés envers les projets de l’Orchestre National Urbain, les choses se passent de manières très positives. Voici un exemple d’un commentaire de Khadra Hamyani, aide éducatrice au « Forum Réfugié », lors de la participation de jeunes réfugiés à un projet développé par le Cra.p à l’Université Lyon III en 2024 intitulé « Du Corps aux mouvements, du geste aux sons »:
Khadra Hamyani, extrait de la vidéo « Du corps aux mots, du geste aux sons » (2’37”-5’34”).
Karine Hahn rappelle qu’il y eu d’une part une visite de Giacomo l’année d’avant la réalisation du projet a été l’occasion de présenter en détail les contours et enjeux du projet, d’autre part une page de présentation du projet et de ses objectifs a été distribuée peu de temps avant sa réalisation. Dans un contexte où souvent les personnes impliquées ne comprennent pas de la même manière les termes d’un projet, ou même il peut arriver qu’elles comprennent exactement le contraire de ce qui est proposé, toute médiation semble peu utile pour éviter l’expression conflictuelle. Ce qui compte par contre, c’est l’affirmation par l’action d’une légitimité.
Joris Cintéro souligne la difficulté qu’ont les institutions à questionner par des enquêtes leurs propres manières de fonctionner, notamment en matière de recrutement des personnes présentes. La dernière enquête sur la composition sociale des étudiants du CNSMD de Lyon date de 1983[1], elle a montré qu’il y avait la présence de 1% d’enfants d’agriculteurs et 2,8% d’ouvriers, etc.
La question de la restitution s’inscrit dans les divers contextes de difficultés par rapport à l’administration générale des institutions et aux personnes qui y travaillent.
Une étudiante présente à l’Université Lyon II note qu’au début du premier jour, personne n’était présent disposé à travailler avec l’Orchestre National Urbain, il n’y avait pas eu de publicité de la part de l’institution d’accueil, pas de soutien. Il a fallu faire des efforts immenses pour rameuter 5 personnes disposées à s’impliquer.
Pour Giacomo, la résistance de l’Université dans ce projet est évidente, il n’y a pas de professeurs impliqués, rien n’avait été fait pour faciliter les choses. On a l’impression que parce que ça ne coûte pas d’argent, il faut que ça se casse la gueule. Le soir du premier jour se pose la question de savoir s’il convient de continuer le lendemain. La réponse est définitivement qu’il faut absolument continuer, il faut persister et jouer avec la situation.
Pour Joris, 5 ou 6 participants sur 29500 étudiants on est loin du compte dans le domaine de la culture.
Sébastien Leborgne décrit en détail le fonctionnement des Grandes Voisines, avec la présence de 415 réfugiés hébergés, beaucoup de femmes et d’enfants.
Karine décrit le démarrage aux Grandes Voisines : tout est prêt à 10 heures du matin, le setup technique est en place, l’équipe prête à travailler, mais personne n’est là pour participer. Mais cette préparation garantit d’être pris au sérieux, l’équipe est là, devant personne, avec le même sérieux que s’il y avait des gens présents. Petit à petit les gens passent par là, ça se met en branle, ça existe, ça marche de toute façon.
Dans le courant de l’après-midi, une vidéo de 11 minutes montre de manière fragmentée ce qui s’est passé aux Grandes voisines. Un des segments qui frappe particulièrement est un quatuor de trombones composé de trois enfants et une mère jouant et en même temps évoluant dans des mouvements corporels d’une grande cohérence collective.
Dans les diverses réponses aux préoccupations des étudiants par les personnes de l’encadrement du projet, on notera les choses suivantes :
- Concernant la question de la nécessité d’un faire immédiat rapidement mis en place, au prix d’un contrôle de qualité, Giacomo souligne que la plupart du temps, les projets qu’il mène dans les différents contextes se déroulent dans des temporalités très limitées, le passage du groupe est souvent éphémère. Ici le faire doit absolument précéder la théorie.
- La question du long terme est abordée en mettant l’accent sur l’existence du Cra.p comme centre de pratiques, comme lieu de formation permanente, avec aussi l’objectif de permettre à des personnes issues des quartiers défavorisés d’accéder à des programmes diplômants d’enseignement supérieur.
- Le choix des instruments utilisés fonctionne sur deux plans : d’une part, il faut permettre une première approche pratique de jeu sur des instruments réputés pour demander des années de travail ; jouer de manière immédiate du trombone et du violoncelle peut susciter l’envie d’apprendre à jouer ces instruments sérieusement. Et d’autre part donner aussi accès à des matériaux qu’on peut manipuler facilement au premier abord. Giacomo donne l’exemple de la guitare électrique à six cordes qui nécessite de montrer comment on en joue, alors que le « spicaphone », instrument qu’il a construit avec une seule corde donne un accès plus immédiat à une pratique effective.
Au sujet de l’accès de tout public aux pratiques musicales, Giacomo rapporte l’histoire d’une mère, lors d’une performance donnée par son fils, qui pleure en disant « je ne savais pas que mon fils pouvait avoir le droit de faire de la musique ». Dans des pans entiers de population, les gens pensent que l’accès à des pratiques artistiques leur est complètement interdit. La question des droits culturels est essentielle. Karine remarque le manque de lieux ouverts aux pratiques : où sont les espaces existant hors « formations structurées » ou écoles spécialisées dont l’accès est limité ? En dehors du Cra.p, il y a un manque crucial.
Photos du projet au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (13’08-13’56”)
Partie IV : Le projet de Création Collective Nomade
à l’Université Lumière Lyon II
4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II
Jean-Charles François :
La session du matin du 21 septembre 2023, se déroule au sein de l’Université Lumière Lyon II (sur les quais du Rhône) dans l’espace où sont exposées des œuvres d’art dans le cadre de la Biennale Hors Norme et dans le grand amphithéâtre.
Étant donné les difficultés rencontrées aux Grandes voisines, au dernier moment 20 réfugiés adolescents (tous masculins) du Centre d’hébergement du 1er arrondissement de Lyon ont pu venir participer à cette matinée et à la restitution du lendemain en fin d’après-midi. Ils ne pouvaient être là que pendant une heure et demie (10h.-11h.30) étant donné les règles strictes du Centre concernant les repas. Trois étudiantes et un étudiant du CNSMD étaient présents de manière volontaire. Des étudiants de Lyon II et des visiteurs de l’exposition de la BHN pouvaient participer aux ateliers, mais cela a été un phénomène très marginal. Giacomo m’a fait part de ce qui s’était passé la veille (le 20 septembre), où un certain nombre d’étudiants de l’Université Lyon II avaient participé aux ateliers, au gré de leur passage dans la salle d’exposition. Ceci malgré le fait qu’aucune publicité n’avait été faite auprès des étudiants. Leur participation dépendant de leur passage dans l’espace des activités et de leur intérêt éventuel pour ce qui était proposé.
C’est un aspect qui arrive souvent aux actions menées par Giacomo et l’Orchestre National Urbain : s’ils sont souvent invités officiellement à développer leurs projets dans une institution, des obstacles ne manquent pas de se manifester de la part des personnels internes à l’institution. Les raisons de ce manque de coopération s’expliquent soit parce que ce qui est proposé vient empiéter sur des prérogatives installées, soit qu’on ne voit pas d’un bon œil la présence de personnes étrangères à l’institution (ou à son public habituel). Dans tous les cas, l’attitude de l’Orchestre National Urbain est de s’installer dans un espace donné et de susciter l’intérêt des personnes qui s’y trouvent ou qui passent par là.
Voici les commentaires d’une étudiante de la Formation à l’Enseignement du CNSMD de Lyon qui a participé à un projet similaire de l’Orchestre National Urbain en 2024 à l’Université Lyon III intitulé « Du corps aux mouvements, du geste aux sons »:
Marie Le Guern, étudiante en formation à l’enseignement, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (8’47”-9’07”)
4.2 Les ateliers
Jean-Charles François :
Étant donné le temps limité par la présence des jeunes réfugiés, l’organisation des ateliers a été limitée à 15 minutes. Cela permettait à 5 groupes de participer à 5 ateliers l’un après l’autre, puis un regroupement général des participants dans l’amphithéâtre de 15 minutes. Cette organisation n’a pas été complètement réalisée dans le temps imparti, chaque groupe n’a participer en fait qu’à 4 ateliers (parmi les 6 proposés) avant la séance dans l’amphithéâtre.
6 ateliers proposés étaient (comme au CNSMD):
a. Danse.
b. Violoncelle.
c. Trombone.
d. Beat box.
e. MAO.
f. Laboratoire sonore.
g. Peinture.
Ateliers à l’Université Lyon II (MAO, Human beat box, violoncelle, trombone), extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (23’58”-26’10”)
Les ateliers se déroulaient dans le grand espace de l’exposition BHN et dans deux espaces adjacents. Le principe était exactement le même que celui décrit plus haut, avec pratique immédiate des matériaux et utilisation des codes couleur. Il s’agit des mêmes mises en situation déjà décrites auparavant, inutile donc de les décrire en détail.
Du fait du temps limité et du nombre déséquilibré entre le groupe du Centre d’hébergement et les autres participants, peu d’interactions entre les différents publics ne pouvaient avoir lieu lors de cette matinée. Certains groupes n’étaient composés que de membres du groupe de réfugiés. Dans le cas de l’atelier peinture, j’ai pu observer une situation de deux grandes feuilles de papiers juxtaposées sur lesquelles dessinaient deux groupes complètement séparés : le premier groupe n’était composé que de réfugiés masculins noirs Africains, le deuxième seulement d’étudiantes blanches Françaises.
La situation de disponibilité limitée du groupe du Centre d’hébergement demandait absolument que la matinée soit centrée principalement sur l’accueil approprié et l’organisation des activités des réfugiés, les autres participants ayant eu d’autres opportunités de participer dans des temps plus longs à tous les ateliers et situations de performance en grand groupe. De ce point de vue, le dispositif proposé a remporté un très grand succès auprès du public visé. Les réfugiés se sont engagés dans les diverses mises en pratique proposées dans les ateliers avec un grand intérêt et une énergie considérable. Une des forces de l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p est la capacité à s’adapter de manière immédiate à toutes les situations possibles, à faire face aux aléas des réalités techniques, institutionnelles, humaines, à contourner tous les obstacles sans pour autant mettre les personnes dans la situation de ne pas respecter les règles clairement établies et sans compromettre la façon d’envisager leurs propres pratiques.
Atelier trombone à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’52”-27’54”)
4.3 L’atelier « Laboratoire sonore » dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II
Jean-Charles François :
Le regroupement de tout le monde dans l’atelier « Laboratoire sonore » animé par Giacomo Spica Capobianco dans le grand Amphithéâtre, dans une situation tout à fait similaire à celle décrite dans la journée du CNSMDL, a été l’occasion d’observer plusieurs nouveaux phénomènes. Si le système des codes couleur a très bien fonctionné pendant cette matinée comme élément commun à tous les ateliers, son utilisation dans le regroupement des diverses activités dans l’amphithéâtre a été moins évidente. On avait là affaire à des représentations culturelles différentes : on peut spéculer que contrairement aux étudiants du CNSMDL, les jeunes Africains avaient rarement fait l’expérience d’un travail avec un chef d’orchestre. La plupart d’entre eux jouaient sans prendre en compte les indications données par les codes couleur, le plaisir d’une activité très nouvelle les centrait sur leur propre production. Par contre, certains d’entre eux ont éprouvé un grand plaisir à se trouver dans le rôle du chef, dans l’idée de pouvoir en quelque sorte sculpter la pâte sonore. Dans le cas d’un très jeune réfugié qui a dirigé à deux occasions (sur les deux jours), on a pu observer un progrès certain dans sa manière de déterminer la forme de la prestation. Les pratiques visuelles de respect d’une organisation écrite ne sont pas forcément présentes dans les représentations qu’on peut avoir des pratiques musicales. Comment résoudre la rencontre de la diversité des conceptions de la communication orale (aurale) et de sa structuration éventuelle par des représentations visuelles ?
Laboratoire sonore à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (34’55”-35’15”)
A l’issue de cette matinée, Giacomo invite les réfugiés à revenir le lendemain pour la restitution à 17 heures (ils ne pourront rester au concert de l’Orchestre National Urbain car ils doivent impérativement être rentrés dans le Centre à 20 heures). Giacomo au vu des aspects très positifs de la matinée exprime en privé, l’idée qu’il faut absolument proposer au Centre d’hébergement de continuer à faire un travail régulier avec les jeunes résidents, même si le temps de résidence de toutes personnes dans ces centres reste très limité.
Guy Dallevet, Artiste plasticien, « La Sauce Singulière », Biennale Hors Normes, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’11”-26’50”)
4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II
Jean-Charles François :
La restitution du travail des divers ateliers a eu lieu le 22 septembre à 17 heures, dans le grand amphithéâtre de l’Université « Lumière », Lyon II.
La grande majorité des jeunes du Centre d’hébergement sont revenus, mais ils doivent impérativement être de retour avant 20 heures. Les mêmes 3 étudiantes et 1 étudiant du CNSMD sont activement présents. Un nombre indéterminé d’autres participants, étudiants de Lyon II ou visiteurs, observateurs sont aussi là, pas forcément en tant que participants aux performances. L’équipe de l’Orchestre National Urbain est là : Giacomo Spica Capobianco, Lucien 16s, Sabrina Boukhenous, Selim Penaranda, Odenson Laurent et David Marduel. Karine Hahn, Joris Cintero, Noémi Lefebvre et Guillaume Le Dréau sont présents représentant l’équipe de la FEM du CNSMD. Certaines de ces personnes faisant partie de l’encadrement du projet participent aussi de temps en temps aux performances. Guy Dallevet est présent en tant qu’animateur des ateliers de peinture et représentant la Biennale Hors Norme en tant que président de l’association organisatrice La Sauce Singulière.
8 groupes différents présentes 8 performances selon la même organisation de stations instrumentales des ateliers regroupés, la présence de chefs et cheffes qui tournent constamment, et le principe des codes couleur.
En observant le déroulement de cette restitution, plusieurs questions viennent à l’esprit. On peut se demander si une telle mise en situation devant un public a sa raison d’être ? Et ceci à la suite aussi de la restitution des ateliers dans la cour du CNSMD et de la question de présenter des choses imparfaites en gestation, de se mettre en porte-à-faux par rapport aux exigences du spectacle vivant professionnel. Il y a pourtant des raisons importantes à publier, à rendre compte ce qu’on fait : non seulement l’objectif principal des ateliers est directement lié à une pratique qui n’a de sens que dans une présentation publique, mais l’acte de rendre public une activité donnée détermine qu’elle n’est pas laissée dans le secret des salles d’atelier, qu’elle est offerte au regard critique de tous, il s’agit de mettre cartes sur table. C’est ce qui différencie l’éthique de l’enseignement du service public des possibles dérives sectaires du privé.
La restitution n’est pas la simple répétition du travail d’atelier. D’autres enjeux se font jour à cette occasion :
- L’idée même de présenter quelque chose en public recentre l’attention des participants sur la nécessité d’un engagement et d’une présence particulière sur scène.
- La répétition du même mais dans un contexte différent avec des enjeux plus étoffés change les conditions de la prestation et l’enrichit considérablement.
- La situation favorise aussi de manière subtile les rencontres et échanges entre les divers groupes en présence, parce que l’attention des performers est partiellement libérée des contingences purement matérielles.
Restent deux questions liées au dispositif des codes couleur :
- Est-ce que la situation d’un ensemble (orchestre ?) dépendant des instructions d’un chef est favorable à l’engagement personnel, ou bien est-elle l’occasion au contraire de se cacher dans la masse ?
- Les codes couleur peuvent empêcher la recherche d’autres solutions temporelles et organisationnelles, notamment dans la recherche de continuités de textures et de micro-variations.
Ces questions sont générales et ne s’appliquent peut-être pas de manière immédiate à un projet aussi limité dans le temps et impliquant des groupes aussi radicalement différents.
Voici un commentaire d’un jeune réfugié, Bouhé Adama Traoré, qui a participé au projet de l’Orchestre National Urbain en 2024 à l’Université Lyon III:
Bouhé Adama Traoré, extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (21’31”-22’12”)
Après la restitution et avant le concert de l’Orchestre National Urbain, un pot a été offert dans la salle d’exposition de la BHN, malheureusement sans la présence des jeunes réfugiés.
Partie V : Le cadre esthétique de l’idée de création collective
Karine Hahn, CNSMDL de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (18’43”-20’07”)
Jean-Charles François :
L’idée de création collective est au centre du projet de l’Orchestre National Urbain : pour que la création collective puisse devenir une réalité dans les groupes hétérogènes en termes d’origines géographiques, sociales et culturelles, il faut absolument éviter qu’un groupe particulier dicte aux autres ses propres règles et conceptions esthétiques. Il convient plutôt de trouver des contextes dans lesquels les différentes personnes présentes ne puissent pas se baser exclusivement sur leurs pratiques usuelles. Par exemple, les musiciens ou musiciennes accomplies (comme dans le cas des étudiants du CNSMDL) ne doivent pas utiliser leurs propres instruments, afin de se mettre dans une situation d’égalité vis-à-vis de celles et ceux qui n’ont jamais fait de musique. Et pour donner un autre exemple, les personnes issues d’autres sphères géographiques extra-européennes ne doivent pas utiliser des chants ou des modes de jeu provenant de leur propre tradition.
Joris Cintéro, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (28’50”-30’28”)
Joris Cintéro :
Plusieurs remarques peuvent être formulées à ce sujet. Tout d’abord, une première liée aux nombreuses « prises »[2] qu’offre le dispositif[3] aux participants et participantes particulièrement lorsqu’ils et elles n’ont pas l’habitude de jouer de la musique. Dans le cadre d’une intervention comme celle de l’Orchestre National Urbain et dans ces circonstances, on peut considérer que ce qui est prévu initialement, et notamment les ateliers, est constamment mis à l’épreuve[4] de ce qui arrive (des lieux peu adaptés, des personnes déjà présentes réticentes et bien entendu des personnes souhaitant participer quand ça leur chante). À ce titre, ce court moment montre à quel point ce dispositif parvient à surmonter l’« épreuve » de son public. En effet, la nature de l’instrumentarium (qui renvoie difficilement à un « connu » antérieur et aux effets symboliques qu’il peut véhiculer), l’absence de codes esthétiques préalables (qui suppose leur connaissance et/ou leur maîtrise), de manières de faire prescrites (tenir son instrument de telle ou telle manière) et la simplicité d’un code couleur accessible aux personnes voyantes permet à celles et ceux qui participent d’élargir, autant que possible, leur nombre, en cours de route et moyennant seulement la présentation du code couleur. Dans les circonstances d’un lieu où le passage des personnes semble être la norme (en dehors des enfants, peu de personnes semblent stationner à l’extérieur), la plasticité du dispositif constitue sa force principale.
Autre remarque, celle du « cadrage » du dispositif par les membres de l’Orchestre National Urbain. Je fais ici l’hypothèse qu’une des conditions de félicité de l’action des membres de cet ensemble repose sur un enjeu majeur de distinction vis-à-vis des autres acteurs en présence. Cet enjeu semble important dans la mesure où, s’il existe véritablement des tensions entre les résidents d’un lieu tel que les Grandes Voisines et les travailleuses et travailleurs sociaux y officiant (comme on l’apprendra à plusieurs reprises pendant la journée), l’Orchestre National Urbain a tout intérêt à marquer sa distance vis-à-vis des dernier.es, et ceci de plusieurs manières. Il m’a semblé, au moins dans les discours et dans les manières d’agir une volonté de se singulariser via le type de « culture » dont il est fait la promotion (qui s’oppose à la chanson française promue par le personnel des Grandes Voisines), dans les manières d’investir les lieux (sans grand succès), dans les manières de s’adresser à autrui (en manifestant une forme de convivialité, qui sans être surjouée, constitue une manière de faire de la totalité des membres de l’Orchestre National Urbain que j’ai pu observer).
Jean-Charles François :
Pourtant, dans l’espace d’exposition de la BHN à l’Université Lyon II, à un moment donné informel du matin s’est déroulé un évènement intéressant :
Était exposée dans cet espace une sculpture sonore fait d’instruments de percussion et d’objets métalliques divers actionnés par un système mécanique automatisé. La sculpture était capable de développer une musique très rythmée d’une durée de 45 minutes sans répétitions de séquences. Un groupe de 5 ou 6 réfugiés s’est placé devant cette sculpture et en même temps que la musique qu’elle déroulait ils se sont mis à chanter et danser des musiques qu’ils connaissaient de leur tradition, pendant une séquence d’une dizaine de minutes.
Cette situation suscite trois commentaires par rapport à l’idée d’éviter ses propres habitudes culturelles dans des perspectives de pouvoir travailler avec n’importe qui d’autres dans l’élaboration collective d’un acte artistique :
- Il s’agit d’une situation spontanée qu’il ne faut surtout pas empêcher.
- La situation implique la confrontation à égalité de deux pratiques esthétiques différentes (la musique produite par une machine, la musique traditionnelle des réfugiés Africains) pour produire un nouvel objet esthétique qui procède des deux et qui les combinent.
- Le principe de situations évitant les pratiques instituées dans différents groupes pour créer un contexte d’égalité devant l’inconfort de l’inconnu s’applique aux rencontres initiales entre groupes hétérogènes, mais n’exclut pas forcément d’autres situations pratiques qui peuvent se développer par la suite.
Jean-Charles François, percussionniste, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (31’10”-34’54”)
Conclusion
Jean-Charles François :
Dans une société de plus en plus fragmentée en microgroupes qui affirment leur identité de manière forte, souvent à travers la disqualification des autres, toute tentative de trouver des médiations entre des univers apparaissant comme incompatibles doit faire face à des difficultés assez considérables. Pourtant la clé de la paix sociale se trouve dans les actions qui mettent en présence dans un même lieu, dans une même temporalité, et dans la même tâche à réaliser, des groupes dont les différences sont radicalement opposées. Dans ce genre de situation, il ne s’agit pas de nier les identités, mais de les ouvrir à la possibilité d’accueillir des personnes extérieures en reconnaissant les termes de leur mode d’existence, de trouver les situations de travail qui réunissent les différences. Il ne s’agit pas non plus de créer des formes artistiques passe-partout, clé en main, qui contenteraient les exigences de tout public, dans un bonheur olympique universel. Il s’agit au contraire de confronter dans des rituels les conflits fondamentaux pour les rendre manifestes et les traiter dans des pratiques communes qui ne prétendent pas les résoudre, mais qui les mettent en jeu (en entrejeu) pacifiquement.
Les actions menées durant l’automne 2023 conjointement par le Cra.p et l’Orchestre National Urbain, le département de la FEM au sein du CNSMD de Lyon, et l’Université Lyon II dans le cadre de la Biennale Hors Norme, correspondent tout à fait à cet idéal de faire se rencontrer des mondes différents. Le dispositif imaginé pour y parvenir se base sur trois conditions qui se combinent : premièrement une manière de structurer les pratiques permettant un fonctionnement immédiat commun à toute personne présente : instruments, matériaux, domaines d’action, codes-couleurs ; deuxièmement, cette structuration permet l’ouverture sur une liberté individuelle : improvisation, textes ; et troisièmement les mises en pratique sont conçues en vue de mettre tout le monde sur un plan d’égalité : situations pensées hors des rôles spécialisés, avec l’impossibilité d’utiliser les savoir-faire techniques acquis.
Giacomo Spica Capobianco, artiste musicien, directeur artistique du Cra.p, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (36’48”-41’10”)
Ceux et celles qui se lancent effrontément dans l’aventure d’établir des points de rencontre entre des groupes humains qui soigneusement évitent de se côtoyer sont bien téméraires. Ils doivent inventer des moyens de mettre en œuvre des pratiques impliquant la prise en considération d’autrui en évitant toute violence, mais sans édulcorer la réalité des tensions qui sont en jeu. Ils doivent si souvent faire face à l’inertie des professionnels installés et parfois à des refus intolérables. Leur présence admirable dans le paysage culturel et artistique, trop rarement reconnue, est d’une très grande importance.
Restitution à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo (41’11”-46’10”)
1.Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
2. Cette notion, empruntée aux sociologues Christian Bessy et Francis Chateauraynaud décrit « la rencontre entre un jeu de catégories et des propriétés matérielles, identifiables par les sens (supposés) communs ou par des instruments d’objectivation » (1992, p.105). Elle est initialement utilisée pour étudier le travail d’estimation des commissaires-priseurs dont la tâche peut être réduite au fait de rechercher des indices permettant d’articuler la perception des propriétés matérielles des objets et l’évaluation de leurs qualités par référence à un espace de circulation – en l’occurrence le marché de l’occasion. Ramenée à la situation dont il est ici question elle permet de comprendre en quoi certaines propriétés matérielles du dispositif (instrumentarium, code couleur, disposition de la salle, qualité des matériaux etc…) favorisent l’engagement des participant·e·s dans le sens où elles ne font pas obstacle à leurs dispositions physiques et perceptives – et qui permet d’expliquer, au moins dans un premier temps, les difficultés que rencontrent les « musicien·ne·s » vis-à-vis de ces mêmes propriétés matérielles.
3. Considérant le dispositif comme un « objet-composé » (Dodier et Stavrianakis, 2018), le terme ne décrit pas seulement ici l’agencement matériel du dispositif mais également le réseau d’individus, de normes et de rôles sociaux qui y sont attachés (les participant·e·s font ainsi partie intégrante du dispositif).
4. Si l’usage du terme « épreuve » peut tout à fait renvoyer à l’usage commun que l’on en fait, je l’utilise ici dans le sens qu’y investit la sociologie dite pragmatique (Lemieux, 2018), qui la définit comme « un moment au cours duquel les personnes font preuve de leurs compétences soit pour agir, soit pour désigner, qualifier, juger ou justifier quelque chose ou quelqu’un » (Nachi, 2015, p.57). Ici, je considère que ce qui est engagé par le dispositif (la crédibilité de l’Orchestre National Urbain, les enjeux artistiques et sociaux portés par les ateliers etc…) est mis à l’épreuve de sa réalisation, même si l’on peut tout autant considérer le dispositif comme une épreuve permettant de (re-) qualifier les individus qui y participent.
Références citées :
Bessy, C., & Chateauraynaud, F. (1992). Le savoir-prendre. Enquête sur l’estimation des objets. Techniques & Culture, 20, 105 134. https://doi.org/10.4000/tc.5029
Dodier, N., & Stavrianakis, A. (Éds.). (2018). Les objets composés : Agencements, dispositifs, assemblages. Éditions de l’EHESS.
Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
Nachi, M (2015). Introduction à la sociologie pragmatique. Dunod.
La ferme du Body Weather
Rencontre autour de la ferme du Body Weather
(la période 1985-90)
Entretien avec
Christine Quoiraud, Katerina Bakatsaki, Oguri
Christine Quoiraud, Katerina Bakatsaki, Oguri
Avec la participation de Jean-Charles François
and Nicolas Sidoroff pour PaaLabRes
2022-23
Traduction du texte original anglais en français de
Jean-Charles François
Sommaire :
1. Introduction.Présentation des entretiens
2. Avant la ferme du Body Weather, la rencontre avec Min Tanaka
3. Maï-Juku V et la création de la ferme. Tokyo-Hachioji-Hakushu
4. Body Weather, la ferme et la danse
5. Les communs au sein de Body Weather
6. Chorégraphie, improvisation, images.
7. Les relations avec le musique.
8. Conclusion. Après la ferme du Body Weather.
1. Introduction: Présentation des entretiens
L’origine de ce texte découle d’une première rencontre à Valcivières (Haute-Loire, en France) en 2020 dans le cadre de rencontres du CEPI (Centre Européen Pour l’Improvisation) entre Christine Quoiraud et Jean-Charles François. À cette occasion, Christine Quoiraud a présenté une conférence illustrée concernant le Body Weather, ses propres activités intitulées tout d’abord Corps/Paysage et de projets improvisés de longues marches pour danseurs et non danseurs, intitulés Marche et Danse. Dans les perspectives de la quatrième édition du collectif PaaLabRes, la documentation précise des diverses pratiques qui s’étaient déroulées pendant la présence de Christine Quoiraud à la ferme Body Weather au Japon (1985-90) est apparue comme d’une grande importance. Il restait en effet de nombreux points critiques à élucider après cette présentation, notamment concernant :
- Les relations entre les activités de la vie quotidienne à la ferme, les pratiques de l’agriculture, de l’élevage d’animaux avec les pratiques artistiques.
- Les relations entre ce qui se déroulait à la ferme et les performances en public.
- Les relations avec les fermiers vivant à proximité.
- Les relations entre la danse et l’environnement.
- Les relations entre la danse et la musique.
Christine Quoiraud a proposé à PaaLabRes d’organiser une rencontre en visio-conférence avec les danseurs, ex-membres ru Maï-Juku, Katerina Bakatsaki, vivant à Amsterdam, Oguri, vivant à Los Angeles, elle-même, vivant dans le sud-ouest de la France, et pour PaaLabRes à Lyon, Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff.
Deux entretiens avec toutes ces personnes se sont déroulés en visio-conférence le 31 mai 2022 et le 15 février 2023. Entre les deux entretiens, Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff ont formulé par écrit une série de questions. Nous avons décidé que les questions posées par PaaLabRes n’apparaîtraient que sous la forme de courtes introductions aux différentes parties.
L’enregistrement des échanges en anglais lors des entretiens a été transcrit par Jean-Charles François, avec l’aide précieuse de Christine Quoiraud, puis traduit en français. Le verbatim original anglais a été édité pour rendre les propos plus clairs pour la lecture, mais dans la mesure du possible, nous avons tenté de préserver le caractère oral des interventions. Nous remercions le Centre National de la Danse (CND) pour la permission donnée de reproduire les photos du Fonds Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
Les différentes parties ne suivent pas forcément le déroulement chronologique des deux entretiens, mais suivent le principe de grands thèmes dans une progression ayant sa propre logique d’organisation.
2. Avant la ferme du Body Weather, la rencontre avec Min Tanaka.
Présentation
Katerina Bakatsaki, Oguri, et Christine Quoiraud sont trois artistes de la danse qui ont en commun d’avoir participé de 1985 à 1990 à la ferme du Body Weather créée par Min Tanaka et Kazue Kobata à une centaine de kilomètres de Tokyo.
Pour situer leur démarche et faire en partie connaissance de leur parcours initial, cette introduction se consacre aux circonstances qui les ont amené à rencontrer Min Tanaka avant leur participation à la Ferme.
Katerina Bakatsaki :
Vous tous, vous me voyez bien rire, car tout cela s’est passé il y a si longtemps. C’est tout un périple. Maintenant que nous nous trouvons tous dans des phases différentes de notre vie, j’ai des sentiments mitigés par rapport à mes souvenirs de ces circonstances, alors mieux vaut en rire. Mais je peux dire en tout premier lieu que lorsque je suis allée pour la première fois au Japon, j’avais vingt et un an et que je n’avais pas la moindre idée de ce que l’avenir me réservait. J’ai rencontré Min à peu près en 1985 : il dansait à La MaMa Theater Club près de New York et Œdipus Rex a été présenté dans ce lieu sur une chorégraphie de Min. Une performance de Œdipus Rex a eu lieu aussi à Athènes et à cette occasion il y avait besoin de la participation d’artistes au niveau local, et donc j’ai eu la chance et le plaisir d’être sélectionnée. C’est ainsi que j’ai pu participer à la production et que j’ai pu rencontrer Min et connaître ses méthodes de travail. 1985, vingt et un ans ! On peut imaginer un jeune cheval qui sait déjà qu’il y a plusieurs chemins possibles, sans savoir exactement ce dont il a besoin et ce qu’il veut, simplement parce qu’il n’a pas assez d’informations à sa disposition. En 1985, on ne savait pas exactement en Grèce ce qu’était le contact improvisation, on en avait juste vaguement entendu parler, les informations sur ce qui se passait dans le monde étant très, très rares, voire inexistantes. J’étais donc curieuse, je commençais à pratiquer la danse en Grèce, mais j’étais à la recherche d’autres choses, sans savoir exactement ce que c’était, j’ai traversé l’Europe en rencontrant différents chorégraphes, en passant des auditions. J’ai rencontré Pina Bausch, j’aurais pu rejoindre sa compagnie, mais je ne l’ai pas fait parce qu’intuitivement je pensais que non, ce n’était pas pour moi. Toujours est-il que j’ai rencontré Min en participant à cette production et je pense qu’avant tout et par-dessus tout, il y avait quelque chose qui provoquait intuitivement en moi une forte croyance, une grande confiance, ou qui permettait de me connecter, mais je ne savais pas encore de quoi il retournait. Quoi qu’il en soit, j’ai pensé : « Eh bien, je veux en savoir plus sur cette personne ». Et c’est à ce moment-là qu’il m’a dit qu’il animait des ateliers d’une durée de deux mois au Japon, donc, je me suis dit : « J’y vais ! ». Juste une petite anecdote amusante : j’ai emporté mes chaussons à pointes avec moi – j’étais alors étudiante et une partie de mes études comportait de la danse classique – ceci pour dire dans quel état de confusion j’étais alors. Je suis arrivée dans le studio à Hachioji, la ferme n’existait pas encore. La création de la ferme a été la conséquence de pratiques qui se faisaient à ce moment-là au sein de la communauté, avant que la ferme ne soit devenue une réalité. Il faut noter, en passant, qu’en 1985 je suis allée là-bas pour deux mois et j’y suis restée huit ans.
Oguri :
Peut-être… c’est mon tour… comment commencer ? Donc – moi aussi cela me fait rire ! – c’était il y a trente ans ! Il y a trente ans, moi aussi, j’ai tout quitté, je suis resté cinq ans, les mêmes années que Katerina et Christine. Comme l’a dit Katerina, il y avait un atelier de deux mois : « Maï-Juku V, atelier intensif ». Min Tanaka avait commencé cela en 1980. OK, je retourne un peu en arrière : je vivais à Tokyo, je n’y suis pas né, j’ai suivi des études d’arts plastiques – un genre d’art conceptuel – à Tokyo avec Genpei Akasegawa. Il est mort en 2014. C’était à ce moment-là un homme important de la scène artistique au Japon. Dans les années 1960, donc avant la grande expo internationale à Osaka dans les années 1970, et avant qu’il ne devienne un artiste non-institutionnel, il a rencontré le mouvement néo dada Hi-Red Center et il a beaucoup collaboré avec Nam June Paik et John Cage. En tout cas, j’étais intéressé à étudier ce genre d’art plastique. Pendant les années 1960, Akasegawa a collaboré extensivement avec le mouvement au Japon Ankoku Butōh de Hijikata Tatsumi[1]. L’enseignement de Akasegawa m’a permis de côtoyer tous les mouvements d’avant-garde des années 1960-70 au Japon (voir Akasegawa Genpei Anatomie du Tomason). Et le Butōh, Ankoku Butōh m’a beaucoup attiré. Mais je n’étais pas prêt à devenir un danseur. Et pendant les années 1980, alors que je faisais encore mes études, j’ai aussi vu le travail de Min Tanaka. Il dansait encore alors avec sa tête rasée et son corps nu, peint, et cette danse consistait en des mouvements lents et graduels se transformant dans le temps. Il a travaillé avec Milford Graves et Derek Bailey, un événement très important à Tokyo. Une très grande impression pour moi, c’était quelque chose qui se plaçait « entre », était-ce de la danse ? Et en fait, à l’époque, le terme de « performance » a été introduit au Japon. Pas « performance art », juste « performance », qu’est-ce qu’une « performance », qu’est-ce qui est un Butōh, qu’est-ce qui est danse ? Cette frontière, il m’est impossible de la définir : petit théâtre ? L’idée de théâtre est devenue populaire à partir des années 1960. Mais ce n’est pas non plus un nouveau type de théâtre, tout cela c’est comme un melting-pot. À ce moment-là, j’ai suivi les ateliers Butōh de Hijikata Tatsumi, c’était très court, peut-être pendant trois jours très intenses. C’est ce qui a constitué ma formation de danseur avant de participer au Maï-Juku « Body Weather » de Min Tanaka. Je n’ai jamais suivi une formation formelle en danse. J’ai vu le travail du Butōh et celui de Min Tanaka, et j’ai participé à une performance, mais je n’étais pas encore un danseur. Pour le premier festival de Butōh au Japon, à Tokyo, Min a réuni quarante danseurs, des corps masculins. Cette performance, c’était ma première participation. Et puis, un an plus tard, oui, j’ai reçu une annonce pour le stage intensif Maï-Juku. C’est là qu’a commencé véritablement mon travail par rapport à cette pratique. C’est donc, oui, effectivement en 1985, pendant le Maï-Juku V, que j’ai été impliqué dans le travail de préparation de la ferme Body Weather à Hakushu. C’était donc une sorte de projet parallèle : il s’agissait de préparer le lieu, la ferme, et de participer à Maï-Juku V. Et une fois commencé l’atelier du Maï-Juku V, je pense qu’un mois après, je me suis déplacé à la ferme de Hakushu… on avait un processus de training[2] à part à la ferme. Je me souviens de ce que nous avons fait à la cascade… Avant que Maï-Juku se mette en place en 1980, Min Tanaka n’avait pas avec lui un groupe de performance. Le concept du Maï-Juku était basé sur la capture des corps – non ! pas le corps – la « capture » des personnes participant au training : quand Min Tanaka était en tournée, c’est comme ça que Katerina a été happée. En Europe et aux États-Unis, La MaMa à New York, et partout où il était en tournée il y avait des performances et des ateliers… c’est donc comme les deux roues d’un même carrosse. Les gens étaient intéressés et participaient tous les ans. Ce fut ainsi Maï-Juku de I à V. La cinquième année, a été créée la troupe Maï-Juku Dance Cie dédiée à la performance. Les termes de Butōh ou de « danse », n’ont pas été utilisés, mais cela s’est appelé « Maï-Juku performance ». Et concernant ce Maï-Juku V, l’année où nous avons participé a constitué un tournant très, très important. Beaucoup des anciens membres du Maï-Juku étaient partis. C’était un moment très étrange. Au début, je pense qu’on était à peu près quarante personnes qui participaient au commencement des deux mois d’atelier. Après deux mois d’une formation intensive, je pense qu’il ne restait plus qu’une dizaine de personnes environ. Mais dix personnes sont restées. Dix personnes y compris deux ou trois personnes originaires du Japon. Donc, un certain nombre de personnes provenant de l’Europe sont restées comme Katerina, Christine, Tess de Quincey d’Australie, Frank van de Ven des Pays-Bas, et (en 1986) Andres Corchero et Montse Garcia d’Espagne – peu de personnes[3]. C’était une transition très importante. Oui, quand Min Tanaka a débuté la ferme, cette transition a été fondamentale, une question essentielle. Min Tanaka n’a jamais appelé sa danse Butōh, mais en 1984, il a dansé en solo une chorégraphie de Tatsumi Hijikata à Tokyo. Cela a été aussi un tournant décisif, qui a changé le… Oui, OK. Je m’arrête de parler.

fonds d’archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
Christine Quoiraud :
J’ai rencontré Min Tanaka en France, plus précisément à Bordeaux, par hasard. Je dansais à ce moment-là dans une compagnie ayant pour style la technique Cunningham. J’étais en train de préparer un spectacle et quelqu’un est venu déposer des tracts avec la photo de Min Tanaka, une publicité pour un atelier à Bordeaux. C’était la seconde année où il est venu en France en 1980 ou 81 à Paris, après une présence importante au festival d’automne en 1978. Et c’était au moment où il a rencontré Michel Foucault et Roger Caillois. Min Tanaka animait un atelier à Bordeaux au moment où j’y étais. J’ai alors tout laissé tomber et je suis allée à son atelier. Dès que j’ai ouvert la porte, j’ai été conquise.
Je m’en souviens très bien, un travail d’écoute des sons avait été proposé : les participants avaient les yeux bandés et marchaient le long d’une ficelle de cuisine posée sur le sol. Min Tanaka produisait des sons, il frappait dans ses mains ou il jouait avec du papier. Il se déplaçait dans la salle, changeait de hauteur, changeait les distances. Nous, on était censé montrer avec l’index la direction de l’endroit d’où venait le son, et pendant ce temps-là il fallait maintenir son équilibre, un pied contre l’autre sur le fil conducteur posé sur le sol. Cela a été une révélation, j’ai été immédiatement complètement convaincue. Avant cela, j’ai fait l’expérience de plusieurs types de techniques de danse contemporaine. À ce moment-là en France, beaucoup d’étrangers sont venus, beaucoup d’américains, mais aussi des asiatiques : j’avais déjà rencontré Yano et Lari Leong qui m’ont donné ce sens d’un état d’esprit venant de l’Asie. Lorsque j’ai rencontré Tanaka, c’était ça ! J’étais conquise. Donc, je me suis immédiatement inscrite pour le prochain atelier qu’il a donné un mois plus tard à Bourg-en-Bresse, il y avait quarante personnes. Il nous a donné les bases du Body Weather, le travail de manipulation/étirements et un peu de travail sur les sensations et il nous a offert l’occasion de participer à une performance. C’est ainsi qu’il a construit une sorte de développement pour la performance, en très grande partie improvisée, avec quelques éléments, quelques consignes. Cela se passait dans un gymnase immense. Lorsque le public est entré, on était assis dans les gradins et progressivement on se penchait sur notre voisin, on s’appuyait contre le public. Puis on a progressé très lentement vers le sol. Cela m’a fait vraiment une très forte impression. Alors, dès ce moment, j’ai quitté mon travail, j’ai arrêté tout ce que je faisais, et j’ai acheté une voiture pour pouvoir vivre dedans. J’ai créé le laboratoire Body Weather nomade. J’ai voyagé dans toute l’Europe. C’est ainsi que j’ai rendu visite à tous les groupes Body Weather qui se mettaient en place à Genève, à Groningen, quelque part en Belgique, c’était peut-être Gand et en France, à Pau, à Paris. Je voyageais d’un groupe à l’autre. On partageait toujours le training et les performances, surtout à l’extérieur dans les rues ou n’importe où dans la ville. Tanaka est venu chaque année à partir de ce moment pour animer des ateliers surtout à Paris ou en Hollande, ou en Belgique, et je participais à tous. Chaque année il me disait : « Christine, pourquoi ne viendrais-tu pas à l’atelier intensif de Tokyo ? » J’ai finalement décidé d’y aller en 1985. Je suis aussi venue au Japon avec un visa valable seulement pour cet atelier, mais je ne suis pas repartie, je ne pouvais pas repartir après ce que j’avais vécu. Je suis restée plus de quatre ans, presque cinq ans. Autant que je me souvienne…

3. Maï-Juku V et la création de la ferme. Tokyo-Hachioji-Hakushu.
Présentation
Dans l’esprit des enquêteurs de PaaLabRes (Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff) le projet de la ferme Body Weather impliquait qu’un groupe de personnes ait décidé de vivre à la ferme, d’où l’idée qu’il y avait un commencement dont une narration détaillée permettrait de saisir l’origine de la démarche. Mais les réponses des trois artistes montrent qu’il n’en a rien été : le processus de la construction de la ferme a été très graduel et s’est inscrit dans un trajet d’allers et retours constants entre Tokyo et Hachioji (une banlieue de Tokyo), puis entre Hachioji, Hakushu (lieu de la ferme) et Tokyo. C’est un des aspects importants de l’idée du Body Weather, le corps comme la météo change constamment et ne se fixe nulle part. Cette conception signifie moins l’idée de migration ou de déplacement, de voyage, mais plutôt de fluctuations produites par friction dans un environnement donné.
On est alors en présence de trois environnements, un complètement urbain (Tokyo), un complètement rural (Hakushu) et un se situant entre ces deux pôles (Hachioji, en banlieue de Tokyo). Les activités de la ferme se sont ainsi construites progressivement, en interaction avec les fermiers déjà sur place.
Christine Quoiraud :
L’atelier intensif Maï-Juku V (en 1985) se déroulait à Tokyo, dans une banlieue éloignée, à Hachioji, où se trouvait un studio. Il y avait des rizières près du studio et une rivière. On est souvent allé travailler près de la rivière. Ou bien, à un moment donné, on est allé dans la montagne à 30 minutes de là. À la fin du stage intensif, on s’est déplacé à la ferme pour clore cette période de travail intensif. On est entrés dans l’eau chutant de la haute cascade, nus. Ceci, et tout ce qui s’en suivit, fut un point clé, un tournant décisif. Min était très fier de nous montrer la ferme. On y est allé tous ensemble. Après cet atelier dans la rivière, on s’est retrouvé devant un grand feu au bord de l’eau. C’était à la fin d’octobre, il faisait un froid glacial. On a terminé l’atelier intensif là, à la ferme. Puis ce furent les débuts de la ferme. Andrés Corchero n’est arrivé qu’en février 1986 pour l’atelier intensif suivant (Maï-Juku VI) qui cette fois, n’a duré qu’un mois.
Katerina Bakatsaki :
Je ne pense pas qu’il y ait eu un jour A. Je pense qu’il s’agissait d’un long processus constitué par différents évènements et de différentes façons de travailler qui a conduit à trouver un lieu, etc. Donc, je ne sais pas s’il y a eu un premier jour, mais avant de dire cela, il me faut souligner, peut-être juste de le dire, que quand j’ai rencontré Min à Athènes, la partie de son travail qui m’a le plus intriguée a été certainement le travail qu’il nous a invité à réaliser à l’extérieur du studio, à l’extérieur de l’espace du théâtre ou de l’espace du studio. Et comme l’ont déjà dit Christine et Oguri, Min était engagé dans un travail qui déjà impliquait des lieux, des situations et des contextes étranges, éloigné de la dance et du formel, de tout type de manifestation d’art formel. Il s’agissait de travailler en dehors des soi-disant espaces artistiques… Je reformule la question : que pourrait être la danse lorsqu’elle est vécue dans beaucoup de contextes différents, quand elle engage beaucoup de corps différents, évidemment pas seulement des corps humains, pas seulement son propre corps, mais aussi le corps des non-humains ? cette question était dès cette époque la préoccupation majeure de Min dans son travail. C’est ce que je voudrais souligner et en fait, pour moi, cet élément et cette recherche que menait Min dans son travail devait inévitablement déboucher sur la création d’une sorte de lieu et de réseau intégrés, existant dans son idée en dehors de la ville et en dehors des contextes artistiques formels.
Christine Quoiraud :
Comme l’a dit Katerina, on n’a pas commencé à travailler à la ferme immédiatement, cela s’inscrivait dans un processus. Et si je me souviens bien, il a fallu construire et organiser la ferme avant qu’elle ne fonctionne. On a commencé par construire plusieurs poulaillers. Oguri peut en parler beaucoup mieux que moi. Peu à peu, on a acheté des poules, puis on s’est mis à cultiver du riz. À l’automne et au printemps, je me souviens que vous, les gars, avez construit les poulaillers. C’est là qu’il y eu cette attaque de guêpes. Ces guêpes, c’était au printemps, non ? Et la plantation du riz plutôt en juin ou quelque chose comme ça. Mai/juin peut-être ?

Fonds Christine Quoiraud, Médiathèque du CND.
Oguri :
Est-ce que je peux parler un peu du cycle ? Bonjour, ici encore Oguri. Oui, la ferme était un peu en préparation juste avant le début de Maï-Juku V… des amis y travaillaient déjà au moment du Maï-Juku. Je suis allé à la ferme avec ma motocyclette. Ma première impression a été de trouver ce paysage magnifique. Oui, cela a beaucoup changé maintenant, mais dans les années 1980… Hakushu est situé à peu près à 100 km à l’ouest de Tokyo. Donc, à peu près à deux heures avec ma moto, en vivant une expérience de changement de décor, un paysage en évolution, changeant, changeant, changeant, d’une telle beauté, une belle rivière et un rocher gigantesque, la dynamique du lit de la rivière avait la beauté du chaos. Il y avait beaucoup de rochers au début, de formes variées, changeant, changeant, changeant. La dernière fois où j’y suis allé en 2017, cela a complètement changé, ce n’est plus du tout la même chose. Mais à cette époque… oui…
Je sais que la ferme n’est pas la nature. La ferme est un travail fait par des humains en utilisant la nature. La ferme est un produit humain dans l’écosystème de la nature. Mais il y a encore beaucoup de formes naturelles à cet endroit, des montagnes, et des rochers imposants et parfois un typhon produit un désastre qui change tout l’ordre humain, en restituant la nature. Et c’est en altitude, autour de 800 mètres, à l’air frais, l’eau coule constamment près de la maison et de la rizière à cause du terrain en pente douce, plat et ouvert. Oui, Hakushu se trouve au pied du Mont Kaikomagatake dans les montagnes des Alpes japonaises du sud, des montagnes hautes de 3000 mètres.
Et comme l’a dit Christine, à Hachioji, qui est une banlieue de Tokyo, c’est là qu’une transition importante a eu lieu, allant du port de Tokyo à cette ville, Hachioji, c’est là où la métropole de Tokyo devient la préfecture de Yamanashi. Il y a des montagnes dans la préfecture de Yamanashi, et c’est une sorte de transition avant qu’on aille à Hakushu. Et cette transition est très intéressante.

Collection personnelle de Christine Quoiraud.
Min Tanaka et Kazue Kobata[4] ont ouvert un petit lieu alternatif de performance à Tokyo. C’était le premier lieu artistique autogéré par des artistes au Japon. C’est un tout petit théâtre underground. Ainsi, chaque mois, ou une fois tous les deux mois, Maï-Juku en tant que groupe y a présenté des performances de danse. Moi-même, j’ai présenté une performance en solo une fois par mois au Plan-B.
Oui, je veux aussi parler de l’idée de transportation, de transport : Tokyo, Hachioji et Hakushu. Une expérience très intéressante, le transport, le déplacement et les activités dans les trois lieux : la ferme, les ateliers et les performances.
La ferme est l’endroit où l’on retourne après le travail à Hachioji, au Plan-B à Tokyo et les tournées nationales et internationales.
Vivre à Hakushu, la vie à la ferme, la ferme organique traditionnelle basée sur l’expérience des rythmes et des cycles de ce style de vie le plus humain qui soit. Cette connexion entre le corps humain et la nature est nécessaire pour la pratique du Body Weather. Beaucoup de choses ont été développées : la production annuelle d’un festival des arts, avec aussi de la sculpture en plein air, des spectacles vivants traditionnels et contemporains, de la musique, des conférences, un symposium…

Collection personnelle de Christine Quoiraud.
La vie à la ferme a rendu nécessaire une transition qui était loin d’être brutale. Notre vie n’en a pas été changée brutalement. Mais, pour moi, cela a eu un impact important dans le cycle de la vie quotidienne : Tokyo, il y a la nuit, on continue à travailler la nuit, on est dans un théâtre, il faut commencer à 20 heures. Mais à la ferme, tous les paysans sont déjà au lit à 19 heures. C’est ainsi que notre cycle de vie a complètement changé, en travaillant avec les poules ou en irrigant une rizière. Si on est en retard, on perd une journée. Ou bien donner à manger aux animaux, cela n’attend pas. Notre cycle en est donc complètement changé. La nuit, c’est l’obscurité complète, ce qui est magnifique avec les étoiles… Donc, cela a un impact très important.
Lorsque je parle de « cycle de la vie quotidienne », c’est complètement lié aux styles de vie et à la question du corps humain. On n’est pratiquement jamais seul vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il y a toujours quelqu’un avec qui on travaille, et tous les jours on mange ensemble, trois fois par jour.
J’en arrive maintenant à l’époque de la ferme : c’est un groupe qui travaille ensemble collectivement, mais en même temps, un sérieux engagement individuel de tous les instants est requis. Bien sûr, le seul fait d’être là est un engagement, mais dans tous les travaux à la fois de la ferme et de la danse – je ne dis pas « la danse » mais l’atelier, le laboratoire – requiert un engagement personnel très intense. Par ailleurs, nous ne sommes pas des fermiers professionnels. Et je n’ai jamais pensé non plus être un danseur professionnel. Cette pratique que je fais, est-ce de la danse ou de la performance ? Et puisque nous ne sommes pas des fermiers professionnels, nous apprenons des fermiers eux-mêmes sur le lieu de travail, sur le terrain. L’idée qu’on n’est pas là pour apprendre une technique est pour nous très importante. C’est la même chose pour Min ou aussi pour la danse Maï-Juku ou pour le Body Weather. On ne procède pas à partir de la technique, mais on se trouve dans un lieu de travail. Je veux dire, il ne s’agit pas d’un studio en tant que lieu préparant une performance qui va se jouer ailleurs. C’est comme ça pour la ferme et aussi pour la pratique de la danse. C’était une transition importante. Hachioji avait un parquet de studio de danse, mais à Hakushu tout d’abord, il n’y avait pas ce genre de parquet. Plus tard on a construit une sorte de scène et on a utilisé un tapis d’art martial Kendo pour faire du travail au sol, mais c’était surtout dans les champs… Donc, ni la ferme, ni la danse, n’avait la priorité dans la vie là-bas.
Christine Quoiraud :
Au moment de l’atelier intensif de 1985, Maï-Juku V, il y avait beaucoup d’allers et retours, retourner à Tokyo, aller à la ferme et retourner à Tokyo, et si je me souviens bien, tu avais été vraiment un des japonais qui a souvent été avec Min et Hisako, là-bas, pour organiser la venue du groupe et tu es le témoin de ce point de départ, mieux probablement que nous, les étrangers, les non-japonais. Je suis sûre que tu as des souvenirs des discussions que tu as eues avec les fermiers, les voisins… Quels sont tes souvenirs, ta mémoire, de ces discussions pour la préparation de la ferme ? Du point de vue administratif, mais aussi du point de vue du travail à la ferme, et aussi de la nécessité d’organiser un programme de ce qui se passait à Tokyo, au Plan B, le lieu de performances.

Fonds d'archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
Oguri :
Oui. En fait, toutes ces trois choses se sont passées simultanément. Vous savez, en fait, je n’ai pas eu beaucoup de relations avec Hachioji parce que j’habitais plus souvent au site de la ferme. Peut-être, oui, Christine et Katerina, Frank et quelques autres personnes habitaient Hachioji. Une maison avait été louée, donc votre base était plus à Hachioji… C’est un temps de transition. Donc, en habitant là, vous avez maintenu des ateliers à Hachioji. Je me souviens que, pendant le Sacre du printemps (ou peut-être pas celui-là, une autre performance), on a fait les répétitions au studio d’Hachioji. Et ensuite on a été au théâtre Ginza Season, un grand théâtre, oui, oui, c’était une performance en hommage à Hijikata. Oui, on a construit les décors et fait les répétitions, là.
Christine Quoiraud :
C’était beaucoup plus tard. Hijikata est mort en janvier 1986. Mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de déplacements entre Hachioji, Tokyo, Hakushu… Il s’agit plus de savoir si tu as des souvenirs de qui a décidé, par exemple, de construire le poulailler ?
Oguri :
Ah ! OK ! Tout le côté de l’organisation… Min Tanaka avait déjà une grande vision, je pense. Pourquoi avait-on ces poules, quelle en était la raison ? On n’avait pas besoin des poules pour les œufs, mais pour les excréments, pour l’engrais. L’agriculture organique n’était pas si populaire à l’époque. On ne savait rien non plus du populaire bio. Oui, nous n’utilisions pas d’engrais chimiques, c’est comme ça qu’on a commencé. Utiliser moins de produits chimiques, les désherbants ou les insecticides. On n’en savait pas plus que ça sur l’organique. On ne connaissait même pas la pratique du recyclage, mais le recyclage était déjà une tradition dans la vie des Japonais. Ce n’était pas nouveau à ce moment-là, mais l’organique était… comment on peut l’utiliser comme dans le cas du tissu traditionnel autochtone. Et en plus, avec peu de revenus.
Dans la ferme du Body Weather et de Min Tanaka, on n’a jamais été propriétaire des terres. On nous a prêté les terres cultivables, le terrain de la ferme et la maison. En ce qui concerne l’agriculture dans un village au Japon, c’est évident que toutes les familles de paysans sont propriétaires de leurs terres. Mais ce sont des paysans du dimanche. Ils ont tous un job à côté, ils ont un travail à plein temps par ailleurs. L’agriculture est leur deuxième métier, il faut qu’ils maintiennent les rizières parce que, comme je l’ai dit, le riz est essentiel chez les Japonais, le riz est plus important que de constituer une source de revenus, le riz c’est la vie, le riz c’est Dieu. Un peu comme chacun de nous, ça pousse, ça se développe. De nombreuses heures de travail intense et une grande pression lors de la récolte dans le ciel d’automne. Le riz pousse, se transforme comme un être humain. Les paysans doivent donc continuer à entretenir les rizières. C’est pour chacun d’eux quelque chose d’essentiel. Quand le paysan devient vieux, ses enfants ne veulent pas continuer derrière lui. C’est ainsi qu’il y a de nombreux champs, à côté des rizières, des champs de culture maraîchère ou bien des montagnes qui ne sont plus entretenus à cause du manque de main-d’œuvre, donc il y a beaucoup de terres qui sont mises à la disposition d’autres personnes. On a donc récupéré beaucoup de terres qui étaient presque abandonnées et pas en très bon état. Alors, on a coupé les arbres, on s’est débarrassé des rochers, on a nettoyé le champ pour pouvoir l’utiliser. De nombreux de paysans nous ont demandé qu’on s’occupe de cela à beaucoup d’endroits, mais aussi de la maison qui va avec. Mais les paysans sont toujours près de leur argent : après plusieurs années, le champ retournant à une bonne condition, « OK, rends-le nous ». Et il faut le leur rendre. On était très aimable avec les paysans, parce qu’on apprenait beaucoup d’eux, parce qu’ils nous permettaient d’utiliser beaucoup de leurs terres. Il y avait donc une relation particulière entre nous et les fermiers du village.

Fonds d'archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
Katerina Bakatsaki :
À ce propos, je me souviens aussi très bien qu’il est arrivé que nous allions très souvent aider les autres fermiers – qu’il y ait eu un accord ou pas à ce sujet – et en fait, c’était aussi un moyen d’apprendre, de savoir comment faire les choses. Je ne sais pas si Min l’avait pensé avant cela, mais c’est comme cela que j’en ai eu l’expérience, alors qu’on était là en essayant de survivre avec le minimum de moyens qu’on avait, il nous fallait en même temps essayer de comprendre comment littéralement faire les choses. Ce que je veux dire par choses, ce sont évidemment la maison, les objets, les terres, les animaux aussi… Comment vivre et travailler avec ces entités. Eh bien, nous vivions là, et nous étions aussi là pour aider les autres fermiers. Alors, en fait, ce n’est pas seulement le cas au Japon, j’ai connu la même chose en Grèce, la campagne et les fermes sont désertées et les jeunes s’en vont. Et en plus, les grandes entreprises achètent les terres agricoles. Cela veut dire que les petits fermiers perdent leurs terres et en conséquence le contact avec leur lieu, le contact avec leur terre, le contact avec leurs connaissances, et avec les manières de vivre qu’ils ont connues. Ainsi, on était en train d’apprendre, mais de cette manière notre présence contribuait aussi d’une façon très modeste à revivifier la vie dans le village et par là, en quelque sorte, véritablement à redonner de la vitalité aux fermiers. Et après, plus tard, le festival a été créé, ce qui a amené plus d’activités, etc. Je pense que cela faisait partie de la vision qu’avaient Min et Kazue, une sorte de militantisme assumé. C’est vrai qu’on allait là-bas pour apprendre, mais aussi pour jouer un rôle de soutien.
Christine Quoiraud :
Et je pense, comment dirais-je, que c’était assez naturel. Avant d’aller au Japon, j’habitais aussi à la campagne en France. C’était très naturel, quand il y avait du foin à couper, c’était le cas dans mon enfance, tout le monde venait en aide, et je pense que cela fait vraiment partie de la vie des communautés rurales. Moins maintenant à cause des machines, mais en ces temps-là, jusqu’au début des années 1980, c’était quelque chose d’assez universel…
Au début de la ferme Body Weather, il n’y avait pas beaucoup de gens qui y vivaient, pas tant que cela… Comme l’a dit Oguri, au tout début, il y a eu l’atelier intensif de deux mois Maï-Juku V. Ensuite la plupart des 40 personnes du groupe sont retournées dans leur pays ou à leur vie personnelle. Nous sommes restés un peu plus de dix personnes, moitié Japonais, moitié non-Japonais. Dans mon souvenir, on était à peu près 16 personnes. Puis, un petit groupe d’Espagnols est venu, et le groupe s’est stabilisé pendant un bon moment, avec d’autres Japonais qui venaient de temps en temps, je ne me souviens pas de leurs noms. Et oui, on est resté le même nombre pendant pas mal de mois, même quelques années. Mais de nombreux étrangers, des non-Japonais sont partis… pour animer des classes, des ateliers dans leurs pays respectifs, comme Frank en Hollande, Tess au Danemark. Ils partaient souvent pour enseigner dans d’autres parties du monde. Je me souviens. Katerina et moi nous étions là. Plus tard, nous sommes partis nous aussi… Je veux dire que la plupart d’entre nous sommes restés pour une longue période. J’ai fini par partir à un moment donné, mais c’était pour des raisons personnelles, la famille en France, des problèmes…
Katerina Bakatsaki :
Je dois dire que je n’ai commencé à enseigner ou même envisager d’enseigner qu’après mon retour en Europe à peu près en 1993. Cela ne faisait pas partie de ma vision à ce moment-là. Et puis, Oguri, je pense que tu sais mieux que nous quand on a déménagé à la ferme, tu y étais beaucoup, bien avant Christine et moi par exemple. Est-ce le cas ?
Oguri :
Oui. J’ai peut-être vécu un ou deux mois à Hachioji quand Maï-Juku V a commencé. Et à la moitié de l’atelier intensif Maï-Juku V, j’ai commencé à vivre à la ferme. À partir de là, j’y suis resté cinq ans. La vie là-bas était très dure. Rien n’avait été préparé pour y vivre.
Une maison avait été louée, une ferme qui était comme une maison abandonnée. Personne n’avait habité cette maison depuis de longues années. Je me souviens qu’avant le début de l’atelier intensif, je me suis rendu là-bas, comme je l’ai dit, avec ma moto, avec mes outils de charpentier, pour aller aider à la construction avec deux personnes du village, Encho (cela veut dire « directeur ») et Akaba San. Ils sont devenus par la suite de grands supporters et des mentors. La maison avait une grande porte en papier, vous savez, shoji. La porte Shoji est en papier. Il n’y avait pas de chauffage. Plus tard, après deux ans à peu près, tout a changé. Mais au commencement, c’était une expérience très intéressante [rire], comme la façon de vivre qu’avaient les gens il y a cent ans, une sorte d’expérience de l’aura des temps passés pendant un an. Eh bien, ce n’était pas une vie de souffrance, mais au début rien n’avait été préparé. Plus tard on a tout aménagé. Là, on n’a pas été puni. Oui, à la base, c’est cela.
Juste une chose, gomme ne [« pardon » en japonais] : ce qu’a dit Christine sur la façon d’observer les choses. Oui. C’est ce qui ressemble beaucoup au rôle d’un mentor japonais, vous savez, un mentor ne parle jamais, même dans le cas de la cuisine japonaise traditionnelle. Il n’y a pas d’enseignement. Oui, il vous faut voler, dérober cette technique… Alors, il y a toujours quelque chose qui manque. C’est ainsi que vous devez développer vos propres capacités à faire les choses. Oui. C’est ce que je voulais ajouter. Et évidemment, observer, c’est fantastique, on était tout le temps en train d’observer. Le regard porté sur les choses, c’est très important. Après, cela fait toute la différence. C’est une chose que j’ai apprise pendant cette première année.
La première année, on ne connaissait rien sur la façon de faire pousser les choses, à part les radis. Les radis, on peut les cueillir après cent jours. Au début, on n’est parti vraiment de rien. Il fallait vivre à partir de rien, mais on a vécu de cette terre et on a reçu beaucoup d’aide. Tous les fermiers nous ont donné quelque chose, comme des outils agricoles. C’est-à-dire des outils d’occasion. Et : « Eh, les gars, vous pouvez utiliser ceci ». Et en même temps, comme l’a dit Katerina, on a apporté de la vitalité au village. Après quelques mois : « Oh ! ces gars-là, ils sont sérieux. OK, il faut les aider ». Il a fallu pourtant au moins un an pour faire nos preuves.
Il faut préciser que, au début, nous avions des cheveux très, très longs, en vue d’une production publique. Min a eu la vision que tous les hommes et toutes les femmes devaient avoir des chevelures très longues, comme des chevaux sauvages sur la scène. Donc, on les avait tous laissés pousser. Pour le Sacre du printemps, on ressemblait à des hippies. Les gens du village pour la plupart ne nous faisaient pas confiance ou ne pensaient pas qu’on allait continuer à s’occuper de la ferme. Cela a changé après une période de deux ans, trois ans, année après année, nos relations avec la communauté ont beaucoup évolué. « Tous ces gens qui travaillent si dur, qui sont honnêtes, et qui font des danses un peu cinglées ! ». Quelque chose a touché leur cœur. On a organisé un festival sur les terres de la ferme, on a fait venir des spectacles de divertissement d’autres régions du Japon, ou de pays étrangers, des performeurs Japonais, des chanteurs, des sculpteurs, et tous ces gens ont fait venir du public et plus d’activités. On les a aussi aidés. « En fait, ces gars-là ne sont pas si mauvais ». On était invité chez eux en permanence. On avait des différences de langues : le grec, le français et l’espagnol. Et avec des différences de couleurs de peaux. La présence de non-Japonais, d’étrangers est devenue maintenant quelque chose d’habituel dans les campagnes au Japon, mais à l’époque les Européens, les Américains étaient rares. Oui, cela a été pour chacun de nous une expérience très particulière. Et pour les gens du village, je pense qu’au premier abord cela a été un choc pour eux. C’était comme ça, la vie là-bas.
Katerina Bakatsaki :
Pour savoir qui allait à la ferme et qui y restait, cela changeait constamment. Bien qu’il faille imaginer par exemple, que la première année, je ne me souviens pas pour combien de temps, tous les étrangers pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, ont gardé leurs logements à Tokyo, dans la banlieue de Tokyo, à Hachioji. Tandis que certains, comme Oguri, avaient déjà déménagés à la ferme. Donc, on allait à la ferme, nous les étrangers – dites-moi si je me trompe, Christine et Oguri – tout en gardant nos logements à Tokyo, parce qu’il fallait aussi qu’on puisse travailler pour gagner notre vie, parce qu’il y avait des coûts pour nous en billets de transport, en business, etc. Pour différentes raisons, on pensait qu’il était nécessaire de continuer à garder pied à Hachioji et de travailler à Tokyo pour gagner de l’argent. C’était ce que nous avons fait. Par contre, vous savez, il n’y avait pas d’argent à la clé dans notre engagement avec la ferme ou avec la pratique de la danse, avec les pratiques qu’on y faisait. C’est pourquoi on avait gardé nos logements et notre travail, et le studio à Hachioji, et on allait à la ferme soit parce que on avait besoin de nos mains ou quand il fallait faire des répétitions pour préparer une performance de groupe au Plan B.
C’est ainsi que la constellation des gens présents à la ferme changeait beaucoup et absolument tout le temps. Il y avait un groupe de base qui se trouvait à la ferme de façon plus régulière, et puis on venait pour faire des travaux à la ferme et pour des répétitions et la pratique de la danse, et ensuite on retournait à Hachioji. Maintenant, il faut imaginer que – j’en viens à ta question – quand on était là, alors le travail devait être fait, parce qu’il fallait construire le poulailler, la clôture dont on avait besoin, ou une poule qu’il fallait égorger, pour ne nommer que quelques trucs… On faisait le travail de la ferme et les travaux d’entretien du lieu, qui étaient aussi considérés comme faisant partie du training. C’est-à-dire que se confronter avec la matière, se confronter avec la temporalité d’une chose autre, d’une autre matière, d’une autre forme de vie, était aussi considéré comme faisant partie du training. Par exemple, plus concrètement : comment désherber les mauvaises herbes, il vous faut se pencher vers la terre, il faut travailler au sol, c’est petit, petit, et on n’utilise pas des outils électriques, on n’utilisait que des types d’outils qui étaient presque des extensions du corps. Ainsi, une très grande partie de la formation consistait à trouver les meilleurs moyens d’utiliser son corps pour être efficace dans le travail. La compréhension de comment exercer sa force et où la mieux placer, dans quelle direction aller pour dynamiser le mouvement, donc, comment utiliser votre poignet pour attraper l’herbe pour pouvoir l’extraire avec sa racine sans qu’elle se brise. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Cela faisait donc partie du training. Alors, c’est vrai qu’il y avait, parce qu’il fallait qu’on répète aussi, des heures réservées au training artistique.
C’est ainsi qu’il fallait se lever très tôt le matin, qu’on allait donner à manger aux animaux, on effectuait le travail urgent de la ferme, ce qui était déjà une forme de training, puis on prenait un rapide petit déjeuner. Et puis le reste de la matinée était consacrée aux répétitions, puis de nouveau un déjeuner, puis de nouveau les travaux de la ferme. Cela se déroulait d’une façon que je n’appellerais pas « organique », mais toutes les différentes nécessités, toutes les différentes préoccupations avaient besoin d’être prises en compte, d’être prises en charge. C’est comme cela que la journée était plus que bien remplie. La cuisine était faite, si je me souviens bien, par rotation. Je me souviens, moi qui ne savais même pas comment faire bouillir des œufs, je devais préparer un repas pour 15 personnes. La panique !!
Christine Quoiraud:
Et parfois, on jeûnait pour se préparer aux performances.
Katerina Bakatsaki :
Oh ! c’est sûr, oh oui ! Mais [rire]…
Mais s’occuper des choses, de ce qu’il fallait faire, que ce soit une performance ou un besoin personnel, était tout aussi important pour toutes les personnes présentes à ce moment-là. S’occuper de la nourriture, de l’entretien de la maison et des lieux, s’occuper de la vie, de la vie sociale dans le village, tout cela constituait une part très importante des activités. Je me rappelle avoir consacré une journée entière à effectuer différents types de travaux, puis de finir la soirée à faire la fête, manger et boire chez Akaba ou chez Encho… jusqu’au lever du jour (Akaba San et Encho étaient deux fermiers qui nous ont beaucoup aidés). Et puis…
Christine Quoiraud :
On était jeunes !!!
Quand je suis arrivée pendant l’été 1985, il y avait un espace à Hachioji dans la banlieue de Tokyo. Et il y avait déjà des animaux autour du bâtiment, comme des poules et un cochon. Et toujours un ou deux chiens, un chat ou deux, oui, et on vivait en compagnie de cette présence. Il y avait des petites loges pour animaux près du bâtiment. C’était dans la banlieue, mais c’était encore la grande ville. Il n’y avait pas de champs en tant que tels. Il n’y avait pas de ferme, seulement un studio de danse. Tout près de là, il y avait des rizières, mais pas beaucoup, et une rivière. Donc l’activité principale se déroulait dans le studio. Le Plan B existait déjà à Tokyo. Pour aller au Plan B il fallait – j’ai oublié – à peu près deux heures de train. Je n’en suis pas sûre, mais c’était quelque chose comme ça. Donc, on se déplaçait souvent du studio au centre-ville.
Et avant cela, Min Tanaka, quand il venait en Europe, il nous a souvent emmené travailler à l’extérieur, on l’a déjà évoqué. Et quand on était encore à Hachioji, durant le stage intensif (1985), nous avons passé une semaine en montagne. Cela veut dire qu’on se confrontait à la vie sauvage en montagne. Et ensuite, à la fin de 1985, début de 1986, on a commencé la ferme. Il y avait beaucoup de déplacements en camion ou en voiture de Hachioji en banlieue jusqu’à la ferme. Et ensuite, peu à peu, une équipe de danseurs a habité à la ferme. D’autres ont continué à vivre à Hachioji. Ils avaient gardé du travail à Tokyo pour survivre. Et parfois on s’assemblait tous dans la ferme pour travailler, pour réaliser un grand chantier, des travaux importants, ou bien pour des répétitions pour les performances. Et aussi, quelquefois on allait en tournée au Japon. Le cœur de l’activité était donc au début à Hachioji et très vite la ferme est devenue le lieu principal peu de temps après son ouverture (dès la fin de 1985).
Je voudrais ajouter quelque chose, concernant ce que vous avez dit tous les deux. C’est au sujet de la langue. Quand j’ai rencontré Tanaka Min en France, il ne parlait pratiquement pas l’anglais. Il utilisait un traducteur, c’est pourquoi il était entouré à cette époque d’un groupe de jeunes Japonais qui étudiaient avec Gilles Deleuze qui lui servaient d’interprètes. À cette époque Kazue Kobata l’accompagnait toujours dans ses déplacements et elle traduisait aussi en anglais, et elle a réussi à présenter Tanaka à Michel Foucault et, si je me souviens bien, à Roger Caillois. Et Min a vraiment pu parler avec les deux et il a été très impressionné grâce à la traduction en anglais de Kazue. Et puis, à ce moment-là, en 1981 je crois, Min a été à New York, grâce à Kazue. Il y a rencontré Susan Sontag et des musiciens comme Derek Bailey, Milford Graves, etc. Et à partir de ce moment, Min a commencé à étudier l’anglais. Petit à petit, quand il est revenu en Europe, il a pu utiliser des termes d’anatomie pour expliquer les manipulations, mais il avait encore besoin d’un interprète. Et quand on arrive au Maï-Juku V, je m’en souviens très bien, Min s’exprimait beaucoup plus en anglais, il demandait aux Japonais d’apprendre l’anglais et aussi il encourageait aussi les étrangers, les non-Japonais, à étudier un peu le japonais. En réalité, et encore aujourd’hui, il y a cet anglais approximatif entre nous.
4. Body Weather, la ferme et la danse
Presentation
Le Body Weather, basé sur l’idée de changement perpétuel du corps, comme dans le cas du temps météorologiste, de l’interaction ininterrompue entre le corps et l’environnement. Cette idée suscite des questions concernant les différentes manières d’envisager le travail à la ferme et le travail de production artistique, le rapport entre la vie quotidienne, l’environnement et le travail de la danse dans ses dimensions de training et de performance. La participation à la ferme du Body Weather impliquait un engagement très intense dans tous les aspects des travaux de la ferme et de la danse. Mais cet engagement restait basé sur une confiance individuelle dans la philosophie du projet, et non pas sur une adhésion aveugle à une communauté fermée
Oguri :
Je veux expliquer un peu l’historique sur une échelle temporelle plus grande. Le Laboratoire Body Weather je pense a commencé dans les années 1980 et a duré jusqu’à il y a quelques années, cela veut dire une histoire d’une quarantaine d’années. Et j’étais là pendant cinq ans, donc il s’agit ici de mon expérience durant ces cinq années. Je suis parti en 1990. Pendant cette période il y a eu beaucoup de changement et avant mon arrivée c’était aussi une autre époque. Et au sujet de Shintaï Kissho, “身体気象”, “Body Weather”, c’est en quelque sorte la méthode de ce mouvement : le corps n’est pas lui-même une entité figée – ce n’est pas un territoire, stable, fixe. Il est en perpétuel changement comme le temps météorologique. Ce n’est pas comme avec une saison. Le temps change constamment à tout moment.
Christine Quoiraud :
J’ai de nouveau une question pour Oguri : est-ce que tu penses que Tanaka avait entendu parler de Masanobu Fukuoka[5] ? Parce que je pense que c’était dans les années 1970 qu’il a quitté son travail d’ingénieur et s’est mis à faire de la culture biologique, à créer une commune. Je pense qu’il était alors assez bien connu pour sa façon de rassembler des volontaires pour travailler à sa ferme et il avait une commune qui changeait tout le temps, de jeunes personnes venant à lui pour apprendre et aider. Ils vivaient là d’une manière très sobre. Et cela me rappelle beaucoup ce qu’on a vécu au début de la ferme. Par exemple, il y avait un groupe, formant le groupe principal, surtout composé de Japonais, vivant à la ferme et les étrangers qui y venaient de temps en temps pour faire un type de travail particulier avec les voisins ou sans les voisins, et après il y a eu pendant toute l’année des bénévoles venus pour aider de différents endroits du Japon. Alors je me demandais si Min avait entendu parler de Fukuoka ? Je ne me souviens pas de l’avoir entendu parler de ce type, mais… peut-être…
Oguri :
Je n’ai jamais entendu le nom de Fukuoka dans la bouche de Min Tanaka. Il ne l’a jamais fait. Je suis sûr qu’il le connaissait mais il n’en a jamais parlé, on reconnait bien là la façon de procéder de Min.
Juste une chose que j’allais oublier à ce sujet. Pour revenir à la première fois où j’ai travaillé à la ferme, j’ai été très impressionné par le paysage. En même temps, dans la ferme, le travail n’est pas fait pour quelqu’un d’autre, le travail est fait pour soi-même. Parce que les gens en milieu urbain dépendent de leurs clients ou de leur patron… Mais là, à la ferme, comme je l’ai dit, il y avait une forme d’engagement et une prise de responsabilité, mais la totalité du travail devait être fait par chacun de nous. La qualité de notre engagement était très forte et c’était la raison d’être de notre présence. Y compris la danse. La méthode de danse, c’était cela. C’était très simple et rien en particulier. Bien sûr, il fallait prendre ses propres décisions et, comme je l’ai dit, nous n’étions pas alors des professionnels. Il fallait découvrir les choses par nous-mêmes – trouver des réponses, parce que tous les fermiers alentours étaient comme des mentors. Je me souviens de cela. Et laissez-moi parler des terres aussi… Je sais que j’ai été dans des perspectives très différentes de Fukuoka… Comme : qu’est-ce qui est particulier à une région, la régionalité. Ce qui est particulier à un voisinage ou à une région, dans cet endroit… Comment dire ? Il y a des rituels traditionnels ou des danses de célébration. Des célébrationq ou des rituels, ou kagura[6], ou des danses – on a beaucoup appris sur la manière de cultiver les terres et sur l’origine de la danse. Parce que cette méthode comme le Body Weather n’est pas en tant que telle une technique de danse. Min Tanaka ne nous a jamais enseigné comment danser, non. C’est-à-dire notre pratique n’est pas une étude de la danse ou une pratique confinée à la salle de répétitions, ce n’est pas cela. Notre apprentissage est orienté dans une très grande mesure vers le travail du sensible. Et… l’enseignement est très ouvert. Je veux dire que notre danse est très ouverte à n’importe quelles compétences.
Katerina Bakatsaki :
D’après ce que je sais, le terme de Body Weather a été emprunté – pas emprunté mais pris – à Seigow Matsuoka[7]. Mais est-ce que j’ai raison de penser cela ? Je n’en suis pas sûre. Je mentionne ceci parce que quand Min était en train de travailler, voyager, explorer, avec Kazue Kobata, il s’intéressait aussi aux mouvements artistiques et intellectuels qui avaient lieu à cette époque. Les stimuli qui ont fait émerger ce qui a été mis en œuvre étaient de nature théorique et aussi philosophique, ils avaient des liens très forts avec les mouvements de pensée existant déjà au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. Je tiens à apporter cette précision… Bien sûr, je n’en sais rien, je ne suis pas sûre que Min se soit exprimé sur tout cela de manière explicite. Je sais que Kazue Kobata l’a fait et j’ai eu des conversations avec elle à ce sujet, sur tous les différents mouvements de pensée qui enrichissaient nos démarches et encourageaient Min à continuer le travail qu’il avait entrepris. Pas seulement Min, mais aussi tous les artistes qui travaillaient avec lui. Car ce n’était pas un génie solitaire. (Je pense qu’on a eu tous ce genre d’expérience !) Il y avait toujours la présence d’une communauté élargie.
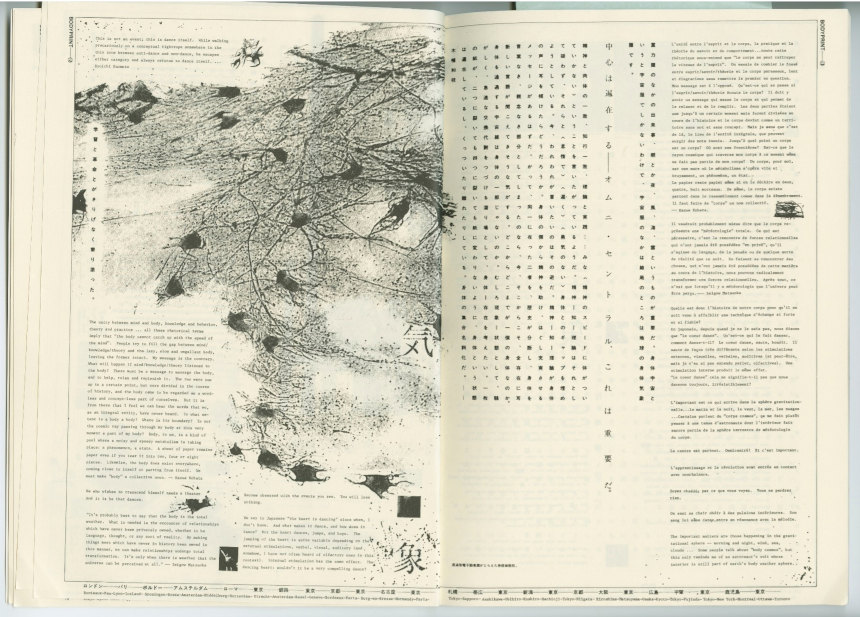
5. Les communs au sein de Body Weather
Présentation
Ce qu’on appelle « communs » peut être défini comme une articulation entre des ressources qui existent au sein d’une communauté et des règles concernant la manière avec laquelle cette communauté fonctionne vis-à-vis de ces ressources. Dans l’expérience du Body Weather, on peut observer qu’il existe beaucoup de ressources liées à la ferme et aux pratiques de la danse, au Plan B et à tous les espaces autour de la ferme. Comment ces aspects de vie en communauté ont été organisés, comment fonctionnait la communauté par rapport ces différentes pratiques se déroulant dans différents espaces, environnements, et avec des créatures vivantes et des objets ? Où il est question de conjonction d’expériences, de l’existence d’une communauté avec peu de choses en commun entre ses membres mais un engagement, d’autonomie et de responsabilités, de prise d’initiatives dans une structure non-formelle, de mouvement perpétuel et d’évolution.
Christine Quoiraud:
Eh bien, il n’y a pas UNE SEULE réponse à ces questions. S’il y a une réponse, elle est liée au déroulé du temps. Quand je suis arrivée en 1985 les choses étaient différentes. La ferme n’existait pas encore. Et ensuite la ferme a commencé, puis la ferme a continué. On a commencé à construire le poulailler, à faire pousser du riz, et c’était des changements progressifs. Alors, il y a plusieurs réponses, beaucoup de réponses.
Katerina Bakatsaki :
Permettez-moi d’utiliser le terme de ”communauté” non pas dans le sens d’une église fermée, mais en tant que réseau de forces, de personnes, de contextes qui ont toujours été au centre de l’engagement de Min Tanaka. Une communauté élargie de personnes et d’artistes qui se posaient les mêmes questions et avaient les mêmes préoccupations que lui. Ça, c’est une chose. Et puis, une autre chose que je voudrais dire au sujet de la question de la communauté : vous êtes là parce que vous l’avez choisi et il vaudrait mieux que vous ayez le courage et la volonté, pour vous-même, de pleinement vous engager. On n’est pas là pour le faire à votre place. Et en même temps, il n’y avait pas non plus de raison préétablie justifiant de notre présence, il n’y avait pas de croyance commune. Nous étions tous là parce que chacune et chacun d’entre nous avait des motivations totalement différentes et des intérêts différents et des types d’investissement différents. Personnellement, j’ai trouvé cela très appréciable, sinon je ne serais pas restée.
Et aussi, je parle pour moi, c’était toujours important de pourvoir ressentir les choses et faire le point avec moi-même. C’est ce qui était intéressant, parce que, vous savez, j’étais jeune. Intuitivement, j’étais capable de comprendre les choses et leur donner une place, et aussi d’écouter l’expérience – pas l’expérience de la danse, mais l’expérience de la vie – que j’avais acquise de mon lieu d’origine. Et aussi les manières d’être en communauté, les manières de faire des choses ensemble, les manières de comprendre et de partager le travail, là où on vivait ensemble avec les autres.
Mais, pour moi, il était aussi important de ressentir que je pouvais aussi trahir ce sens d’engagement, même si ce n’était qu’avec moi-même. Pourquoi dis-je cela, parce que cela me donnait la sécurité de savoir que je n’étais pas dans une secte. Ceci dit, je veux aussi dire qu’il y avait en même temps une fascination pour comment nous tous, chacun et chacune d’entre nous, étions là du fait de nos propres différentes motivations, et pourtant ayant tous pris l’engagement d’être là ensemble. Et aussi de faire des choses ensemble, sans qu’il y ait un accord sur ce que cela devait être. Bien sûr il y avait le training dans les ateliers, il y avait la nécessité de nous développer en tant qu’artistes et éventuellement en tant que personnes. Il y avait une confiance dans le constat du travail et dans son accomplissement éventuel. Ce n’était pas fait en vue de développer une méthode mais de la manière avec laquelle les questions se posaient : sur la danse, sur les mouvements, sur les terres et la nature, et sur la non-nature. C’est ainsi que ces questions étaient présentes dans les formes de productions, dans n’importe quel type d’activités liées au travail qu’il fallait accomplir, que ce soit tondre l’herbe ou apprendre des fermiers, des autres fermiers qui étaient là depuis longtemps à travers les générations. Lorsqu’ils tentaient de définir ce que nous étions, ils se demandaient si ce n’était pas « faire des erreurs ». Mais l’engagement, c’était vraiment de faire cela ensemble. Aussi en termes d’engagement, je pense, cela a été toujours pour moi très intéressant, très fascinant, très excitant. J’ai toujours à m’engager pour quelque chose d’autre que moi-même. C’est quelque chose qui existe chez les fermiers, il est nécessaire de nourrir les animaux, on n’est pas en vacances, il faut être là.
Il n’y a pas un partage entre le temps des loisirs et le temps du travail, il faut être là, disponible, et votre rythme et vos besoins, votre corps sont disponibles pour le service d’un autre, des animaux, des plantes, des saisons, de l’eau qui suit son cours ou qui s’arrête de couler, etc., etc. Donc, ce sens de : « OK, je suis un individu, je suis ici pour moi-même, et je suis responsable de mes actes, je suis autonome » et pourtant il y a toujours cet appel qui me met vraiment en relation et qui est engagé avec quelque chose d’autre qui n’est pas moi-même. Et ce n’est pas forcément lié à cette communauté en tant que telle, c’est toujours quelque chose de plus large que ça. Ce sont les autres humains, être ensemble, mais aussi ce sont les animaux, les plantes, la cultivation, etc. Les outils que nous utilisons. Oui, il convient d’apporter beaucoup de nuances à cette notion d’engagement.
Christine Quoiraud :
Je pense qu’on a beaucoup appris en regardant… en observant ce qui est aussi une manière de comprendre le travail à la ferme, comme, je me rappelle, d’avoir été aider Encho (l’un des fermiers, un voisin) à la rizière. Il nous a montré comment couper le riz et le suspendre sur un poteau. On était dans la situation d’avoir à observer l’action, pour pouvoir la faire soi-même. Ou bien lorsqu’il nous a montré comment utiliser un outil pour retourner les bûches sur lesquelles poussent des champignons shitaké. On regardait ses gestes pour pouvoir les imiter – pas les imiter exactement – il s’agissait de saisir, d’incorporer le geste de celui qui sait le faire.
Et je me souviens de moi-même essayant de suivre le « training M. B. »[8], il me fallait regarder les corps des personnes qui étaient devant, de Min quand il corrigeait un petit peu ou démontrant différents rythmes ou d’autres choses. Et c’était pareil quand il dirigeait la préparation des performances. J’écoutais, je regardais son corps plutôt que d’écouter ce qu’il disait, ses explications qui restaient un peu surréalistes pour moi. Mais son corps n’était pas du tout surréaliste, j’étais capable de capter beaucoup de choses. Et, au fait, Oguri, dans mon souvenir, avant Maï-Juku V, quelques performances solos ont eu lieu au Plan B. Mais à partir du Maï-Juku V et par la suite, Min a commencé à chorégraphier pour nous encourager – je pense que j’étais en quelque sorte la première personne, parmi les étrangers présents en ce temps-là, à présenter une performance. Ma composition tout d’abord. Tous ont bien ri… J’ai donc demandé à Min de chorégraphier le solo suivant. C’était début janvier 1986, peu avant la mort de Hijikata. Après, Min a encouragé tout le monde à faire une performance une fois par mois, ce que nous trois avons fait autant qu’il était possible. C’était en parallèle avec le travail collectif du groupe ou les travaux dirigés par Min Tanaka. Nous avons tous eu la possibilité de développer notre propre recherche et de la tester devant un public au Plan B, ce qui était un privilège incroyable, une manière d’apprendre incroyable… et aussi une preuve de confiance extraordinaire. Voilà.
Katerina Bakatsaki :
En ce qui concerne la possibilité de proposer des initiatives, je ne me souviens pas d’en avoir ressenti le besoin. Cependant, je n’ai pas non plus l’impression d’être quelqu’un qui suit passivement le cours des choses, parce que j’ai ma propre manière de m’engager, comme par exemple avoir ma propre mobylette me permettant à certains moments de m’éloigner de la ferme et d’y revenir, quand j’en ressentais le besoin. Je n’avais pas besoin de prendre concrètement des initiatives et je pense que je ne suis pas le type de personne à faire cela, mais en même temps je n’ai jamais eu l’impression de ne pas avoir d’espace pour me retrouver et agir de moi-même, pour prendre les décisions de manière indépendante et autonome.
Je pense que si Min n’avait pas été l’élément déclencheur, en suggérant : « Pourquoi tu ne ferais pas… », je ne suis pas sûre que j’aurais fait quoi que ce soit. Bien sûr, Min était là pour en quelque sorte m’y encourager. Et pourtant, dans ce contexte où un large espace nous était offert pour mener notre travail comme on l’entendait, pour réaliser ce qu’on avait besoin de faire. Étant donné qu’il y avait aussi cet espace, le Plan B, mis à notre disposition.
Christine Quoiraud :
Je pense qu’on a été à la source de petites initiatives. Oguri, peut-être tu te souviens de quand on a commencé à travailler ensemble, on s’occupait de la communication, comment dire, de l’élaboration du calendrier du Plan B, et à un moment donné, je traduisais en anglais – il me fallait travailler avec Oguri, parce que je n’avais aucune idée du japonais. Ce sont de petites choses, mais cela contribuait à ajouter une pierre à l’édifice du projet principal. Et en ce qui me concerne, j’ai réussi à prendre de moi-même beaucoup d’initiatives, de la même façon que Katerina pouvait prendre sa motocyclette pour s’échapper. Donc j’avais aussi la possibilité de prendre de petites initiatives pour moi-même me ressourcer, pour pouvoir ensuite retourner à participer au groupe. Et c’était parce que je n’étais pas Japonaise, que j’avais ce besoin-là… Il me fallait vraiment le faire, et c’est en retournant à ma langue d’origine, le Français, que j’ai pu réaliser cela.
Katerina Bakatsaki :
Je pense qu’il y avait des lieux différents. C’est bien de les considérer sous différents angles, on a des lieux. Il y avait au début un lieu à Hachioji, qui était le studio de danse. Puis il y a eu la ferme, quelque chose de complétement différent, un lieu avec sa structure intrinsèque, avec toute la complexité, et son caractère d’improvisation. Il y avait aussi un lieu fondateur, le Plan B, un lieu de performances. Et toutes sortes d’autres lieux, différents lieux de performances qui étaient soit des théâtres ou des endroits en plein air, au Japon ou ailleurs. Ensuite il y avait en tant que lieux, tous les endroits où il fallait aller pour vendre et s’occuper des produits de la ferme et je pense que cela faisait aussi partie de notre vie, de nos pratiques.
Si j’essaie de définir les communs en termes de lieux, il y avait a) des lieux fondateurs, b) des lieux importants et c) des endroits où une activité particulière se déroulait. Évidemment, il y avait aussi d’autres endroits : plus tard est apparue une autre maison plus au sud, près de la mer, parce que la ferme du Body Weather était dans les montagnes. Mais je pense que la vie en groupe s’ajustait en rapport à ces différents lieux, j’espère que cela fait sens. Je le redis encore une fois, il y avait Hachioji, le studio, et bien sûr les maisons autour, ce lieu particulier, une situation comme dans un petit village, dans la banlieue de Tokyo. Et puis, il y a la ferme et le Plan B à Tokyo, le théâtre, il y a les autres espaces qui accueillaient les performances. Ensuite, dans ma perception, il y avait toutes les activités importantes initiées par Min, toutes les performances importantes, les tournées, et on était invité à y participer. On n’était pas obligé, mais on était invité à participer.
Il y avait aussi les migrations – Oguri et Christine dites-moi si je me trompe – les grands déplacements vers la ferme. Je veux dire que ces grands mouvements migratoires vers la ferme étaient initiés par Min et peut-être aussi en collaboration avec Kazue Kobata et d’autres personnes qui appartenaient au monde artistique de Tokyo à ce moment-là. Mais ces grands mouvements étaient à l’initiative de Min et on était invité à y participer. Le Plan B en tant qu’espace était déjà en existence, je pense, au moins quand je suis arrivée. Donc il y a ces endroits qui existent et on a une sorte de structure qui se déplace qui est déterminée et déclenchée par Min, Kobata et par les personnes qui travaillent auprès de lui. Et puis, à l’intérieur de ces lieux et structures de grande importance, on est invité à participer en prenant nos propres initiatives, pour créer notre propre travail. C’est comme cela que je vois les choses, que je les comprends, parce qu’une part très importante était laissée à notre initiative, je veux dire que ça a grandi au fur et à mesure et selon les besoins.
C’est comme cela que j’ai vécu le développement des différentes activités. Les animaux sont arrivés. Il fallut vite s’occuper des rizières. Parce que c’est ce qui se passait à la ferme, il fallait s’en occuper. D’une certaine façon, il s’agissait d’activités organiques, mais en même temps il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà là, ou qui existaient à l’initiative de Min. Je pense aux grandes performances dans les grands théâtres, organisées par Min, ou par d’autres artistes qui avaient invités Min à participer ou à réaliser des chorégraphies, et alors il invitait aussi le groupe du Maï-Juku à y participer. C’est ainsi qu’une partie de ces communs était déterminée au fur et à mesure des besoins, par la nécessité de faire quelque chose à un moment donné. Mais chacun de nous de manières différentes initiait, accompagnait, suivait ou réorientait ce qui se passait. Mais il y avait aussi une structure au-dessus de tout cela – je l’appelle structure mais c’était une structure très fragile, une structure non-formelle : Min avait sa vision des choses et il la poursuivait, il allait de l’avant. Ceux et celles qui voulaient se joindre à ses projets, très bien, sinon bye-bye, c’était un peu comme ça. Et pourtant, à l’intérieur de cela, il y avait beaucoup de place pour nous et beaucoup d’invitations de la part de Min pour que nous prenions nos propres initiatives, pour développer notre propre créativité, pour avoir nos propres connexions aux différents lieux, d’être là et de comprendre et de ressentir ce qu’on avait besoin de faire.
Oguri :
Donc, comme je l’ai déjà dit, le mouvement de l’histoire de Body Weather est aussi en perpétuel changement comme l’a bien expliqué Christine. Katerina l’a dit aussi. « S’il y a quelque chose dont nous avons besoin, [presque chanté] nous———————– allons le faire ». Les communs ne sont pas fixés définitivement : la ferme, la compagnie de danse, et le Plan B. J’étais complètement impliqué dans ces trois activités, pour moi, c’est la même chose, il n’y a pas de séparation. Il y avait la communauté nojo [les paysans]. La communauté de ceux qui travaillaient la terre. Il y avait des personnes qui n’étaient pas impliquées dans les performances, d’autres personnes participant aux performances mais pas dans celles du Plan B[9]. Il y avait différentes manières d’envisager ces « communs », vous savez, avec un peu plus de flexibilité ou en les déployant et en les faisant évoluer. Au sujet de Maï-Juku, le déménagement de Hachioji à la ferme a été une transition importante. Depuis le début du Body Weather, non pas comme un paramètre mais disons, en tant qu’essence du Body Weather, il n’était pas question de rester uniquement dans le studio de danse à Hachioji. Il fallait déplacer les activités vers la ferme, vers le monde rural – je ne dis pas « nature » mais « terres agricoles », lieu environnemental. C’est comme l’avait fait Min Tanaka quand il avait commencé à danser, dans la rue, puis dans un théâtre. Là encore, il s’agissait pour lui de danser dans un site spécifique ou à l’extérieur. Il ne s’est jamais fixé sur une scène particulière, mais il s’est toujours intégré à de nouveaux lieux, allant de l’un à l’autre. J’espère qu’il est clair que Maï-Juku n’est pas une compagnie de danse – oui, dans un sens c’en est une – mais ce n’est pas une compagnie de danse fixée une fois pour toute, avec un chorégraphe et des danseurs sous contrats qui sont payés pour leurs performances. Ce n’était pas du tout cela, c’est certain… Et en même temps, il s’agit d’un autre contexte qui dépend des individus – je pense avoir dit quelque chose au sujet d’un fort engagement des personnes individuellement – il y a bien une organisation importante, mais c’est aussi beaucoup l’affaire de chacun et de chacune individuellement. En réalité, Christine, Katerina et moi, nous avons travaillé complètement séparément et aussi développé des danses très différentes. Donc, nous n’étions pas là pour assimiler la chorégraphie de Min Tanaka ou pour acquérir une technique, la technique de danse de Min Tanaka. Dans cette communauté, ce n’est pas comme cela que ça se passe. Les communs sont déterminés par les individus au sein du commun. Pour revenir aux individualités – est-ce que c’est lié réellement aux communs (je me pose moi-même la question) ? – évidemment, financièrement, cela n’a été facile pour personne. Parce que j’étais là pendant cinq ans, à partir du moment où on a commencé le travail à la ferme. On a commencé par apprendre des fermiers comment s’y prendre, oui, personne d’entre nous n’était d’emblée expert en la matière, il fallait tout apprendre. Alors le travail à la ferme ne payait pas, en tant que tel. Non, peut-être à cette époque, la danse, les grands projets rapportaient un peu d’argent ou les activités commerciales, les films[10]. Oui, beaucoup de choses se passaient en même temps.
La ferme a commencé en 1986. Les gens du village dans leur totalité ne nous faisaient pas confiance ou ne pensaient pas qu’on allait continuer à s’occuper de la ferme. C’est ce qui a changé après une période de deux ans, trois ans, année après année, nos relations avec la communauté ont beaucoup évolué. Quelque chose a touché leur cœur : durant cette première année, Min, Kobata San et d’autres ont organisé un festival, « Art festival », un projet pionnier au Japon, un festival en plein air. Quelque chose qui ne s’était jamais passé dans la métropole de Tokyo. Mais dans ce lieu plus marginal, sur les terres de la ferme, en plein air, un évènement d’arts vivants : sculpture, musique, performance. On a donc fait venir beaucoup de spectacles de divertissement d’autres régions du Japon, ou de pays étrangers, des performeurs Japonais, des chanteurs, des sculpteurs, et tous ces gens font venir plus de public et des activités. Vraiment c’était un projet pionnier dans ce début des années 1980, aujourd’hui c’est beaucoup plus habituel. C’était une autre forme d’activité du Body Weather et au-delà et on y était tous impliqués à la ferme : travailler à la ferme, étudier, pratiquer la danse de manière stimulante et l’organisation, la production d’évènements. On a pu être mieux acceptés par la communauté. En fait, on était invité chez eux en permanence. Bien sûr, maintenant, la présence de non-Japonais, d’étrangers est devenue quelque chose d’habituel dans les campagnes au Japon, mais à l’époque les Européens, les Américains étaient rares, oui, cela a été pour chacun de nous une expérience très particulière.
Ah oui, autre chose, c’est un peu symbolique au sujet du riz : le riz est une matière essentielle pour les Japonais, je l’ai déjà dit. Il y a tant de noms donnés à un grain de riz, du riz qui pousse au riz qui vient à ma bouche, le nom change. C’est comme les différentes appellations de l’eau : glace, eau, neige, toutes les transformations suscitant des noms différents. Donc beaucoup de noms chaque fois se transforment par rapport à d’autres façons d’être. C’est un peu comme ça que les communs peuvent être envisagés dans le cadre du Body Weather. Mais j’ai appris cela de la tradition, sur le terrain – OK, d’accord, je suis sans doute en train de semer le chaos – OK, posez-moi des questions précises ! [Rires]
Christine Quoiraud :
Peut-être que je peux ajouter quelque chose qui étoffe un peu ou qui est relié à ce qu’Oguri vient de dire : je me souviens que quand on a commencé la ferme, il n’y avait pas d’animaux. On se concentrait vraiment sur le riz, de démarrer la culture du riz, puis, petit à petit, on a construit le poulailler, et tout à coup il y avait des milliers de poules. Ce n’était pas seulement Min qui décidait du développement de la ferme, je pense que Hisako participait pour une bonne part dans ces choix impulsifs. Tout à coup on avait des chèvres et des ânes. Et je me souviens, quand j’ai quitté le Japon, Tanaka Min m’a offert de me confier des vaches. Il voulait que je prenne en charge des vaches. J’ai dit : « Non merci ! » Mais c’était là une façon d’entrer en relation. On parlait des lieux. C’est ainsi que le groupe de l’origine devait s’adapter. Il fallait qu’on prenne en charge ces animaux, ils faisaient partie de l’environnement. Au début, ils n’étaient pas présents et puis un tout petit peu présents, et ensuite de plus en plus présents. Et il y avait une obligation d’avoir du riz, parce qu’au Japon il y en a partout, d’après ce que je sais… Mais les animaux il me semble, étaient très importants pour Min et pour Hisako. Les animaux étaient là aussi pour l’utilisation de leurs déjections comme fertiliseur, mais aussi pour gagner de l’argent, parce qu’on vendait les œufs des poules. Voilà, je perds un peu le fil de mes pensées, mais… Je pense très clairement aux animaux et à leurs sons, leurs odeurs et leurs déjections.
Katerina Bakatsaki :
Je voudrais tenter de préciser cette notion de communs et de communauté. Parce que savoir qu’il existe une communauté vous plaît beaucoup – et c’est aussi mon cas, c’est merveilleux de se l’entendre dire, encore et encore. Mais dans le contexte du Body Weather, il n’y avait rien de commun entre ses membres et c’est ce qui a donné au projet une force particulière. Bien sûr il y a la danse, il y a la nécessité de danser et d’explorer la danse, d’explorer comment comprendre la danse au sein de la vie, comment être en relation, comment exister entre nous, comment exister avec les choses, avec les objets, avec les plantes, avec les outils, avec l’argent, avec le manque d’argent, comment exister avec d’autres communautés qui existent aussi avec nous, alors qu’on n’est pas exactement certain si oui ou non on forme une communauté. On ne le savait pas. En tout cas, je ne le savais pas. Je ne pense pas qu’on n’ait jamais ressenti qu’il y avait quelque chose qu’on pouvait désigner comme faisant partie de l’ordre du commun.
Il y avait un désir partagé d’être là, mais chacune et chacun d’entre nous avait ses besoins particuliers et ses propres attentes et ses propres projections. Et aussi ses propres manières de s’engager par rapport à toute cette complexité, ou en d’autres termes à tout ce chaos. Ce n’était pas un chaos en termes de n’importe quoi, mais un chaos en termes d’imprévisibilité. Tout est en relation, on est en relation. Il y a des principes qui sont définis et qui nous guident et restent en nous, comme le riz, comme se mettre en relation, comme se remettre en question, comment ne pas se contenter d’être seulement en relation, mais de questionner comment on doit le faire, c’est-à-dire de faire ce qu’on ne sait pas faire. Et de questionner aussi la morale, l’éthique, la politique de tout cela. Personne ne décidait : « OK, on va faire ça comme cela maintenant ». On réfléchissait, on évaluait. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, il y avait des schèmes plus importants qui étaient continuellement en mouvement et je veux dire par là que toutes les notions se situaient constamment dans des contextes particuliers. Il y avait toujours la présence de toutes sortes de danseurs, de corps, de micro-communautés. La communauté sans qu’il y ait quelque chose en commun, c’était très radical, au moins dans mon esprit, ça l’est toujours, et c’est ce qui fait que ce groupe de personnes ne constituait pas une secte, il n’y avait pas de terre promise, pas d’obligations. On était là parce qu’on était arrivé à la conclusion que « OK, je peux le faire, je peux m’y identifier, je peux répondre à ce qu’il y a besoin de faire, je peux… »
Christine Quoiraud :
Une petite chose, encore. D’après mes souvenirs, la configuration du groupe et l’activité se développaient par elles-mêmes, mais quand on était en tournée, quand on voyageait en France pour des performances, je me souviens qu’il y avait beaucoup de différences relevées entre le monde japonais et l’univers européen. Min parlait souvent de tradition, de la tradition au Japon. Et quand il était à Paris à ce moment-là, il avait un regard un peu critique sur le style de démocratie en usage en France. Je me souviens juste d’une « remarque » de Min Tanaka quand on a présenté le Sacre du Printemps. Nario Goda[11], un critique de danse, était avec nous et il est tombé malade. Il a été hospitalisé pendant quelque temps, et Goda San, Monsieur Goda, était très enthousiaste : « Oh ! je suis malade, je vais rester à Paris, je veux rester à Paris, j’aime Paris, j’aime la France, il y a beaucoup de bonne cuisine, de bons vins… » Et Min Tanaka lui a dit alors : « Non ! Il ne faut pas rester en France, c’est trop doux, l’esprit est trop mou, l’esprit est trop délicat ». Cela me parlait beaucoup, alors, c’était comme : « Au Japon, nous avons cette forte énergie, cette forte capacité à travailler. On ne s’arrête pas, on ne renonce pas », comme les cosaques – une image qui vient de moi, bien sûr – mais c’est ainsi que je ressentais un peu les choses à ce moment-là. On n’est jamais fatigué, on peut continuer malgré la fatigue, eh oui… Alors je suppose que Min devait aussi se demander comment un groupe pouvait se comporter, comment la vie avec les autres pouvait être envisagée. Comment c’est de vivre à plusieurs et avec un nombre de participants toujours fluctuant. Pendant la première année, il y avait beaucoup de monde à la ferme et ensuite au cours de l’hiver, cela s’écroulait. La taille du groupe variait constamment. Il y avait, je pense, quelque chose qui ressemblait à une non-adhésion au capitalisme, par la manière de se confronter à l’économie. Mais par ailleurs, d’après moi, il y avait une grande tendance à se tourner vers la tradition. Et en conséquence, cela créait des tensions entre la tradition et une certaine volonté d’inventer de nouvelles choses. Et probablement, d’autres influences, je ne sais pas, mais je pense qu’on peut sentir ou imaginer quelque chose de plus ouvert, en quelque sorte avec – je n’ose pas utiliser le mot – une certaine anarchie, mais…
Oguri :
Je voudrais juste dire ceci : les relations avec la terre s’appliquent aussi à celles de la danse. La danse, c’est la mobilité. Ça peut avoir lieu dans n’importe quel endroit. Avec seulement le corps on peut produire de la danse, des choses qui ne se répètent jamais de la même manière. Nous ne sommes pas non plus propriétaires de notre danse. En toutes circonstances, la danse peut être là, présente. Je pense donc que c’est une méthode très efficace. Je veux dire que si l’on considère cette notion du commun, ou des communs, on en revient à l’essence du Body Weather, il s’agit bien de ne pas posséder la terre, de ne pas posséder la danse. Ce n’est pas une question de propriété.
Ça tombe sous le sens que la danse et les terres sont toujours des emprunts. On nous prête les terres et on nous prête aussi la danse. Mais lors de la pandémie, c’est la première chose qui se passe, cela limite tellement la danse qu’on ne peut plus rien faire. Oui, je suis désolé d’avoir à rappeler cela, toutes mes excuses. J’ai toujours pensé que la danse était le média le plus puissant, pas besoin de transporter des instruments, on peut aller n’importe où, avec juste son corps. Or durant la pandémie, ce fut si difficile. J’arrête là. OK, merci.
Katerina Bakatsaki :
Et pourtant, on est en tant que danseurs toujours en mouvement, je veux dire que ça a été toujours une fascination pour moi la manière de travailler au développement de la vie du groupe, il y a un sens de mobilité, de changements de direction soudains, de mutations, de mouvements. Et pourtant il y a la question de ne pas posséder les terres, et pourtant il y a la question de travailler la terre, la question d’être en relation avec la terre. Se salir les mains…
Oguri :
… Oui, trouver ses racines…
Katerina Bakatsaki :
…trouver ses racines, travailler la terre, je veux dire créer une relation à la terre, comme tu le dis, à la rizière. Comprendre aussi avec le corps, quels sont ses besoins, quelle est sa temporalité et être capable de le prendre en compte, de le soutenir, d’être à son service, la même chose avec les animaux, la même chose entre chacun d’entre nous, la même chose avec la musique, la même chose avec les performances, partout où l’on partage l’espace avec d’autres, qu’il s’agisse de corps humains, ou d’objets, etc. Je pense que c’était cela, la notion de travailler la terre : prendre racines sans rien posséder. Et je me souviens de cela maintenant en entendant tes paroles et « Ooooooooooh ! »[rire], c’est vraiment stimulant, encore et encore. Et je pense que c’était en termes de cette notion des communs : vous savez, les choses bougent, évoluent, les lieux changent, on fait face à ce qui doit être fait, etc. Il y a donc sans cesse du mouvement, pourtant il faut saisir ce qui est de l’ordre des relations avec le village, avec les villageois, avec le riz, avec les animaux, avec la terre, avec chacun d’entre nous, et ainsi de suite. On ne possède pas la terre, mais on doit travailler la terre, encore et encore.
Oguri :
C’était notre communauté Body Weather. Mais vous savez, parfois j’ai aussi le sentiment que c’est principalement une des raisons pour lesquelles j’ai quitté la Ferme Body Weather. Parce que c’était en même temps une communauté très surannée. Ces fermiers étaient aussi très conservateurs ! Oui. Mais c’était pour Min une sorte de défi de travailler dans cet endroit. Je ne dis pas, comment dire, qu’il n’est pas un grand homme et une personne intègre, mais je pense qu’à ce moment-là… OK, je me tais.

Fonds d'archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
6. Chorégraphie, improvisation et images
Presentation
Min Tanaka était-il un chorégraphe ? Il semble qu’il ne l’était pas dans le strict sens du terme, mais il l’était malgré tout en tant qu’initiateur de performances et metteur en scène de la danse. Cela voulait dire qu’il y avait des hiérarchies dans la valeur artistique des différentes formes de chorégraphies. Dans ces conditions, comment se passaient les sessions de préparation aux performances ? Quel était le degré d’improvisation dans les performances ? Quelle était la place de la technique, si celle-ci a un sens ?
La présence d’images était un élément important qui permettait l’émergence formelle des différentes prestations.
Oguri :
Avant tout, d’après mes souvenirs, dans les années 1980 Min n’a jamais mis son nom sur les programmes en tant que chorégraphe, comme par exemple « composé par Min Tanaka »[12] dans une performance de groupe, je m’en souviens bien. L’idée de composition impliquait trop pour lui un cadre très strict. Et la chorégraphie, en quoi cela consiste ? Ça a changé au fur et à mesure du temps – je ne parle que de cette période 1985/86 – oui, c’était des tâches. Un mouvement, proposé comme une tâche. La tâche de sauter en l’air, la tâche de sauter en l’air cent fois de suite en se tenant avec le corps droit. Voilà un exemple. Mais la composition, c’est comme une carte routière très claire alors que d’habitude, on ne répète jamais deux fois la même performance. Même au cours de la même série de performances. Le deuxième jour, dans la même série, beaucoup de changements ont lieu, même la composition est sujette à quelques changements. Une saison après cela, on retrouve dans la performance des ressemblances au modèle original, mais avec des petites différences. Les performances n’ont donc jamais été identiques durant cette période.
Plus tard, particulièrement quand on vivait à la ferme, beaucoup de productions et répétitions avaient lieu à la ferme. À l’intérieur, dans un studio – ce n’était pas vraiment un studio de danse, c’était dans la maison, nous avions une plus grande pièce, à l’étage. Les répétitions avaient lieu là ou bien dehors où on avait construit une scène pour les répétitions. Là encore, pour les performances, cela induisait différentes situations. Quelque fois on présentait une performance dans un petit studio ou bien à d’autres moments on présentait dans un grand théâtre des pièces expérimentales élaborées dans un petit studio. C’étaient des processus différents. Habituellement, on élaborait des compositions. Et puisqu’on vivait ensemble, la composition pouvait être expliquée dans un langage plus abstrait… Mais elle était toujours très liée à chaque corps pris individuellement. Le corps incluant aussi l’esprit, oui, sans prendre en compte de savoir si une personne en particulier avait de la souplesse ou si elle avait de grandes capacités dans ses mouvements, cela n’était pas très important. Et il y avait beaucoup d’improvisation à l’intérieur de tout cela. Min exigeait de chaque performeur une vraie responsabilité. Min Tanaka n’indiquait pas comment il fallait danser, il ne déterminait pas le mouvement de la chorégraphie. Plus tard, après avoir acquis une grande expérience de la danse à la ferme en extérieur, je me souviens d’une composition – très, très simple : se contenter d’être là, d’assumer une présence. Mais à chaque fois, après les répétitions, il nous faisait part clairement de ce qu’il avait noté pour chaque danseur individuellement. Tout ce qu’il observait donnait lieu à des commentaires très clairs pour préciser ou changer des choses en vue d’une meilleure performance, oui, sans donner jamais un but à atteindre. C’est ce que je me souviens de la façon d’aborder le travail en ce temps-là. Merci[13].
Christine Quoiraud :
On travaillait avec beaucoup d’images, et ces images provenaient de l’expérience de Tanaka Min avec Hijikata lorsqu’il a chorégraphié un solo pour Min. Il a utilisé les images peut-être à partir de ce moment, pendant les années où il travaillait sous la direction de Hijikata, je pense que c’était 1984. On est arrivé en 1985. C’est alors qu’il a utilisé les images. Dans mon souvenir, il nous proposait une méthodologie pour travailler à partir d’images. Il s’agissait donc d’une liste d’images. Et comme l’a dit Oguri, il ne nous a jamais montré des mouvements. Il nous donnait juste des mots et nous laissait nous débrouiller avec ces mots. Et ensuite il nous voyait aux répétitions. Et alors il ajustait. Encore une fois, dans mes souvenirs, c’était comme s’il sculptait ou créait l’espace du corps dans l’espace. Et dans l’espace, cela veut dire ici avec la lumière, avec le décor, avec le déroulement du temps, avec les autres, et je pense qu’il avait toujours en tête la conscience de la présence du public. Que cela soit à l’intérieur ou à l’extérieur, la question de la présence du public était toujours très importante. Et ce que j’ai le plus appris à ce moment-là, c’est je pense le respect du public. Ce travail sur les images consistait à toujours chercher comment donner une vitalité et une énergie au cheminement des images, c’était quelque chose impossible à stabiliser ou à fixer dans une forme. Si maintenant, on tentait de vous montrer une image, peut-être que Katerina, Oguri et moi, on devrait chercher comment faire vivre cette image.
Quand j’utilise le terme d’« image », il s’agit d’une liste de mots, oui. En fait, en 2017, j’ai organisé un atelier au CND (Centre National de la Danse) et j’ai invité Oguri pour l’animer en mettant l’accent sur l’« image » et il y a un enregistrement de cet atelier au CND. Et en fait, dans le travail de retour sur cette expérience que j’ai fait et qui est en ligne, (médiathèque du CND), j’ai transcrit le travail d’Oguri. J’ai transcrit, traduit et commenté son travail. J’ai même traité des fondements de l’enseignement d’Oguri. Par « traité », je veux dire décrypté, [en français dans l’original en anglais] : « Oguri dit ceci et il montre cela ». Et je décris : « ses mains sont sur sa tête, et son épaule est en train d’aller vers l’arrière, … ». Je décris ce que je vois sur la vidéo, ce que je vois de ses mouvements, de son corps, dans l’espace, alors qu’il enseigne.
Oguri :
Juste une chose concernant la chorégraphie de Min Tanaka et de ce travail sur les images que vient de mentionner Christine. Hijikata Tatsumi, Tatsumi Hijikata a été une source d’inspiration pour Min Tanaka. Et Min Tanaka a été chorégraphié par Hijikata Tatsumi je pense en 1984. Alors, à cette époque, Min Tanaka est très proche du Ankoku butō[14]. Ce que Tanaka a partagé avec Hijikata Tatsumi, c’est ce travail sur les images. Ainsi, Hijikata Tatsumi a utilisé beaucoup d’images de l’environnement et de tableaux. Min nous a introduit à ce travail avec Hijikata et on a aussi inclus ce travail sur les images dans nos performances. Et plus tard, l’approche de ce « travail sur les images » a été quelque peu modifiée[15]. Les choses que j’ai mentionnées au CND représentaient vraiement un ancien travail. Ce sont juste différents outils qui ne correspondent plus aux chorégraphies d’aujourd’hui. Ils étaient datés de ce temps-là. De ce qu’on faisait alors. Je pense que plus tard, il a changé de méthode. Ce travail sur les images avait été intégré dans nos corps. Dans nos corps, on contient l’extérieur. En conséquence, à partir de ce moment, les paysages sont inscrits dans notre corps : on peut dire que l’on a un « grand lac dans le corps ». Et il y a une « forêt tropicale dans la tête » et il y a « une maison qui brûle à l’intérieur du corps » et « la fumée monte ». Ce n’est pas une image à l’extérieur. Ça vient du dedans. La lune, le ciel sont incorporés en nous. Ce fut un grand changement pour les performances. Avant c’était très précis. Avec cette partie du corps, on rend telle image. Il faut avoir un esprit très vif pour comprendre et adopter n’importe quelle position du corps. L’idée de l’interne-externe a tout changé, c’est l’expérience de Min Tanaka qui est devenue la mienne. Je ne sais pas comment il travaille aujourd’hui avec les personnes. Son style de danse ou de chorégraphie est comme le Body Weather, cela ne reste jamais au même stade. Alors, oui, je le redis, je suis un peu comme un témoin des années 1980. C’était seulement cinq années… mais cela a suscité en moi beaucoup de changements.
Katerina Bakatsaki :
Comme Oguri l’a dit, il y a eu différentes périodes et il y a eu une évolution dans les différentes images utilisées à des périodes données. Donc j’hésite, je pense qu’il y a des images dont on se souvient particulièrement bien. Mais ce que je veux dire c’est que le travail avec les images s’inscrivait aussi dans la pratique et était une des nombreuses manières de sensibiliser le corps aux mots qui existent dans chaque image. Et aussi sensibiliser le corps à des entités non-humaines, que cela soit un objet, que cela soit l’eau, que cela soit la rivière, le riz, etc. Les images évoquaient, pour le dire autrement, une altérité en dehors de l’humain, elles invitaient les non-humains à s’introduire dans le corps. Donc, une des images qui me vient maintenant à l’esprit est celle d’un jeune singe qui boxe dans le ciel, boxe le ciel, dites-moi si j’ai tort. Boxer avec le ciel ou boxer le ciel.
Christine Quoiraud :
Avec des gants de boxe rouges et ce singe était assis sur une chaise de salon de coiffure [rires], chez le barbier… Ailleurs, à un autre moment dans une performance, on était trois femmes en train de danser avec des culs comme ceux des vaches et nos bassins se balançaient « ting…ting… ting… ting… » (comme la queue des vaches chassant les mouches, on balançait les hanches d’un côté à l’autre). Ou bien on avait un poteau électrique vertical à l’intérieur du corps.
Katerina Bakatsaki :
C’est ainsi que les images étaient utilisées dans différentes pratiques pour sensibiliser et pour éveiller le corps, mais ce qui était spécifique, comme je l’ai déjà dit, c’est que les images invitaient les non-humains et elles étaient extraordinaires, je veux dire dans leurs échelles, par leur richesse
Christine Quoiraud :
Mais c’était aussi l’occasion de fragmenter le corps. On avait en même temps à se concentrer sur plusieurs images s’adressant au corps et chaque partie du corps se chargeait d’une image particulière : la tête, les bras, le torse, le ventre, le dos, les jambes et les pieds, tout cela en même temps. Puis on changeait subitement de collection d’images, c’était aussi une source de tension pour le système nerveux. Comme si on était… Min Tanaka utilisait l’expression « d’être attaqué » par les images. Et ainsi, c’était aussi une manière d’être à la fois en contrôle et sur la frontière, au bord du manque de contrôle. On était toujours en danger de tomber totalement dans ce qu’on ne pouvait plus contrôler, fatalement. C’était pour moi quelque chose qui ressemblait au risque de l’improvisation, c’est bien cela. On essayait aussi d’atteindre les images, et elles étaient en quelque sorte hors de portée de nos mains, elles s’échappaient constamment. Il s’agissait dans mon souvenir de monter en intensité, l’intensité de la capacité à se concentrer.
Katerina Bakatsaki :
Une autre image, un autre travail, qui a été utilisé plus tard : je me souviens qu’on a beaucoup pratiqué, pratiqué dans le sens de la recherche et l’expérimentation : c’était un travail sur la notion de marionnette. On était une marionnette dont les mouvements étaient manipulés par les fils d’un marionnettiste. Il ne s’agissait pas d’imitation mais de cette notion, de cette invitation au corps à se désarticuler – comment dire ? – une invitation au corps d’être contrôlé par quelque chose d’autre que lui-même. Et la notion aussi, je pense, que beaucoup de ces images appelaient à la perméabilité. La perméabilité du corps –je me souviens que Min utilisait plutôt le mot « attaque » – mais celle du corps ouvert à l’imagination, par le biais des sensations et de l’imagination de ce qui était en dehors de lui-même.
Christine Quoiraud :
Être « attaquée », bombardée d’images, c’est une façon de saturer d’informations le cerveau, de déjouer l’habituelle production d’images propre à chacun. Se donner une chance d’« être dansé(e) » par quelque chose d’autre que sa propre imagination.
On a beaucoup travaillé aussi la « stop motion ». On commence le mouvement et on s’arrête… on introduit l’idée de couper le sens du mouvement et de réfléchir à la durée du mouvement, son ampleur et combien de temps va durer l’arrêt. On a beaucoup fait cela et aussi à un moment donné on a beaucoup travaillé sur la répétition du même mouvement, « encore… encore… », ou « continuez longtemps ».
Oguri :
Je pense aussi un peu au « training » et au « M. B. training ». On a pratiqué la coordination du corps avec des rythmes, pour la droite et pour la gauche du corps. C’est une façon de bien prendre conscience du corps, de se connecter avec le corps, avec des parties du corps, en soulevant les genoux, tournant les hanches, des choses très simples. C’était comme l’intention d’aller vers autre chose, vers la manière de parvenir à la dislocation du corps. La dislocation… Oui. Ce « travail sur l’image » dont vient de parler Christine, consiste à diviser tous les membres du corps : la tête, les bras, le torse et les jambes. Et en même temps de mettre en mouvement des qualités différentes, des vitesses différentes, des mouvements d’images complètement différentes à faire en même temps. Et cette image se transforme dans le mouvement suivant, les parties du corps changeant des centaines de fois dans des transitions, des transitions, des transitions, la transition entre les images faisant aussi partie de l’essence de la pratique. Il s’agit donc plutôt d’un processus de dislocation du corps, comme une mémoire de la petite enfance, de la façon qu’a un nouveau-né de se mouvoir. Ce mouvement n’est certainement pas lié à son esprit ou sa conscience, ou à un sourire d’ange. Quand un bébé commence à sourire, ce n’est pas sous l’effet d’une émotion, c’est une sorte de sensation qui émerge. Je pense donc que Min Tanaka ou Hijikata Tatsumi ont été à l’origine de cette façon de se concentrer sur ces aspects. Il s’agit de notre mémoire corporelle de l’expérience de la petite enfance à ce stade du développement du mouvement. Et encore ici, cette image précise fait entrer les choses de l’extérieur à l’intérieur de soi. Cela pose un défi considérable. Si on ne comprend pas ceci, on ne peut pas faire cela. Certaines personnes peuvent y arriver et d’autres non. Comment accepter cela : faire entrer à l’intérieur de son corps tout un paysage urbain. Mais je pense que la danse peut le permettre, oui !
Christine Quoiraud :
Cet exercice est très difficile à réaliser. Il y avait des danseurs qui n’étaient pas capables de réaliser cela ou de le faire par eux-mêmes. Il s’agissait de remplir la totalité du corps avec une collection d’images changeant constamment. Une concentration difficile à tenir.
Oguri :
Concernant la chorégraphie de Min, le training, le M. B. training pour coordonner le corps, je pense qu’il s’agissait plutôt d’aller vers le démembrement.
Christine Quoiraud :
Le training n’était pas là pour renforcer les capacités du corps mais plutôt de déconstruire sa cohérence en tant qu’unité psychosociale.
Oguri :
Oui, on travaillait beaucoup avec un partenaire. Et le corps est le meilleur des textes pour apprendre. On a des méthodes d’étirement du corps et des séries d’alignement du corps appelées « Manipulations pour les corps ». Entre deux partenaires : ne pas parler pendant deux heures et porter mutuellement attention au corps de l’autre. Puis parler entre partenaires de cette expérience, pour y répondre complètement. Partager ce qui s’était passé pendant ces deux heures d’engagement mutuel. Et de partager, encore et encore. Et apprendre que les corps sont en perpétuel changement. On retrouve là tous les concepts de Body Weather : ne jamais répéter la même chose et assumer la responsabilité de partager le temps et l’espace avec les autres. Ces principes ont perduré sur le long terme.
[Voir Inventaire (Archives Christine Quoiraud de la médiatéque du Centre national de la Danse).]
C’est un peu lié à l’idée de mentor japonais. Cela n’a pas d’importance si c’est japonais ou pas. Mais l’idée du mentor, de la morale ou de l’éthique était bien là. On apprend que la technique fait partie de l’espace. Comme dans les arts martiaux, il faut toujours d’abord faire le vide dans l’espace et commencer par un salut. C’est ce genre de morale ou de respect de l’espace qui opère. On apprend l’espace dans la danse. Et que chacun est pour l’autre un mentor. J’ai beaucoup appris de Min Tanaka et de Noguchi San en opérant les lumières dans les coulisses du théâtre. Ou en faisant pousser des légumes à la ferme, ou avec les paysans du coin jouant le rôle de mentors. Et même après cinq années passées à devenir un danseur compétent ou un fermier compétent. Parce que parfois je servais de mentor à des jeunes ou à des débutants. Les relations que j’ai eues avec ces personnes m’ont aussi beaucoup appris. Tout cela est donc lié à la question des communs. C’est la communauté, on apprend mutuellement à faire les choses. Tout le monde est mentor, dans tout. Notre productrice Kazue Kobata en était une. Mes collègues, comme Christine ou Katerina venaient d’horizons différents, c’est une caractéristique unique du Body Weather : Européens, Japonais, Américains, on vivait ensemble. Et le langage en commun était l’anglais, qu’aujourd’hui je ne parle toujours pas très bien. C’est comme cela qu’on communiquait et que les choses pouvaient se faire. Et après tant d’années, on a encore aujourd’hui ce genre de relations.
Christine Quoiraud :
Je pense que je suis très reconnaissante des relations entre nous. On s’entraidait les uns les autres. On s’influençait. Je pense que j’étais comme Oguri. Oguri m’a aidé d’une certaine façon à la ferme à entrevoir la tournure d’esprit des Japonais et peut-être, en se parlant, je transmettais la tournure d’esprit individualiste occidentale – j’évoluais plutôt dans une pensée faite de rencontres et d’échanges. On s’influençait mutuellement, peut-être sans en être conscients, mais c’était facilité par le fait qu’on passait beaucoup de temps ensemble. Cela semble très banal, mais cela ne l’était pas tant que ça. Comme le dit Oguri, nous continuons d’avoir le même type de relations après beaucoup de décennies, après tant de temps, c’est un lien très fort. Et je veux partager l’idée que je ne pense pas avoir été là-bas pour apprendre une technique ou comment danser. Mais je sais qu’à l’issue de cette expérience, comme Oguri l’a dit, j’ai aussi senti que j’étais totalement prête à aller dans le monde et à danser. J’avais vraiment la sensation, non pas que j’étais orgueilleuse ou prétentieuse, mais que j’avais la pêche, le courage oui ! Et ce qui a été le plus difficile pour moi quand je suis revenue en Europe, c’était de pouvoir continuer avec la même intensité, de trouver le moyen de continuer cette intensité de vie. Et à ce moment-là en France, en Europe, c’était une logique complètement différente. C’était le début des « intermittents du spectacle » en France, s’apparentant à cet état d’esprit de fonctionnaire et moi, je ne pouvais pas entrer dans cet état d’esprit. Oui.
Katerina Bakatsaki :
En termes de technique, je pense que nous savons tous que la technique comprend plusieurs états, différentes formes, différentes manières de la comprendre ou de la disséminer. Je pense que tout le training, le M. B. inclus, était là pour répondre à la question fondamentale, qui était, si je peux me permettre, comment s’incarner de manière plurielle dans des corps multiples. Pour être plus précise, si l’on considère le training comme une recherche et pas comme une méthodologie pour devenir quelque chose, cela clarifie déjà beaucoup les choses. Et pour moi, la question qui constamment se pose, c’est comment s’incarner dans des corps, encore une fois dans une pluralité. On peut objecter, en se plaçant d’un point de vue différent, que cette pluralité est problématique, mais en tout cas, en tant que question philosophique, il faut se demander : que se passe-t-il si le corps n’est jamais un, s’il est plus qu’une entité et s’il est plus qu’être humain ? Ainsi, tout le training est constitué comme recherche, comme trouver des manières d’explorer cette question fondamentale. Dans ce sens, je ne pense pas que la technique sert à devenir quelque chose, mais c’est une méthodologie très claire, très cohérente, toutefois pas fermée, de questionner les choses. C’est comme ça que je vois les choses. Cependant, comment est-ce que cela peut déboucher sur une performance, sur une présentation sur scène, des choses très basiques que je suis capable de saisir ? Encore une fois, c’est cultiver la perméabilité du corps et aussi sa capacité à être lucide, clair, attentif, sans pour autant être égocentrique, de façon à pouvoir disposer d’outils pour exister dans les performances. Pourtant ce n’est pas un entraînement qui nous conduit à la performance, c’est comme le dit aussi Deborah Hay[16] : au cours d’une performance on continue à s’entraîner, on continue à pratiquer ; ou bien la pratique en tant que telle n’existe pas, car on est toujours en train de faire une performance. Il y a la nécessité de porter l’attention à la fois sur le corps et sur tout ce qui n’est pas le corps, c’est cet aspect qui doit être l’objet d’un entraînement. Donc, dans un sens, c’est une technique, une technique non-formelle, qui est présente chez d’autres artistes tels que Déborah Hay, Anna Halprin, Simone Forti, etc. Il s’agit d’une pratique basée sur le non formel. La question que je me suis posée au sujet de la technique ou de son absence après avoir quitté le Japon (et jusqu’à aujourd’hui), s’articule en quelque sorte de la façon suivante : « Comment est-ce que je peux continuer à m’entraîner, comment est-ce que je peux continuer à pratiquer ? » Comment pratiquer la vie et tous les aspects de la vie quand je ne suis plus au Japon ?
7. Les relations avec la musique
Présentation
Les relations entre la danse et la musique dans le Body Weather sont sources de conjectures. S’agit-il d’une histoire où la danse a acquis une autonomie progressive par rapport à toute illustration du discours musical, ou la musique fait-elle partie d’un environnement sonore général dans lequel la danse prend place selon divers modes de relations ? La notion de sons environnementaux peut inclure les sons de la vie quotidienne (urbains, ruraux et naturels), la composition musicale d’un espace donné, des interactions improvisées avec un musicien ou la musique enregistrée dans de nombreux styles. Les sons de l’environnement sont-ils des points de contact pour Body Weather, des supports de mouvements du corps ou des sources d’inspiration ?
Katerina Bakatsaki :
Avant la musique il y a l’écoute. C’est-à-dire qu’avant d’avoir conscience de la musique, il y a la conscience d’une écoute. Au fait, quand on aborde la question de langage, ce n’est pas comme s’il n’y en avait pas. Le langage était présent, mais peut-être parce qu’on ne se comprenait pas, il y avait différentes manières d’écouter le langage. Rien de nouveau dans ce que je dis, mais je veux juste dire qu’on n’avait pas éliminé le langage. Toutes sortes de langues étaient utilisées, anglais approximatif, japonais approximatif, tentative de parler sans perdre le sens de ce qu’on dit, essayer de comprendre avec les yeux et les oreilles en même temps, pendant qu’une personne parle, etc. Ainsi, le langage était présent comme mode d’écoute, comme quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre mais que vous tentez de comprendre, mais pas en termes de sémantique. À ce propos, je n’oublierai jamais le festival Obon (festival d’été traditionnel, vers le 15 août, la fête des morts)[17]. La musique, la danse et le chant au festival Obon.
La musique… ? Il y a beaucoup à dire ! Oguri ? Christine ?
Oguri :
Je me souviens très bien du son des grenouilles. Dans la ferme il y avait une deuxième maison servant d’entrepôt. Et dans le temps, ils utilisaient l’étage supérieur de cet entrepôt pour les vers à soie. C’était juste au premier étage. En fait, dans la ferme il n’y avait pas de portes sauf pour les toilettes, c’était juste… vous savez… Donc, une grande pièce à l’étage et à l’origine il n’y avait pas de fenêtres… Au début de l’été, on préparait l’eau de la rizière. La surface de l’eau est très claire et il y a des grenouilles, des grenouilles qui produisent des sons, d’une rizière à une autre elles font un chorus en copulant aux yeux de tous. C’était… Je n’oublierai jamais cela. « Hrogh, ghrogh, hrogh, ghrogh » [il imite une grenouille]], je ne sais pas, comme un millier de grenouilles, comme le bruit d’une centaine de grenouilles mettant ces deux rizières en mouvement…
Christine Quoiraud :
… et le son constant de l’eau qui coule.
Oguri :
Ah oui ! Et l’eau est si belle, « trrrrrrrrp », et… Et je ne sais pas si c’est encore là aujourd’hui.
Christine Quoiraud :
Oui c’est toujours comme ça.
Oguri :
Je veux dire, l’eau peut couler mais c’est aussi une eau différente. Cela ne fait pas le même son. Et les maisons, la circulation, tout cela a changé. Ce n’est plus aussi silencieux…
Christine Quoiraud :
… et le son des feux d’artifice…
Oguri :
Sons de feux d’artifice ? Oui… Mais de toute façon il y avait dans la maison toujours des bruits, comme l’a dit Katerina, plein de langages dans la maison, pas de portes. Oui… et des filles qui se disputaient… seules les filles…[rire] Oh ! je ne devrais pas dire cela [rires]…
Christine Quoiraud :
… et aussi souvent chanter des chansons, on m’a souvent demandé de chanter en français…
Oguri :
Oh oui, oui ! Tu as une voix magnifique, Christine !
Christine Quoiraud :
… un des premiers solos d’Oguri au Plan B, il a dansé sur Klaus Nomi, [elle chante] “I’m wasting my time… on you———-” (souncloud.com).
Oguri :
[Rire] Tu chantes moins bien !
Christine Quoiraud :
On avait le M.B.Training sur la musique des Beatles, comme « Stand by me », comme « bla, bla, bla », Michael Jackson… Et ainsi de suite… Et il y avait la musique des groupes traditionnels. Parfois il y avait la visite de musiciens étrangers avec une guitare ou d’autres instruments. Et il y avait aussi principalement Cecil Taylor, Derek Bailey…
Oguri :
Et… Oui… Nous n’avons pas parlé du « Art Camp », le festival annuel à Hakushu (festival international d’été, organisé par toute l’équipe et avec les villageois)[18]. Vous savez, je pense que la seconde année de vie à la ferme, le festival a commencé. On n’était pas encore des fermiers, mais on a commencé à organiser le festival annuel, c’était aussi un autre évènement remarquable.
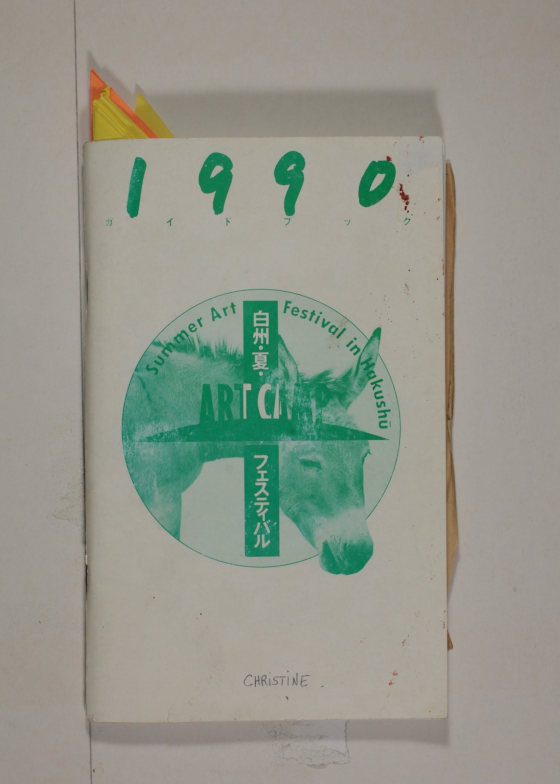
Fonds d'archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
Katerina Bakatsaki :
Je voudrais en revenir à la musique. En termes de musique, comme la musique instrumentale, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas parler de Min, parce que Min en tant qu’artiste a eu des collaborations extraordinaires avec beaucoup de musiciens, et de penseurs aussi. Mais en ce qui nous concerne et la manière avec laquelle on envisageait les relations avec la musique, je pense qu’on se posait des questions – peut-être que je parle pour moi – sur comment faire, on se plaçait un peu dans les perspectives de l’autonomie de la danse vis-à-vis de la musique, ce qui n’était pas nouveau, parce que cela avait été déjà fait aux Etats-Unis et en Europe. Mais on avait en quelque sorte hâte de comprendre comment la danse pouvait se suffire à elle-même indépendamment de la musique et de ce qu’elle représentait. Et à partir de cela, petit à petit, on a construit, on a cherché les connexions avec la musique.
Je n’ai pas de réponses définitives à proposer sur les relations de toutes choses par rapport à d’autres dans ce qu’on appelle le Body Weather. Il y a aussi une différence qui est peut-être plus spécifique, entre d’une part l’utilisation de l’expérience de la musique et le partage de l’espace et de la musique durant la performance, et d’autre part, dans la pratique dans les ateliers, durant l’entraînement, dans la manière de conduire nos vies, dans notre engagement mutuel les uns avec les autres et notre engagement avec le travail. Il s’agit donc de territoires différents qui sont bien sûr en interaction, mais qui impliquent des situations différentes. C’est quelque chose que j’ai besoin de clarifier. Aussi, si on place cette expérience ou cette expérimentation dans le cadre de notre training et de celui de nos performances, c’est parce que nos relations à la musique et aux sons étaient différentes dans les deux cas. C’était aussi quelque chose qui n’était pas exclusif au travail réalisé dans cette communauté. Je veux dire, pour se placer dans un contexte beaucoup plus élargi, on connaît bien l’expérimentation post-moderne et tous les travaux des pionniers de la Judson Church[19], il s’agit là aussi du même type d’expérimentation et d’exploration. Donc, je ne pense pas que c’était quelque chose d’unique au travail que nous faisions. C’était quelque chose qui mettait en lumière ce qui était présent chez un grand nombre de différents artistes dans différents lieux dans le monde : l’importance primordiale de l’écoute (je l’ai déjà dit), c’est-à-dire de mettre en action le corps pour être à l’écoute. Je pense bien sûr que voir, regarder sont des choses importantes, mais l’oralité était fondamentale dans le training lui-même, la mise en action de l’écoute à tout ce qui est du domaine du son. Cela implique donc beaucoup de travail en silence dans des environnements naturels – je parle ici d’une sorte d’entraînement – l’oreille se mettait donc en action pour porter une attention intense aux micro-sonorités, à celles que notre propre corps peut produire, en relation avec les sons qui proviennent de l’environnement et aux sonorités qui sont produites par interaction.
Et aussi, je me souviens, on s’occupait d’animaux, c’était essentiel aussi d’apprendre à écouter littéralement les sons produits par les animaux en vue d’établir une proximité. Mais là aussi, il n’y a rien de nouveau à cela, ce n’est pas quelque chose d’innovant, c’est quelque chose que tous les paysans connaissent. C’est aussi très présent chez toutes les personnes qui s’occupent d’animaux. Et donc, vous le voyez bien, je continue à ne pas traiter de la question de la musique et je me limite à l’écoute de différents types de productions sonores et des réponses éventuelles qui peuvent y être apportées.
Christine Quoiraud :
Min Tanaka proposait dans ses ateliers, au début de ses visites en Europe, des exercices d’écoute tels que celui que j’ai décrit plus haut concernant les participants ayant les yeux bandés et devant désigner avec leur index la direction des sons produits à divers endroits dans l’espace.
Oguri :
OK, je me souviens bien de ces ateliers et de ce qu’en a dit Katerina. Oui, je suis d’accord. J’ajouterais juste quelques éléments. Dans les performances, il n’y avait rien qui reliait directement le rythme et les mouvements, dans le Maï-Juku ou dans la danse de Min Tanaka. Et je ne me souviens pas qu’il y ait eu des mouvements correspondant exactement à la musique, comme par exemple des mouvements suscités par une mélodie[20]. La danse n’était pas liée de cette façon à la musique. Je pense que la danse ne se construisait pas à partir de la musique, c’est dans ce sens que je veux dire qu’il n’y avait pas de relations directes. Il était possible d’envisager la musique comme un élément important en tant qu’environnement. Avec la musique, on pouvait ressentir quelque chose provoquant une émotion, ou faire la rencontre avec des sons et des silences permettant une compréhension de l’espace. C’est cela qu’on avait appris à l’écoute de l’environnement naturel, comme ce que j’ai dit au sujet des chants de grenouilles dans la nuit, comment les sons passaient d’une rizière à une autre, une expérience totale de l’environnement dans l’espace et le temps… toute la nuit jusqu’à ce que je m’endorme. Et c’est ainsi dans la vie quotidienne et dans la création artistique, ou dans les ateliers où l’on fait l’expérience stimulée par la vie… par toute la vie. Pour moi, la ferme, la performance, ne sont pas séparées de la vie. Je ne sépare pas, notre vie est une.
Et que dire d’autre ? Oh, il faut noter la présence permanente de Minori Noguchi[21], un compositeur invité. Il joue du synthétiseur. Donc il joue toujours en temps réel, il n’utilise pas de disques, d’échantillonnages, ou des compositions enregistrées. Il n’enregistre jamais ses compositions, comme la danse qui ne se produit qu’une seule fois. Les sons de Minori Noguchi ne se produisent qu’une seule fois. Il est facile de dire ”improvisation”, mais c’est de la musique vivante et vous savez, ce n’est pas gagner sa vie. Et, comment dire ? Il ne s’agit pas de créer des raisons de faire bouger les corps par des ambiances sonores suscitant des mouvements flottants. Ce n’est pas ça avec lui. C’est tout à fait comme une stimulation, quelque chose à laquelle il faut faire face dans l’espace. Oui, spatial, spatialité. Oui, il crée un espace sonore. C’est ce dont je me souviens.
Minori Noguchi (électronique vivante) et Min Tanaka (danse), 2006, Tokyo.
Cliquer sur « Regarder sur YouTube ».
ESSSAI
 |
Cliquer sur le logo ci-contre, le propriétaire de la vidéo ayant désactivé la lecture sur d’autres sites Web. |
Minoru Noguchi est un compositeur qui utilise l’électronique, les bruits, et des équipements variés. Je me rappelle qu’il avait installé beaucoup de petits haut-parleurs dans l’espace où le public était assis. Et avant que la performance ne commence, dans le temps qui précède la performance, il commençait à diffuser ”t… ttt… tt… t… ttt… » [des bruits de bouche presque imperceptibles], des bruits très subtils se faisaient entendre, oui, et cela changeait graduellement pour en quelque sorte se libérer « free———— » [presque chanté]… Oui ! Des sons tout à fait liés à l’espace et à la conscience des auditeurs ou des performeurs, la conscience qui s’éveille, ce type de composition et ce qu’elle pouvait susciter.
Katerina Bakatsaki :
Je pense que c’est très intéressant, Oguri, la manière que tu as de soulever la question de la spatialité des sons. Et aussi, tu prends soin de souligner l’importance de déterminer quelle était la fonction du travail de Noguchi, des sons, de la musique de Noguchi. Ce n’était pas une musique d’ambiance, comme tu l’as dit, en vue de créer une atmosphère, mais plutôt de créer un espace littéralement en termes de vibrations dont la nature est effectivement très concrète. Je veux dire par là qu’il s’agit de créer un espace, différents types d’espace, des micro-espaces, ou différents sens de l’espace, différents espaces d’imagination, différentes sensibilités, ou bien de provoquer dans l’oreille différentes sensibilités à l’espace, à l’espace tel qu’il existe. Je pense que la contribution de Noguchi a été de cet ordre. C’est évident qu’il était aussi conscient que sa contribution s’inscrivait dans une œuvre d’art total. Mais ce qu’il produisait constamment était perçu par nous, comme des couches de l’espace se superposant. Et cela m’amène à revenir sur le training, et sur la façon dont le training s’intègre dans les performances : je suis d’accord avec toi Oguri, il y a des interrelations constantes mêlant les éléments les uns dans les autres, et en même temps, je pense que cela se combine avec des situations toujours différentes. Le training, c’était vraiment un entraînement du corps à écouter de différentes manières, à répondre à l’expérience acoustique de beaucoup de façons différentes et à s’orienter soi-même dans la capacité de savoir où l’on est, de savoir se situer, de se placer soi-même quelque part en relation avec les sons. Ainsi, à cet égard, toute production acoustique, la musique si vous voulez, la matière sonore était reçue de la même manière pendant les performances. Ou pour le dire autrement, les corps étaient formés et sensibilisés pour répondre aux sons comme si c’était une matière et comme s’il y avait aussi un espace qui constamment demandait au corps de s’orienter à partir du système nerveux, de s’orienter et de se réorienter soi-même pour se replacer, se placer soi-même, encore et encore. J’espère que ce que je dis fait sens. Oui, c’était une activation constante du corps qui tentait de s’orienter en relation avec les sons.
Christine Quoiraud :
Puisqu’on parle de performance, je me souviens encore de performances avec Min Tanaka lors de ses premiers séjours en Europe. Et à ce moment-là, il dansait en mouvements lents, presque nu, sans musique. Sauf quand il était en duo avec Derek Bailey au Palace à Paris et plus tard avec Milford Graves. Mais ensuite, il a commencé une série de performances intitulée « Émotion » au début des années 1980. Mais c’était plutôt “a motion”, comme dans le sens de se mettre en mouvement. C’était accompagné d’une musique avec une charge émotionnelle très forte, comme de la musique populaire, mais c’était vraiment une décision très claire de sa part de jouer sur les affects du public. Mais quand on participait au Maï-Juku, si je me souviens bien, il y a eu plusieurs types de performances. Parfois la performance se déroulait à l’intérieur. La plupart du temps Minori Noguchi était celui qui construisait l’espace sonore. Mais quelque fois, dans une pièce solo, Min venait avec une musique de son choix. Ou bien souvent, on dansait à l’extérieur, comme dans des rivières. Dans le film de Eric Sandrin “Min Tanaka et Maï-Juku”, on peut voir une séquence de danse dans la rivière, il s’agissait d’un exercice et non pas d’une performance. L’auteur du film a choisi de mettre de la musique qui n’avait rien à voir avec les circonstances[22]. C’était à la fin du Maï-Juku intensif en 1985.
Voici la vidéo « Danse Body Weather dans la rivière » (Eric Sandrin, Min Tanaka et Maï-Juku, part 4/5 à 2’57):
Eric Sandrin, « Min Tanaka et Maï-Juku » Part 4/5.
Cliquer sur « Regarder sur YouTube » et aller à 2’57”.
Voici une autre partie de la vidéo d’Eric Sandrin où l’on voit Hisako Horikawa en répétition. Elle travaille sur la musique de Noguchi (à 8’19”) :
Eric Sandrin, « Min Tanaka et Maï-Juku » Part 2/5, à 8’19”..
Katerina Bakatsaki :
Et bien évidemment, la bande-son du documentaire est le choix artistique de l’auteur du film.
Pour revenir à la question des relations de la musique avec la danse, sa pratique, sa performance, de l’exploration de ses mouvements ou de la recherche en danse, encore une fois je ressens le besoin de dire que c’était à travers la pratique et les performances, cela veut dire la totalité du travail, que la préoccupation principale consistait à soulever la question de « qu’est-ce que la danse ? » encore, encore et encore. Par conséquent, il ne s’agit pas de considérer la danse comme une discipline mais comme un phénomène qui fait partie de la vie non seulement des humains mais aussi des entités autres que le monde des humains. La danse était explorée comme une chose en soi. Vous savez, on ne se posait peut-être pas la question de la danse et de la musique. Parce que la danse était considérée comme un phénomène en relation avec quoi que ce soit d’autre. Donc on peut le dire de cette façon : ce qui est sonorité est sonorité, ce qui est mouvement est mouvement, et c’est tout. De ce point de vue, la préoccupation majeure ne portait pas sur la musique, mais sur la question de l’écoute par le corps. Pour moi, avec le recul, je comprends que quand on parle de la danse et de la musique, une des questions principales portait sur l’idée qu’il n’était pas question de musique, mais de la manière dont le corps écoute quand il danse, ou même en dehors de toute performance.
Christine Quoiraud :
Je veux seulement ajouter quelque chose sur ce point. Dans mon souvenir, il faut distinguer deux situations : d’une part, il y avait des moments, lorsque Tanaka était chorégraphe, où parfois il proposait de la musique enregistrée. D’autre part, à d’autres moments, il dansait avec un musicien en improvisant. Il improvisait la danse et la musique était improvisée, c’était une musique vivante. Et Noguchi prenait aussi part à ce processus. À ce propos, cela faisait plusieurs décennies que Noguchi travaillait avec Min. Ils se connaissaient depuis très longtemps et avaient travaillé ensemble pendant de longues périodes. Et oui, je me souviens, quand Min chorégraphiait des pièces de groupe dans un théâtre fermé, il organisait vraiment tout. Par exemple, il déterminait les lumières, le décor et aussi les mouvements, les mouvements chorégraphiques, il organisait les choses en élaborant une sorte de narration correspondant aux sons, y compris les silences. Il proposait une narration prêtant aux sons une raison d’être, un motif, un objectif. Dans mon souvenir, c’est ce que j’ai ressenti. Et je me souviens aussi, par exemple, que pour les solos qu’il a chorégraphiés pour moi, il était très clair que c’était une forme d’organisation avec un pic, un sommet et puis quelque chose de peut-être plus plat, et à un moment donné j’étais sur une sorte de point de rupture, un silence, un long silence, auquel j’avais à me confronter en tant que danseuse sur scène. Et c’était comme s’il forçait l’attention du danseur, mais aussi du public.
Katerina Bakatsaki :
Tu veux dire, Christine, qu’il y avait en quelque sorte une partition ? C’est-à-dire un environnement acoustique qui était, d’une certaine manière, imposé à d’autres personnes par une partition, c’est ça que tu veux dire ?
Christine Quoiraud :
Déterminé en quelque sorte par une partition, oui, comme l’était la conception des lumières. En fait, Min nous a encouragé, nous a conseillé de réaliser la chorégraphie de nos propres pièces au Plan B, par nous-mêmes, de développer notre propre production, et je me souviens très bien qu’on était tout le temps en train de s’entraider, un danseur aidant un autre danseur. On a tous appris à construire la scène, la scénographie de nos performances, avec l’organisation des lumières, avec un décor, même l’absence de décors était évidemment un décor en tant que tel, et aussi les sons. C’était comme déterminer une distribution des éléments au fil du temps de la performance. Et pour moi, cela a été quelque chose de très important, cette opportunité, cette grande chance, cette chance de tenter de faire les choses par moi-même. Cela m’a aussi permis de m’approcher du sens de ce que Min Tanaka avait pu développer par rapport à la musique. Peut-être que je ne suis pas en train de décrire ce qu’était le Body Weather en tant que tel, mais plutôt de parler de mon expérience personnelle, là avec Min, avec le training, avec la vie et avec les autres danseurs.
Oguri :
Juste une chose. Je me rappelle que pendant la création et dans les relations entre la lumière et les sons, une sorte de communication était présente entre les performeurs, danseurs et musiciens, et aussi avec la lumière. Oui, c’est une rencontre qui se fait comme cela, je pense que Christine l’a déjà dit, pour le public et pour le danseur. On ressentait aussi, vous savez, non pas une vibration artistique mais une vibration spirituelle, quelque chose qui nous poussait, oui, à faire les choses. Mais j’ai plus personnellement l’impression que… c’est une chose secondaire. Je me souviens que j’avais beaucoup à m’occuper des lumières au côté de Noguchi. Donc j’ai beaucoup travaillé comme concepteur de lumières. J’étais à la cabine d’éclairages pendant les performances, en plus de la danse. Et Noguchi, vous savez, provoquait parfois les danseurs. Comme je l’ai dit, il avait un synthétiseur et une table de mixage. Quelquefois, vous savez, c’était juste « boum, boum » pour provoquer les réactions de la personne qui dansait en diffusant des sons perturbateurs… OK, « go on, go, go on, go on ! », une sorte de son qui nous poussait à continuer. En sa compagnie, je sentais que c’était pour une grande part comme la vie elle-même, et plutôt que d’être une question d’expérience esthétique, c’était une manière d’être très spirituelle pendant la performance. Oui, définitivement, quelque chose qui est en plus.
Katerina Bakatsaki :
J’aime bien ce que tu dis, je veux juste ajouter ceci, j’aime bien ce terme de « spirituel », j’utiliserais pour ma part, comme je l’ai déjà dit, l’expression « matériel » (ou « matériau »). Je veux dire par là que les sons de Noguchi et les lumières d’Oguri, par leur présence en tant que faisant partie intégrale de la performance, impliquaient une interaction, une indépendance, une résistance, etc… Et encore une fois, ce n’est pas le style de musique, le contenu musical, qui comptaient, mais le pouvoir de la matière elle-même. Le pouvoir du matériau était ce qui comptait le plus. La musique comme matériau, comme matière vivante très concrète, avec aussi tous les autres corps et lumières en vie sur scène. Autrement dit, c’est l’idée que tout ce qui est du domaine des sons ou du domaine des mouvements fait partie de la totalité de la performance et se trouve en constante interaction. Je pense que c’est comme ça que j’envisageais les choses, c’est comme cela que je peux l’exprimer aujourd’hui et que cela me parle, en considérant ce que c’était alors.
Oguri :
Je pense comme toi, le « matériel », le « matériau ». Dans le bon sens, j’ai compris. Et je pense que quand j’étais à la cabine des lumières au côté de Noguchi, il y avait ce type de réactions ou d’approches esthétiques et matérielles, spirituelles. Plus tard j’ai beaucoup appris en dansant avec des musiciens. Parce qu’on partageait l’espace en quelque sorte sans s’interrompre les uns les autres, mais avec presque ce genre de provocation : « Allez, vas-y, réponds si tu peux ! » [“come on!”], ce genre de relation. Au cours de cette expérience, j’ai mieux compris comment Tanaka envisageait la danse dans l’improvisation libre, cette relation-là. J’ai appris cet aspect des interrelations quand j’étais dans la cabine d’éclairage. J’étais impliqué en tant que troisième personne, avec Noguchi et en collaboration avec Min, OK, tous les trois on construisait une sorte de relation. C’était un autre type de matériel sur scène, une autre sorte de présence durant la performance. Plus tard j’ai beaucoup appris en dansant avec des musiciens.
Katerina Bakatsaki :
Oui, pour clarifier ma position, lorsque je dis « matériel » je ne parle pas d’objets, mais de matérialité, vraiment comme les corps, comme les lumières, comme les objets qui sont présents, comme le public, c’est à cela que je fais allusion.
Oguri :
Ce n’est pas quelque chose d’ambivalent, d’invisible et ce n’est pas quelque chose qui a lieu en coulisse, c’est ce qui se passe dans le réel, là, devant le public.
Katerina Bakatsaki :
Oui.
Oguri :
Je n’ai pas dit que la danse et la musique devraient constituer une unité dans laquelle elles sont intrinsèquement liées. Il s’agit de partager le même espace, sans pour autant empiéter sur le terrain des uns et des autres.
Christine Quoiraud :
J’ai deux souvenirs qui me reviennent :
a) Au début de Body Weather, il y avait aussi Hisako Horikawa. Elle explorait la voix – je pense que j’ai lu quelque part que l’exploration de l’expression vocale faisait partie du Body Weather dans les premiers temps. Je pense qu’au départ elle était vocaliste, puis elle est devenue danseuse.
b) Et je me souviens qu’une ou deux fois, dans une performance solo que Tanaka a chorégraphiée pour moi, il m’a demandé de parler. De parler, de donner de la voix sur scène, en improvisant. Et une fois il m’a demandé très clairement : « S’il te plait, peux-tu, sur scène, évoquer un souvenir d’enfance ». Et aussi une autre fois, je ne me souviens pas de ce que c’était exactement. Au moins à deux reprises il m’a demandé de parler pendant ma performance. Il s’agissait plus de paroles, de phrases. Il m’a demandé de raconter une histoire. Et évidemment, j’aurais pu mentir, je parlais en français à un public japonais. Oui, j’aurais pu mentir, mais je n’y ai pas pensé [rires].
Katerina Bakatsaki :
Concernant la différence entre les sons de la vie quotidienne et la musique, je ne me souviens pas d’une conversation en tant que telle sur ce sujet, mais je me souviens que la musique a été utilisée en tant que telle, aussi avec des pièces enregistrées déjà en existence. Je ne me souviens pas d’avoir eu à choisir une relation particulière à la musique, comme d’être invitée à se relier d’une manière particulière à la musique. Mais différents types de partitions musicales étaient utilisés. Quand je dis « musique », je veux dire les sons produits pendant la performance ou les repères sonores produits par une autre personne faisant partie de la performance, ou les partitions musicales. Mais je ne me souviens pas qu’il y ait eu des invitations à se relier à la musique en tant que telle d’une manière particulière. Cela ne voulait pas dire qu’il n’y avait pas de distinction entre différents styles de musique. Et aussi, Min lui-même a travaillé avec beaucoup de musiciens jouant en temps réel, c’est-à-dire, en improvisant. Donc, la musique en tant que telle était là, présente.
Christine Quoiraud :
Et aussi dans ses performances il lui arrivait de produire des grommellements. Je me souviens très bien au Plan B, quelque fois il était comme un homme ivre sur la scène, utilisant sa voix. Il n’utilisait plus des mots intelligibles, cela n’avait plus aucun sens, le sens était plutôt dans le ton de la voix…
8. Après la ferme du Body Weather
Présentation
En guise de conclusion, Katerina Bakatsaki, Oguri et Christine Quoiraud décrivent succinctement ce qui a constitué leur parcours artistique après avoir quitté (à peu près en 1990) la ferme du Body Weather. Katerina et Christine sont revenues en Europe et Oguri à émigré en Californie. Il est intéressant de constater que, tout en continuant de s’inspirer largement de leur expérience de la ferme, les trois protagonistes ont eu par la suite des démarches artistiques très différentes s’inscrivant dans des contextes de vie et de lieux eux aussi bien différents.
Katerina Bakatsaki :
Quand je suis retournée en Europe, le contexte japonais pour moi a été inévitablement très présent à ce moment-là et en même temps pas tant que cela. Beaucoup d’aspects de la vie là-bas restaient pour moi importants, intéressants, fascinants, peu importe l’endroit où je me trouvais, du moins c’est ce que je pensais à l’époque. La question principale était donc de savoir dans quelle mesure cette expérience de vie et de travail au Japon était pertinente ici même ? Avec qui la partager, comment la continuer, qui sont mes pairs, qui est capable de me comprendre ? Parce que lorsque j’ai débarqué à Amsterdam, tout le travail, la manière de l’envisager et son éthique ne pouvaient pas être compris, c’était comme si je venais d’une autre planète.
Quand je suis arrivée à Amsterdam en 1993, il se passait beaucoup de choses : le milieu de la danse moderne, de la danse post-moderne, était très orienté sur l’individu en tant que tel, je veux dire que toutes les méthodologies se préoccupaient de « ce que je ressens » et « c’est la vérité, c’est pertinent, c’est bien ». Mais si on venait d’un autre lieu, on se posait constamment des questions telles que : « Ah ! Ah! Hm ! Hm ! Est-ce que c’est OK ? Est-ce que c’est ce que je ressens ? Et malgré tout, est-ce vrai ? Est-ce pertinent ? Et comment l’expérience que je suis en train de vivre rencontre-t-elle l’autre, le corps de l’autre, ou l’espace et le temps de l’autre ? » La pratique que j’avais acquise ne correspondait pas aux contextes en vigueur en Europe à ce moment-là. Il fallait donc créer petit à petit nos propres environnements de travail avec les personnes qui voulaient bien y participer. Il a fallu trouver le moyen de se former, de pratiquer, et ensuite d’embarquer d’autres personnes dans ce processus, etc.
Cela va sembler ringard, mais la plus grande des leçons, le lieu de pratique le plus important, a été de donner vie à un être, d’avoir près de soi un petit corps, de s’occuper d’un petit bébé, et d’avoir à comprendre qui il était, d’être patiente, d’apprendre à vivre avec, etc. Et puis, il a fallu travailler avec des personnes qui n’avaient pas choisi de travailler avec moi. J’ai donc vécu une longue période où j’ai travaillé avec des personnes qui n’avaient jamais auparavant travaillé sur le mouvement ou sur quoi que ce soit de ce genre. Je ne les choisissais pas, mais pour des raisons arbitraires elles faisaient partie de mon projet. Il fallait que je sois à leur service, il me fallait comprendre leurs besoins, puis inventer et trouver les moyens et les méthodologies pour partager mon travail avec elles. Cela a été pour moi l’école la plus importante après mon retour du Japon. Parce que, évidemment, au Japon tout le monde partageait la même motivation à être là, présent : « C’est ici que je veux être, et vous savez, quoi qu’il arrive je peux prendre soin de moi en quelque sorte ». J’avais maintenant à travailler avec des gens qui étaient là avec moi presque par hasard. Cela créait une différence de dynamique très intéressante pour moi et il me fallait trouver les mots appropriés, les moyens de concevoir des exercices, de concevoir des méthodologies, de déterminer les conditions de travail.
Maintenant je ne danse plus. Je ne participe plus à des performances désormais mais je travaille beaucoup avec d’autres. La chorégraphie ne m’intéresse plus, en tant que méthode de présentation d’un travail. En tout cas, j’ai beaucoup travaillé à développer des pièces que je présentais dans des espaces autres que dans les théâtres. Il y a eu toute une période où j’ai travaillé avec un groupe de danseurs et cela se passait dans des environnements urbains marginalisés. Cela voulait dire des foyers d’accueil des sans-abris ou des foyers pour des handicapés mentaux ou pour des victimes de violence domestique. Il est donc vrai que mon intérêt en tant que créatrice n’était pas tellement de faire des pièces, mais plutôt d’inventer des pratiques orientées vers le questionnement sur les pratiques, sur les rapports entre les corps appropriés à de tels lieux. Cela a fait son temps, et je suis passée à autre chose. Maintenant je travaille la plupart du temps en tant que mentor, conseillère artistique et enseignante.
Christine Quoiraud :
Eh bien, quand je suis revenue, j’étais un peu perdue. Il m’a fallu du temps pour me réajuster à la mentalité des Français, comme je l’ai déjà dit, et pendant deux ans j’ai vécu avec mon sac sur le dos. Je ne pouvais me fixer en un seul lieu. J’ai présenté des performances et animé des ateliers et circulé. Sans domicile fixe. Dans une très, très grande pauvreté. Mais cela me convenait et j’ai pris en charge ma vie en tant que soliste en quelque sorte. Et puis petit à petit j’ai commencé à essayer d’organiser une ferme en espérant répéter d’une certaine façon l’expérience. Dans le sud de la France. Mais cela a été très rapidement un échec total. Cette expérience m’a donné l’opportunité de commencer ce que j’appelle un « camp de danse », le Camp de Danse d’Été. C’est comme cela qu’ont commencé les projets intitulés « Corps/Paysage ». Et cela a duré cinq ans.
Et puis j’ai commencé à développer des projets sur des tranches de cinq ans à peu près. Les « Corps/Paysage » ont eu lieu partout, en milieu rural, dans les grandes villes. J’ai partagé à cette époque les projets « Corps/Paysage » avec Frank van de Ven. Ces projets ont pris chaque année des tournures différentes. Un projet que je voulais évolutif, ce qu’il fut. J’ai aussi joué le rôle de mentor pour de jeunes artistes, pour de jeunes danseurs. Dans un sens, je reproduisais un peu ce que j’avais appris au Japon. Non pas en tant qu’enseignante, mais comme une personne qui peut donner des outils pour être indépendant et autonome dans la production et l’exploration. Et pendant ces projets du » Corps/Paysage », j’ai aussi réussi à rassembler les danseurs que j’avais rencontrés au Japon. Comme Katerina, qui est venue plusieurs fois et d’autres comme Andrès Corchero, Frank van de Ven.
Et puis on s’est séparé avec Frank. Quand j’ai commencé les projets de marche. C’était pour moi le moyen de me rapprocher des questions essentielles : Qu’est-ce que la danse ? Quelle est la fonction de l’art ? Pour qui ? Est-ce que l’art est séparé de la vie ? Les projets de marche ont donc été développés sur plusieurs années, en fait sept ans. Un acte total le fait de marcher, la notion d’être un collectif en mouvement. Pour, disons, un mois, mille kilomètres. Rien n’était planifié, rien n’était organisé. J’appelais cela « atelier d’improvisation ». Et la première improvisation consistait à trouver une place pour passer la nuit. Parfois il pleuvait dehors. On n’avait pas de tente. Et petit à petit j’amenais les personnes vers la performance publique. Il s’agissait de rencontrer le public. Il s’agissait aussi de percevoir des modes de vie, la vie ordinaire sur les lieux qu’on traversait, que ce soit dans des villes ou à la campagne. On avait un comportement différent s’il y avait un groupe de dix ou douze personnes. Si on se trouve au milieu des montagnes, ou soudainement à Pampelune ou dans une grande ville, on est obligé de changer, d’ajuster son comportement à ce qu’on est en train de rencontrer[23]. Et pour moi, cela a été la période de ma vie la plus heureuse, ces marches. Parce que finalement il n’y avait pas d’« enseignement », pas de « performance ». Il s’agissait juste de marcher parfois sans rien emporter, même pas une brosse à dents. Voilà, et depuis ce temps-là, je vieillis c’est tout [rire], occupée à classer des archives et à raconter des histoires. Mais je continue d’enseigner un peu en animant des ateliers. Je suis encore parfois mentor ou regard extérieur quand on me le demande.

Collection personnelle Christine Quoiraud.

Fonds d'archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
Oguri :
Qu’est-ce qui m’est arrivé ? J’ai trouvé une mine d’or, oui, avec la vie avec une partenaire, Roxanne Steinberg[24] et j’ai déménagé aux Etats-Unis, il y a trente ans. Elle avait participé au sixième Maï-Juku (1986). Avec Roxanne et Melinda Ring, nous avons créé le Body Weather Training à Los Angeles. Et on a été invité à participer à des résidences artistiques dans un foyer pour femmes sans-abris au centre-ville de Los Angeles. C’était ma nouvelle plateforme pour enseigner et présenter des performances. Et avec ce programme on a transformé une chapelle désaffectée en espace de théâtre, appelé Sunshine Mission, au sein du foyer pour femmes sans-abris. C’était le début de ma carrière à Los Angeles, on avait un espace, un studio pour enseigner et présenter des performances. C’est ce qui constituait le Body Weather Laboratory/Los Angeles. Et on a demandé à être reconnu comme une association à but non lucratif [non-profit organization] pour pouvoir de cette façon recevoir des subventions du département des Affaires culturelles de la ville, de la métropole de Los Angeles, de l’État de Californie, et ainsi de suite… On a commencé à présenter un programme d’évènements artistiques. Et après cinq ou six ans, on a déménagé à Venice, à l’ouest de Los Angeles pour installer notre propre studio. Je suis maintenant en résidence artistique à Electric Lodge, un petit théâtre. Je continue les ateliers Body Weather, et je participe à des performances et productions en solo ou en groupe. Je présente des artistes de la danse émergents ou reconnus à Los Angeles, ainsi que mes collègues de longue date. J’ai invité Christine, Andrés Corchero, Frank van de Ven pour enseigner et présenter des performances ici à Los Angeles. En faisant cela, et parce que mon expérience au Japon avait été très liée avec la terre, j’ai développé des projets dans les terres de la Californie. J’ai consacré deux ans à un projet dans le désert, une recherche pour trouver des manières de faire de la danse aux Etats-Unis avec une diversité de ressources. J’explorais le désert pour trouver des lieux pour produire des œuvres spécifiques en travaillant avec des personnes n’ayant jamais pratiqué la danse. Il s’agissait de travailler avec un grand groupe de personnes, dans un lieu spécifique, sans en demander la permission, une sorte de performance se passant dans un espace public. Et périodiquement, j’ai été professeur invité à UCLA ou au Bennington College (dans le Vermont), dans un contexte d’enseignement universitaire. Et j’ai continué à présenter des solos et des performances en groupe. Et j’ai beaucoup collaboré avec Andrés Corchero de Barcelone, et aussi avec Christine Quoiraud.

1. Hijikata Tatsumi (1928-1986), danseur, chorégraphe et enseignant japonais, notamment connu comme le père de la danse butōh. Voir : Encyclopédie Universalis
2. NdT : Dans ce texte, on a gardé l’anglais « training » pour souligner que c’était vraiment un entraînement physique des corps, mais pas tout à fait un entraînement au sens sportif du terme.
3. Tess de Quincey est une chorégraphe et danseuse vivant et travaillant en Australie. Elle a dansé et enseigné en Europe, Japon,et aux Indes en tant que performeuse soliste, enseignante et directrice. Elle a fondé la compagnie De Quincey Co en 2000. Voir de Quincey Co.

Fonds d'archives Christine Quoiraud, médiathèque du CND.
Danseur et chorégraphe, Frank Van de Ven suit l’enseignement de Min Tanaka au Japon, performe dans sa compagnie, la Maï-juku Performance Company de 1983 à 1992 et est l’un des fondateurs de la Body Weather Farm. En 1993, il fonde avec Katerina Bakatsaki le « Body Weather d’Amsterdam », centre d’entraînement et de recherche chorégraphique. Depuis 1995, il conduit avec Milos Sejn (Académie des beaux-arts de Prague) le projet interdisciplinaire Bohemia Rosa, rencontre entre le corps, l’art, le paysage, la géologie et l’architecture. Il performe, chorégraphie et enseigne régulièrement dans toute l’Europe ainsi qu’aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Voir Centre national de la Danse.
Andrés Corchero, danseur résidant en Catalogne, explorateur des langages du corps, qui a travaillé au Japon avec Kazuo Ohno et Min Tanaka. Voir Body Weather
4. Kazue Kobata (1946-2019) ) a été professeure au département d’art multimédia, université des arts de Tokyo, conservatrice adjointe de longue date à Tokyo pour le PS1 Contemporary Art Center, membre du comité de l’espace de performance/studio Plan B, coopérative d’artistes depuis 1982, auteure, traductrice, curatrice, productrice et chercheuse.
Voir : artforum.org
Voir aussi dans les archives Christine Quoiraud, recherche CND, “Dive in in fine”: Médiathèque du CND
5. Masanobu Fukuoka (1913-2008) est un agriculteur japonais, connu pour son engagement en faveur de l’agriculture naturelle. Voir wikipedia
7. Seigow Matsuoka: essayiste, spécialisé dans l’art, auteur de nombreux ouvrages sur la culture, l’art japonais, chinois. Directeur de « Editorial engineering laboratory », Tokyo.
Voir data.bnf
8. M. B. training, muscles et ossature, esprit et corps, etc.: entrainement dynamique sur de la musique, comprenant des sauts, des squats-pliés, des étirements, travaillant le rythme, la coordination, la flexibilité, l’ancrage entre autres.Voir Centre National de la Danse.
9. Note de Christine Quoiraud : à la ferme, il y avait beaucoup de personnes qui n’étaient là que de passage, pas forcément impliquée dans les performances. Parfois aussi des artistes de la danse mais qui ne se produisaient pas au Plan B. Il y avait beaucoup de passage et de géométrie variable à la ferme. Oguri était tout le temps au cœur de toutes les activités du Body Weather, une vie complètement impliquée et dédiée à la vision de Min Tanaka.
10. Note de Christine Quoiraud : une large somme d’argent provenait de grandes productions ou de la participation à des films commerciaux. L’argent était alors utilisé pour la vie à la ferme.
11. Nario Goda, critique de danse, journaliste, spécialiste du Butōh. Voir « Interview avec Sherwood Chen, 7 février 2019, Paris”, traduction et notes de Christine Quoiraud, note 23, p.11. Médiathèque du CND
12. Ceci peut être vérifié en consultant les « Plan B calendars » disponibles dans le fonds Christine Quoiraud au CND/Pantin. Voir CND
13. Note de Christine Quoiraud : Min revenait vers nous après les performances avec des retours très précis. Il changeait constamment la composition pour l’améliorer, en l’ajustant à chacun et chacune d’entre nous. Il souhaitait que rien ne soit fixé. Pas de version déterminée à l’avance. Son travail consistait à mettre en forme les choses avec les danseurs.
14. Ankoku butō = la danse des ténèbres.
15. Note de Christine Quoiraud : Tanaka nous a transmis ce qu’il avait appris de Hijikata. Tout d’abord dans les ateliers, puis dans l’utilisation de cette pratique dans les performances.
16. Deborah Hay est une chorégraphe expérimentale américaine travaillant dans le domaine de la danse postmoderne. Elle est l’un des membres fondateurs du Judson Dance Theater. wikipedia
17. O bon (…) est un festival bouddhiste japonais honorant les esprits des ancêtres. O bon existe depuis plus de cinq cents ans et fut importé de Chine où il est appelé « fête des fantômes ». wikipedia
18. Voir les archives de Christine Quoiraud au CND et le film d’Eric Sandrin « Min Tanaka et Maï-Juku » et encore, du même auteur, le film « Milford Graves and the japanese » sur YouTube.
19. Église progressiste de New York, consacrée à l’aide sociale, la Judson Church devient dans les années 1950s un centre très actif de la création artistique contemporaine, notamment chorégraphique. Église progressiste de New York, consacrée à l’aide sociale, la Judson Church devient dans les années 1950s un centre très actif de la création artistique contemporaine, notamment chorégraphique. Voir wikipedia
20. Note de Christine Quoiraud : Min Tanaka dansait souvent sur des airs très connus de salsa ou autres musiques très sentimentales.
21. Minoru Noguchi est un musicien et compositeur qui a accompagné et composé pour Tanaka Min jusqu’à aujourd’hui. Voir Youtube
23. Christine Quoiraud avait alors comme mot d’ordre « circuler, circulez ».
The Body Weather Farm
The Body Weather Farm (1985-90 period)
Encounter with
Christine Quoiraud, Katerina Bakatsaki, Oguri
With the participation of Jean-Charles François
and Nicolas Sidoroff for PaaLabRes
2022-23
Summary :
1. Introduction.
2. Before the Body Weather Farm, the encounter with Min Tanaka.
3. Maï-Juku V and the beginning of the farm. Tokyo-Hachioji-Hakushu.
4. Body Weather, the farm, and the dance.
5. The commons within Body Weather.
6. Choreography, improvisation, images.
7. Relationships to music.
8. Conclusion. After the Body Weather farm.
1. Introduction: Presentation of the Encounters.
The origin of this text stems from a first encounter in Valcivières (a village in the Forez, France) in 2020, as part of CEPI (Centre Européen Pour l’Improvisation) between Christine Quoiraud and Jean-Charles François. On this occasion, Christine Quoiraud presented an illustrated lecture on Body Weather, her own activities firstly called Body/Landscape (“Corps/Paysage”), and her improvised long marching journeys for dancers and non-dancers (called “Marche et Danse”). In the perspectives of the fourth edition of the PaaLabRes collective, the precise documentation of the diverse practices that had taken place during Christine’s presence at the Body Weather farm in Japan (1985-90) appeared to be of great importance. Many critical points remained to be clarified after this presentation, notably concerning:
- The relationships between the activities of everyday life at the farm, the practices of cultivating the land, of raising animals, with the artistic practices.
- The relationships between the various participants committed to the farm project.
- The relationships with nearby farmers.
- The relationships between dance and the environment.
- The relationships between dance and music.
Christine suggested to PaaLabRes to organize an encounter by videoconference with dancers, ex-members of Maï-Juku, Katerina Bakatsaki, living in Amsterdam, Oguri, living in Los Angeles, herself, living in south-west of France, and for PaaLabRes in Lyon, Jean-Charles François and Nicolas Sidoroff.
Two encounters with all these people took place by videoconference on May 31, 2022, and February 15, 2023. In between these two interviews, Jean-Charles François and Nicolas Sidoroff formulated in writing a series of questions. We decided that the questions asked by PaaLabRes would not appear in the present text, except as short introductions to the various sections of the document.
The recording of the oral exchanges in English during the two interviews have been transcribed (with the precious help of Christine Quoiraud) by Jean-Charles François and translated into French. The original English verbatim has been edited to make it clearer for readers, but wherever possible, we tried to preserve the oral nature of the exchanges. We thank the Centre National de la Danse (CND) for allowing us to publish the photos from the Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
The different sections do not automatically follow the chronological order of the two interviews but are based on the principal themes discussed in a specific logical progression.
2. Before the Body Weather farm, meeting Min Tanaka.
Presentation
Katerina Bakatsaki, Oguri, and Christine Quoiraud are three dance artists who, from 1985 to 1990, had in common their participation in the Body Weather farm created by Min Tanaka and Kazue Kobata a hundred kilometers from Tokyo.
In order to situate their approach and provide insight into their initial careers, this introductory part is devoted to the circumstances that led them to meet Min Tanaka prior to their participation in the farm.
Katerina Bakatsaki:
You can all see me laughing, of course, because it happened so long ago. It’s been quite a journey. Now that we’re all in different phases of our lives, I have mixed feelings about my memory of those circumstances, so it’s best to laugh about it. But to answer straight away to your question, I can tell you that when I first went to Japan, I was twenty-one years old. I had no clue of what was ahead of me. I met Min Tanaka around 1985, he was dancing at La MaMa Theater Club near New York, and Œdipus Rex was presented with Min being the choreographer. A performance of Œdipus Rex also took place in Athens, and for that production they needed local artists to paticipate, so I had the chance and pleasure to be selected. That’s how I got involved in the production and this is how I got to meet Min and his way of working. 1985, twenty-one years old! You can imagine a young horse knowing that there are several possible paths, but without knowing exactly what it needs and wants, because simply of a lack of information. In 1985, we didn’t know exactly in Greece what « contact improvisation » was, we’d only vaguely heard about it, so information about what was going on in the world was very, very rare, if at all existent. So, I was curious, I’d just started to dance in Greece at the time, but I was looking for something else and without knowing exactly what it was, I was travelling in Europe, meeting different choreographers, having auditions. I met Pina Bausch, I could have joined her company, but I didn’t because intuitively I thought no, it wasn’t for me. So, I was curious, I’d just started to dance in Greece at the time, but I was looking for something else and without knowing exactly what it was, I was travelling in Europe, meeting different choreographers, having auditions. Anyway, I met Min in that production, and, I think, before and above anything else, there was something that I strongly believed in intuitively, that I trusted, or that I could connect with, but I still didn’t know what it was. Whatever it was, I thought, “Well, I want to know what this person is doing”. And at that time, he mentioned to me that he was conducting two-month workshops in Japan, so, I thought “I am going!” Just a funny anecdote: I took my pointe shoes with me – I was a student at the time and part of my studies was classical ballet – just to give you an idea how clueless I was. So, I landed in the studio in Hachioji, the farm was not founded yet. So, going to the farm was a consequence of being part of the practice in the community at that time, before the farm came into existence. By the way, I went there in 1985 for two months and then I stayed for eight years.
Oguri:
So… maybe it’s my turn… Let’s start. So – I am laughing! – it was thirty years ago! Thirty years ago, I left also everything behind, I was there five years, same years as Katerina and Christine. Like Katerina said, there was a two-month workshop: “Maï-Juku V, an intensive workshop”. Min Tanaka started this series in 1980. OK, I’m going back a bit: I lived in Tokyo. I wasn’t born there, I studied visual arts – a kind of conceptual art – with Genpei Akasegawa. He passed away in 2014. He was a very important name at that time in the art’s scene in Japan. When, in the 1960s, so before Japan had a big world expo in the 1970s in Osaka, and before that he was a non-established artist, he met the movement of the Neo-Dada organizers at the Hi-Red Center and collaborated a lot with Nam June Paik and John Cage. Anyway, I was interested in studying with that kind of visual arts. And during the 1960s, Akasegawa collaborated extensively with Hijikata Tatsumi[1] as part of the Japanese Ankoku Butōh movement. Studying with Akasegawa, I was introduced to all avant-garde work of the sixties (see Akasegawa Genpei Anatomie du Tomason). And Butōh, Ankoku Butōh was very attractive. But I wasn’t really ready to become a dancer. And in the 1980s, when I was still studying, I also saw Min Tanaka’s work. He was still dancing then with a shaved head and naked body, painted, with very gradual slow movements and longtime performances. And he worked with Milford Graves and Derek Bayley, this was a big event in Tokyo. Very strong impression for me, being something “in between”, was it dance? And actually, at that time, the term “performance” was introduced in Japan. Not “performance art”, just “performance”. What is a “performance”, what is a Butōh, and what is dance? That boundary, it’s impossible for me to define: small theater? The idea of theater became popular from the 1960s on. But it’s not a new type of a theater either, it’s all like a melting pot. At that time, I took Hijikata Tatsumi’s Butōh Workshop. It was very short, maybe a three-day intensive. That was what I got as dance training before participating in Min Tanaka’s Body Weather work. I never had a formal dance training background. I had seen Butōh and Min Tanaka’s work and I took part in a performance. But I wasn’t a dancer yet. During the first Butōh festival in Japan, in Tokyo. Min brought together forty male dancers, male bodies. This performance was my first participation. Then a year after, yes, I got some flyer advertising the intensive workshop Maï-Juku. That’s where my work with this practice really began. So, yes, actually in 1985, during Maï-Juku V, I was also involved in the preparation of the Body Weather farm in Hakushu. So, it’s kind of a parallel project: it was the start of preparing the place, the farm, and taking part in Maï-Juku V. And once Maï-Juku V started, I think, after one month, we moved, we had a separate training in the farm. I remember what we did in a waterfall… Before the Maï-Juku V, Min Tanaka didn’t have a performance group. Maï-Juku’s concept was collecting bodies – no, not the body – the “capture” of the people participating in the training: when Min Tanaka was touring, that’s how Katerina was caught. In Europe and the U.S., La MaMa and always touring, he had performances and teaching workshops… so it’s like two wheels, and the people were interested and participated every year. So Maï-Juku I to V. In the fifth year, they started Maï-Juku Dance Troup for doing performance work. In that time, they didn’t call what they were doing Butōh or dance performance, but it was called “Maï-Juku performance”. And regarding this Maï-Juku V year, when we participated, it was a big, big turning point. Many of the former Maï-Juku members had left. It was a very strange moment. At the beginning, I believe we had about forty people who participated the first two months. After the two months of intensive training, I think we were left with only ten people or something. But ten people stayed. Ten people may be including about two or three from Japan. So, a number of European people stayed, like Katerina, Christine, Tess de Quincey from Australia, Frank van de Ven from Holland, and (in 1986) Andres Corchero and Montse Garcia from Spai – a few people.[2] It was a big transition, Yes, I think that when Min Tanaka started the farm, this transition was a big issue. He never named his dance as Butōh, but in 1984, Min danced Hijikata’s choreography, he performed his solo dance. That was also a big turning point, changing the… Yes, ok. I stop talking now.

fonds d’archives Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
Christine Quoiraud:
I met Min Tanaka in France, actually in Bordeaux, by chance. I was at that time dancing in a company whose style was based on the Cunningham technique. I was preparing a spectacle when someone came up with a small flyer with a photo of Tanaka Min advertising a workshop. It was the second year he came to France in 1980 or 81 in Paris, after a big presence in the Festival d’Automne in 1978. And that’s when he met Michel Foucault and Roger Caillois. Min Tanaka was giving a workshop in Bordeaux, so I left everything and went to his workshop. And as soon as I opened the door, I was captivated.
I remember it very well a sound-listening exercise was proposed: people were blindfolded and walked along a string laid on the floor. Min Tanaka produced sounds, clapping his hands or playing with paper. He moved around the room, changing heights and distances. We were supposed to point with the index finger in the direction of where the sound was coming from, and meanwhile you had to keep your balance, one foot against the other on the thread laid on the floor. It was a revelation, I was immediately totally convinced. Before that, I’d experienced several types of techniques in contemporary dance. At that time in France, a lot of foreigners were coming, many Americans, but also Asian people: I had met Yano and Lari Leong who already gave me a sense of what the state of mind of these parts of Asia was. But when I met Tanaka, that was it! I was totally won over. So, I immediately went to the next workshop he gave a month later in Bourg-en-Bresse. There were forty people. He was giving us the basics of Body Weather, the manipulations/stretching work, and a bit of work on sensations, and he offered us the opportunity to take part in a performance. So, he designed a kind of development for the performance, which was mostly improvised, with some elements given, with few instructions. It took place in a huge gymnasium. When the audience came in, we were seated in the audience and gradually we bent over slowly against our neighbor, we leaned on the public. Then moving down slowly towards the floor. And that impressed me immensely, actually. So, from that moment on, I quit my job, stopped everything I was doing. I bought a car to live in it. I started the Body Weather nomad laboratory. I travelled all over Europe. So, I was visiting all the Body Weather groups, which were being set up in Geneva, in Groningen, somewhere in Belgium, maybe it was Ghent, and in France, in Pau, in Paris. I’d travel from one group to the next, always sharing training and performances, mainly outdoors, in the streets, or anywhere in the city. Tanaka came every year from then on to give workshops mainly in Paris, or in Holland, or Belgium, and I joined all of them. Every year he would say to me: “Christine, why don’t you come to the intensive workshop in Tokyo?” I finally decided to go in 1985. Also, I came there with a visa valid only for that workshop, but I didn’t go back. I could not leave after what I’d been through. I stayed for over four years, almost five years. As far as I remember…

3. Maï-Juku V and the creation of the farm. Tokyo-Hachioji-Hakushu.
Presentation
In the minds of the PaaLabRes inquirers (Jean-Charles François and Nicolas Sidoroff) the Body Weather farm project implied that a group of people had decided to live on a farm. Hence the idea that there was a beginning, which could be described in detail to grasp the origin of the approach. But the answers from the three artists demonstrate that this was not the case: the process of building the farm was very gradual and was inscribed in a constant back and forth travel between Tokyo and Hachioji (a suburb of Tokyo), then between Hachioji, Hakushu (the place of the farm) and Tokyo. This is one of the important aspects of the Body Weather idea: the body like the weather is constantly changing and not fixed anywhere. This concept means less the idea of migration or displacement, of travel, but rather of fluctuations produced by friction in a given environment.
We’re dealing here with three environments, one completely urban (Tokyo), one completely rural (Hakushu) and one somewhere in between (Hachioji, a suburb of Tokyo). The activities at the farm developed gradually in interaction with the local farmers.
Christine Quoiraud:
Before the beginning of the farm, the intensive workshop Maï-Juku V (1985) took place in Tokyo, in a suburb far from Tokyo, Hachioji with a dance studio. There were rice fields near the studio and a river, and we often went to work near the river. Or at one point we went to the mountains 30 minutes away. At the end of the intensive workshop, we moved to the farm for the final workshop of the two months period. We went into the water of the high waterfall, naked. This, and all that followed, was the key turning point. And Min was very proud to show us the farm. We all went there together. There was this workshop in the river and there was a fire after that, it was late October, it was freezing cold. We finished the intensive workshop there, on the farm. Then came the beginnings of the farm.
Andres Corchero didn’t arrive until February 1986 for the next intensive workshop, which only lasted a month that year.
Katerina Bakatsaki:
I don’t think that there was an “A-day”. I think it was really a long process of different events and different ways of working that led to finding a place and do on. So, I don’t know if there was a first day, but before I say that, I just want to point out perhaps, maybe just to say, that when I met Min in Athens, the part of his work that intrigued me the most was certainly the work that he invited us to do outside the studio, outside the theatre space or the studio space. And as Christine and Oguri have already said, Min was engaged in work that already involved weird places, situations and contexts, away from dance or any kind of formal art manifestation. It was a question of working outside so-called art spaces… Let me rephrase the question: what dance can be when experienced in many different contexts, when engaged with many different bodies, not only human bodies of course, not only one’s own body, but also the bodies of the non-humans? This question was Min’s major preoccupation in his work from that time onwards. That’s what I just want to point out, and actually for me, that element and that quest within the work that Min was doing inevitably led to creating a sort of place and network embedded outside the city, and outside formal artistic contexts.
Christine Quoiraud:
Like Katerina said, we didn’t start working on the farm straight away, it was part of a process. And, in my memory, we had to build and organize the farm before it became operational. We started by building several chicken houses. Oguri can talk about that much better than me. It’s only gradually, little by little that we got chickens and then started growing rice. In autumn and springtime, I remember you guys building the chicken houses. That’s when we had this wasp attack. Those wasps were in springtime, no? And planting the rice was more like June or something, May/June maybe?

Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
Oguri:
Shall I talk a little bit about the cycle? So hi, Oguri here again. Yes, farm was being prepared right before Maï-Juku V started… some friends were already working there at the time of Maï-Juku. I went at the farm with my motorcycle. And my first impression was that this land was so beautiful. Yes. It’s changed a lot now, but in the 1980s… Hakushu is about 100 km west of Tokyo. So, about 2 hours away with my motorcycle, experiencing a change of scenery, an evolving landscape, changing, changing, changing, so beautiful, beautiful river and gigantic rocks in various shapes, really almost like chaos. The last time I was there in 2017, it changed completely. Now, it’s not the same at all. But at that time… yes…
I know, a farm is not real nature. A farm is a work done by humans using nature. A farm is a human product in the ecosystem of nature, but there are still a lot of nature forms, mountains, and big rocks, and sometimes a typhoon producing a disaster that changes all human order, bringing back the nature. And it’s a quite high elevation area, around 800 meters high, it’s a cool air, water is constantly running by the house and rice field because of the slow open flat land. Yes. Hakushu lies at the foot of Mount Kaikomagatake in the 3000-meter-high mountains of the Southern Japanese Alps.
And as Christine said, in Hachioji, which is a suburb from Tokyo, that’s where already a big transition is happening, from the harbor of Tokyo to that city, Hachioji, where the Tokyo metropolis becomes Yamanashi prefecture and it’s a kind of transition before we go to Hakushu. And that transition is very interesting.

Christine Quoiraud’s personal collection.
Min Tanaka and Kazue Kobata[3] are at that time running a small alternative performance space in Tokyo: Plan-B. This is like a first artist self-running alternative art space. It’s a tiny underground theater. So, every month, or every other month, at Plan B, Maï-Juku as a group presented a dance performance there. Myself I presented a solo performance there every month.
Yes, I will talk about that too: this has to do with something like transportation, transport: Tokyo, Hachioji, and Hakushu. A very interesting experience, transportation, moving, and activities in the three places: the farm, the workshops, and the performances.
Anyway, the farm is the place to return to after work at Hachioji, Plan-B in Tokyo, and national and international tours.
Living in Hakushu, the farm life, the traditional organic farming, experiencing the rhythms and cycles of this most human lifestyle. This connection of the human body to nature is necessary for Body Weather practice. We developed many things: the annual production of an arts festival, also with outdoor sculpture, traditional and contemporary performing arts, music, conferences, a symposium…

Christine Quoiraud’s personal collection.
Life on the farm necessitated a transition that was far from brutal. Our life is not shockingly changed. But, for me, it had a big impact on the life cycle: Tokyo, you have the night, you keep working in the night, you are in a theater, you have to start at 8 o’clock or whatever. But in that farmland, all farmers got to the bed at 7 o’clock. So, our cycle completely changed, working with a chicken, or irrigating the rice field. If you are late, you lose a day. Or feeding animals, they cannot wait. So, our cycle is completely changed. The night is completely dark, which is beautiful with the stars… So, that’s big impact, change. When I mention “life cycle”, it’s completely linked to most human lifestyle and the question of the human body. When we started working in Maï-Juku and Body Weather farm, we’re almost never alone, twenty-four hours a day. Always somebody is working with you, and every day you’re eating three meals together.
And I’m now jumping to the farm time: it’s a community group working together, but at the same time, you know, a very serious individual commitment is required at all times. Of course, just being there is a commitment, but in all the work both in the farm and the dance – I don’t say “the dance” but the workshop, the laboratory – self commitment was very strong. On the other hand, we’re not professional farmers. And I never think that I am a professional dancer either. This practice I’ve taken up, is it dance or performance? And as we are not like professional farmers, we learned from the farmers themselves on the job site, in the field. The idea that we’re not there to learn a technique is very important to us. It’s the same for Min or for the Maï-Juku Body Weather dance too. We don’t proceed from technique, but we’re very much like in a job site. I mean, it is not like a studio as a place preparing a performance elsewhere. So, farming was like this, and dance practice as well. It was a big transition: Hachioji had a dance studio floor, but in Hakushu at first, we didn’t have this kind of floor. Later, we built something like a stage, and we used a Kendo martial arts floor, to do floor work mainly in the land. So, farm and dance, neither had priority for the life in there.
Christine Quoiraud:
At the time of the 1985 workshop, Maï-Juku V, there was a lot of back and forth, going back to Tokyo, going to the farm and back to Tokyo, and in my memory, you were really one of the Japanese who often went with Min and Hisako, over there to the farm, to organize the venue of the group, and you are one of the witness of this beginning point, more than probably we, the foreigners, the non-Japanese. I’m sure you have memories about the discussions you had with the farmers, the neighbors… What do you remember of these talks when preparing the farm? From an administrative point of view, but also from the farm point of view, and also the necessity of organizing a program of what was going on in Tokyo and to Plan B, the performing space.

Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
Oguri:
Yes. These all three things happened simultaneously. Actually, I didn’t have much connection with the place in Hachioji because I lived more often on the farm side. Maybe, yes, Christine and Katerina, Frank and a few other people lived in Hachioji. They had rented a house there, so, your base was more in Hachioji…That’s a transition time. So, while living there, you were keeping a training in Hachioji. I remember that, during the Rite of Spring (or maybe not that one, another performance), we had rehearsal in the Hachioji studio. And then we went to the Ginza Season theater, a big theater, for a performance in homage to Hijikata. Yes, we built a set and rehearsed there too.
Christine Quoiraud:
That was much later. Hijikata passed away in January 1986. But at that time, there were lots of moves between Hachioji, Tokyo, Hakushu… It’s more a question of whether you have any memories of who decided, for example, to build the chicken houses?
Oguri:
Ah! OK! All the organizational side…. Min Tanaka had a big vision, I think. Why did we have these chicken, to what purpose? We didn’t need the chicken for the eggs, but for the shit, for the fertilizer. It was thanks to this fertilizer that we were able to successfully grow vegetables. Organic farming wasn’t so popular back then. We didn’t know about popular organic either. Yes, we didn’t use chemical fertilizers, we started like this. Use less chemicals, you know, weed killers or insecticides. That’s all we knew about organic farming. We didn’t even know about recycling, but recycling was already a tradition in Japanese life. It was nothing knew at that time, but organic was … how can you use it as in the case of traditional fabric. And besides, not much income.
It’s very interesting seeing that in the farm, Body Weather farm and Min Tanaka, we never owned the land. Instead, we just borrowed the land and the house. About agriculture in Japan in a village, of course all farmer families own their land. But most of the farmers are like Sunday farmers, they all have a job. They have a full-time job on the side. Farming is their second job, they have to keep the rice fields going, because as I said, rice is very essential to Japanese, rice is more than money, rice is like life, rice is like God. A bit like each of us, it grows, it develops. Many hours of intense work and a great deal of pressure during the harvest under the autumn sky. Rice grows and changes like a human being. Farmers must therefore continue to keep up rice fields. That’s an essential thing for each farmer. When the farmer gets old, children don’t want to take over being farmers. As a result, there are many fields, beside rice fields, as vegetable fields or mountains that are no longer tended due to lack of human power, so a lot of places are let to somebody to use. So, we got many places and fields that are like abandoned, and not in very good condition. So, we cut down the trees, got rid of the rocks, cleaned up the field and put it to good use. In many places, lots of farmers asked us to take care of this, as well as the house that goes with it. But farmers are always close to their money: after a few years, the field got intoo good conditions, “OK, give it back to us”. And you have to give it back. We were very kind to the farmers because we were learning a lot from them, and they let us use a lot of their land. So that was a very unique relationship between us and the village farmers.

Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
Katerina Bakatsaki:
In that respect, I also remember very strongly that there were times when we very often went to help other farmers – whether there was an agreement about it or not – and in fact, it was also a way of learning and knowing how to do things. I don’t know if Min pre-thought about it, but that’s how I have experienced it, while we were out there trying to survive with the minimal means, we had to at the same time try to figure out how to literally make things. What I mean by things, is of course the house, the objects, the lands, the animals also… How to live and work with these entities. Well, we lived there, we were also there helping the other farmers. Then, in fact, it’s not just the case in Japan, I know the same thing in Greece, the countryside and the farms are deserted, and young people are leaving. And on top of that, you have big corporations buying up farming land. That means that small farmers are losing their land and therefore the connection to their place, the connection to their land, the connection to the knowledge, and to their ways of living they’ve known. So, we were learning, but in this way our presence was also contributing in a very modest way to reviving also the life of the village, and thereby, in a way, literally restoring vitality to the farmers. And then, later on, came the festival that brought more activities in, and so on. I think that this was part of Min and Kazue’s vision, as a sort of conscious activism: OK, we went there to learn, but also to play a supporting role.
Christine Quoiraud:
And I think, how shall I put it, that it was pretty natural. Before going to Japan, I also lived in the countryside in France. It was very natural, when there was hay to cut, which was the case when I was a child, everybody came to help, and I think it’s really part of the life of rural community. Less so now because of machines, but at that time, up to the early 1980s it was still fairly universal…
In the early day of the Body Weather farm, there were not so many people living there, not that many… Like Oguri said, at the earliest, there has been the two-month intensive Maï-Juku V workshop. Then from the group of 40 people many returned to their own countries or personal lives. We remained to meet with just over ten people, half of them Japanese, the other half non-Japanese. I remember that there were about 16 people or something like that. Then, a small group of Spanish people came, and we remained a kind of settled group for quite a while, with other Japanese coming in from time to time, I don’t remember their names. And yes, we remained with the same number for quite some time, even a few years. But, a lot of foreigners, of non-Japanese, left… went to give classes and workshops in their respective countries like Frank in Holland, Tess in Denmark. They often left to teach in other parts of the world. I remember that. Katerina and I were there. Later, we left too… I mean, most of us remained there for a long time. I ended up leaving at one point, but it was mainly for personal reasons, like family in France, problems…
Katerina Bakatsaki:
I have to say that I only started teaching and even thinking about teaching after I came back to Europe after 1993. It wasn’t part of my vision at that time. Then in terms of knowing when we moved to the farm, I think Oguri you were there much earlier than Christine and I, for example. Is that so?
Oguri:
Yes. I lived may be two months or a month in Hachioji when Maï-Juku V started. And halfway through the Maï-Juku V intensive training, I started living on the farm. From then on, I lived there for five years. Living there, it is very hard. Nothing there was really prepared for living.
We used some rental house, a farmhouse, a deserted house. Nobody had lived in that house for many years. I remember that before the intensive training started, I went there, as I said, by motorcycle, with my tools, hammer, and a saw, like carpentry tools, to help build with two people from the village, Encho and Akaba San. They later became big supporters and mentors. The house had a big paper door, you know, shoji. Shoji door is made of paper. There were no heaters. I mean, later on, like after two years, everything was changed. But in the beginning, it was a very interesting experience [laughing], like the way people lived a hundred years ago, that kind of aura experience for one year. So, we were not but, in the beginning nothing was prepared. Later we prepared everything. We were not punished then. Yeah, basically that’s it.
Just one thing, gomme ne [Japanese for “sorry”]: what Christine said about watching things. Yes. This is very much like Japanese mentorship, you know, a mentor never talks, even in the case of Japanese cooking, traditional cooking. They never teach you. Yes, you have to steal, steal that technique… Then, there is always some gap too. So, you develop your own ability to do things. Yes. That’s what I wanted to add. And of course, watching is amazing, we were always watching. Watching is very important. After that, you can see the difference. That’s one thing I learned during my first year.
The first year, we knew nothing about how to grow things, except radishes. Radishes, you can get after hundred days. We really started from scratch at first. So living is also from scratch, but we lived from that land, and we got lot of support. All farmers giving us something, even agriculture equipment tools. That is, secondhand tools. And “You know, you guys, use this”. And at the same time, as Katerina said, we brought some vitality to the village. After a few months: “Oh, these guys are serious… OK, we better help them.” But it took at least a year to prove ourselves.
At the beginning, we all grew very, very long hair, it was for performance purposes. Min had some vision, all males and females would have very, very long hair, like wild horses on stage. So, everybody let their hair grow. For the Rite of Spring, we looked like hippies. All village people didn’t trust us or didn’t believe we were going to continue running the farm. That’s what changed after a period of two years, three years, year by year, our relationship with the community changed a lot. “All these guys working so hard, honest people, and who do these crazy dances.” Something touched their hearts. We organized that festival in the farmland, so we brought entertainment from other regions of Japan, or foreign countries, Japanese performers, singers, sculptors, and all these people brought more audience and activities there. We also helped them. “Actually these guys are not bad.” In fact, we were always invited in their homes. We had different languages: Greek, French, and Spanish. And with different skin colors. Of course, nowadays, the presence of non-Japanese, of foreigners has become a common occurrence in the Japanese countryside, but back then European, Americans, were rare and unusual. Yeah, it was a very unique experience for each of us. For the village people, I think it was a shocking impact at first. That’s what life was like there.
Katerina Bakatsaki:
In terms of who went to the farm and who stayed there, it changed constantly. Although you have to imagine, for example, that in the first year, I don’t remember for how long all the foreigners for different reasons, good or bad, were still keeping houses in Tokyo, in the suburb of Tokyo, in Hachioji. While some people, like Oguri, had already moved to the farm. So, we’d go to the farm, us foreigners – correct me if I am wrong, Oguri and Christine – while still keeping our accommodations in Tokyo, because we all also had to work to earn a living, because there were costs involved for us for transport tickets, for business, and so on. For different reasons, we felt it was necessary to keep somehow a foothold in Hachioji, and work to earn money in Tokyo. That’s what we did. However, there was no money involved in our commitment to the farm or to the dance practice, to the practices we did there. That’s why we kept our lodgings and our jobs, and the studio in Hachioji, and we would go to the farm either when hands were needed, or when we would have to rehearse, to prepare for a group performance at Plan B.
So, the constellation of people at the farm changed a lot, absolutely all the time. There was a core group that would be at the farm on a more regular basis, and then we’d come to do farm work, for rehearsals and dance practice, and then we’d go back to Hachioji. Now, you have to imagine that – and this brings me to your question –when we were there, then the work had to be done, because things needed to be built, the chicken house, the fence needed to be corrected, or some chicken needed to be slaughtered, just to name a few things… We did the farm work and the maintenance work for the place, which were also considered part of the training. I mean, engaging with material, engaging with the timing of another thing, another material, another form of life, was considered as part of the training as well. For example, more concretely: how to weed the wild grass, you have to bend down to the ground, you have to work on the ground, it’s small, it’s small, and we were not using electrical tools, we only use all types of tools that were almost extension of one’s body. So, a massive part of the training consisted of finding the best ways to use the body to be efficient in the work. The understanding of how to exert force, in which direction you are going to gear the movement, so, how to use your wrist to grab the grass in a way that you can pull it out with its root, so that it doesn’t break. And so on, and so on. So, that was part of the training.
Now, indeed, because we had to rehearse as well, there were hours set aside for artistic training. So, we had to wake up early in the morning, feed the animals, do the urgent farm work, which was already a form of training, and then have a very quick breakfast. And then the rest of the morning was devoted to rehearsals, then lunch again, and then farm work again. It was happening in a way that I wouldn’t call “organic”, but all the different needs, all the different concerns needed to be taken care of, to be attended to. This is how the day was being packed. The cooking was done, as I recall, on a rotating basis. I remember, me not being able to boil an egg, having then to prepare dinner for 15 people. The panic!!
Christine Quoiraud:
And sometimes we fasted to prepare for performances.
Katerina Bakatsaki:
Oh sure, oh yeah! But [laugh]…
But attending to things, attending to needs, whether it was a performance, whether it was a personal need, was as much a matter for the people who were present at that time. Attending to food, attending to the maintenance of the house and of the place, attending to the life, to the social life in the village, because that was also a big part of the activities. I can still remember spending a full day doing different kinds of work, and then ending partying, I mean, eating and drinking at Akaba’s house, or at Encho’s house… until early in the morning (Akaba San and Encho were two of the farmers who supported us). And then…
Christine Quoiraud:
We were young!!!
When I first arrived in the summer of 1985, there was that studio space in Hachioji in a suburb of Tokyo. And there were already animals around the building like chickens and a pig. And always a dog or two, or a cat or two, yes, and we lived with that presence. They were really small shacks near the building for the animals. It was in the suburbs, but it was still the city. There were no fields as such. There was no farm, just a dance studio. Nearby, there were rice fields, but not so many, and a river. So, the main activity was in the studio. Already Plan B existed in Tokyo. To go to Plan B took like – I forgot – but maybe two hours by train. I’m not sure but it was something like that. So, we often travelled from the studio to the city center.
And before that, Min Tanaka, when he came to Europe, often took us to work outside in parks, anywhere. And when we were still in Hachioji, during the intensive workshop (1985), he took us to the mountains for a week. That means that we were also dealing with wildlife in the mountains. And then, at the end of 1985, beginning of 1986, we started the farm. There were a lot of travelling by truck or by car, from Hachioji to the farm. And then, gradually, a team of dancers lived at the farm. Others continued to live in Hachioji. They kept jobs in Tokyo to survive. And then sometimes we would all gather at the farm to work, to carry out a major work, or to rehearse for performances. And then, sometimes we would go on tour in Japan. So, at the beginning, the core place of the activity was in Hachioji, and very soon after its opening (at the end of 1985), the farm became the main place.
I would like to add something about what you both said. About language, when I met Tanaka Min in France, he practically spoke no English at all. He used a translator, so he was at that time surrounded by a bunch of young Japanese, who were studying with Gilles Deleuze in Paris, and were translating for him. At that time Kazue Kobata was always travelling with him, and she was also translating in English, and she managed to introduce Tanaka to Michel Foucault, and, if I remember correctly, to Roger Caillois. And Min really talked a lot with both of them and was very impressed thanks to Kazue’s English. And then, around this time, I think in 1981, Min went to New York, thanks to Kazue. There he met Susan Sontag and musicians like Derek Bayley, Milford Graves, and so on. And, from then on, Min started to study English. Gradually, when he returned to Europe, he could use anatomic terms to explain manipulations, but he still always had a translator. And when we get to Maï-Juku V, I remember it very well, Min spoke much more in English, he asked the Japanese to learn a bit of English, and also encouraged the foreigners, non-Japanese, to study a bit of Japanese. In reality, and still today, there’s this kind of broken English between us.
4. Body Weather, Farming and Dancing
Presentation
Body Weather was based on the idea of perpetual change in the body and the weather. This raises questions about different ways of looking at farm work and artistic production work, the relationship between everyday life, the environment and dance work in its training and performance dimensions. Participation in the Body Weather farm involved a very intense commitment to all aspects of farm work and dance. But this commitment remained based on individual confidence in the philosophy of the project, and not on blind adherence to a closed community.
Oguri:
I want to explain a little of the history on a larger time scale. The Body Weather Laboratory I think started around the 1980s and lasted until maybe a few years ago, that means about a forty-year history. And I was there five years, so that’s what I am talking about, my experience over five years. I left in 1990. During that period there were many changes, and before I was there it was another time too. And about Shintaï Kissho, “身体気象”, “Body Weather”, that’s kind of a method of this movement: the body is not a fixed entity itself – not stable, fixed territory. It changes perpetually like the weather. Not like just one season; weather is constantly changing at any moment.
Christine Quoiraud:
I have a question for Oguri again: do you think that Tanaka had heard then of Masanobu Fukuoka?[4] Because I think it was in the 1970s that he left his job as an engineer and started to do organic farming, creating a commune. I think he was pretty well known then for the way he gathered volunteers to work on his farm and he had a commune that changed all the time, young people coming to him to learn and help. They lived there in a very sober way. And that reminds me a lot of what we went through in the beginning of the farm. For example, there was a group, forming the main group, mostly Japanese, living on the farm, and foreigners who came from time to time to do some special type of work with the neighbors or without the neighbors, and then also throughout the year there were volunteers coming to help from different parts of Japan. So, I was wondering if Min had heard of Fukuoka? I don’t remember hearing him talk about this guy but… may be…
Oguri:
I’ve never heard Fukuoka’s name from Min Tanaka’s voice. He never did mention him. I’m sure he knew but he didn’t mention it, but I think that’s very much Min.
Just one thing, I was about to forget about that. Going back to that first time when I was working in the farm, I was very impressed by the land. At the same time, on the farm, labor is not done for someone, labor is for yourself. Because people in urban environments depend on their customers, or their boss… But there, on the farm, as I said, there was a form of commitment and responsibility, but the whole work was for yourself. That was a very strong kind of our commitment and, you know, and that was the purpose for being there. Including the dance too. That’s what the dance method was all about. It was a very simple world and nothing special. Of course, you had to make your own decisions and, as I said, we are not professionals at that time. We have to find things out on our own – like some answers, because all the neighbor farmers were like mentors too. I remember that. And let me talk about land also… I know I had very different perspectives from Fukuoka. Like: what’s special about a region, regionality. What’s particular in that area or region, in that place… How to say? There are traditional ritual or celebration dances. Celebrations or some rituals, or kagura,[5] or dances there – we learned a lot about how to cultivate the land and how we think about the origin of dance. Because this type of method, Body Weather, is not a dance technique as such. Min Tanaka, he never teaches us how to dance, no. In other words, our practice is not a study of how to dance or a practice confined to the studio. Our training is very much oriented towards sensitivity work. And… the class is very open. I mean, our dance is very open for any kind of skill.
Katerina Bakatsaki:
As far as I know, the term Body Weather was borrowed – not borrowed but taken – from Seigow Matsuoka.[6] But am I right to think so? I am not sure. I mention this because when Min was working, traveling, exploring, with Kazue Kobata, he was also a lot involved in artistic and thought movements taking place at the time. The stimuli that gave rise to the work that emerged, to everything that he did, were of a theoretical as well as philosophical nature, and had also a very strong connection to movements of thought already existing in Japan, the United States and Europe. So, I just want to bring that in… Of course, I don’t know. I am not sure if Min has explicitly spoken about all this. I do know that Kazue Kobata did, and I’ve had conversations with her about it, about all the different movements of thoughts that were enlarging our approaches and encouraging Min to continue with the work he was doing. Not only Min, but also all the artists that he was working with. Because he wasn’t a solitary genius. I think we all had that kind of experience! There was always the presence of an extended community.
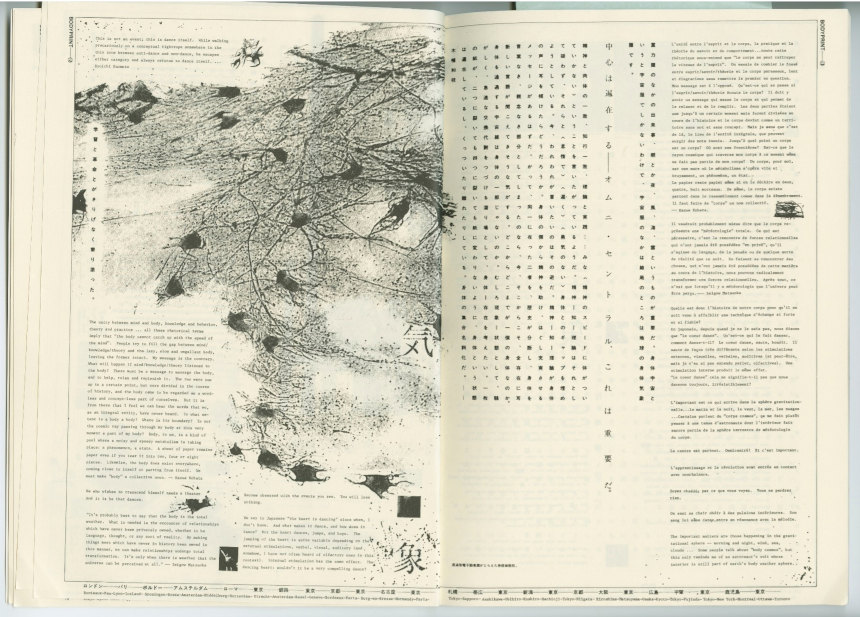
5. Commons and Body Weather
Presentation
Commons, what we call in French « communs« , can be defined as an articulation between resources that exist within a community, and rules concerning the way in which that community operates with regard to these resources. In the Body Weather experience, we can see that there are a lot of resources linked to the farm and to the dance practice, to Plan B and to all the spaces around the farm. How these aspects of common life were organized, how did the community function in relation to different interactive practices taking place in different spaces, environments, and with living creatures and objects? It’s about the conjunction of experiences, the existence of a community with little in common between its members but a commitment, autonomy and responsibility, taking initiatives in a non-formal structure, perpetual movement and evolution.
Christine Quoiraud:
Well, there’s not ONE answer to the questions about the commons. If there is an answer, it has to do with the passage of time. When I first arrive in 1985, things were different. The farm didn’t exist yet. And then the farm started. Then the farm continued. We started by building the chicken house and growing rice, and it was a gradual change. So, there are several answers, many answers.
Katerina Bakatsaki:
Allow me to use the word “community” not in the sense of a closed church, but as a network of forces, of people, of contexts, that always been central to Min Tanaka’s engagement. A bigger community of people, of artists, who had the same questions and the same concerns as he did. That’s one thing. And another thing I’d like to say, concerning that question of community: you are there because you’ve chosen to be, and you better have the guts and the commitment, for yourself, to fully engage. We’re not there to do it for you. And at the same time there was no pre-agreed reason for why we were there, there was no common belief. We are all here because each one of us had totally different motivations, and different interests, and different types of investment. Personally, I found that precious, I would not have stayed otherwise.
And also, I speak for myself, it was always important to feel things out and also to register with myself. That’s what was interesting because, you know, I was young. Intuitively I could understand things and give them a place, also listen to my experience – not the dance experience but the life experience – I’d acquired from the place I came from. And also the ways of being in community, the ways of doing things together, the ways of understanding and sharing work, where we lived together with others.
But, for me, it was also important to feel that I could actually betray that sense of commitment, even if only with myself. Why do I say that, because it gave me the security of knowing that I wasn’t in a sect. That said, I also want to say that it was fascinating at the same time how all of us, each one of us, were there out of our own different motivation, and still we had all made the commitment to be there together. And also doing things together, without there being any agreement on what that should be. Of course, there was the training, there was the necessity to grow as artists and eventually as people. There was a trust in witnessing the work and its potential outcome. It was not about developing a method, but in the way questions were posed: about dance, about movements, about land and nature, and about non-nature. So, these questions were present in all forms of production, in any kind of work activities, that had to be carried out, whether it was cutting the grass, whether it was learning from other farmers who have been there for generations. When they tried to figure out who we were, they wondered if that was “making mistakes”. But the commitment was to actually do that together. So, in terms of commitment, I mean, that has been always for me very interesting, very fascinating, very exciting. I always had to commit myself to something other than just myself. It’s something that exist among farmers, they know that you have to feed the animals, you are not on a vacation, you have to be there.
There’s no division between leisure time and work time, you have to be there, available, and your rhythm and your needs, your body are available for the service of something else, of the animals, of the plants, of the seasons, of the water that follows its course or stops flowing, etc., etc., etc. So, that sense of: “OK, I’m an individual, I’m here for myself, and I’m responsible for my actions, I’m autonomous”, and yet there’s always this call to actually relate and commit to something else that isn’t myself. And it’s not necessarily linked to that community as such, it’s always bigger than that. It’s the other humans, as being together, but it’s also the animals, the plants, the cultivation, and so on. The tools that we use. Yes, there are a lot of nuances to this notion of commitment.
Christine Quoiraud:
I think we learned a lot by watching… by observing, which is also a way of understanding farm work, like, I remember, when we went to help Encho (one of the farmers, a neighbor) in the rice field. He showed us how to cut the rice and hang it on a pole. It was a situation of having to observe the action, in order to be able to do it ourselves. Or when he showed us how to use a tool to turn over the wooden logs on which shitake mushrooms grow, we watched his gestures so we could imitate them – not imitate them exactly – it was a question of grasping, of embodying the gesture of the one who knows how to do it.
And I remember myself trying to follow the M.B. training (« Mind and Body training », a very dynamic training as part of Body Weather),[7] I had to watch the bodies of the guys in front, of Min when he was correcting a little or showing different rhythms or other things. And when he was directing the preparation of the performances, it was the same. I’d listen, I’d watch his body rather than listen to what he was saying, his explanations which remained a bit surrealist for me. But for me, his body was not at all surrealist, I could grasp a lot of things. And by the way, Oguri, in my memory, before Maï-Juku V, there were a few solo performances at Plan B. But from Maï-Juku V onwards, Min started choreographing to encourage us – I think I was kind of the first one of the foreigners of that time to present a performance. So, my composition was first. Everyone laughed… So, I asked Min to choreograph my next solo. It was early January 1986, shortly before Hijikata’s death. Afterwards, Min encouraged everybody to do a performance once a month, which the three of us did as much as we could. This was in parallel with the collective work of the group, or the work directed by Min Tanaka. Each of us had the opportunity to develop our own research and test it in front of an audience at Plan B, which was an amazing privilege, an amazing way of learning… and also an extraordinary proof of trust. Voilà.
Katerina Bakatsaki:
In terms of the possibility of proposing initiatives, I don’t recall having the need to do so. However, I also don’t have the impression that I’m someone who passively follows the course of things, because I could have my own ways of engaging with things, like for example I could have my own motorbike and, at given times, I could move away from the farm and come back whenever I thought it was necessary. So, I, personally did not feel the need to initiate concrete things. And I guess, I am not also the type of person to do that, but at the same time I never felt I didn’t have the space for myself and act on my own, to make decisions independently and autonomously.
I think if Min had not given the trigger, suggesting: “Why don’t you do…” I’m not sure I would have done anything. Actually, Min somehow encouraged me, and yet, in this context, there was plenty of space to do our work, to do whatever it felt necessary to do. Given that there was a space also, Plan B was there, available to us.
Christine Quoiraud:
I think we initiated small things. Oguri, maybe you remember, when we started working together, we were in charge of the communication, how to say, designing the Plan B calendar, and at one point, I was translating into English – I had to work with Oguri, because I had no idea of Japanese. These are small things, but they added a stone to the edifice, to the main project. And as far as I am concerned, I managed to take a lot of initiative on my own, in the same way that Katerina could take a motorbike to escape. So, I was also able to take small initiatives to resource myself, so that I could then come back to taking part in the group. And it was because I was not Japanese, sometimes I really needed to do that, and it was by returning to my own language, to the French language, that I was able to realize this. I created a French language poesy club in Tokyo
Katerina Bakatsaki:
I think there were different places. It’s good to look at them from different angles. At the beginning there was a location in Hachioji, which was the dance studio. Then there was the farm, something completely different, a place with its intrinsic structure, with all its complexity and its improvisational character. We have also a seminal place, Plan B, a performance space. And all sorts of other places where performance would take place that were either theaters or outdoor places, within Japan or elsewhere. Then there were also all the places we had to go to sell and deal with the products of the farm, and I think that was part of our lives, of our practices as well.
If I try to define the commons in terms of locations, there were a) seminal places, b) important locations and c) places where a particular activity took place. Of course, there were other places as well, and, later on, came another house more to the south, close to the sea.Because the Body Weather farm was in the mountains. But, I mean, the life of the group changed in relation to these different places. I hope that this makes sense. So, again I repeat, it was Hachioji, the studio, and of course the houses around it, this particular space, a kind of small village situation on the outskirts of Tokyo. And then, you have the farm, you have Plan B in Tokyo, the theater space, and you have these other spaces where performances took place. Then, in my perception, there were all the big activities initiated by Min, so most of the important performances, the tours, and we were invited to participate. We were never obliged, but we were invited to take part.
There were also the moves – Oguri and Christine correct me if I am wrong – the big moves to the farm. I mean, these big migratory moves were initiated by Min, and maybe also in collaboration with Kazue Kobata and with other people who belonged to the artistic scene of Tokyo at that time. But these big moves were initiated by Min, and we were invited to participate. Plan B as a space was already in existence, I think, at least when I arrived. So, we have these places that exist, and we have some sort of structure that moves around that it is initiated and triggered by Min, Kobata, and the people who work closely with him. And then, within these bigger main locations and structures, we’re invited to participate by taking our own initiatives and to create our own work. That’s how I see it, that’s how I can make sense out of it, because a lot of it was left to our own initiative, I mean it was growing as we went along and according to needs.
That’s how I experienced the development of the different activities. The animals arrived. The rice fields had to be taken care of. Because that’s what was happening on the farm, we had to take care of it. In a way, there was an aspect of organicity, but at the same time there were many things that were already there, or that existed on Min’s initiative. I mean, the big performances, big theaters, were initiated by Min, or by other artists who had invited Min to participate or to choreograph, and then he would also invite Maï-Juku group to participate. So, some of these commons were determined as and when necessary, by the need to do something at a given moment. But each one of us, in different ways, initiated, supported, followed or redirected what was happening. But there was also a bigger structure above all that – I call it structure, but it was a very fragile structure, a non-formal structure: Min had his vision of things, and he was going on, he was moving on. Who wanted to join, fine, who did not, bye-bye, something like that. And yet, within that, there was a lot of space for us and a lot of invitations from Min’s side for us to take our own initiatives, to develop our own creativity, to have our own connections to the different places, to be there and understand and feel what needed to be done.
Oguri:
So, as I said before, the movement of Body Weather history is also constantly changing, as Christine explained. Katerina said it too. “If there’s something that we need, [chanting] we———– are going to do it.” Commons, the commons are not permanently fixed: the farm, the dance company, and Plan B. I was completely involved in all three activities, for me it’s the same, there’s no separation. There was the nojo’s [farmers] community. The community of who worked the land. People who weren’t involved in the performances, other people included in performances, but not in those of Plan B.[8] There were different ways of looking at these “commons”, a little more flexible, or expending and moving to. On the subject of Maï-Juku, moving from Hachioji to the farm was a big transition. Since the beginning of Body Weather, not as a parameter but as, let’s say, the essence of Body Weather, there was no question of staying solely at Hachioji, in this dance studio. It was necessary to move the activities to the farmland, to the rural world – I don’t say “nature”, just “farmland”, or environmental place. It’s just as Min Tanaka had done when he started dancing, first on the street, then in a theater. And now again, it was question of dancing in a specific site or outdoors. He never fixed the stage, but integrated into new places, moving to one another. So, I hope you understand, Maï-Juku is not a dance company – yes, in a sense it is – but it’s not a dance company fixed once and for all, with a choreographer and contracted dancers, who get paid for their performances. Not at all like that, yes… And at the same time, it’s another context that depends on individuals – I think I said something about a strong commitment on the part of individuals – it is very much organized, but it’s also very much an individual thing. In fact, now, Christine, Katerina, and I, we’ve been working completely separately and developed very different dances. So, we weren’t there to assimilate Min Tanaka’s choreography or to acquire a technique, Min Tanaka’s dance technique. This community is not like this. The commons are determined by the individuals within the commons. To come back to individualities – is it really linked to the commons? (I’m wondering myself) – obviously, financially, it hasn’t been easy for anyone. Because I was there for five years, from the moment we started working on the farm. We started by learning from the farmers how to do it. Yeah, none of us were experts at it at first, so, we were learning that. So, farm work didn’t pay as such. No, maybe at that time, dancing, big projects, brought a bit of money or commercial work, movies.[9] So, yes, many things were happening at the same time.
The farm started I think in 1986. All village people didn’t trust us or didn’t believe we were going to continue running the farm. That’s what changed after a period of two years, three years, year by year, our relationship with the community have changed a lot. All these guys working so hard, honest people, and who do these crazy dances. Something touched their hearts: that first year, Min, Kobata San, and other people organized a festival, the Art Festival, a pioneer project in Japan, outdoor. Something that never happened in Tokyo metropolis. But in this more marginal place, in the farmland, outdoor, a performing art event: sculpture, and music and performance. We brought many entertainments from other regions of Japan, or foreign countries, Japanese performers, singers, sculptors, and all these people bring in more audience and activities there. That was very much like a pioneer project in the 1980’s, now it’s getting more common place. It was another activity form of Body Weather activity and beyond, and we were all involved for this at the farm: farming, studying, driving the dance, and organizing, producing events. We were getting more accepted by the community. In fact, we were always invited in their homes. Of course, nowadays, the presence of non-Japanese, of foreigners has become a common occurrence in the Japanese countryside, but back then European, Americans, were rare, it’s unusual in that time, yeah, it was very unique experience for each of us.
Oh yeah, another thing, this is a bit symbolic about rice: rice is a very essential matter we plant, especially for the Japanese, I already said that. There are so many names given to one grain of rice, from the rice growing to the rice coming to my mouth, the name changes. It’s like these different names given to water: ice, water, snow, all transformations giving rise to different names. So many names are transformed each time in relation to other ways of being. That’s how the commons can be seen in the context of Body Weather. But I’ve learned from that tradition in the field – OK, all right, maybe I’m probably creating chaos – OK, ask me some specific questions! [laugh]
Christine Quoiraud:
I can add something which maybe extend somewhat or is connected to what Oguri just said: I remember that when we started the farm, there were no animals. The main focus was really on rice, getting the rice crop going, and then, gradually, we built the chicken house, and suddenly there were thousands of chickens. It wasn’t just Min who decided on the development of the farm, I think Hisako played a big part in these kinds of impulses. Suddenly we had goats and donkeys. And I remember that, when I left Japan, Tanaka Min offered to entrust me with cows. He wanted, me to take charge of the cows. I said: “No, thank you!”. But it was a way to establishing a relationship. We spoke about the place. This was how the original group had to adapt. These animals had to be taken care of, they were part of the environment. At first, they weren’t present, and then a little bit present, and more and more present. And so, the rice was like a must, because in Japan it’s everywhere, as far as I know… But the animals, it seems to me, were very important for Min and Hisako. The animals were present also for their shit as a fertilizer, but also to earn money, because we were selling the eggs. I’m thinking clearly about the animals and their sounds and their smells and their pee.
Katerina Bakatsaki:
I just like to try and clarify this notion of commons and of community. Because from many of you, you hear it said – and it’s also for me, wonderful to hear it – again and again, again, that there is a community in existence. But in the context of Body Weather, there was nothing in common between its members, and this is what gave the project its particular strength. Of course, there’s dancing, there is a need to dance and to explore dance, to explore how to understand dancing in life, how to relate, how to exist with each other, how to exist with things, with objects, with plants, with tools, with money, with no money, how to exist within other communities that also exist with us, while we are also not exactly sure whether or not we form a community. We just didn’t know. At least I didn’t know. I don’t think that we ever felt that there was anything we could designate as part of a common order.
There was a shared desire to be there, but each one of us had our own particular needs, expectations, and projections, and so forth. And also, their own ways of engaging with all this complexity, or chaos in other words, not chaos in terms of whatever, but chaos in terms of unpredictability. Everything relate, we are related. There are principles that are laid and guide us and stay with us, like the rice, like putting ourselves in relation, like questioning ourselves, how not just be in relation, but questioning how to do it, that is to do what we don’t know. Also questioning the morals, the ethics, and the politics of all that. Nobody decided: “OK, this is how we are going to do it”. We thought about it, we were figuring it out. And yet, and yet, and yet, there were bigger schemes that were constantly in motion, by which I mean that all notions were constantly situated in particular contexts. There was always the presence of all kinds of dancers, of bodies, as micro-communities. The community without something in common, that was very radical, it still is, at least in my mind, and that’s why this whole bunch of people wasn’t a sect, there’s no promise land, no obligations. We were there because we’d realize that “OK, I can do this, I can relate, I can respond to what needs to be done, I can…”
Christine Quoiraud:
Just one more thing. As far as I remember, the shape of the group and the activity developed on their own, but when we were on tour, when we travelled to France for performances, I remember that there were a lot of differences between what was relevant to the Japanese world and to the European universe. Min often talked about the tradition, tradition in Japan… And when he was in Paris at the time, he was somewhat critical of the style of democracy in use in France. I just remember one of Min Tanaka’s “remarks” when we presented the Rite of Spring. Nario Goda,[10] a dance critic, was with us and he fell ill. He was in hospital for a while, and Goda San, Mister Goda was very excited: “Oh, I am sick, I’m going to stay in Paris, I want to stay in Paris, I love Paris, I love France, there’s lots of good food, good wine …” And Min Tanaka said to him: “No! You shouldn’t stay in France, it’s too soft, the mind is too soft, the mind is too mild”. It spoke to me a lot, then, it was like: “In Japan, we can have this strong energy, this strong capacity to work. We don’t stop, we don’t give up,” like the Cossacks – an image that comes from me indeed – but that’s how I felt a bit at the time. You’d never get tired. You could continue even if you were tired, yes, absolutely… So I suppose Min was also wondering what it’s about to be a group, how a group could behave, how life with others could be envisaged. How is it to live with several people, and with an ever-fluctuating number of participants. During the first year, there were a lot of people on the farm, and then in the middle of the winter, it shrunk. The size of the group varied constantly. There was, I think, something akin to a non-adhesion to capitalism, in the way we were confronted with the economy. But on the other hand, to my feeling, there was a strong tendency to turn to tradition. And as a result, there was this tension between tradition and a certain willingness to invent something new. And probably, other influences, I don’t know, but I think I can feel or imagine something more open, somehow, – I would not dare to use the word – a certain anarchy, but…
Oguri:
Just I want to say this: as we are related to the land, it is also the case with dance. Dance is mobility, it can take place anywhere. With just the body you can present dance and it’s a one-time thing. And we don’t own our dance either. So, I think, it’s a very effective method. What I mean is that if we consider this notion of communs or of the commons, it’s kind of the essence of Body Weather: of not owning the land, of not owning the dance. It’s not about ownership.
So, that make sense now, that the dance and the land are always rented. We borrow the land and the dance as well. But during the pandemic, it is the first thing that becomes impossible, it limits the dance so much, that we can’t do anything. Yes, I am sorry to remind you of that. I’ve always thought that dance was the strongest media, you don’t need to carry instruments, you can go any place, just with your body. But during the pandemic, it was so difficult. I’ll stop here. OK, thanks.
Katerina Bakatsaki:
And yet, we as dancers we’re always moving. I mean, it was always another fascinating for me the way while working the life of the group was growing, that there’s a sense of mobility, of sudden shifts, changes of direction, mutations, movement. And yet there’s the question of not owning land, and yet there’s the question of working the land, of relating to the land. Getting your working hands dirty…
Oguri:
… Yeah, rooting, finding you roots…
Katerina Bakatsaki:
… finding your roots, working the land, I mean, creating a relationship with the land, as you say, with the rice field. Understanding also with the body, what it needs, its timing and being able to accommodate and support it, to be at its service, the same thing with the animals, the same thing between each other, the same thing with the music, the same thing with performances, wherever we are sharing the space with others, whether they are human bodies, or objects, etc. I think that was this notion of working the land: finding your roots, without owning. And this, for me, now I am recalling it, also with hearing your words, and “Ooooooooh!” [laughs], it’s really inspiring, time and again. And I think that was in terms of this notion of the commons: you know, things are moving, shifting, places are changing, we are embracing what needs to be done, etc. And so, there’s a constant move, and yet we need to get the actual relationships working with the village, with the villagers, with the rice, with animals, with the land, with each other, and so on. So, we are not owning land and yet we are working the land, again and again.
Oguri:
That was our Body Weather community. But you know, sometimes I feel that’s the big reason why I left the Body Weather Farm, was because it was at the same time a very old-style community. These farmers were very conservative too! Yes. But that was a kind of challenge for Min working there. I am not putting it, how to say, that he is not a great man and a fair person either, but I think at that time… OK I shut up now.

Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
6. Choreography, Improvisation, Images
Presentation
Was Min Tanaka a choreographer? It seems that he wasn’t in the strict sense of the term, but he was nevertheless an initiator of performances and stage director of dance. This meant that there were hierarchies in the artistic value of different forms of choreographies. Given these circumstances, what happened in reality during the preparatory sessions to performances? How much improvisation went into the performances? What was the place of technique, if it made sense?
The presence of images was an important element that enabled different pieces to formally emerge.
Oguri:
First of all, at least in my memory, in the 1980s, Min Tanaka never put his name on programs as a choreographer, such as “composed by Min Tanaka”[11] in a group performance, I remember it well. Composition implied a very strong framework. And choreography what task is it? It changed over time – I am just talking about this1985/86 period – it is a task, a movement or choreography proposed as a task. The task of jumping in the air, a task like jumping up one hundred times, and body straight. That’s an example. But composition is like a very clear road map, whereas usually we never repeat the same performance again. Even in the same series of performances. The second day, in the same series, a lot of changes take place, even this composition is slightly subject to changes. The next season, the performance resembles the original model, but still with some little differences. So, performances never stayed the same, at that time.
Later on, especially when we were living on the farm, then many productions, rehearsals took place on the farm. Indoor, in a studio – it’s not really a dance studio, it was in the house, we had a bigger room there, upstairs. So, rehearsals took place there or in the field, where we built a stage to rehearse. Again, for the performances it would create different situations. Sometimes we are doing the performance in the small studio, or at other time we’d present in a big theater the study pieces we’d created in the small studio. Processes were different. Usually, we worked out composition. And since we were living together, composition could be explained in a more abstract language… But very much related to each individual body. Body including spirit too, yeah, not like considering if someone had flexibility or if someone moved well, it wasn’t that important. And there was a lot of improvisation involved. Min demanded so much responsibility from each performer. Min Tanaka didn’t say how to move, he didn’t determine the form of the movement to choreograph. Later on, when we had gained a lot of experiences of dance in the farm, in outdoors, I remember a composition – very, very simple: just being there, assuming a presence. But each time, after rehearsals, he’d tell us clearly what he noted for each dancer individually. Everything he observes gives rise to very clear comments pointing to change things, to make the performance better, yes, without ever giving a goal to achieve. That’s what I remember about working in those days. Thank you.[12]
Christine Quoiraud:
We worked a lot with images, and these images came from Tanaka Min’s experience with Hijikata who choreographed a solo for Min. He used the images maybe from that moment on, the years when he was working under Hijikata’s direction, I think it was 1984. We got there in 1985. That was when he used the images. As I recall, he was really proposing us a methodology for working with images. So, it was a list of images. And as Oguri said, he would never show us movements. He just gave us the words and let us work with those words. And then, he would see us in rehearsals. And then he would adjust. And, again, to my memory, it was as if he were sculpting or creating the space of the body in space. And in space, that means here with the light, with the set, with the unfolding of time, with others, and I think he was always conscious of the audience’s presence. Whether inside or outside, the question of the audience’s presence was always a big deal. And what I learned most at that time, I think, was the consideration for the audience. And this image work consisted of always searching for ways to give vitality and energy to the pathway of the images, something impossible to stabilize or fix. Impossible to fix it in a form. Even now, if we showed you an image, maybe I suppose Katerina, Oguri and me would probably start looking for bringing this image to life.
When I use the term “image”, it was a list of words. Actually, in 2017, I organized a workshop at the CND (Centre National de la Danse), and I invited Oguri to lead it, focusing on “image”, and there is a recording of that workshop at the CND. And, in fact, in the feedback work I did on this experience, which is online (médiathèque du CND), I transcribed Oguri’s work. I transcribed, translated, and commented on his work. In that text, I even dealt with the fundamentals of Oguri’s teaching. By “dealt”, I mean décrypté, to decipher: “Oguri says this, and he shows that”. And I describe: “his hands are on his head, and his shoulder is moving towards the back, …”. I describe what I see on the video, what I see of his movements, of his body, in space, as he teaches.
Oguri:
Just one thing about the choreography of Min Tanaka, and this image work that Christine just mentioned. Hijikata Tatsumi, Tatsumi Hijikata was a big, big, big inspiration for Min Tanaka. And Min Tanaka was choreographed by Hijikata Tatsumi, I think in 1984. Then, at that time, Min Tanaka was very close to the Ankoku butō[13] movement. What Tanaka shared with Hijikata Tatsumi that experience working with those images. So, Hijikata Tatsumi used many images from the environment or paintings. And Min kind of introduced us to this work with Hijikata, and we also included this work on images in many of our performances. And later on, the approach to this “image work” changed somewhat.[14] The things that I introduced at the CND were really old work. They’re just all different tools that no longer correspond to actual choreography. They belong to that particular time. To what we did at that time. I think later on, he changed his method. This work on images has been internalized in our body. The outside world is in our body. As a result, from that moment on, landscapes are inscribed in our bodies: we have like a “big lake in the body” or a “tropical forest in the head”. And there is “a house burning inside the body”, and “smoke comes up”. It’s not an external image. It’s Internal. We have moon, or sky in our body too. That was a big change for the performances. Before it was so precise. With this body part, you render this image. You have to have a very quick mind to recognize and adopt any body position. This idea of inside-out changed everything, and Min Tanaka’s experience became mine. I don’t know how he now works with people. So, as his style of dance or choreography method is like Body Weather, it never stays at the same stage. So, yeah, again, I am a kind of a witness to the 1980s. It was only five years… but it made a lot of change in me.
Katerina Bakatsaki:
As Oguri said, there were different periods, and there was an evolution in the different images used at given times. So, I would be hesitant, I mean, some images are strongly remembered. But what I do want to say is that the work with the images was also part of the practice and was one of the many different ways of sensitizing the body to the words that exist within each image. And to sensitize the body to also non-human entities, whether it is an object, whether it is the water, whether it is the river, the rice, and so on. So, the images evoked again something other than human, coming, inviting non-humans in the body. So, one of the images that comes to my mind now, is that of a young monkey boxing with the sky, boxing the sky, correct me if I’m wrong. Boxing with the sky or boxing the sky.
Christine Quoiraud:
With red gloves, and this monkey was sitting on a barber’s chair [laughs]. At another moment in a performance, we were three women dancing and we were like the asses of cows [le cul des vaches], and our pelvis were swinging “ting… ting… ting… ting…” (like the cow’s tails chasing flies, we swayed the hips from one side to the other). Or you had a vertical electric pole inside your body.
Katerina Bakatsaki:
So, the images were used in many different practices to sensitize and to alert the body, but what was specific, as I said before, was that the images were inviting the other non-human and they were extraordinary, I mean, in their scale, in their richness.
Christine Quoiraud:
But it was also an opportunity to fragment the body. We had at the same time to focus on several images addressed to the body, and each part of the body would be in charge of a particular image: head, and arms, and torso, and belly, and back, and legs, and feet, all at the same time. And then we would switch to another set of images, which was also a source of stress for the nervous system. As if we were… Min Tanaka was using the words “to be attacked” by images. And so, it was also a way of being in control and on the frontière, on the borderline of lack of control, and we were always on the verge of falling totally out of control. Fatally, it was akin to the risk of improvisation, that’s what it was. We were also trying to reach the images, and they were somehow out of our hands, always escaping. In my memory, it was a question of increasing intensity, the intensity of the capacity to concentrate.
Katerina Bakatsaki:
Another image, another work, which was used later on: I remember that we practiced a lot, we practiced in the sense of research and exploration: it was a work with the notion of the puppet. So, you are a puppet, and you are moved by a puppeteer, you are moved by strings. It wasn’t a question of imitating, but of that notion, that invitation to the body to disarticulate itself – how can I say? – the invitation to the body to be moved by something else than the body itself. And the notion also, I think, that many of these images called for permeability. The permeability of the body – I remember Min using the word “attack” instead – but it’s actually about the body being permeable to the imagination, through again sensations, and imagination that is outside of itself.
Christine Quoiraud:
To be “attacked”, bombarded with images, is a way of saturating the brain with information, of thwarting the habitual production of images specific to each individual. You have to give yourself a chance to be “danced” by something other than your own imagination.
We also worked a lot with “stop motion”, like you start the movement, and you stop… you introduce the idea of cutting off the direction of movement and thinking about the duration of the movement, its extent and how long the stop will last. So, we did a lot of this, and at one point we also worked a lot on repeating the same movement, “again… again…”, or “long time”.
Oguri:
I think, a little bit, also, about “training” and “M.B. training”. We practiced the very coordinated body, body coordination with a rhythm, right side and left side. So, it’s a way of becoming conscious of connecting with the body and body parts. By lifting knees, turning hips, very simple things. But these shifts of direction were like the intention of how to go towards something else and to achieve the dismembering of the body. Dismembering… Yeah. This “image work” that Christine has just introduced, involved dividing up all the limbs of the body: head parts, arms parts, torso, and legs. And at the same time, moving different qualities, different speeds, completely different images movements at the same time. And this image is shifting into the next movement, the body parts changing with a hundred of transitions, transitioning, transitioning, transitioning between images also being part of the essence of the practice. So, that is more a purpose of dismembering the body, like a memory of early childhood, of a newborn baby’s way of moving. Of course, that movement is not connected with your mind or consciousness, or angel’s smile. When a baby starts smiling, it’s not the result of an emotion. It’s a kind of sensation to come. So, I think the inspiration focusing on these aspects came from Min Tanaka or Hijikata Tatsumi. It’s our body memory of early childhood experience at that stage of the movement. And again, that precise image brings external things into the inside. This is a huge challenge. If you don’t understand this, you can’t do that. Some people can do it, and some people cannot. How to accept that: you are bringing a whole city landscape inside your body? But I think dance can do that, yeah!
Christine Quoiraud:
This exercise was very hard. There were dancers who couldn’t realize it or couldn’t realize it on their own. It was a question to fill the whole body with a patchwork of constantly changing images. A concentration hard to hold.
Oguri:
Concerning Min’s choreography, training, M.B. training to coordinate body, actually I think the purpose was more about dismembering.
Christine Quoiraud:
The training was not there to strengthen the body’s capacities, but rather to deconstruct its coherence as a psychosocial unit.
Oguri:
Yes, we worked a lot with a partner. And body is best text for learning. We have a body stretching method and body alignment series called “Body Manipulations”. Between two partners: no talking for two hours to commit with each other’s body. Stretching like a body alignment. And after to talk to each other about the experience, responding to it fully. To share what had happened during the two hours of mutual commitment. And to share again and again. And learn that bodies are never the same, ever changing. Again, here we have all the concepts of Body Weather: never stay the same and take responsibility for sharing time and space with others. These principles were maintained over time.
[See Inventaire (Archive Christine Quoiraud, Centre national de la Danse Mediatheque).]
It’s a little bit related to the idea of the Japanese mentor. It doesn’t matter if it’s Japanese or not. But about mentorship or morals or ethics, it’s there: we learn that technique includes the space. As in martial arts, we always start to clean the space and start with a salut. That kind of morality and respect of the space. In dance, we’re learning space. And that each is a mentor to the other. I learned a lot from Min Tanaka, and from Noguchi San, operating lighting backstage at the theater. Or producing vegetables on the farm, or from the area farmers acting as mentors. And even after five years becoming known as a skilled dancer or skilled farmer. For sometimes I had to act as a leader for young people or beginners. The relationships I had with these people also taught me a lot. So, all this is also related to the communs. In that community, it’s also very much learning from each other. Everyone is a mentor to everything, it’s everywhere. Our producer, Kazue Kobata was one. Our colleagues, like Christine or Katerina, all came from different backgrounds, this is a very unique part of Body Weather: Europeans, Japanese, Americans, we all lived together too. And the common language is English, which I still don’t speak very well. So, that’s how we communicate and make things happen. And still, we have this kind of strong relationship after so many years.
Christine Quoiraud:
I think I’m very grateful for the mutual relationships between us. We helped each other. We influenced each other. I mean, I was, like Oguri. Oguri helped me somehow on the farm to get a glimpse of the Japanese state of mind and maybe, as we discussed, I was transmitting the Western individualistic state of mind – I was more into thinking about encounters and exchanges. We influenced each other, maybe without being conscious of it, but mediated by the fact that we spent so much time together. It seems to be very banal, but it wasn’t so banal. As Oguri said, we continue to have the same kind of relationship after so many decades, after such a long time, it’s a very strong connection. And I want to share the idea that I don’t think I went there to learn a technique or how to dance. But I know that at the end of that experience, as Oguri said, I also felt that I was totally ready to go out into the world and dance. I really had this feeling, not that I was proud or pretentious, but I had the guts, the courage, yeah! And the most difficult thing for me when I came back to Europe, was to be able to continue this intensity of life. And at that time in France, in Europe, it was a totally different logic. It was the beginning of the “intermittents du spectacle” in France, similar to this state of mind of a civil servant, a fonctionnaire state of mind, and I couldn’t enter that state of mind. Yes.
Katerina Bakatsaki:
In terms of technique, I think that we all know that technique has different states, different forms, different ways of understanding or disseminating. I think that the whole training including M.B. was there to answer the core question, which was, if I may say so, how to embody oneself in a plural way, in multiple bodies. I mean, if you consider training as research and not as a methodology for becoming something, that already clarifies things a lot. And, for me again, the question that constantly arises is how to be embodied in a plurality of bodies. You might question that possibility, maybe seeing from other points of view, that this plurality is problematic, but anyway, as a philosophical question, you have to ask yourselves: what if the body is never one, is more than one, and if it’s more than human? So, this is why the whole training is research, is finding ways to explore this fundamental question. In that sense, I don’t think that technique serves to become something, but it is a very clear, a very coherent, however not closed, methodology for questioning things. This is how I perceive it. Now, how does it lead to performance, how does it become a presentation on stage, very basic things that I can pick up? Once again, it’s all about cultivating the body’s permeability, and also its capacity to be lucid, clear, attentive, but without being self-absorbed, so as to have the tools to exist in performance. However, it is not a training that leads to performance, it’s, as Deborah Hay[15] also puts it: you are always training, you are always practicing also while you are performing; or you are never practicing, because you are always in the process of performing. There is the need to pay attention both to the body and to everything that isn’t the body, and it’s this aspect that needs to be the focus of training. So, in that sense, this is a technique, a non-formal technique, which is present in other artists such as Deborah Hay, Anna Halprin, Simone Forti, etc. So, it’s a non-formal based practice. The question I asked myself in relation to technique or the lack of it, after I left Japan (and to this day), goes something like this: “How can I keep training, how can I keep practicing?” How can I practice the life and all aspects of that life when I’m no longer in Japan?
7. Relationship to Music
Presentation
The relationships between dance and music in Body Weather is open to conjectures. Is this a story of dance gaining gradual autonomy from any illustration of musical discourse, or is music part of a general sound environment in which dance takes place in various modes of relationships? The notion of environmental sounds might include everyday life sounds (urban, rural, and natural), musical composition of a given space, improvised interactions with a musician, or recorded music in many styles. Are the sounds of the environment points of contact for Body Weather supports for body movements or sources of inspiration?
Katerina Bakatsaki:
Before music there was listening. I mean, before the conscience of music, there was the conscience of listening. By the way, when we talk about language, it’s not as if language was not there. Language was present, but perhaps because we didn’t understand each other, there were different ways of listening to language. I am not saying something new, but I just want to say that language wasn’t eliminated. All sorts of different languages were present, broken English, broken Japanese, attempt to speak without losing the sense of what you are saying, trying to understand with the eye and the ear at the same time while somebody is talking, etc. So, language was present as a mode of listening, as something that you clearly can’t understand, but you attempt to, but not in terms of semantics. By the way, I’ll never forget the Obon festival [Traditional summer festival, around August 15, celebrating the deaths].[16] The music, the dancing, and the singing, at Obon festival. Anyway, music…? There is a lot to say, right? Oguri? Christine?
Oguri:
Music, music at the farm, [laugh]… I have still strong memory of the sound of frogs. There is a second house on the farm that served as storage. And formally they used the upstairs for the silkworm. It was just one floor. Actually, the farmhouse has no doors, except for the toilets, it’s just… you know… Anyway, one big room upstairs, and originally there were no windows… At the early summer, the water from the rice field was prepared. The surface of the water is very clear, and there are frogs, frogs making a sound, from one field to the other field, they are making some chorus, and copulating in open air. It was… I’ll never forget it. “Hrogh, ghrogh, hrogh, ghrogh”, [he imitates a frog] I don’t know, like a thousand of frogs, like hundred frogs making noise, and setting these two fields in motion…
Christine Quoiraud:
… and constant sound of running water.
Oguri:
Ah yes! And water is so beautiful, trrrrrrrrrrp, and… And, I don’t know if it’s still there today or not.
Christine Quoiraud:
Yes, it’s the same.
Oguri:
I mean, water is running but it’s a different water too. Doesn’t make the same sound. And the houses, and traffic, it’s all changed. It’s not so quiet anymore…
Christine Quoiraud:
… and the sound of fireworks…
Oguri:
Sound of fireworks? Yeah… But anyway, there were always some noises in the house, like Katerina said, lot of languages in the house, no doors. Yeah… and some girls are fighting… only girls… [laugh] Oh! I shouldn’t say that. [laugh]…
Christine Quoiraud:
…and also singing songs a lot, I’ve often been asked to sing in French…
Oguri:
Oh, yeah! yeah! You have a beautiful voice, Christine!
Christine Quoiraud:
… one of the first solo of Oguri in Plan B, he danced on Klaus Nomi… [singing] “I’m wasting my time… on you———-” (souncloud.com).
Oguri:
[laugh] You sound worse! I mean, there was…
Christine Quoiraud:
We had M.B.Training on music like the Beatles, like “Stand by me”, like “bla, bla, bla,” Michael Jackson… And so on… And there was the music from traditional groups. Sometimes we had also visitors, like foreigners coming with guitar or other instruments. And there was also mainly Cecil Taylor, Derek Bailey…
Oguri:
We didn’t talk about “Art Camp”, the Hakushu annual festival (international summer festival organized by the whole group and with the villagers).[17] You know, I think the second year we lived on the farm, we started organizing the annual festival. We were not farmers yet, but we started this annual festival, that was another remarkable event.
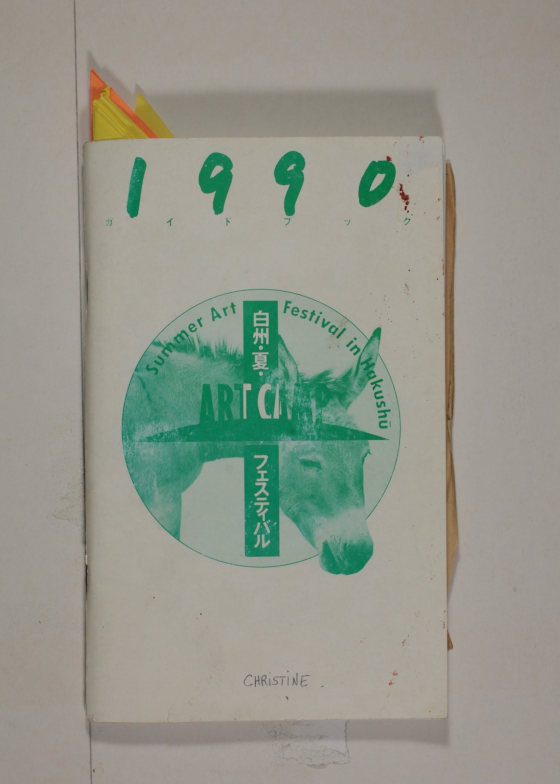
Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
Katerina Bakatsaki:
I would like to go back to music. In terms of music, like instrumental music, there’s a lot to say. I don’t want to speak about Min, because Min as an artist has had incredible collaborations with a lot of musicians, and thinkers too. But as far as we were concern, and the way we were relating to music, I think we were questioning, – maybe I’m speaking for myself – about how to do it, we were playing a little bit the perspective of the autonomy of dance in relation to music, which wasn’t new, because it had already been done in the United States and in Europe. But we were sort of eager to understand how dance could stand on its own independently from what music is or can be. And from there, little by little, we built, we researched the connections to music.
I don’t have the answer as to what is the relationship for anything to the thing we call Body Weather. There’s also a difference that’s perhaps more specific, between on the one hand the use of the experience of music and the sharing of space with music during performances, and on the other hand in practice, in training, in the ways we conduct our lives, in our mutual engagement with each other and with the work. So, we’re talking about different territories that interact, of course, but also imply different situations. That’s something I need to clarify. Also, if we place this experience, or experimentation in the context of our training and our performances, it’s because our relationships to music and sound were different in both cases. It was also something that wasn’t exclusive to the work happening within that community. I mean, to draw the bigger context, we know the post-modern experimentation and all the work of the pioneers of the Judson Church,[18] it’s also the same kind of experimentation, an exploration. So, I don’t believe that it was something unique to the work we were doing. It was something that put a light on what was present in a great many different artists and in different places around the world: the primordial importance of listening (I already said this), that is, activating the body to listening. Of course, I think that seeing and looking are important, but orality was a fundamental thing in the training itself, the activation to listening to anything that sounds. So, a lot of silent work was taking place in natural environments – I am talking about training here – so, that was an activation of the ear to tune into micro-sounds, to micro-sounds that one makes in one’s own body, in relation to the sounds of the environment, and to the sounds that are produced by interaction.
And then also, I do remember, we were dealing with animals, so learning to listen also literally to the sounds that animals make was essential, was necessary, to actually find a proximity. But here again, it’s nothing new, I mean, it’s not an innovative thing, it’s a thing that all farmers know. It’s also very present among anyone who deal with animals. And so, as you can see, I am still not addressing the question of music and I am dealing with listening to different types of sounds that are produced, and the possible responses that can be made to them.
Christine Quoiraud:
During the early days of his visits to Europe, Min Tanaka proposed in his workshops listening exercises such as the one I described above, where participants were blindfolded and had to point with their index finger to the place of sounds produced at various locations in space.
Oguri:
I remember those workshops, and what Katerina said about them. Yes, I agree. Just few things. In performance, there was not anything directly relating rhythm with movement, in Maï-Juku or in Min Tanaka’s dance. And I don’t remember any movements that corresponded exactly to the music, such as a moody melody.[19] So, dance wasn’t related to music in this way. I think really that music is not like making construction of the dance, it was not this kind of relationship. Music is possibly an important element as environment. With music, we could feel something like an emotional trigger or encounter the sounds and silence allowing an understanding of the space. That is what we learned from the natural environment, like I said of the frog sounds, how that sound passed from one field to another, a total experience of the environment in space and time… all night long until I fell asleep. And so, it is in a daily life or artistic creation, or in workshops, where we are experiencing, stimulated by life… this whole life. For me, farming and performing are not separated from living. I don’t separate, our life is one.
And what else? Oh, there was one composer always invited. Mister Noguchi.[20] He plays the synthesizer. So, he always plays music live, he never used records, sampled material, or recorded compositions. He never records his compositions, as dance only happens once. Mr. Noguchi’s sounds happen only one time. It’s easy to say “improvisation”, but it is live music, and it’s not, you know, making a living. How to say? It’s not a question of finding a reason to make the body move through a moody sound that elicit a floating movement. With him, it’s not the case. It’s very much like a stimulation and a space facing. Yes, spatial, spatiality. Yes, he creates a sonic space. That’s my memory.
Minori Noguchi (live electronics) and Min Tanaka (dance), 2006, Tokyo.
Click on « Regarder sur YouTube ».
Minoru Noguchi is a composer who uses electronics, noise, and various equipments. I remember he installed many micro-speakers in the space where the audience was seated. And before the performance starts, in the pre-performance time, that’s start making “t… ttt… tt… t… tttt…” [faint vocal noises], very, very subtle noises happening, yes, and this would gradually change to make like a “free———-” [almost singing]… Yeah. Very much sounds related to space and to the consciousness of the people in the audience, or of performers, consciousness that awakens, that kind of composition and what it could arouse.
Katerina Bakatsaki:
I think it is very interesting, Oguri, the way you raise the question of spatiality of sound. And also, you’re careful to stress the importance of distinguishing the function of the work of Noguchi, of the sounds, of the music made by Noguchi. It wasn’t an ambient music, as you said, it was not creating an atmosphere, but rather to create a space literally in terms of vibrations whose nature is actually very concrete. By this I mean creating space, different types of space, micro-spaces, or different senses of space, different imagination spaces, different sensitivities, or triggering through the ear different sensitivities to space, to space as it exists. I think Noguchi’s input was of this order. Of course, he was also aware that his contribution was part of a work of art in its totality. But his constant input was perceived by us as layers of space superimposed on each other. And that brings me back to training and how training comes into performance. I agree with you Oguri, there are constant interrelationships, flowing into each other, and at the same time, I think there is a combination of ever different situations. The training was really about training the body to listen in different ways, to respond to acoustic experience in many different ways, and to orient oneself in the ability to know where one is, and to situate oneself, to place oneself somewhere in relation to sound. So, in this respect, any acoustic production, the music if you want, the sound matter, during performance was actually received in the same way. Or to put it another way, the bodies were trained or alerted to respond to sound as if it were material, and as if there were also a space that constantly ask the body to orient itself from the nervous system, to orient and re-orient itself, to reposition itself, to place itself again and again. I hope it makes sense what I am saying. Yeah, it was a constant activation of the body trying to orient itself in relationship to sound.
Christine Quoiraud:
As we speak about performance, I have one more memory of early Tanaka Min in Europe. And, at that time, he was performing like almost naked, dancing in slow motion with no music. Except for some duets with Derek Bailey, in Le Palace in Paris, and later with Milford Graves. But then, he started this series called “Emotion”, that was in the early 1980s. But it was “a motion”, as in the sense of setting oneself in motion. And it was accompanied with very strong emotional music, like a very popular music, but it was really a clear decision on his part to play on the audience’s affects. But when we took part in Maï-Juku, if I remember correctly, there were several different kinds of performances. Sometimes we would perform indoors. Most of the time Minoru Noguchi was the sound space maker. But sometimes for solo work, Min would come in with music of his own choosing. Or many times also, we performed outside, for example in rivers. In the movie by Eric Sandrin “Min Tanaka et Maï-Juku”,[21] a sequence of dance in the river is shown, it was an exercise, it was not a performance. The movie maker chose to put some music for the film that had nothing to do with the circumstances. It was at the end of the intensive Maï-Juku in 1985.
Body Weather Dance in the River. Eric Sandrin, « Min Tanaka et Maï-Juku » Part 4/5.
Click on « Regarder sur YouTube » and go to 2’57”.
Here is another part of the Eric Sandrin’s video in which you can see Hisako Horikawa in rehearsal. She is working with the music by Noguchi (at 8’19”) :
Eric Sandrin, « Min Tanaka et Maï-Juku », part 2/5 (at 8’17”)
Katerina Bakatsaki:
And of course, the soundtrack of the documentary is the artistic choice of the maker of the film.
To go back to the question of music’s relationship with dancing, practicing, performing, moving or exploring, researching dance, again, I feel the need to say that it was through practice and performance, by which I mean the totality of the work, that the main focus was to raise the question of “what is dance?” again and again, and again. And then seeing dance not as a discipline, but as a phenomenon that belongs to life, not only to humans but also to entities other than human. Dance was explored as a thing of its own. You know, maybe the question of dance and music was not even raised. Because dance was seen as a phenomenon in relation to anything else. So, what sounds, sounds, what moves, moves, and that’s it, to put it that way. From this point of view, the major concern was not with the music, but the question was how does the body listen? For me, looking back, I understand that when we talk about dance and music, one of the core questions was not about the music, but how the body listens when it’s dancing, even if it’s outside of any performance.
Christine Quoiraud:
I just want to add something on this point. In my memory you have to distinguish between two situations: on the one hand, there were times when Tanaka was choreographing, and then he would sometimes propose recorded music. On the other hand, at other times, he would perform with a musician, improvising. He would be improvising the dance, and the music would be improvised, with live music. And Noguchi also took part in this process. And by the way, Noguchi had been working with Min for several decades. They knew each other for a very long time, and they worked together for long periods. And, yes, I remember that when Min was choreographing group pieces in a closed theatre, he really organized everything. For example, he would organize the lights, the set, and also the movements, the choreographic movements, he would organize things by giving a kind of narration to the sound somehow, including the silences. He proposed a narrative that would give sounds a raison d’être, a purpose, an objective. I remember feeling that way. And I also remember, for example, that for the solos he choreographed for me, it was pretty clear that it was a form of organization with a peak, a summit, and maybe something perhaps flatter, and at a given moment, I was on a kind of rupture, a silence, a long silence which I had to confront as a dancer on stage. And it was like he forced the dancer’s attention, but also that of the audience.
Katerina Bakatsaki:
Do you mean, Christine, that it was somehow scored? I mean, the acoustic environment was scored in some way and imposed to other people, is that what you’re saying?
Christine Quoiraud:
Somehow scored, yes, as was the lighting design. Actually, when Min encouraged us, advise us to choreograph our own pieces at Plan B, to develop our own work, and I remember very well that we were like helping each other, one dancer helping another dancer. We all tried to construct the stage, the scenography of our performances, with an organization of the lights, with a set, even though the absence of set was of course a set as such, and also the sounds. It was like giving a distribution of elements over the course of the performance. And for me, this was something very important, to have the opportunity, this great chance, this chance to try to do things by myself. It gave me also the possibility to come closer to what Min Tanaka had developed in relation to music. Maybe I’m not just describing what Body Weather was as such, but rather talking about my personal experience, there with Min, with training, with life, and with the other dancers.
Oguri:
Just one thing. I remember that during the creation and in the relationship between lighting and sound, there is a kind of communication between the performers, the dancers, and the musician, and with the lighting too. Yes, it is a meeting that happens like that, I think Christine already told you, for the audience and for the dancer. We also felt not an artistic vibration but a spiritual vibration, something to push us to do things, yeah. But I have personally the feeling that… it’s like a secondary thing. I remember that I have a lot to do with lighting at Noguchi’s side. So, I worked a lot as a lighting designer too. I was operating in the lighting booth during the performances, beside dancing. And Noguchi, you know, sometimes provoked the dancers. As I said, he had a synthesizer and a mixer. Sometimes, you know, it was just “boom, boom”, to provoke reactions from the dancers by playing disruptive sounds… OK, “go on, go, go on, go on!”, this kind of noise that urged us to go on. In his company, I felt that it was very much like life itself, rather than a matter of aesthetic experience, a very spiritual matter of being during the performance. Yes, definitively something extra.
Katerina Bakatsaki:
I like what you’re saying, I like this term “spiritual”, I just want to say this: I would use for my part, again, the expression “material”. By this I mean that Noguchi’s sounds and Oguri’s lights, by their presence as an integral part of the performance, implied an interaction, an independence, a resistance, etc… And once again, it wasn’t the type of music, the musical aspect of the music, that counted, but the material, the power of the material itself. The power of the material was what mattered most. Music as material, as very concrete living matter, with all the other bodies and lights alive on stage. I mean, it’s the idea that everything that sounds or moves is part of the totality of the performance and is interrelating constantly. I think this is the way I saw it, that’s how I can voice it today, and how it speaks to me, looking at what it was then.
Oguri:
I think so, material, yeah. In a good way, I understand. And I think that, again, when I was in the lighting booth with Noguchi, we had these kinds of reactions or approaches, aesthetic, and material, spiritual. I learned a lot, later on, when I was dancing with musicians. Because we were like sharing the space, not at any time interrupting each other, but with this kind of almost provocation “come on!”, this kind of relationship. I learned from this experience: how Min Tanaka approached dancing in free improvisation, that relationship. It is this part of interrelationships I learned from when I was in the lighting booth. I am involved at the same time as a third person, working with Noguchi and with Min, we were building a kind of relationship. And it was another kind of material on stage, another being present in the performance. I learned a lot, later on, when I was dancing with musicians.
Katerina Bakatsaki:
Yes, just to clarify my position, when I say “material” I don’t mean ideas, but materiality, just like bodies, such like light, such like the objects that are present, such like the audience, that’s what I’m referring to.
Oguri:
It’s not an ambivalent, invisible thing, and it’s not something that happens backstage, it is really actual, right in front of the audience.
Katerina Bakatsaki:
Yes.
Oguri:
I did not say that dance and music should form a package, in which they are intrinsically linked. It’s about sharing the same space, yeah, and not encroaching on each other’s territory.
Christine Quoiraud:
I have two more memories that come back to me:
a) At the very beginning of Body Weather, there was also Hisako Horikawa. She was exploring voice. She was – I think I read somewhere that exploring voice was part of Body Weather in the early years. I believe she started out as a vocalist, then she became a dancer.
b) I remember once or twice, in a solo performance Tanaka Min choreographed for me, he asked me to speak. To talk, to make my voice heard on stage, improvising. And once, he asked me very clearly: “Please can you evoke a memory of your childhood on stage”. And another time, I forgot what it was exactly. Twice, at least, he asked me to speak during my performance. It was more giving words, sentences. He asked me to tell a story. And of course, I could have lied, and I was speaking in French to a Japanese audience. Yes, I could have lied, but did not think about it [laugh].
Katerina Bakatsaki:
Concerning the difference between the sounds of everyday life and music, I don’t remember a conversation as such on this subject, but I do remember that music was used as such, also with recorded pieces already in existence. I don’t remember having to choose a particular relationship to music, I don’t recall that, like being invited to relate in a particular way to music. But different types of musical scores were used. When I say “music”, I mean the sounds produced during the performance, like sounds produced by another person being part of the performance, or the musical scores. But I don’t recall any particular, specific invitations to relate to music as such in a particular way. That didn’t mean that there was no distinction between different kinds of music. And also, Min himself worked with a lot of musicians playing live music, I mean, in improvisation. So, the music as such was there, present.
Christine Quoiraud:
And also, in his performances he would sometimes produce gibberish. I remember very well at Plan B, sometimes he was like a drunken guy on stage, using his voice. He wasn’t using intelligible words anymore, it didn’t make any sense, the meaning was more into the tone of the voice…
8. Conclusion: After the Body Weather Farm
Presentation
In conclusion, Katerina Bakatsaki, Oguri and Christine Quoiraud briefly describe their artistic trajectory after leaving (around 1990) the Body Weather farm. Katerina and Christine returned to Europe and Oguri emigrated to California. It’s interesting to note that, while continuing to be greatly inspired by their experience on the farm, they went on to develop very different artistic initiatives in very different living contexts and places.
Katerina Bakatsaki:
When I came back to Europe, the Japanese context for me was of course inevitably very present at the time, and at the same time also not so much. Many aspects of life there remained important, interesting, fascinating, and relevant to me no matter where I was, or at least I thought so at the time. So, the main question then was how relevant was that experience of life and work in Japan here? Who could I share it with, how could I continue it, who could be my peers, who could understand me? Because when I landed back in Amsterdam, all the work, the way of looking at it, and its ethics could not be understood at all, it was as if I was coming from another planet.
When I arrived in Amsterdam in 1993, there was a lot going on: the milieu of the modern dance, post-modern dance, was in a way much oriented towards the individual as such, I mean, all the methodologies were concern with “what do I feel”, and “this is the truth, this is relevant and good”. But if you were coming from another place, you would constantly ask question like: “Ah! Ah! Hm! Hm! is this OK? Is this how I feel? And yet, is it true? Is it relevant? And how what I experience does meet the other, the other’s body, or the other’s space and time?” The practice that I was embodying didn’t correspond to the contexts prevailing in Europe at that time. So, little by little, we had to create our own working environments with people who were willing to participate. We built up ways of training ourselves, of practicing and then engaging others, and so on.
It might sound tedious or cheesy, but the biggest lessons for me, the biggest place for practice, was to give birth to a being, to have a little body next to you, to deal with a little baby, a little young body, and to have to understand what it was and to be patient, to learn to live with it, etc. And then, I had to work with people who did not choose to work with me. So, I had a long period of working with people who did not have any background in movement or anything like that. I would not choose them, but for some irrelevant reasons, they would be part of my project. So, I had to be at their service, I had to understand their needs, then invent and devise ways and methodologies to share my work with them. This was for me the biggest school after coming back from Japan. Because of course, in Japan, everyone shared a similar motivation to be there: “I want to be here, and you know, whatever happens I can take care of myself somehow”. Now, I had to work with people who were working with me almost by chance. This created a difference, that dynamic was very interesting for me, and I had to find the appropriate words, ways of devising exercises and methodologies, determining ways of working.
Now, I am not dancing anymore, I am not performing as such anymore, but I am working a lot with others. I am not interested in choreography as such, as a way of presenting work anyway. I did a lot of work developing pieces for non-theatrical spaces. There was a period when I worked with a group of dancers, and we would work in marginalized urban environments. And that meant homeless shelters, or shelters for people who lived with psychiatric or mental illnesses, or houses for victims of domestic violence. So, it’s true that my interest as a maker wasn’t so much in making pieces but rather devising practices geared towards questioning what a practice is and what are the bodies that could be relevant to exist in such spaces. This was rounded up and then I moved on. Now I am working most of the time as a mentor, artistic advisor, and teacher.
Christine Quoiraud:
Well, when I came back, I was pretty lost. It took me a while to readjust to the French state of mind, as I’ve already said, and for two years I was living with my bag on the shoulder. I couldn’t stay in one place. I was just performing and giving workshops. With nowhere to stay really. I lived in a very, very great poverty. But it suited me, and I took charge of my life as a soloist somehow. And then, gradually, I started trying to organize a farm with a dream of repeating somehow the experience. In the South of France. But very quickly that failed totally. It gave me the opportunity to start what I call the “dance camp”, the Summer Dance Camp [Camp de Danse d’Été]. And that’s how I started the Body Landscape projects [Corps/Paysages]. And that lasted over five years.
And then I started developing projects over periods of five years or so. The “Body/Landscape” projects happened everywhere, in countryside, in big cities. I shared a lot of that with Frank Van de Ven at the time. Each year these projects took different profiles. I wanted them to be evolutive, and they did. I also tried to play the role of mentor for young artists, for young dancers. In a way, I was reproducing a bit what I’d learned Japan. Not as a teacher, but as someone who can give the tools to be independent and autonomous in production and exploration. And during these “Body/Landscape” projects, I also managed to bring together the dancers I’d met in Japan. Like Katerina who came several times and others like Andrés Corchero, Frank van de Ven.
And then, Frank and I split up. And I started the walking projects. And that was for me a way of getting closer to the essential questions: What is dance? What is art for? For whom? Is art separated from life? So, the walking projects were developed over many years, in fact seven years. I focused everything into the fact of walking, on the notion of being a collective in movement. For, say, one month, one thousand kilometers. Nothing was planned, nothing was organized. I called that an “improvisation workshop”. And the first improvisation was to find a place to stay at night. Sometimes it was raining outside. We had no tent. And gradually I took people along towards doing public performances. It was a question of meeting the public. So, it was also dealing with the reasons of life, of the ordinary life in the places we were passing by, whether crossing cities or in the countryside. We behaved differently if there was a group of ten people, or twelve people. If you are in the middle of the mountain, or suddenly you are in Pamplona or in a big city, you’re obliged to change, to adjust your behavior to what you’re encountering.[22] And for me, those walks were the happiest period of my life. Because in the end, there was no “teaching”, no “performing”. It was just a matter of walking, sometimes without taking anything, not even a toothbrush. And since then, I’m just getting old, that’s all, [laugh] busy with archives and telling stories. But I am still teaching, giving workshops a little bit. Sometimes being a mentor when asked.

Personal collection, Christine Quoiraud.

Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
Oguri:
OK, what happened to me? I found, yeah, gold, I got a life partner, Roxanne Steinberg,[25] and I moved to the United States thirty years ago. She participated to the sixth Maï-Juku (1986). With Roxanne and Melinda Ring, we started the Body Weather Training in Los Angeles. And we were invited to participate in an artistic residency program at a homeless women’s shelter in downtown Los Angeles. So, that was my new platform for teaching and performing. And with that program, I made a contract for transforming an old chapel into a theatre space, called Sunshine Mission, as part of the homeless women’s shelter. That was the beginning of my career in Los Angeles, we had a space, a studio to teach and perform. It formed the Body Weather Laboratory/Los Angeles. And we applied to be recognized as a non-profit organization. That way we could get support from the city, like the Cultural Affairs department, or the County of Los Angeles, the State of California, and so on… We started presenting an art program. And after five or six years, we moved to Venice, west of Los Angeles, to set up our own studio. Now I am in artistic residency at the Electric Lodge, a studio theatre. I continue the Body Weather workshops and performing and producing by myself, or in group work. And I present emerging dancers or master dancers in the city, and my old colleagues. I invited Christine, Andrés Corchero, Frank van de Ven to be here, teaching and performing here in Los Angeles. So, in doing that, and also since my experience in Japan was very much related with the land, I developed projects in the lands in California. I spent a couple of years to a project in the desert, a research for ways to find dance resources in the United States. So, I was digging desert land to produce site specific works, working with non-dancers. Working with a big group of people, in a specific site, without taking any permission, something like a happening performance in a public space. And seasonally, I am invited to be guest faculty at UCLA or Bennington College (Vermont), in a university teaching context. And I’m still presenting my solo dance and group work. And I’ve been collaborating a lot with Andrés Corchero from Barcelona, and collaborating with Christine Quoiraud as well.

1.Hijikata Tatsumi (1928-1986), Japanese dancer, choreograph and teacher, well-known as the creator of butōh dance. See
See: wikipedia and Encyclopédie Universalis
2.Tess de Quincey is a choreographer and dancer who has worked extensively in Australia, Europe, Japan and India as a solo performer, teacher and director. She founded De Quincey Co in 2000. See de Quincey Co

Archive Christine Quoiraud, CND Mediatheque.
Frank van de Ven is a dancer and choreographer who spent his formative years in Japan working with Min Tanaka and the Maijuku Performance Company. In 1993 he, together with Katerina Bakatsaki, founded Body Weather Amsterdam, a platform for training and performance. See Centre national de la Danse
Andrés Corchero, dancer, resident of Catalonia, explorer of body languages, he worked in Japan with Kazuo Ohno and Min Tanaka. See Body Weather
3.Kazue Kobata (1946-2019) was a Japanese curator, professor, translator, and former Artforum contributing editor, whose interests spanned film, architecture, avant-garde music, and dance improvisation.
See: artforum.org
See also in Christine Quoiraud archives, CND research, “Dive in in fine”: Médiathèque du CND
4.Masanobu Fukuoka (1913-2008) is a Japanese farmer, known for his commitment in favor of natural agriculture.
See: wikipedia
6.Seigow Matsuoka: essayist, specialized in art, author of numerous works on culture, Japanese and Chinese art. Director of Editorial Engineering Laboratory, Tokyo.
data.bnf
7.M.B. training, muscles and bones, mind, and body, etc.: dynamic training on music, with jumps, squats, stretching, rhythms, coordination, flexibility, anchoring, etc. See Centre National de la Danse
8.Christine Quoiraud’s note: At the farm, there were a lot of people who were just passing through, not necessarily involved in performances. Sometimes there were also dance artists who were not performing at Plan B. There was a lot of passage and variable geometry at the farm. Oguri was at the main core of all Body Weather activities, at all times. A life entirely committed and dedicated to Min Tanaka’s vision.
9.Christine Quoiraud’s note: It happened that a large sum of money came from big productions or participation in commercial films. The money was then used for the life on the farm.
10. Nario Goda, dance critic and journalist. specialist of Butōh. See “Interview avec Sherwood Chen, 7 février 2019, Paris”, translation and notes by Christine Quoiraud, note 232, p. 11. Médiathèque du CND
11. This can be verified by consulting the “Plan B calendars” in Christine Quoiraud’s archives at the CND/Pantin. See CND
12. Christine Quoiraud’s notes: Min was briefing us after the performances with clear feedback comments. He was constantly changing, improving the composition, adjusting for each one. His wish was that nothing should be fixed. No version in advance. He worked by shaping performances with the dancers.
13. Ankoku butō = the dance of the darkness. [la danse des ténèbres]
14. Christine Quoiraud’s note: Min Tanaka transmitted this learning received from Hijikata to us, dancers, first in a workshop situation and then in the use of this practice in performance.
15. Deborah Hay is an American experimental choreographer working in the domain of postmodern dance. She is one of the funding members of the Judson Dance Theater. wikipedia
16. Obon (…) is a fusion of the ancient Japanese belief in ancestral spirits and a Japanese Buddhist custom to honor the spirits of one’s ancestors. wikipedia
17. See Christine Quoiraud’s archives at the CND, Eric Sandrin’s film “Min Tanaka et Maï-Juku”, and by the same author, the film “Milford Graves and the Japanese” on YouTube.
18. Judson Dance Theater was a collective of dancers, composers, and visual artists who performed at the Judson Memorial Church in New York between 1962 and 1964. wikipedia
19. Christine Quoiraud’s note : Min Tanaka often danced to well-known salsa tunes or other very sentimental music.
22. My watchword then was “circuler, circulez” (pass by, go through, let’s move on)
György Kurtag – English
Duration of the instant and moments of encounter
György Kurtag
The sound recordings are by György Kurtag.
The text is a quote from Pr. André Haynal, psychiatrist, psychanalyst, emeritus professor at Genève University, concerning the book by Daniel N. Stern, Le moment présent en psychothérapie : un monde dans un grain de sable, Paris : Éditions Odile Jacob, 2003.
See https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2004-2-page-11.htm
1. György Kurtag – Insectes confinés
“In his new book, Stern talks, as a psychotherapist and observer of daily life, about what he calls the ‘present moment’, what could also be called the blissful moment, during which, all of a sudden, a change can take place. This phenomenon, which the Greeks call Kairos, is a moment of intense interaction among those who do not appear on stage without a long prior preparation. This book focuses our attention on the ‘here and now’, the present experience, often lived on a non-verbal and unconscious level. In the first part, the author gives a very subtle description of this ‘now’, the problem of its nature, its temporal architecture and its organization.”
2. György Kurtag – Résonance
“In the second part, entitled ‘The contextualization of the present moment’, he talks, among other things, about implicit and intersubjective knowledge.”
3. György Kurtag – GriveHarpShort
“Implicit<>explicit:
to make the implicit explicit and the unconscious conscious is an important task of psychotherapies of psychoanalytical (for him ‘psychodynamic’) or cognitive inspiration. The therapeutic process leads to moments of encounter and ‘good moments’ particularly conducive to a work of interpretation, or even to a work of verbal clarification. These moments of encounter can precede, lead to or follow the interpretation.”
4. György Kurtag – Deltal.izi
“These ideas are obviously inspired by research on implicit non-declarative knowledge and memory on the one hand, and explicit or declarative knowledge and memory on the other. These terms refer to whether or not they can be retrieved, consciously or not. The second therefore concerns a memory system involved in an information process that an individual can consciously retrieve and declare. ‘Procedural memory’, on the other hand, is a type of non-declarative memory, which consists of several separate memory subsystems. Moreover, it is clear that non-declarative memory influences experience and behavior (the most frequently cited example is knowing how to ride a bicycle or play the piano, without necessarily being able to describe the movements involved).”
5. György Kurtag – CantorDigit1
“A therapy séance can be seen as a series of present moments driven by the desire that a new way of being together is likely to emerge. These new experiences will enter into consciousness, sometimes as implicit knowledge. Most of the growing therapeutic change appears to be done in this way, slowly, gradually and silently. More spectacular is the emergence of ‘urgent moments’ that produce ‘moments of encounter’.”
6. György Kurtag – TrainTrain
“Stern emphasizes experience and not meaning, although the latter, and thus the dimension of language, plays an important role. For him, present moments occur in parallel with the language exchange during the séance. The two reinforce and influence each other in turn. The importance of language and explicitness is therefore not called into question, although Stern wants to focus on direct and implicit experience.”
7. György Kurtag – SongScratch1
“The problem of interpretation formulated as a hypothesis, whose veracity and heuristic value will be tested by the patient and the therapist, adds a powerful directional influence to the flow of a two-person progression process. Since it is introduced partly based on the therapist’s knowledge outside the session, it forces the protagonists to renegotiate the distance between them. The implication of this process on the frequency and timing of interpretations is a next step in these technical reflections…”
György Kurtag
Durée de l’instant et les moments de rencontre
György Kurtag
Les enregistrements sonores sont de György Kurtag.
Le texte est tiré d’un article du Professeur André Haynal psychiatre, psychanalyste, professeur honoraire à l’Université de Genève, au sujet du livre de Daniel N. Stern, Le moment présent en psychothérapie : un monde dans un grain de sable, Paris : Éditions Odile Jacob, 2003.
Voir https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2004-2-page-11.htm
1. György Kurtag – Insectes confinés
« Dans son nouveau livre, Stern parle, en psychothérapeute et observateur de la vie quotidienne, de ce qu’il appelle le “moment présent”, ce qu’on pourrait aussi dénommer le moment béni, au cours duquel, tout d’un coup, un changement peut s’opérer. Ce phénomène, que les Grecs appellent kaïros, est un moment d’interaction intense parmi ceux qui n’apparaissent pas sans une longue préparation préalable. Cet ouvrage centre notre regard sur le “ici et maintenant”, l’expérience présente, vécue souvent à un niveau non verbal et non conscient. Dans la première partie, l’auteur donne une description pleine de nuances de ce “maintenant”, du problème de sa nature, de son architecture temporelle et de son organisation. »
2. György Kurtag – Résonance
« Dans la deuxième partie, intitulée La contextualisation du moment présent, il parle entre autres de la connaissance implicite et de celle intersubjective. »
3. György Kurtag – GriveHarpShort
« Implicite <> explicite
…rendre l’implicite explicite et l’inconscient conscient est une tâche importante des psychothérapies d’inspiration psychanalytique (pour lui “psychodynamiques”) ou cognitive. Le processus thérapeutique mène à des moments de rencontre et à des “bons moments” particulièrement propices à un travail d’interprétation, ou encore à un travail d’éclaircissement verbal. Ces moments de rencontre peuvent précéder l’interprétation, amener à elle ou la suivre. »
4. György Kurtag – Deltal.izi
« Ces idées sont de toute évidence inspirées par des recherches sur le savoir et la mémoire implicite non déclarative d’une part, et explicite ou déclarative d’autre part. Ces termes se réfèrent au fait qu’ils peuvent ou non être retrouvés, consciemment ou non. Le second concerne donc un système de mémoire impliqué dans un processus d’information qu’un individu peut retrouver consciemment et déclarer. La “mémoire procédurale”, en revanche, est un type de mémoire non déclarative, qui comprend plusieurs sous-systèmes de mémoire séparés. En outre il est clair que la mémoire non déclarative influence l’expérience et le comportement (l’exemple le plus souvent cité est celui de savoir rouler à bicyclette ou jouer du piano, sans nécessairement pouvoir décrire les mouvements impliqués). »
5. György Kurtag – CantorDigit1
« Une séance de thérapie peut être vue comme une série de moments présents mus par le désir qu’une nouvelle manière d’être ensemble ait des chances d’apparaître. Ces nouvelles expériences vont entrer dans la conscience, parfois la connaissance implicite. La plus grande partie du changement thérapeutique croissant, lent, progressif et silencieux, paraît être faite de cette manière. Plus spectaculaire est l’émergence de “moments urgents” qui produisent des “moments de rencontre”. »
6. György Kurtag – TrainTrain
« Stern met l’accent sur l’expérience et non sur le sens, même si ce dernier, et ainsi la dimension du langage, joue un rôle important. Pour lui, les moments présents se produisent parallèlement à l’échange langagier pendant la séance. Les deux se renforcent et s’influencent l’un l’autre, tour à tour. L’importance du langage et de l’explicite, n’est donc pas mis en question, bien que Stern veuille centrer l’attention sur l’expérience directe et implicite. »
7. György Kurtag – SongScratch1
« Le problème de l’interprétation formulée comme une hypothèse, dont le patient et le thérapeute vont tester la véracité et la valeur heuristique, ajoute une influence directionnelle puissante au flux d’un processus de cheminement à deux. Puisqu’elle est introduite en partie en se basant sur des connaissances du thérapeute extérieures à la séance, elle oblige les protagonistes à renégocier la distance entre eux. L’implication de ce processus sur la fréquence et le timing des interprétations constitue une étape suivante de ces réflexions techniques… »
Gilles Laval – Edges
Access to the texts associated with Gilles Laval:
A. Gunkanjima par Noemi Lefebvre : Gunkanjima – English
B. Reflections on some walls of misunderstanding between musical practices : Gilles Laval – English
Accéder aux textes originaux en français :
A. Gunkanjima : Gunkanjima
B. Réflexions sur quelques murs d’incompréhension entre pratiques musicales : texte original en français
C. Lisières – Gilles Laval : texte original en français
Edges: Gilles Laval Contribution
Is there an improvised present, at instantaneous instant T? What are its edges, from the instant to be born or not born, or not-being, the instantaneous not frozen at the instant, right there, hop it’s over! Were you present yesterday at this precise shared but short-lived instant? I don’t want to know, I prefer to do it, with no return, towards the commissures of the senses.
Is improvisation self-deluding? Without other others is it possible/impossible? What target, if target there is?
Instantaneous stinging interpenetrations and projections, agglutinating morphological introspective replicas, turbulent scarlet distant junctions, easy or silly combinations, sharp synchronic, diachronic reactions, skillful oxymoristic fusions and confusions. If blue is the place of the sea, out of the water, it is measured in green, on the edge it is like a rainbow. Superb mass of elusive waves where inside shine and abound edges of gradations, departures with no return, unclear stops, blushing pink blurs, who knows whether to silence, to sight land or say here yes hearsay.
I’ve yes heard the hallali sensitive to the edges of improbreezation, (sometimes gurus with angry desires of grips tumble in slow scales (choose your slope), when others sparkle with unpredictable happy and overexcited surprises). End-to-end, let us invite ourselves to the kairostic heuristic commissures of imagined spaces and meanders, alone or with others, to moreofdames [pludames], to moreofall [plutoustes].
“commissure: (…) The majority of 19th century and 20th century dictionaries also record the ancient use of the term in music to mean: Chord, a harmonic union of sounds where a dissonance is placed between two consonants.”
cnrtl.fr
“The end-to-end principle is a design framework in computer networking. In networks designed according to this principle, application-specific features reside in the communicating end nodes of the network, rather than in intermediary nodes, such as gateways and routers, that exist to establish the network.” (Wikipedia, End-to-end principle).
“Kairos (Ancient Greek: καιρός) is an Ancient Greek word meaning the right, critical, or opportune moment. The ancient Greeks had two words for time: chronos (χρόνος) and kairos. The former refers to chronological or sequential time, while the latter signifies a proper or opportune time for action.” (Wikipedia, Kairos)
Kairos is the god of opportune occasion, of right time, as opposed to Chronos who is the god of time.
Return to the other texts by Gilles Laval.
Gilles Laval – Lisières
Accès aux textes liés à Gilles Laval :
A. Gunkanjima par Noemi Lefebvre : Gunkanjima
B. Extrait d’une conversation entre Gilles Laval et Jean-Charles François : Conversation
Access to the English translations:
A. Gunkanjima : Gunkanjima – English
B. Reflections on some walls of misunderstanding between musical practices : Gilles Laval – English
C. Edges – Gilles Laval : Lisières – English
Lisières : contribution de Gilles Laval
Existe-t-il un présent improvisé, à l’instant T instantané ? Quelles sont ses lisières, de l’instant à naitre ou non, ou non-être, l’instantané non figé à l’instant, juste là, hop c’est passé !
Étiez-vous présent hier à cet instant précis, partagé sans lendemain ? Je ne veux pas le savoir, je préfère le faire, sans repasser, vers les commissures des sens. L’improvisation se joue-t-elle d’elle-même ? Sans autre autres est-ce possible/impossible ? Quelle cible, si cible il y a ?
Interpénétrations et projections piquantes instantanées, répliques introspectives morphologiques agglutinantes, jonctions éloignées mouvementées écarlates, combinaisons à l’aise ou niaises, réactions à vif synchroniques, diachroniques, fusions et confusions oxymoristiques habiles. Si bleu est le lieu de mer, hors de l’eau, il se mesure en vert, en lisière c’est arc-en-ciel. Superbe masse d’ondes insaisissables où dedans brillent et foisonnent des lisières de dégradés, des départs sans retours, des arrêts pas nets, des flous roses rougissants, va savoir s’il faut faire taire, se faire terre ou ouï-dire.
J’ai ouï l’hallali sensible aux lisières des improvisalizés, (parfois des gourous courroucés d’envies d’emprises dégringolent en gammes lentes (choisis ta pente), quand d’autres pétillent d’un imprévisible heureux et de surprises survoltées). Invitons-nous de bout en bout aux commissures heuristiques kaïrostiques des espaces et des méandres imaginés, seul ou à plusieurs, à pludames, à plutoustes.
« Commissure : Rem. 1. La majorité des dict. du 19e s. et Lar. 20e enregistrent également l’emploi vieilli du terme en musique pour signifier : Accord, union harmonique de sons où une dissonance est placée entre deux consonances (DG). »
cnrtl.fr
Le principe de bout en bout (en anglais : end-to-end principle) est un principe central de l’architecture du réseau Internet.
Il énonce que « plutôt que d’installer l’intelligence au cœur du réseau, il faut la situer aux extrémités : les ordinateurs au sein du réseau n’ont à exécuter que les fonctions très simples qui sont nécessaires pour les applications les plus diverses, alors que les fonctions qui sont requises par certaines applications spécifiques seulement doivent être exécutées en bordure de réseau. Ainsi, la complexité et l’intelligence du réseau sont repoussées vers ses lisières. Des réseaux simples pour des applications intelligentes. »
Wikipedia, Principe de bout en bout
« Kairos : Concept de la Grèce antique qui correspond au temps de l’occasion opportune, c’est-à-dire qui se rapporte à un moment de rupture, à un basculement décisif par rapport au temps qui passe. »
(L’internaute)
Kairos est le dieu de l’occasion opportune, du right time, par opposition à Chronos qui est le dieu du temps.
Retour aux autres textes de Gilles Laval.
Gilles Laval
Gilles Laval – Trois textes
A. Gunkanjima par Noémi Lefebvre
Texte publié dans la première édition 2016 de paalabres.org : Gunkanjima
Text published in the 2016 edition of paalabres.org : Gunkanjima – English translation
B. Extrait d’une conversation entre Gilles Laval et Jean-Charles François
Réflexions sur quelques murs d’incompréhension entre pratiques musicales : Conversation
Reflections on some walls of misunderstanding between musical practices : Gilles Laval – English
C. Lisières : contribution de Gilles Laval
Version en français Lisières – français
English translation : Edges – Gilles Laval – English
Yves Favier – English
Return to the French original text: Éloge des écotones
To Live on the Edges, to Praise the Ecotones
Yves Favier
Summary:
1. Edges, Fringes
2. Improvisation, Social Practice
3. Free Comments about “Gaya Sapor”
Edges, Fringes
Evidently the notion of “Edge” or “Fringe” is the one that tickles the most (the best?) especially when it is determined as an « autonomous zone between 2 territories », moving and indeterminate musical zones, yet identifiable.
They are not for me a “no man’s (women’s) land”, but rather a transition zones between two (or more) environments…
In ecology, these singular zones are called “ecotones”, zones that shelter both species and communities of the different environments that border them, but also particular communities that are specific to them. Here we touch on two concepts: Guattari’s “Ecosophy”, where everything holds together, and Deleuze’s “Hecceity = Event.”
These edges between meadow, lake and forest are home to prairie species that prefer darker and cooler environments, others more aquatic ones, and forest species that prefer light and warmth.
Isn’t this the case in improvisation?…
- Would the improviser be this particular “being on the alert”?
Hunter/gatherer always ready to collect (capture?) existing SOUNDS, but also “herder”, in order to let those “immanent” ones emerge? Not yet manifest but already “possible in in the making”?… - “The territory is only valid in relation to a movement by which one leaves it.”
In the case of the notion of Hocquard’s border associated with the classical political conception, the improviser would be a transmitter between 2 territories determined in advance to be academic by convention: a transmitter between THE contemporary (sacred art) music and THE spontaneous (social prosaic) music. …we’ll say that it’s a good start, but which will have no development other than in and through conventions…it will always be a line that separates, it’s an “abstraction” from which concrete bodies (including the public) are de facto excluded. - What (musical) LINE, could mark as limit, an “extremity” (also abstract) to a music so-called “free” only to be considered from the inside (supposedly from the inside of the improviser).
Effectively taking away any possibility of breaking out of these identity limits (“improvisation is this and no other thing”, “leave Improvisation to the improvisers”) comes from the fantasy of the creative origins and its isolated “geniuses”. … for me the “no man’s land” suggested by Hocquard can be found here!
…fluctuating moving data…leaving at no time the possibility of describing a stable/definitive situation…
temporary…valid only momentarily…on the nerve…
to touch the nerve is to touch the edge, the fringe, the margin…
improvisation as rapture…temporal kidnapping…
…where one is no longer quite yourself and finally oneself…
…testing time by gesture combined with form…and vice versa…
the irrational at the edge of well-reasoned frequency physics…
…well-tempered…nothing magical…just a fringe, an edge, reached by nerves…
ecotone…tension BETWEEN…
…between certainties…
…between existing and pre-existing…
immanent attractor…
…between silence and what is possible in the making…
this force that hits the nerve…
…that disturbs silence?…
…the edge, the fringe, the margin as a perpetually moving continuity…
The inclusion of each milieu in the other
Not directly connected to each other
Changing its ecological properties
Very common of milieux interpenetration
Terrier
Termite mound
A place where one changes one’s environment
For its own benefice and for that of other species
What narrative does the edge convey?…
Improvisation, Social Practice
Moving from a belief in certainty to working creatively with uncertainty.
Moving from frozen equilibria to proliferating disequilibria.
Moving from instilled objectivity to inter-subjective productions.
Moving from frozen equilibria to proliferating disequilibria.
Moving from ingrained objectivities to intersubjective productions?
Moving from deterministic predictions (hegemony) to an awareness of fundamental instabilities.
Moving from the unsurpassable to the possible/probable horizon.
Move from universal knowledge (centralization/hierarchicalization) to localized knowledge (rhizome/decentralized networks).
Moving from the supposedly objective structure to a broader movement of thought and dialogue between subjectivities…
…the edge of science/art being ecotone…
Gilles Deleuze and Félix Guattari:
From the central layer to the periphery, then from the new center to the new periphery, nomadic waves or deterritorialization flows pass through, falling back on the old center and rushing towards the new.
Connectivité Plus forts
Plus forts Le centre comme milieu
Le centre comme milieu
et vice versa
Free Comments about “Gaya Sapor”
August 2020
1/ ForewordLiving in the environment in the time allotted to us, engages us in 3 simultaneous ecologies: Contemporary globalized society/civilization is dragging us into a particularly powerful anxiety-provoking “maelstrom”, heightened by the media grinder. The conjunction of these anxiogenic currents (crisis: employment, financial, political, environmental, health, cultural, etc.) pushes us, by combined powers under the millstone of the injunction to adapt to the maladjusted, to resignation, surrender, individual abdication or collective struggles fueled by despair (even despairing)… In order to “move from a belief in Certainty, to recognition and creative work with uncertainty”, emerges the need to implement “antidotes” to this toxic mental construction, to “produce” an alternative… unconventional… not “conventioned”… subjectivity?
2/ To live “on the edges of…”, or “Praise the Ecotones”The edge between Arts and Sciences (erudite or incorporated) is an “ecotone”, a precarious shelter, a “skènè” (stage) that changes/turns the conventional order “between” the different actors, inhabitants (human and non-human), audiences… Nothing can remain fixed, frontal, everything becomes precarious and uncertain… everything is in perpetual movement, change, evolution, emancipation from one to/for/against the other… But always in diversity… biodiversity, in interdependent (autopoiesis) & interdependent moving ecosystems… The music(s) in “social ecotones” are major vectors of shared sensibilities, transmitted in and with total uncertainty as to how they will be perceived (if, in the best of cases, they are) nor by whom they will be perceived. All the rest of the subject and its implementation could be under the sharpened poetic gaze of Italo Calvino… in Le città invisibili, 1972:
I like the latter … it carries the flavor of knowledge(s) … in perpetual movement. To be continued… |
– Félix Guattari, The three ecologies, The Athlone Press, 2000, transl. Ian Pindar & Paul Sutton (first pub. in France, 1989). – Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, University of Chicago Press, 1972. – Bernard Stiegler, Automatic Society: The Future of Work, Wiley, 2017, transl. Daniel Ross (first pub. in France, 2015), see chap. 5. – Hans Jonas, The imperative of responsibility in search of an ethics for the technological age, University of Chicago Press, 1984, transl. Hans Jonas & David Herr (first pub. in Germany, 1979). – Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, coll. NRF Essais, 2019. – Ilya Prigogine (The End of Certainty: Time, Chaos and the New Laws of Nature, Free Press, 1997, first pub. in France, 1996), cited by Deborah Bird Rose, Wild Dog Dreaming. Love and Extinction, 2011, Univ. of Virginia, and The ecological humanities in action: an invitation, Australian Humanities Review, 2004.
The ecotone is often also a corridor, which according to the seasons develop different functions for different species.
|