Création collective nomade
Dans le cadre de la Biennale Hors Norme, Lyon.
15-23 septembre 2023
Aux Grandes voisines,
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
et Université Lumière Lyon II
Bilan sur les observations des ateliers organisés par
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
Comptes-rendus de Joris Cintéro, Jean-Charles François
et
de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et
de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p
Sommaire :
Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain « Création collective nomade »
1.1 Le projet de l’Orchestre National Urbain
1.2 Période de préparation du projet
Partie II : Les Grandes Voisines
2.1 Ateliers aux Grandes Voisines
2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines
2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines
2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines
Partie III : Le projet au CNSMD de Lyon
3.1 Les réunions dans le cadre du projet
3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMD
3.3 L’atelier Human Beat-Box
3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.
3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon
Partie IV : Le projet à l’Université « Lumière » Lyon II
4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II
4.2 Les ateliers à L’Université Lyon II
4.3 L’atelier Laboratoire sonore dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II
4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II
Partie V : Le cadre esthétique de l’idée de création collective
Conclusion
Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain,
« Création collective nomade »
Dans cet article, nous racontons sur un mode volontairement personnel la manière dont nous avons perçu le déroulement des ateliers organisés par l’Orchestre National Urbain/Cra.p dans le cadre du projet de Création Collective Nomade. Ce projet s’est déroulé du 15 au 21 septembre 2023 dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023, aux Grandes Voisines à Francheville, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) et à l’Université Lumière Lyon II.
Le compte-rendu de Joris Cintéro porte sur la période de préparation du projet et la journée du 15 septembre aux Grandes Voisines. Il décrit sa façon de procéder de la manière suivante :
N’ayant quasiment pas pris de notes ce jour-là (j’y allais explicitement dans l’esprit de participer), le CR suivant s’appuie essentiellement sur mes souvenirs. Ce mode d’écriture m’a justement permis de creuser ces souvenirs, à côté de photos et de vidéos que j’ai pris durant la journée – et qui m’ont également permis de « retrouver » la mémoire.
Celui de Jean-Charles François est basé sur une journée passée au CNSMD de Lyon, le 19 septembre et de deux journées à l’Université Lyon II, les 21 et 22 septembre. Il a été élaboré à partir d’observations (sans participation) et de prises de note.
Dans les deux cas, les comptes-rendus alternent descriptions, contextualisations et bribes d’analyse qui demandent à être approfondies.
Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne, membres de l’Orchestre National Urbain/Cra.p, apportent quelques éléments d’information essentiels à la compréhension de leur démarche.
Les textes sont entrecoupés d’extrait d’une vidéo réalisée par l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p qui contient des interviews de divers participants et des segments du déroulé des ateliers.
1.1 Le Projet de l’Orchestre National Urbain – Cra.p
Jean-Charles François :
Le projet de Création Collective Nomade a été élaboré par Giacomo Spica Capobianco dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023. Giacomo est directeur artistique de l’Orchestre National Urbain et de CRA.P qu’il a créé il y a plus de trente ans. Selon son site « L’équipe du Cra.p a pour objectif d’échanger des savoirs et savoirs-faire dans le domaine des musiques urbaines électro, croiser les esthétiques et les pratiques, susciter les rencontres, inventer des nouvelles formes, créer des chocs artistiques, donner les moyens de s’exprimer » (Cra.p). Le projet a été développé avec les membres de l’Orchestre National Urbain, l’équipe de la FEM [Formation à l’Enseignement de la Musique] du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL – FEM), autour de Karine Hahn, et avec l’artiste plasticien Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme (BHN).
La description du projet par ses organisateurs peut se résumer à plusieurs éléments dans un dispositif visant d’une manière générale à amener des publics très diversifiés à travailler ensemble pour produire collectivement de la musique, de la danse et de la peinture :
- Trois axes de médiation se combinent ici : a) mettre en présence des groupes sociaux très différents ; b) mettre en présence des personnes qualifiées à se nommer « artistes » (étudiants, étudiantes du CNSMD) avec des personnes a priori sans compétences reconnues dans ce domaine ; c) mettre en présence des pratiques dans des domaines artistiques différents (musique, danse, théâtre, arts plastiques, poésie).
- Les rencontres se basent sur des pratiques artistiques immédiates, faire de la musique, faire de la danse, faire de la peinture. Pour que cette mise en pratique commune n’avantage pas un groupe sur un autre elles sont organisées en sorte que toutes les personnes présentes soient mises devant des tâches qui sont nouvelles pour elles, comme par exemple jouer du trombone alors qu’on n’en a jamais fait l’expérience ou se mettre à danser si on est musicien.
- Le dispositif est structuré dans une série d’ateliers animés par les membres de l’Orchestre National Urbain :
Sébastien Leborgne (Lucien 16’s), beat box and spoken voice.
Rudy Badstuber Rodriguez, MAO et éléments de percussion.
Selim Penaranda, violoncelle.
Odenson Laurent, trombone.
Sabrina Boukhenous, mouvements corporels.
Clément Bres, batterie.
Giacomo Spica Capobianco, Laboratoire sonore, un atelier regroupant après coup toutes les activités des autres ateliers, dans des perspectives de création collective.
Les ateliers peinture sont animés par Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme.
Le point commun à ces ateliers (sauf pour la peinture) très différents en termes de manipulation de matériaux, est constitué d’une série de codes couleurs définissant des modes de jeu :
a) orange = vent soutenu ;
b) blanc = ralenti graduel ;
c) rouge = rythme répété (trois noires et un soupir) ;
d) marron = 8 pulsations régulières ;
e) noir = arrêt au sol, silence ;
f) bleu = peur, tremblement, énergie ;
g) vert = improvisation libre.
Les diverses mises en pratique des différents ateliers sont toutes basées sur l’exploration de ces codes couleurs.
- Une autre activité importante initiée par les membres de l’Orchestre National Urbain, c’est l’élaboration personnelle de textes appelés à être parlés (en rythmes précis ou librement) lors de la rencontre sur la scène de tous les éléments des ateliers.
- Les personnes présentes suivent chaque atelier l’un après l’autre dans des groupes d’une dizaine de personnes. À la suite de cela tout le monde se retrouve dans un ensemble général – Le Laboratoire Sonore – composé de diverses stations : trombone, violoncelle, voix (microphone), batterie, des objets divers suspendus à un portique, 2 stations « electro » (loops, jeu avec les doigts sur un pad), un spicaphone (genre de guitare électrique à une corde construite par Giacomo Spica), un instrument à cordes tendues sur un cadre en métal (dénommé miroir sonore), une guitare électrique posée horizontalement pour être jouée comme un instrument de percussion, un espace pour la danse. Un chef ou une cheffe est désignée parmi les participants pour organiser la performance en montrant au fur et à mesure les cartons de codes couleur. Dans l’esprit de Giacomo, il ne s’agit pas là de « sound painting », celui ou celle qui dirige doit seulement montrer des couleurs et indiquer un niveau sonore général, sans imposer une énergie particulière. L’expérience du dispositif à montré que dans la pratique les personnes qui participent au dispositif (dans et en dehors des membres de l’Orchestre National Urbain) mettent souvent une « énergie particulière » dans la direction – se baisser pour incarner une nuance, jouer à échanger rapidement les cartons, faire en sorte qu’une partie seulement de l’ensemble soit concernée par un carton, etc…).
- A un moment donné, dans l’institution où se passe les ateliers, une restitution générale du travail réalisé est présentée en présence d’un public extérieur (c’est ce qui s’est passé au CNSMDL à l’issu de deux jours de travail, et à l’Université Lyon II à l’issue de deux journées de travail). A l’université, cette restitution a été suivie d’un concert par l’Orchestre National Urbain.
Le projet lié à la Biennale Hors Norme s’est déroulé dans trois lieux différents :
- Les 15 et 16 septembre au Grandes Voisines, à Francheville près de Lyon, qui se décrivent dans leur site comme « un tiers-lieu social et solidaire où il est possible de dormir, manger, travailler, peindre, découvrir une exposition, participer à une chorale… et vivre des rencontres » (Les Grandes Voisines). Ce lieu d’hébergement accueille des réfugiés en attente de régulation. C’est ce public particulier qui a été visé pendant les deux journées de pratique.
- Les 18 et 19 septembre au CNSMD de Lyon, dans le cadre du programme de la Formation à l’Enseignement en Musique (FEM). Deux journées d’atelier, occasion d’une rencontre autour de pratiques entre les étudiants de la FEM et les réfugiés hébergés aux Grandes Voisines, avec une présentation publique du travail à la fin de la deuxième journée.
- Les 20 et 21 septembre, à l’Université Lumière, Lyon II, ateliers avec les réfugiés et les étudiants de l’université et du conservatoire (sur la base du volontariat) avec une restitution du travail en fin de journée du 21 septembre, suivie le soir d’un concert de l’Orchestre National Urbain.
1.2 Période de préparation du projet
Joris Cintéro :
Au moment où j’écris ces lignes, je ne me souviens pas tout à fait clairement des circonstances dans lesquelles on m’a présenté le dispositif pour la première fois. Je me souviens seulement de plusieurs bribes de discussion avec Karine me décrivant un « projet auquel on participe avec le Cra.p » dont la première étape se déroule « à Francheville, dans un centre d’accueil pour réfugiés », et que « les étudiants et les étudiantes ont été tenu·e·s au courant » de longue date. J’ai des souvenirs quant aux objectifs que l’on fixait pour les étudiantes et étudiants à travers un dispositif comme celui-ci, particulièrement aux Grandes-Voisines : rencontre avec une altérité dont nous supposons qu’elle n’est pas fréquente dans l’ordinaire de leur travail de pédagogues, création de moments musicaux pensés pour inviter un public non rompu aux traditions de ladite musique savante occidentale, adaptation dans des circonstances peu propices à l’enseignement artistique et bien entendu, prise de recul sur les enjeux sociaux et politiques de l’enseignement artistique.
Quelques jours avant la première séance aux Grandes Voisines [GV], Karine rappelle aux étudiants et aux étudiantes de la formation CA la teneur du projet. Après les avoir interrogés pendant un moment collectif sur la possibilité de se rendre aux Grandes Voisines le vendredi et/ou le samedi, nous nous rendons compte que très peu d’entre elles et eux se trouvent être disponibles pour venir avec nous ces jours-là. C’est le cas d’un seul étudiant en première année (Grégoire), que nous connaissons à ce moment-là, assez mal – la formation n’ayant démarré que depuis une semaine. Le groupe dans sa quasi-totalité nous a fait savoir de leur souhait de pouvoir venir, mais de leur impossibilité à participer à cause d’un manque de temps ou n’ayant pas reçu l’information à temps.
Nous soulignons également la nécessité, pour celles et ceux souhaitant venir, d’apporter des instruments qui soient susceptibles d’être manipulés par des enfants – je me souviens d’ailleurs avoir maladroitement insisté là-dessus, laissant penser qu’il ne s’agissait de travailler qu’avec des enfants et que ces derniers seraient particulièrement peu soigneux. Les réponses des étudiant et des étudiantes nous amènent à découvrir que très peu disposent de plusieurs instruments de musique.
Partie II. La Création collective nomade aux Grandes Voisines
2.1 Ateliers aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Le samedi 16 septembre 2023, après avoir récupéré une vieille guitare classique chez moi et la harpe électrique de Karine à Villeurbanne, nous nous rendons tous deux aux Grandes Voisines en voiture et arrivons en milieu d’après-midi, aux alentours de 15h30. Karine se gare sur le parking de l’entrée, à deux pas d’une sorte de guérite défraichie (vide ?) permettant de surveiller les allées et venues au centre d’accueil. C’est un peu loin du lieu où se déroulent les ateliers (il faut dire que la signalétique n’était pas très claire et que rien de l’extérieur n’annonce la Biennale Hors-Normes). Après un court appel téléphonique, Giacomo nous fait signe au loin de nous approcher et nous accueille.
Je rencontre pour la première fois les membres de l’Orchestre National Urbain, qui sortent alors d’une salle dans laquelle sont entreposés différents instruments. S’ensuit une visite « critique » rapide des lieux en compagnie de Giacomo. Nous découvrons un dédale de pièces, de portes, de couloirs et sommes informés rapidement de l’organisation du lieu. En effet, Giacomo connaît déjà bien l’endroit (l’Orchestre National Urbain est déjà intervenu dans les lieux) et a connu des tensions avec certains des acteurs et actrices qui y travaillent. Au cours de la visite, je comprends assez rapidement qu’il y a des difficultés de communication entre les acteurs (et leurs institutions respectives) quant à la gestion du lieu et qu’une partie des artistes présentes et présents dans le cadre de la Biennale Hors-Normes [BHN] ne sont pas « sur la même longueur d’ondes » que Giacomo.
J’ai l’impression d’un lieu labyrinthique qui peine à cacher les stigmates de son ancien usage (hôpital pour personnes âgées). Bien que certains couloirs soient bardés de peintures et d’œuvres en tous genres, que certains points extérieurs laissent percevoir une activité artistique (sculptures etc…), le lieu dégage une certaine froideur (néons, faux-plafond, peintures grisâtres, dalles fendues, etc…) typique des bâtiments administratifs, des maisons de retraite ou encore des hôpitaux. Certaines pièces paraissent un peu glauques et sentent l’humidité – c’est le cas de la salle de concert au rez-de-chaussée du bâtiment, qui se tient en lieu et place de l’ancienne chapelle du bâtiment. Pour ajouter à cette impression, Giacomo ajoutera durant la visite que les tables d’autopsie sont toujours présentes dans les sous-sols du bâtiment. On aperçoit au loin un stade de foot dont on peine à comprendre l’usage dans un hôpital gériatrique et des affiches présentant une installation qui doit s’y tenir. Je suis frappé à ce moment-là par la « valse » des clés qui accompagne cette visite, sensation probablement due à l’agacement dont fait part Giacomo vis-à-vis du fait qu’il soit nécessaire de fermer derrière soi « au cas où », « parce que certains réfugiés n’hésitent pas à se servir » ou parce que le matériel ne peut être surveillé en notre absence (et celle des membres de l’Orchestre National Urbain qui animent les ateliers).
Après un tour d’une bonne quinzaine de minutes où nous repérons où se déroulent les différents ateliers nous revenons au point de départ sous la sorte de barnum où l’équipe de l’Orchestre National Urbain nous avait accueilli un peu plus tôt. Il fait assez chaud, et Grégoire, le seul étudiant du CNSMDL ce jour-là, vient d’arriver.
Une fois la visite terminée, Giacomo souligne au détour d’une phrase la difficulté majeure de l’après-midi, difficulté que nous ne tardons pas à observer : personne ne s’est inscrit pour participer aux ateliers. Cette situation s’explique d’après lui du fait que les travailleuse et travailleurs sociaux intervenant sur le lieu n’ont pas relayé l’information aux usagers du lieu (en effet on n’a pas vu d’affiches pendant la visite et nous croisons des personnes travaillant sur le lieu qui ne sont pas au courant de la tenue d’ateliers musicaux), manque de communication s’expliquant lui-même par une brouille entre les porteurs de projet de la BHN et l’organisation du lieu – dont on apprendra un peu plus précisément, par la suite, la teneur. C’est donc sans aucun enfant/adulte, en dehors d’Omet – un usager du lieu qui n’est d’ailleurs pas initialement présenté/catégorisé comme un bénéficiaire du dispositif mais plutôt comme un membre à part entière de l’activité – que commence la journée.
En l’absence de public, les membres de l’Orchestre National Urbain ne se démontent pas et nous invitent à commencer à jouer, Karine, Grégoire, Omet et moi-même, en leur compagnie dans l’atelier sonore collectif (le laboratoire sonore de Giacomo).
2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Giacomo nous présente un atelier musical collectif similaire aux ateliers de groupe qui seront proposés par la suite au CNSMDL et à l’Université Lumière Lyon 2. Il s’agit d’une improvisation collective dirigée par un chef, officiant seulement par le biais d’un jeu de cartons colorés indiquant des intentions musicales particulières devant orienter le groupe improvisateur.
L’instrumentarium est le suivant :
– Instruments de « lutherie urbaine » : Spicaphone / Harpe-miroir [amplifiés]
– Instruments électroniques : (Korg monotribe/Kaosspad/Roland SP 404SX/MicroKorg)
– Pédales d’effet (Whammy avec Spicaphone)
– Microphone [amplifié]
– Instruments acoustiques (Caisse claire, guitare électrique, « baguettes chinoises » en guise de baguettes de batterie)
La console et les différents câbles qui permettent l’amplification des instruments ne sont pas utilisés comme moyens de jeu dans le dispositif.
Le jeu de cartons comprend 7 couleurs associées aux conventions décrites ci-dessus. À ce jeu de « code-couleur » s’ajoute la possibilité de faire varier le volume sonore du groupe improvisateur en signalant avec la main plus ou moins haute.
L’instrumentarium est ce jour-là disposé tout autour du chef ou de la cheffe. L’atelier se déroule dans une grande salle au lino vert, dotée de plusieurs baies vitrées (certaines occultées par des rideaux), donnant directement sur l’extérieur – permettant ainsi aux personnes qui passent de voir (et accessoirement d’entendre) ce qu’il s’y passe. Si elle n’est pas pour ainsi dire centrale dans l’architecture du centre d’accueil, cette salle se trouve néanmoins dans le passage des piétons et des voitures et donne sur plusieurs autres bâtiments – ce qui aura son importance pour la suite de la journée.
L’atelier démarre donc par le biais d’une explication de Giacomo qui en présente les différents aspects, mettant notamment l’accent sur le code couleur et les objectifs visés (travailler sur la matière sonore, libérer les éventuelles inhibitions de chacun, créer un espace d’égalité entre musicien·ne·s et non musicien·ne·s, etc…). Étant moi-même impliqué tout au long du dispositif, je ne sais pas tout à fait combien de temps chaque improvisation a duré. La seule chose que je sais c’est que les tours d’improvisation ont cessé une fois que tout le monde avait « cheffé » au moins une fois – certain·e·s répétant l’exercice plusieurs fois.
L’atelier débute. Tout le monde semble prendre beaucoup de plaisir à jouer de la sorte. Les remarques des personnes présentes tiennent essentiellement à la difficulté de se remémorer dans l’instant des conventions associées aux cartons colorés (j’ai dû attendre le 4ème ou 5ème tour pour m’aligner « correctement » sur les cartons), aux nuances proposées par le/la cheffe ainsi qu’au plaisir de jouer sur des instruments « exotiques » (la harpe-miroir et le spicaphone particulièrement). Presque chaque « tour » d’atelier se clôt par une discussion sur ce qui vient de se passer, discussion portant essentiellement sur des questions musicales (l’intention des chefs, les nuances etc…). Les premiers ateliers se passent « très bien » dans la mesure où il me semble que la majorité des personnes présentes sont rompues à l’exercice.
Durant les improvisations on voit parfois passer des groupes d’adultes, d’enfants, de parents qui pour certains s’approchent discrètement de la salle – feignant pour la plupart ne pas être vus. C’est au gré de ce flux qu’un homme d’une petite quarantaine d’années, accompagné de sa fille d’environ 5 ans se joignent à nous. Assez réservé, il déclare dès le début venir « pour sa fille », qui semble particulièrement heureuse et enjouée au moment où les membres de l’Orchestre National Urbain l’invitent à se joindre à l’improvisation collective. L’enfant participe à plusieurs « tours » d’atelier accompagnée par différentes personnes (qui la mettront sur un fauteuil pour qu’elle puisse jouer sur le Microkorg par exemple ou recadreront son jeu vis-à-vis des cartons colorés) et le père endossera le rôle du chef une fois – en plus de participer à quelques tours d’atelier lui-aussi. D’abord réticent au fait-même de participer (il comptait seulement regarder sa fille), il se joint à nous à la demande de Giacomo et se « détend » peu à peu, sans qu’il témoigne pour autant d’une forme de lâcher prise (que j’interprète par le fait que les participants se prêtent totalement au jeu et qu’ils se trouvent par moments dépassés par celui-ci). Le père et sa fille quittent la pièce après plusieurs tours d’ateliers, visiblement heureux d’y être passés.
Une fois la salle fermée nous passons dans la pièce adjacente dans laquelle se tient un atelier d’improvisation au violoncelle et de peinture.
2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines
Karine Hahn, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (11’19”- 11’44”)
Joris Cintéro :
L’atelier violoncelle-peinture est dirigé par Selim Penaranda (pour le violoncelle) et une personne (pour la peinture) dont j’ai oublié le nom (dont j’apprendrais par la suite qu’elle remplaçait Guy Dallevet, absent ce jour-là). Il se déroule dans une salle, grande mais assez encombrée de cartons, de peintures, de sculptures et d’objets divers.
L’organisation de l’atelier est assez simple. On a d’un côté Selim avec 3 violoncelles (un acoustique et deux électriques amplifiés) et de l’autre l’intervenante peinture avec un ensemble de feuilles, de peinture acrylique, de cartons pour l’étaler et de tenues de protection qui sont visiblement usées – la pièce semble utilisée très souvent pour réaliser des activités de ce genre, en témoignent les nombreuses peintures affichées aux murs et les tâches de peinture dans l’évier. Dans le même esprit que les productions qui suivront le reste de la semaine, ce dispositif consiste dans une interaction entre les groupes qui peignent et les groupes qui font du violoncelle. L’atelier se termine par des improvisations individuelles au violoncelle au départ d’un support peint par l’interprète.
Lucien 16’s (Sébastien Leborgne) sur les relations musique et peinture, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (3’48”-4’48”)
L’activité violoncelle dirigée par Selim s’organise toujours de la même manière.
1. Présentation de l’instrument et du dispositif.
2. « Tâtonnement » à l’instrument.
3. Improvisation dirigée avec code couleur. Cette activité nécessite au moins deux personnes
qui jouent, (dont Selim parfois) et une personne qui dirige.
Selim présente dans un premier temps le violoncelle en jouant quelques notes et soulignant de façon récurrente qu’il n’y a pas de bonne position pour en jouer, que l’essentiel c’est d’être à l’aise en jouant. Dans ce sens, il n’hésite pas à montrer des positions que l’on pourrait qualifier d’hétérodoxes vis-à-vis de la représentation commune du jeu au violoncelle qui est associée à une position dite « classique » (l’instrument se tient entre les jambes, les pieds à terre, le manche de l’instrument reposant sur l’épaule). Il met, à dessein, les pieds sur les bords du violoncelle, montrant qu’il est possible de procéder ainsi pour en jouer. Même chose du côté de l’archet qu’il propose de tenir de plusieurs manières différentes soulignant, comme il le fera plus tard au CNSMDL, que « ça peut se tenir comme une poignée de porte ». Il n’empêche pas, toutefois, les personnes présentes de tenir l’instrument et l’archet de façon « conventionnelle ». Une fois ce « rituel » de présentation accompli, il laisse les participants explorer sur le violoncelle tout en présentant la suite de l’atelier qui consiste en une improvisation avec une autre personne.
La personne qui « cheffe » durant l’atelier alterne au fur et à mesure de l’avancement de ce dernier. Le code utilisé est le même que dans l’atelier précédent.
De l’autre côté de l’atelier, on trouve la peinture, qui s’organise de façon tout aussi récurrente. L’encadrante présente la tâche à réaliser, c’est-à-dire peindre une toile en s’imprégnant de l’ambiance sonore créée du côté des violoncellistes et ceci à l’aide d’un bout de carton, permettant de réaliser, comme le montre l’encadrante, des formes circulaires pluri-colores. En somme il s’agit de verser quelques gouttes de peinture (une ou plusieurs couleurs) sur la toile, et d’étaler avec le support cartonné la peinture sur une feuille en réalisant des sortes de spirales.
Le lien entre les deux parties de l’atelier ne semble pas évident pour tout le monde, en témoignent, lors d’une pause dans le violoncelle où je jette un œil à l’autre partie de l’atelier, certain·e·s peintres ne prêtant aucun cas à la musique (ce qui n’est pas tout le temps vrai puisque les silences trop longs amènent les peintres à parfois gentiment râler de l’absence de musique pour peindre). Je prends quelques photos de l’atelier.
L’atelier se termine par une série d’improvisations individuelles sur le violoncelle, réalisées à partir d’un support visuel, c’est-à-dire la peinture réalisée plus tôt dans l’atelier. Personne parmi ceux et celles habitant le lieu ne viendra nous rejoindre durant le dispositif. Nous décidons de faire une pause après une petite heure de travail collectif.
Atelier violoncelle et peinture aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (5’45”-12’28”)
2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
La pause est l’occasion de s’allumer une cigarette, de boire un peu d’eau et de discuter plus généralement des dispositifs proposés et de l’absence de public. Si l’ambiance est très amicale, je sens tout de même une forme de déception chez les membres de l’Orchestre National Urbain. Je me dis aussi à ce moment-là qu’en effet, mobiliser autant de monde sur deux jours pour si peu de public constitue une perte de temps et d’argent considérable. On disserte un peu sur le lieu, ses défauts (on y serait logé par « ethnie ») et sur le fait qu’en dehors de son esthétique hospitalière, on n’y semble pas si mal accueilli que ça. On mentionne l’existence d’un bâtiment dédié aux femmes seules, public difficile à convier aux activités selon Giacomo, ces dernières ayant vécu des parcours migratoires traumatiques. Tout le monde y va de sa petite anecdote, surtout celles et ceux qui connaissent déjà le lieu.
L’après-midi avançant, Odenson Laurent, jeune membre de l’Orchestre National Urbain joue quelques notes au trombone. Ces notes ont l’effet d’un appel. Plusieurs enfants se rapprochent, timidement d’abord puis de façon plus directe ensuite. Ils et elles veulent jouer et nous le font savoir. Giacomo et Sébastien se précipitent pour récupérer les trombones qui avaient été entreposés dans une pièce du bâtiment. La scène donne l’impression qu’on est pris de court, le « public » afflue enfin, il s’agirait de ne pas louper le coche.
Les étuis des trombones arrivent et sont posés à la va-vite à terre. Le moment est assez intéressant dans la mesure où nous nous mettons toutes et tous (qui ont participé des ateliers précédents) progressivement à « cadrer » cet atelier qui prend forme. Ici on désinfecte les embouchures à l’alcool, là on montre à un enfant comment s’attrape et se tient le trombone, à côté on fait patienter celles et ceux qui attendent leur tour.
Atelier de trombone aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (0’23”-0’56”)
Odenson prend la main de l’atelier, parle fort (il faut dire que les enfants sont nombreux et pressés de jouer) et donne à voir comment on souffle dans l’embouchure du trombone. La majorité des enfants y arrivent. Il propose une série d’exercices/jeux où il s’agit d’abord de souffler fort une fois. Les enfants s’exécutent avec succès, rient et réessaient sans attendre l’invitation d’Odenson. Le volume sonore augmente rapidement, les enfants semblent emballés par l’activité. Odenson propose ensuite de jouer avec la coulisse. Certains enfants font tomber la coulisse (il faut dire que dans certains cas, les trombones sont aussi grands que celles et ceux qui les jouent), ce qui entraîne les rires des autres et l’impatience de ceux qui attendent leur tour – certains viennent alors en aide à leurs camarades en tenant la coulisse. Les enfants semblent visiblement très heureux de l’expérience qu’ils viennent de vivre. De nouvelles têtes qui font leur apparition : plusieurs femmes commencent à arriver et certaines se penchent aux balcons pour voir ce qu’il se passe.
Rebelote, on nettoie les embouchures, on donne quelques informations aux enfants sur la façon de tenir le trombone (chacun y va un peu de son conseil), on fait patienter celles et ceux qui passeront après, on invite les femmes qui viennent d’arriver à tenter l’expérience. On se partage les rôles pour y arriver : Karine est par exemple invitée à convaincre une habitante des lieux de se joindre à l’exercice, ce qu’elle parvient à faire.
Il est intéressant de noter que si en dehors d’Odenson, personne ne « joue » du trombone (du moins personne ne se catégorise comme étant « tromboniste ») tout le monde s’autorise le fait de montrer aux enfants comment on souffle dans l’embouchure, comment réaliser le mouvement des lèvres permettant d’y arriver ou de montrer comment se tient l’instrument – par exemple dans l’entre deux à celles et ceux qui attendent ou directement à celles et ceux qui sont en train de participer à l’atelier.
Après plusieurs passages, l’atelier s’arrête et les membres de l’Orchestre National Urbain échangent avec les femmes et les enfants présents pour les prévenir de la journée du lendemain et de la poursuite des ateliers.
Photos des Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (2’37”-3’33”)
Partie III : le projet de Création Collective Nomade au CNSMD de Lyon
3.1 Les réunions dans le cadre du projet
Jean-Charles François :
Avant de commencer les ateliers de chaque journée, l’équipe de L’Orcherstre National Urbain a l’habitude de se réunir afin de (re-)définir le contenu de la journée à venir, à partir d’un bilan des actions qui ont directement précédées.
Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne :
Premier temps, « Réunion d’équipe » :
Le directeur artistique (Giacomo Spica Capobianco) fait un point avec tous les artistes intervenants de l’Orchestre National Urbain. Ces réunions permettent d’évaluer les ateliers collégialement afin de faire évoluer le projet. Ces moments de discussion permettent d’échanger sur les évolutions, les contraintes, les difficultés rencontrées.
Afin de proposer le programme de la journée, un point préalable est prévu et permet de s’adapter aux situations vécues au jour le jour.
Deuxième temps, « Réunion d’équipe avec les stagiaires » :
Chaque matin un moment de discussion est programmé avec tous les stagiaires.
Ce moment et évidemment important étant donné qu’aucun niveau de sélection n’est requis au préalable, autant sur un plan technique que sur un plan social, les stagiaires vont être sujet à travailler collectivement.
Il est important que les uns aillent vers les autres pour une rencontre plus constructive vers une réflexion de création improbable.
L’intérêt est de faire comprendre au stagiaire qu’il est au service du projet au sein d’une création collective.
Tous les ateliers sont filmés.
Il est important d’avoir un support vidéo de chaque atelier afin que tous les membres de l’équipe de l’Orchestre National Urbain découvrent le travail de l’autre. Cela permet de faire évoluer le projet.
Jean-Charles François :
Par exemple, voici la description d’une telle réunion qui s’est déroulée lors de la deuxième journée d’ateliers au CNSMDL, le matin du 19 septembre 2023. Cette réunion regroupe l’équipe de l’Orchestre National Urbain et celle de la Formation à l’Enseignement de la Musique du CNSMDL.
Giacomo fait part des problèmes rencontrés au Centre d’accueil des Grandes Voisines. Il semble que les personnels encadrants du centre n’ont pas très bien organisé la venue du l’Orchestre National Urbain. Apparemment peu d’information a été donnée aux réfugiés, en conséquence il a fallu que les membres de l’orchestre se mettent à jouer dans la cour pour accueillir les personnes qui passaient et les inviter à participer. Ce sont surtout des enfants et les mères de ces enfants qui ont participé. En conséquence seulement un réfugié a pu venir participer aux journées de rencontre au CNSMDL. Giacomo résume les objectifs de la journée qui consiste à la possibilité de se prendre en main à partir d’éléments à travailler qui sont nouveaux pour les étudiants. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas le droit d’utiliser leur propre instrument. Pour Giacomo, on n’est pas là pour dicter des comportements mais pour se mettre en situation d’une recherche collégiale en vue de se projeter dans des pratiques à faire avec tout public.
3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMDL
Jean-Charles François :
La séance du matin du 19 septembre 2023 se déroule dans la salle de musique d’ensemble qui comporte une estrade. Un large espace sur la scène est organisé avec une série de stations instrumentales (instruments traditionnels, simples instruments construits, instruments électroniques, voix amplifiée) comme décrit ci-dessus. Un espace en dehors de cette estrade est réservé à la danse. Les étudiants sont partagés en trois groupes. Ceux ou celles qui ne participent pas à la performance d’un groupe sont assis par terre ou sur des chaises en dehors de ces deux espaces.
La séance commence par un échauffement du corps de 10 minutes animé par Sabrina Boukhenous. Elle est membre de l’Orchestre National Urbain, comédienne, directrice d’acteur et technicienne son-lumière. Son rôle dans l’Orchestre est de prendre en charge le corps en mouvement et le spoken word. L’échauffement se déroule dans la bonne humeur et le plaisir de faire : frottements de mains, exercices de respiration, mettre en action les différentes parties du corps, sauter, etc.
Concernant le travail d’atelier de Sabrina Boukhenous, voici un extrait d’un atelier qui s’est tenu dans le cadre d’un projet similaire à celui qui est décrit dans ce document: « Du corps aux mouvements, du geste aux sons », Université Lyon III, 2024 :
Atelier de Sabrina Boukhenous. Extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (9’30”-10’50”)
La première partie du matin (9h20-10h45) se déroule dans la salle d’ensemble, dans la configuration décrite ci-dessus. Les activités expérimentées lors des différents ateliers qui se sont tenus la veille (le 18 septembre) et qui ont été suivis par toutes et tous, sont maintenant regroupées dans un seul ensemble : jeu sur divers instruments, voix amplifiée et corps en mouvement. Il y a trois groupes d’une quinzaine de personnes qui se succèdent sur l’espace de l’estrade et utilisant aussi l’espace de la danse, pour expérimenter des situations avec une personne dirigeant à l’aide des cartons de couleur. Les temps de séquences de performance varient de 2 minutes à 4 minutes. Elles sont suivies à chaque fois d’une courte période (entre 4 et 10 minutes) pour exprimer des réactions, des sentiments ou proposer des actions, parfois soulever des questions importantes. À chaque fois la direction de l’ensemble et les différents rôles changent librement, les danseurs devenant instrumentistes, la voix parlée est assumée par quelqu’un d’autre, etc.
Laboratoire sonore au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (17’25”-18’42”)
Un des aspects spécifiques du dispositif est la présence des textes écrits lors des ateliers, lus à haute voix à travers le microphone placé sur scène à cet usage. Selon les consignes données par Giacomo, la voix n’a pas à suivre les codes couleur, mais déroule son débit en solo, selon le choix de celle ou celui qui le lit. La difficulté principale est de pouvoir entendre clairement la voix parlée, soit que les protagonistes n’ont pas l’habitude du micro, soit qu’ils manquent d’assurance ou d’énergie, soit encore que le niveau sonore des instruments reste trop fort, le regard porté sur les cartons de couleurs ne permettant peut-être pas une écoute immédiate de ce que font les autres. Giacomo assez tôt dans la séance montre au micro comment la voix doit s’engager plus franchement. Lors de la période de jeu du groupe 3, à un moment donné, il est décidé de ne pas utiliser les codes couleur, mais de se baser uniquement sur la voix avec la nécessité de pouvoir comprendre le texte, la voix devenant le chef d’orchestre. Après avoir essayé cette idée, un court débat a lieu sur des notions d’improvisation : la nécessité de l’écoute, la question des réactions par rapport aux énergies en présence, par rapport aux propositions, l’idée de laisser la place aux autres, notamment au texte. À la fin de cette première partie de matinée, une situation est expérimentée avec 3 personnes à la voix lisant leur texte.
La présence des textes, donne à plusieurs reprises l’occasion de soulever la question de l’engagement physique (notamment par Giacomo) et vis-à-vis du sens qu’on met dans le texte. Il est bien sûr très difficile de s’engager de manière immédiate dans une activité qu’on fait pour la première fois, lorsqu’on ne sait pas où cela va mener. Mais la difficulté de l’engagement chez les étudiants provient aussi du fait qu’on n’adhère pas (encore) à quelque chose trop éloigné des valeurs esthétiques qu’on défend au quotidien dans le conservatoire. Les comportements induits par la musique savante européenne écrite sur partition impliquent à la fois un engagement profond des compositeurs dans leurs projets esthétiques, et au contraire un détachement assumé des interprètes appelés à jouer une diversité d’esthétiques. On pourrait dire que dans ce contexte, l’engagement de l’interprète ne se fait qu’au moment de prestation en public, dans une posture où, comme chez les acteurs de théâtre, l’engagement approprié est « joué ». Dans ce contexte, on n’a pas l’habitude de se lancer corps et âme dans n’importe quelle activité sans auparavant avoir pu mener une réflexion à son sujet, l’esthétique n’est donc pas un engagement mais un jeu. L’engagement des interprètes du secteur qu’on appelle « classique » se manifeste surtout vis-à-vis de la manière d’envisager la production sonore et par là, leur identité principale est tournée vers leur instrument ou leur voix. Le corps de l’être humain occidental tend à être déconnecté de la signification, le corps doit construire la signification par le biais de contextes particuliers, avec le risque de ne pas accéder à un état plus fondamental dans lequel le corps assume et croit en sa propre production de signification. Or il existe beaucoup de pratiques musicales (et de danse) où l’engagement des performers n’est pas séparé des conditions de production et où la signification est fondamentale dès le départ, c’est-à-dire à tous les niveaux de compétence. C’est le cas notamment des pratiques musicales de l’Orchestre National Urbain et au sein des actions qu’il mène dans les quartiers défavorisés.
Certains étudiants ont décidé d’être présents aux séances, mais de ne pas participer aux pratiques proposées et d’être là en observateurs. C’est une infime minorité, 2 ou 3 parmi la cinquantaine de présents. Giacomo avait bien spécifié qu’il était permis d’avoir cette attitude, qu’il n’y avait pas d’obligation à participer à l’action. Pourtant l’un d’entre eux a rejoint le groupe actif au moment où ont été essayées des improvisations non basées sur les codes couleur et sans la présence d’un chef, en suivant les évolutions d’un texte ou en se laissant influencer par la danse. Il a pris la guitare électrique posée à l’horizontal, l’a accordée selon la norme et s’est mis à la jouer dans la position habituelle du jeu à la guitare.
Pour la danse, les termes de « mouvements du corps » sont souvent utilisés pour bien marquer qu’il s’agit d’une part de déplacements libres dans l’espace et d’autre part qu’il n’y a pas une ambition artistique à caractère technique qui empêcherait la participation immédiate de toute personne présente. La danse n’est pas utilisée pendant la première partie du groupe 1, puis petit à petit prend plus d’importance. Très vite on voit la nécessité pour le chef ou cheffe de voir la danse (autant que d’écouter les instruments) pour influencer les décisions de changement de couleur. Avec le groupe 3 (après l’expérimentation de suivre le texte) il est décidé que la musique soit influencée par la danse plutôt que de suivre les codes couleur. Comme dans le cas du texte, cet essai suscite un débat sur les rapports danse-musique : sont abordées les questions de l’imitation en miroir, des conditions de suivi collectif des musiciens, du risque de l’empire d’un domaine artistique sur un autre et de la nécessité d’une communication qui circule. Une idée est proposée : une improvisation où tous ces axes de travail se mélangent.
Concernant la présence d’une personne qui dirige avec les cartons de couleur, la pratique effective soulève au fur et à mesure plusieurs questions. Un des aspects importants est qu’à chaque séquence de jeu, il y a une nouvelle personne qui dirige, il n’y a donc pas l’écueil du développement de « spécialistes » de cette activité, et il y a une distribution démocratique des différents rôles. Mais ce dispositif précisément tend à renforcer la représentation générale qu’ont les personnes présentes du pouvoir dominateur du chef d’orchestre. Aussi, ceux et celles qui en assument le rôle, ont tendance à surinvestir le pouvoir qui leur est donné : il ne s’agit pas seulement de montrer des codes couleur et d’indiquer des niveaux d’intensité sonore, il s’agit par des attitudes corporelles exagérées de faire passer des informations aux instrumentistes pour qu’elles soient respectées, on est rapidement dans une situation similaire au « sound painting ». Ce surinvestissement de et sur la personne du chef, résulte dans la domination de l’œil sur l’oreille, avoir à regarder constamment le chef empêche de se concentrer à la fois sur sa propre production et sur l’écoute de la production des autres.
La dualité oralité-écriture est un élément très important qui se joue dans le contexte du CNSMD et des formes musicales qui en définissent les contours. Mais l’enjeu paraît tout à fait différent s’agissant de contextes dans lesquels toute personne (quel que soit son niveau de compétences et son origine sociale) peut accéder de manière quasiment immédiate à des pratiques musicales artistiques. Dans ce cas, il convient pour y parvenir de manière convaincante d’inventer des mécanismes très précis. Vers la fin de cette première partie de matinée, Giacomo rappelle le contexte pédagogique du travail en cours : la difficulté est de faire des choses dans des contextes de culture défavorisés, ou dans le cas de la rencontre entre différentes cultures. Comment construire des activités qui dès le début offrent la possibilité de se confronter à des enjeux fondamentaux mais de manière accessible, comment faire construire par celles et ceux qui participent leurs propres situations significatives. L’accès à des comportements actifs priment au début sur toute considération de qualité artistique ou de comportements normalisés. Les codes couleur et la présence d’une personne qui les manipule pour donner une forme à la performance assurent dans tous les contextes un accès rapide à une pratique effective, dans laquelle les enjeux artistiques ne sont pas du tout réglés, mais qui pourtant sont déjà inscrits dans le contenu de l’action.
3.3 L’atelier Human Beat-Box
Joris Cintéro :
La journée du 16 septembre (aux grandes Voisines) se clôt par le biais de l’atelier de Sébastien Leborgne (Lucien16), centré sur le Human beat-box. Sébastien est membre de l’Orchestre National Urbain et artiste rap, spoken word.
L’atelier se déroule dans une salle à l’intérieur du bâtiment. La salle est particulièrement petite et se trouve dans le passage d’un couloir, en face de plusieurs ascenseurs : il y a un peu de passage.
L’atelier mobilise assez peu de matériel : quelques feuilles de papier, une console, un looper, un micro ainsi qu’une enceinte permettant d’amplifier le tout.
Sébastien décrit le déroulement de son atelier. Il commence par expliquer le principe du Human beat-box. Pour ce faire, il dessine sur une feuille plusieurs instruments. On voit une grosse caisse, une caisse claire ainsi qu’une cymbale charleston. Il montre directement le son qui peut être associé à chacun des éléments dessinés sur la feuille en les pointant du doigt. Il met ensuite en pratique ce qu’il dit en enregistrant une boucle de beat-box.
Par la suite il demande aux participants de l’atelier (qui sont essentiellement des membres de l’Orchestre National Urbain et du CNSMDL) de réaliser une boucle eux-mêmes. Durant les ateliers un groupe de 3 enfants s’arrête pour écouter ce qu’il se passe. Sébastien les invite à essayer à leur tour de produire une boucle avec le looper. Les enfants rient semblent gênés mais s’exécutent néanmoins. Il en profite pour leur demander s’ils sont disponibles le lendemain pour participer à l’atelier. Cet atelier se déroule dans un temps particulièrement limité au regard des précédents, donnant à voir la plasticité du dispositif mis en œuvre par les membres de l’Orchestre National Urbain – ainsi que les difficultés, visiblement, régulières auxquelles se heurte le collectif.
Jean-Charles François :
Pendant la deuxième partie de la matinée du 19 septembre (au CNSMDL), j’ai assisté à un atelier de « Human beat-box » animé par Sébastien Leborgne (Lucien 16’s).
L’agencement technique du studio au CNSMDL consiste en un micro pour amplifier la voix du soliste, avec une machine qui permet l’échantillonnage des sons produits et la mise en boucle, pour créer des rythmes répétitifs, avec possibilité de superposer les échantillonnages de productions vocales. Plusieurs micros sont à disposition pour pouvoir enregistrer plusieurs voix en même temps.
L’introduction par Sébastien définit le contexte de production de rythmes par l’imitation vocale de sons de batterie (beat box) sur lesquels on va pouvoir parler un texte.
La première expérimentation concerne l’imitation à la voix de sons de grosse caisse, de charley, de caisse claire, et de les enregistrer pour les mettre en boucle. On crée une boucle sur laquelle les participants peuvent ajouter une autre production vocale pour former une nouvelle boucle.
La situation suivante décrite par Sébastien concerne a) l’élaboration d’une boucle rythmique avec 4 vocalistes ; b) puis le placement du texte sur cette structure rythmique. Sébastien dit que les étudiants doivent réaliser cette tâche en complète autonomie, il n’est là que pour répondre à des questions éventuelles. La réalisation de la boucle se fait assez facilement sans qu’il y ait beaucoup de temps pour essayer plusieurs exemples. L’ajout du texte sur la boucle inventée pose plus de problème, car les participants lisent leur texte sans inflexions rythmiques, indépendamment du contenu de la boucle. Sébastien suggère que la boucle qui accompagne le rythme du Human Beat box corresponde au caractère du texte et non l’inverse : « vu que ce texte est un rêve », la boucle doit refléter cette atmosphère.
Nouvel essai d’élaboration d’une boucle beat box à cinq voix superposées. Une étudiante dit son texte sur la boucle. Elle tente de faire corresponde son texte au caractère rythmique de la beat box. Sébastien fait remarquer que l’enjeux principal n’est pas de correspondre au rythme de la boucle, mais de « s’imposer sur le rythme ». Le spoken word consiste à ne pas se soumettre au rythme de base, mais d’être guidé par l’émotion juste et vraie. L’étudiante refait la lecture de son texte sur la boucle, mais s’arrête assez vite.
Quelqu’un demande s’il est possible de chanter le texte. Réponse de Sébastien : « tu peux faire ce que tu veux ». Une étudiante essaie alors de parler son texte et de le chanter en partie.
En observant cet atelier, il apparaît clairement que le problème principal des étudiants du CNSMDL dans ce projet se trouve dans cette activité très nouvelle pour eux et elles d’avoir à écrire un texte et surtout de le parler avec un accompagnement rythmique.
Atelier Human beat box au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes »(13’25”-14’29”)
3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.
Jean-Charles François :
Dans l’après-midi du 19 septembre, une restitution du travail réalisé dans les ateliers a été proposée à l’ensemble de la communauté du CNSMDL, dans la cour intérieure juxtaposant la salle de concert. Un dispositif de diffusion des sons amplifiés avait été installé et l’espace était organisé de manière similaire à ce qu’on avait eu dans la salle de musique d’ensemble, une combinaison regroupée d’instruments autour d’une voix, un espace pour les mouvements de danse et les productions de peinture exposées à même le sol. Le public (peu nombreux en dehors des participants eux-mêmes) était assis sur les marches devant le bâtiment de la salle de concert.
Les trois groupes proposent des performances dans lesquelles il y a des musiciens, des danseurs et des « déclameurs » de texte avec souvent un changement de rôle au milieu. Dans l’attitude des performers, il y a un effet de compensation du fait que la production encore trop expérimentale ne correspond pas aux critères d’excellence artistiques en usage au CNSMD. Il s’agit semble-t-il de montrer a) le plaisir de faire une activité non conventionnelle, b) d’accentuer le côté énergique de l’expérience, c) de montrer qu’on est dans une situation de divertissement dans laquelle on peut se contenter de n’être engagé qu’à moitié et d) parfois de faire ressortir le caractère ironique par rapport à cette situation d’inconfort. Il n’y a pourtant aucune agressivité dans ces attitudes vis-à-vis de ce qui a été proposé, mais plutôt un problème de positionnement vis-à-vis de la communauté dans laquelle la restitution est proposée.
Dans le groupe 2, un chef très « compositeur » développe une forme qui met en scène des éléments dans une sorte de narration qui permet au texte d’émerger. Grâce à ce savoir-faire « maison », on se rapproche plus de ce qui pourrait éventuellement être accepté par l’institution comme artistiquement valable.
Restitution dans la cour du CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (20’35”-22’46”)
Lors de cette restitution, à un moment donné, une professeure du CNSMD est venue dans la cour pour manifester avec véhémence son désaccord avec ce qui était proposé et notamment le niveau sonore de l’amplification qui l’empêchait de faire cours.
En dehors de l’équipe de la FEM, partenaire du projet, aucune représentation de la direction du CNSMD n’était présente lors de cette restitution. Le directeur est pourtant très favorable au développement de ce type de projet.
3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon
Jean-Charles François :
Une journée de bilan du projet a été organisée au CNSMD de Lyon avec les personnes qui ont participé en tant qu’encadrants du projet et les étudiants de la FEM.
A) Réunion de bilan des encadrants de l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et du CNSMD de Lyon
La matinée a commencé avec une réunion de l’équipe d’encadrants, pendant que les étudiants et étudiantes se sont réunies séparément dans des petits groupes 4 ou 5 pour préparer ce qu’ils allaient dire lors de la séance générale de retour d’expérience. Étaient présents à la réunion de l’équipe : pour le Cra.p, Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne ; pour le CNSMD Karine Hahn, Joris Cintéro, Guillaume Le Dréau ; et moi-même, Jean-Charles François en tant qu’observateur extérieur pour PaaLabRes.
Voici en vrac les questions posées lors de la réunion :
- Quels sont les aspects formatifs du projet pour les étudiants et à travers quelles problématiques ?
- Quels sont les enjeux du projet ?
- Penser l’après projet : d’autres partenariats avec l’Orchestre National Urbain ou d’autres cadres ?
Les étudiantes et étudiants ont eu à se confronter de manière pratique à des enjeux musicaux pensés dans une continuité avec des contextes sociaux et politiques. Ils et elles ont dû manipuler, fabriquer des sons dans des situations de transversalité et de transdisciplinarité, c’est-à-dire en se confrontant à des matériaux musicaux inconnus, à envisager des pratiques impliquant plusieurs domaines artistiques simultanément, et à rencontrer des cultures différentes de leur environnement social et artistique. Leurs représentations esthétiques ont été remises en question par ces diverses approches. Les aspects pédagogiques du projet étaient centrés sur l’expérimentation de pratiques musicales ouvertes à tous et toutes quelles que soient les capacités, sur l’invention de dispositifs en vue de la rencontre avec l’altérité. Les deux questions essentielles ont été : comment faire faire de la musique ensemble avec tout public ? Et qu’est-ce que c’est exactement de monter un projet dans des lieux et des circonstances déterminés ?
Deux réflexions critiques apparaissent dans le cours de cette réunion :
- Le problème de la valse des étiquettes prévalentes dans chaque milieu culturel qui classifient une fois pour toute les pratiques, soit pour les porter aux nues, soit plus souvent pour les considérer comme non digne d’intérêt, soit encore pour les rationnaliser pour mieux les contrôler dans l’ordre dominant des choses. Comment dans les rencontres transversales, trans-esthétiques, envisager des situations où une certaine indétermination des matériaux va pourvoir faire émerger des terrains esthétiques nouveaux et communs aux diversités en présence ?
- Le problème du tourisme intellectuel et artistique est prévalent aujourd’hui dans beaucoup de programmes d’enseignement supérieur au nom de l’accès à la diversité du monde. Les expériences de cette diversité se multiplient dans le cours d’une formation sans qu’il y ait assez de temps pour approfondir les contours d’une seule situation. L’enrichissement culturel va souvent de pair avec une incompréhension des enjeux majeurs des diverses pratiques. Comment dans des situations de temps limités sortir de cette difficulté ?
L’Orchestre National Urbain a comme cahier des charges le « tutorat », il est ouvert en permanence à des demandes de formation et de développement de projets ou de lieux.
B) Bilan avec les étudiantes et étudiants du CNSMD
Chaque groupe d’étudiants présente tour à tour les conclusions de leur réflexion. Le groupe d’étudiantes et étudiants ayant été présent aussi à l’Université Lyon II prendra la parole en dernier. Dans l’ensemble la tonalité des retours est en très grande majorité très positive, les objectifs artistiques, sociaux et politiques d’une telle action sont bien compris et les mises en pratiques ont été vécues de manière significative. Voici les différents éléments qui ont été exprimés :
- L’idée de désacraliser l’instrument de musique. L’instrument n’est plus considéré comme une entité spécialisée, mais plutôt comme un objet comme un autre susceptible de produire des sons. L’accès immédiat de tous à la production sonore permet une mise en situation de tous les enjeux présents dans la pratique musicale, que ce soit du côté des techniques de production que des questions artistiques. La nécessité de produire une musique à partir de matériaux qu’on ne maîtrise pas au premier abord permet de sortir des logiques d’expertise et met tous les participants à un niveau égal de compétences. Pour un des étudiants, on est proche des démarches de l’art brut et de Fluxus. Cela devrait permettre les rencontres effectives entre participants d’origine différente. Les instruments bricolés (ou le bricolage des instruments) permettent d’envisager une façon différente de considérer la matière sonore, le timbre, l’utilisation de sons généralement considérés comme étrangers au monde de la musique.
- Déclamer un texte avec les instruments. Cet aspect est sans doute l’élément le plus difficile à réaliser pour des spécialistes de musique instrumentale. Le « Human beat-box » est vécu comme l’activité qui suscite le plus l’invention de matières sonores par le biais de simples rythmes.
- L’improvisation à partir de consignes simples à réaliser. C’est ce qui rend possible d’être maître de sa propre production. C’est un moyen de s’approprier l’improvisation de manière décomplexée. Cela crée une dynamique de la production immédiate découplée des préoccupations de ne jouer que ce qui est complètement maîtrisé.
- Les logiques de l’amplification sont ce qui est le plus mal connu des étudiants du CNSMDL, cette première approche a été très appréciée.
- Le rôle de la direction d’orchestre : il faut oser assumer ce rôle pour contrôler la forme générale d’une improvisation, dans les perspectives de construire une composition instantanée. Pour une partie des étudiants/étudiantes, la présence du chef est un obstacle à l’improvisation qui implique une responsabilité individuelle et demande à être abordée de manière moins urgente pour permettre l’établissement de dialogues sans passer par l’autorité du chef ou de la cheffe.
- L’idée de faire des choses immédiatement avant toute réflexion est un élément important des pratiques qui ont été proposées. Il y a l’urgence de se mettre à faire des choses sans se poser de questions, de faire ce qu’on ne maîtrise pas encore avant d’envisager les moyens à employer pour y arriver.
- Un aspect important du projet est d’encourager la participation du public, comme ce qui s’est passé à la fin du concert de l’Orchestre National Urbain (à l’Université Lyon II) où tout le monde s’est mis à danser dans l’amphithéâtre de l’Université.
Parmi les problèmes soulevés par le projet, certains ont noté une organisation du temps qui a paru parfois trop lente et parfois trop courte. L’ennui ou la frustration est à l’origine d’une certaine fatigue. Il y a une inquiétude au sujet de la notion de « travail », induit par cette situation d’immédiateté du faire qui peut instiller l’idée d’une dévaluation très forte de la notion d’art. Une étudiante fait part de sa frustration devant les niveaux d’amplification trop forts et l’absence de sons consonants, qui résultent en une grande fatigue chez elle. Plusieurs personnes ont noté l’absence de relations entre l’atelier de peinture et la musique.
Le problème de la restitution dans la cour du Conservatoire a fait l’objet d’un vif débat. La situation allait complètement à l’encontre de la culture dominante de l’institution vis-à-vis d’une grande exigence d’excellence dans toute prestation. En plus la restitution utilisait des moyens de production musicale très peu en usage au sein de l’institution, dans un style indéfini par rapport aux contextes en vigueur. Les niveaux d’amplification rendaient impossible d’ignorer cet évènement dans les moindres contours du Conservatoire. Les étudiants étaient donc placés devant l’obligation de faire quelque chose qui allait entrer directement en conflit avec la communauté alentour et qui risquait de les disqualifier. Beaucoup des participants se demandent si cette idée de restitution était vraiment nécessaire à la conduite générale du projet. Les étudiants ont dû faire face aux nombreux commentaires ironiques de leurs collègues présents à la restitution. Une phrase a été retenue à ce sujet : « Les ploucs de la cour ! ». D’autre termes avaient été prononcés comme celui de « dégénérés » aux connotations historiques plus inquiétantes. Une médiation était peut-être nécessaire auprès du public avant la restitution en vue d’expliquer la situation et son contexte pédagogique.
Joris Cintéro, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (22’50”-23’44”)
Dans les réponses apportées par les membres de l’encadrement du projet la nécessité de rendre public une activité peu commune dans les pratiques du Conservatoire reste d’une importance capitale, ce n’est pas une question générale qu’il conviendrait de balayer sous les tapis de l’anonymat, mais quelque chose qui a besoin d’être mise « sur la table » des réflexions actuelles sur l’art et de sa transmission à tous les publics.
Pour Giacomo la restitution au CNSMD n’était pas prévue au départ, mais l’impossibilité d’avoir tous les étudiants présents à Lyon II pour la restitution générale du projet a changé la donne. Il comprend la frustration des personnes présentes au niveau « art », mais il convient de déplacer le problème du côté de la légitimité des activités proposées. Pour lui, la question est de savoir comment les institutions d’enseignement de la musique vont mettre en place des dispositifs en vue d’ouvrir leurs activités à des personnes n’ayant aucun accès aux pratiques. Il fait remarquer que le problème le plus évident dans son travail au sein des diverses institutions dans lesquelles il développe ses projets, c’est l’attitude souvent négative des personnels de l’encadrement, professeurs, animateurs, travailleurs sociaux, etc. Ceux-ci défendent leur pré carré et ont souvent une attitude qui consiste à penser que les personnes placées sous leur autorité doivent se plier à leur propre mode de pensée. S’ils ne sont pas impliqués directement dans le projet, le déroulement du projet est fortement menacé. La connaissance effective d’un projet par l’institution d’accueil dans sa totalité est un élément essentiel pour commencer à faire vivre une idée.
Lorsque les animareurs culturels sont bien disposés envers les projets de l’Orchestre National Urbain, les choses se passent de manières très positives. Voici un exemple d’un commentaire de Khadra Hamyani, aide éducatrice au « Forum Réfugié », lors de la participation de jeunes réfugiés à un projet développé par le Cra.p à l’Université Lyon III en 2024 intitulé « Du Corps aux mouvements, du geste aux sons »:
Khadra Hamyani, extrait de la vidéo « Du corps aux mots, du geste aux sons » (2’37”-5’34”).
Karine Hahn rappelle qu’il y eu d’une part une visite de Giacomo l’année d’avant la réalisation du projet a été l’occasion de présenter en détail les contours et enjeux du projet, d’autre part une page de présentation du projet et de ses objectifs a été distribuée peu de temps avant sa réalisation. Dans un contexte où souvent les personnes impliquées ne comprennent pas de la même manière les termes d’un projet, ou même il peut arriver qu’elles comprennent exactement le contraire de ce qui est proposé, toute médiation semble peu utile pour éviter l’expression conflictuelle. Ce qui compte par contre, c’est l’affirmation par l’action d’une légitimité.
Joris Cintéro souligne la difficulté qu’ont les institutions à questionner par des enquêtes leurs propres manières de fonctionner, notamment en matière de recrutement des personnes présentes. La dernière enquête sur la composition sociale des étudiants du CNSMD de Lyon date de 1983[1], elle a montré qu’il y avait la présence de 1% d’enfants d’agriculteurs et 2,8% d’ouvriers, etc.
La question de la restitution s’inscrit dans les divers contextes de difficultés par rapport à l’administration générale des institutions et aux personnes qui y travaillent.
Une étudiante présente à l’Université Lyon II note qu’au début du premier jour, personne n’était présent disposé à travailler avec l’Orchestre National Urbain, il n’y avait pas eu de publicité de la part de l’institution d’accueil, pas de soutien. Il a fallu faire des efforts immenses pour rameuter 5 personnes disposées à s’impliquer.
Pour Giacomo, la résistance de l’Université dans ce projet est évidente, il n’y a pas de professeurs impliqués, rien n’avait été fait pour faciliter les choses. On a l’impression que parce que ça ne coûte pas d’argent, il faut que ça se casse la gueule. Le soir du premier jour se pose la question de savoir s’il convient de continuer le lendemain. La réponse est définitivement qu’il faut absolument continuer, il faut persister et jouer avec la situation.
Pour Joris, 5 ou 6 participants sur 29500 étudiants on est loin du compte dans le domaine de la culture.
Sébastien Leborgne décrit en détail le fonctionnement des Grandes Voisines, avec la présence de 415 réfugiés hébergés, beaucoup de femmes et d’enfants.
Karine décrit le démarrage aux Grandes Voisines : tout est prêt à 10 heures du matin, le setup technique est en place, l’équipe prête à travailler, mais personne n’est là pour participer. Mais cette préparation garantit d’être pris au sérieux, l’équipe est là, devant personne, avec le même sérieux que s’il y avait des gens présents. Petit à petit les gens passent par là, ça se met en branle, ça existe, ça marche de toute façon.
Dans le courant de l’après-midi, une vidéo de 11 minutes montre de manière fragmentée ce qui s’est passé aux Grandes voisines. Un des segments qui frappe particulièrement est un quatuor de trombones composé de trois enfants et une mère jouant et en même temps évoluant dans des mouvements corporels d’une grande cohérence collective.
Dans les diverses réponses aux préoccupations des étudiants par les personnes de l’encadrement du projet, on notera les choses suivantes :
- Concernant la question de la nécessité d’un faire immédiat rapidement mis en place, au prix d’un contrôle de qualité, Giacomo souligne que la plupart du temps, les projets qu’il mène dans les différents contextes se déroulent dans des temporalités très limitées, le passage du groupe est souvent éphémère. Ici le faire doit absolument précéder la théorie.
- La question du long terme est abordée en mettant l’accent sur l’existence du Cra.p comme centre de pratiques, comme lieu de formation permanente, avec aussi l’objectif de permettre à des personnes issues des quartiers défavorisés d’accéder à des programmes diplômants d’enseignement supérieur.
- Le choix des instruments utilisés fonctionne sur deux plans : d’une part, il faut permettre une première approche pratique de jeu sur des instruments réputés pour demander des années de travail ; jouer de manière immédiate du trombone et du violoncelle peut susciter l’envie d’apprendre à jouer ces instruments sérieusement. Et d’autre part donner aussi accès à des matériaux qu’on peut manipuler facilement au premier abord. Giacomo donne l’exemple de la guitare électrique à six cordes qui nécessite de montrer comment on en joue, alors que le « spicaphone », instrument qu’il a construit avec une seule corde donne un accès plus immédiat à une pratique effective.
Au sujet de l’accès de tout public aux pratiques musicales, Giacomo rapporte l’histoire d’une mère, lors d’une performance donnée par son fils, qui pleure en disant « je ne savais pas que mon fils pouvait avoir le droit de faire de la musique ». Dans des pans entiers de population, les gens pensent que l’accès à des pratiques artistiques leur est complètement interdit. La question des droits culturels est essentielle. Karine remarque le manque de lieux ouverts aux pratiques : où sont les espaces existant hors « formations structurées » ou écoles spécialisées dont l’accès est limité ? En dehors du Cra.p, il y a un manque crucial.
Photos du projet au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (13’08-13’56”)
Partie IV : Le projet de Création Collective Nomade
à l’Université Lumière Lyon II
4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II
Jean-Charles François :
La session du matin du 21 septembre 2023, se déroule au sein de l’Université Lumière Lyon II (sur les quais du Rhône) dans l’espace où sont exposées des œuvres d’art dans le cadre de la Biennale Hors Norme et dans le grand amphithéâtre.
Étant donné les difficultés rencontrées aux Grandes voisines, au dernier moment 20 réfugiés adolescents (tous masculins) du Centre d’hébergement du 1er arrondissement de Lyon ont pu venir participer à cette matinée et à la restitution du lendemain en fin d’après-midi. Ils ne pouvaient être là que pendant une heure et demie (10h.-11h.30) étant donné les règles strictes du Centre concernant les repas. Trois étudiantes et un étudiant du CNSMD étaient présents de manière volontaire. Des étudiants de Lyon II et des visiteurs de l’exposition de la BHN pouvaient participer aux ateliers, mais cela a été un phénomène très marginal. Giacomo m’a fait part de ce qui s’était passé la veille (le 20 septembre), où un certain nombre d’étudiants de l’Université Lyon II avaient participé aux ateliers, au gré de leur passage dans la salle d’exposition. Ceci malgré le fait qu’aucune publicité n’avait été faite auprès des étudiants. Leur participation dépendant de leur passage dans l’espace des activités et de leur intérêt éventuel pour ce qui était proposé.
C’est un aspect qui arrive souvent aux actions menées par Giacomo et l’Orchestre National Urbain : s’ils sont souvent invités officiellement à développer leurs projets dans une institution, des obstacles ne manquent pas de se manifester de la part des personnels internes à l’institution. Les raisons de ce manque de coopération s’expliquent soit parce que ce qui est proposé vient empiéter sur des prérogatives installées, soit qu’on ne voit pas d’un bon œil la présence de personnes étrangères à l’institution (ou à son public habituel). Dans tous les cas, l’attitude de l’Orchestre National Urbain est de s’installer dans un espace donné et de susciter l’intérêt des personnes qui s’y trouvent ou qui passent par là.
Voici les commentaires d’une étudiante de la Formation à l’Enseignement du CNSMD de Lyon qui a particpé à un projet similaire de l’Orchestre National Urbain en 2024 à l’Université Lyon III intitulé « Du corps aux mouvements, du geste aux sons »:
Marie Le Guern, étudiante en formation à l’enseignement, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (8’47”-9’07”)
4.2 Les ateliers
Jean-Charles François :
Étant donné le temps limité par la présence des jeunes réfugiés, l’organisation des ateliers a été limitée à 15 minutes. Cela permettait à 5 groupes de participer à 5 ateliers l’un après l’autre, puis un regroupement général des participants dans l’amphithéâtre de 15 minutes. Cette organisation n’a pas été complètement réalisée dans le temps imparti, chaque groupe n’a participer en fait qu’à 4 ateliers (parmi les 6 proposés) avant la séance dans l’amphithéâtre.
6 ateliers proposés étaient (comme au CNSMD):
a. Danse.
b. Violoncelle.
c. Trombone.
d. Beat box.
e. MAO.
f. Laboratoire sonore.
g. Peinture.
Ateliers à l’Université Lyon II (MAO, Human beat box, violoncelle, trombone), extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (23’58”-26’10”)
Les ateliers se déroulaient dans le grand espace de l’exposition BHN et dans deux espaces adjacents. Le principe était exactement le même que celui décrit plus haut, avec pratique immédiate des matériaux et utilisation des codes couleur. Il s’agit des mêmes mises en situation déjà décrites auparavant, inutile donc de les décrire en détail.
Du fait du temps limité et du nombre déséquilibré entre le groupe du Centre d’hébergement et les autres participants, peu d’interactions entre les différents publics ne pouvaient avoir lieu lors de cette matinée. Certains groupes n’étaient composés que de membres du groupe de réfugiés. Dans le cas de l’atelier peinture, j’ai pu observer une situation de deux grandes feuilles de papiers juxtaposées sur lesquelles dessinaient deux groupes complètement séparés : le premier groupe n’était composé que de réfugiés masculins noirs Africains, le deuxième seulement d’étudiantes blanches Françaises.
La situation de disponibilité limitée du groupe du Centre d’hébergement demandait absolument que la matinée soit centrée principalement sur l’accueil approprié et l’organisation des activités des réfugiés, les autres participants ayant eu d’autres opportunités de participer dans des temps plus longs à tous les ateliers et situations de performance en grand groupe. De ce point de vue, le dispositif proposé a remporté un très grand succès auprès du public visé. Les réfugiés se sont engagés dans les diverses mises en pratique proposées dans les ateliers avec un grand intérêt et une énergie considérable. Une des forces de l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p est la capacité à s’adapter de manière immédiate à toutes les situations possibles, à faire face aux aléas des réalités techniques, institutionnelles, humaines, à contourner tous les obstacles sans pour autant mettre les personnes dans la situation de ne pas respecter les règles clairement établies et sans compromettre la façon d’envisager leurs propres pratiques.
Atelier trombone à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’52”-27’54”)
4.3 L’atelier « Laboratoire sonore » dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II
Jean-Charles François :
Le regroupement de tout le monde dans l’atelier « Laboratoire sonore » animé par Giacomo Spica Capobianco dans le grand Amphithéâtre, dans une situation tout à fait similaire à celle décrite dans la journée du CNSMDL, a été l’occasion d’observer plusieurs nouveaux phénomènes. Si le système des codes couleur a très bien fonctionné pendant cette matinée comme élément commun à tous les ateliers, son utilisation dans le regroupement des diverses activités dans l’amphithéâtre a été moins évidente. On avait là affaire à des représentations culturelles différentes : on peut spéculer que contrairement aux étudiants du CNSMDL, les jeunes Africains avaient rarement fait l’expérience d’un travail avec un chef d’orchestre. La plupart d’entre eux jouaient sans prendre en compte les indications données par les codes couleur, le plaisir d’une activité très nouvelle les centrait sur leur propre production. Par contre, certains d’entre eux ont éprouvé un grand plaisir à se trouver dans le rôle du chef, dans l’idée de pouvoir en quelque sorte sculpter la pâte sonore. Dans le cas d’un très jeune réfugié qui a dirigé à deux occasions (sur les deux jours), on a pu observer un progrès certain dans sa manière de déterminer la forme de la prestation. Les pratiques visuelles de respect d’une organisation écrite ne sont pas forcément présentes dans les représentations qu’on peut avoir des pratiques musicales. Comment résoudre la rencontre de la diversité des conceptions de la communication orale (aurale) et de sa structuration éventuelle par des représentations visuelles ?
Laboratoire sonore à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (34’55”-35’15”)
A l’issue de cette matinée, Giacomo invite les réfugiés à revenir le lendemain pour la restitution à 17 heures (ils ne pourront rester au concert de l’Orchestre National Urbain car ils doivent impérativement être rentrés dans le Centre à 20 heures). Giacomo au vu des aspects très positifs de la matinée exprime en privé, l’idée qu’il faut absolument proposer au Centre d’hébergement de continuer à faire un travail régulier avec les jeunes résidents, même si le temps de résidence de toutes personnes dans ces centres reste très limité.
Guy Dallevet, Artiste plasticien, « La Sauce Singulière », Biennale Hors Normes, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’11”-26’50”)
4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II
Jean-Charles François :
La restitution du travail des divers ateliers a eu lieu le 22 septembre à 17 heures, dans le grand amphithéâtre de l’Université « Lumière », Lyon II.
La grande majorité des jeunes du Centre d’hébergement sont revenus, mais ils doivent impérativement être de retour avant 20 heures. Les mêmes 3 étudiantes et 1 étudiant du CNSMD sont activement présents. Un nombre indéterminé d’autres participants, étudiants de Lyon II ou visiteurs, observateurs sont aussi là, pas forcément en tant que participants aux performances. L’équipe de l’Orchestre National Urbain est là : Giacomo Spica Capobianco, Lucien 16s, Sabrina Boukhenous, Selim Penaranda, Odenson Laurent et David Marduel. Karine Hahn, Joris Cintero, Noémi Lefebvre et Guillaume Le Dréau sont présents représentant l’équipe de la FEM du CNSMD. Certaines de ces personnes faisant partie de l’encadrement du projet participent aussi de temps en temps aux performances. Guy Dallevet est présent en tant qu’animateur des ateliers de peinture et représentant la Biennale Hors Norme en tant que président de l’association organisatrice La Sauce Singulière.
8 groupes différents présentes 8 performances selon la même organisation de stations instrumentales des ateliers regroupés, la présence de chefs et cheffes qui tournent constamment, et le principe des codes couleur.
En observant le déroulement de cette restitution, plusieurs questions viennent à l’esprit. On peut se demander si une telle mise en situation devant un public a sa raison d’être ? Et ceci à la suite aussi de la restitution des ateliers dans la cour du CNSMD et de la question de présenter des choses imparfaites en gestation, de se mettre en porte-à-faux par rapport aux exigences du spectacle vivant professionnel. Il y a pourtant des raisons importantes à publier, à rendre compte ce qu’on fait : non seulement l’objectif principal des ateliers est directement lié à une pratique qui n’a de sens que dans une présentation publique, mais l’acte de rendre public une activité donnée détermine qu’elle n’est pas laissée dans le secret des salles d’atelier, qu’elle est offerte au regard critique de tous, il s’agit de mettre cartes sur table. C’est ce qui différencie l’éthique de l’enseignement du service public des possibles dérives sectaires du privé.
La restitution n’est pas la simple répétition du travail d’atelier. D’autres enjeux se font jour à cette occasion :
- L’idée même de présenter quelque chose en public recentre l’attention des participants sur la nécessité d’un engagement et d’une présence particulière sur scène.
- La répétition du même mais dans un contexte différent avec des enjeux plus étoffés change les conditions de la prestation et l’enrichit considérablement.
- La situation favorise aussi de manière subtile les rencontres et échanges entre les divers groupes en présence, parce que l’attention des performers est partiellement libérée des contingences purement matérielles.
Restent deux questions liées au dispositif des codes couleur :
- Est-ce que la situation d’un ensemble (orchestre ?) dépendant des instructions d’un chef est favorable à l’engagement personnel, ou bien est-elle l’occasion au contraire de se cacher dans la masse ?
- Les codes couleur peuvent empêcher la recherche d’autres solutions temporelles et organisationnelles, notamment dans la recherche de continuités de textures et de micro-variations.
Ces questions sont générales et ne s’appliquent peut-être pas de manière immédiate à un projet aussi limité dans le temps et impliquant des groupes aussi radicalement différents.
Voici un commentaire d’un jeune réfugié, Bouhé Adama Traoré, qui a participé au projet de l’Orchestre National Urbain en 2024 à l’Université Lyon III:
Bouhé Adama Traoré, extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (21’31”-22’12”)
Après la restitution et avant le concert de l’Orchestre National Urbain, un pot a été offert dans la salle d’exposition de la BHN, malheureusement sans la présence des jeunes réfugiés.
Partie V : Le cadre esthétique de l’idée de création collective
Karine Hahn, CNSMDL de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (18’43”-20’07”)
Jean-Charles François :
L’idée de création collective est au centre du projet de l’Orchestre National Urbain : pour que la création collective puisse devenir une réalité dans les groupes hétérogènes en termes d’origines géographiques, sociales et culturelles, il faut absolument éviter qu’un groupe particulier dicte aux autres ses propres règles et conceptions esthétiques. Il convient plutôt de trouver des contextes dans lesquels les différentes personnes présentes ne puissent pas se baser exclusivement sur leurs pratiques usuelles. Par exemple, les musiciens ou musiciennes accomplies (comme dans le cas des étudiants du CNSMDL) ne doivent pas utiliser leurs propres instruments, afin de se mettre dans une situation d’égalité vis-à-vis de celles et ceux qui n’ont jamais fait de musique. Et pour donner un autre exemple, les personnes issues d’autres sphères géographiques extra-européennes ne doivent pas utiliser des chants ou des modes de jeu provenant de leur propre tradition.
Joris Cintéro, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (28’50”-30’28”)
Joris Cintéro :
Plusieurs remarques peuvent être formulées à ce sujet. Tout d’abord, une première liée aux nombreuses « prises »[2] qu’offre le dispositif[3] aux participants et participantes particulièrement lorsqu’ils et elles n’ont pas l’habitude de jouer de la musique. Dans le cadre d’une intervention comme celle de l’Orchestre National Urbain et dans ces circonstances, on peut considérer que ce qui est prévu initialement, et notamment les ateliers, est constamment mis à l’épreuve[4] de ce qui arrive (des lieux peu adaptés, des personnes déjà présentes réticentes et bien entendu des personnes souhaitant participer quand ça leur chante). À ce titre, ce court moment montre à quel point ce dispositif parvient à surmonter l’« épreuve » de son public. En effet, la nature de l’instrumentarium (qui renvoie difficilement à un « connu » antérieur et aux effets symboliques qu’il peut véhiculer), l’absence de codes esthétiques préalables (qui suppose leur connaissance et/ou leur maîtrise), de manières de faire prescrites (tenir son instrument de telle ou telle manière) et la simplicité d’un code couleur accessible aux personnes voyantes permet à celles et ceux qui participent d’élargir, autant que possible, leur nombre, en cours de route et moyennant seulement la présentation du code couleur. Dans les circonstances d’un lieu où le passage des personnes semble être la norme (en dehors des enfants, peu de personnes semblent stationner à l’extérieur), la plasticité du dispositif constitue sa force principale.
Autre remarque, celle du « cadrage » du dispositif par les membres de l’Orchestre National Urbain. Je fais ici l’hypothèse qu’une des conditions de félicité de l’action des membres de cet ensemble repose sur un enjeu majeur de distinction vis-à-vis des autres acteurs en présence. Cet enjeu semble important dans la mesure où, s’il existe véritablement des tensions entre les résidents d’un lieu tel que les Grandes Voisines et les travailleuses et travailleurs sociaux y officiant (comme on l’apprendra à plusieurs reprises pendant la journée), l’Orchestre National Urbain a tout intérêt à marquer sa distance vis-à-vis des dernier.es, et ceci de plusieurs manières. Il m’a semblé, au moins dans les discours et dans les manières d’agir une volonté de se singulariser via le type de « culture » dont il est fait la promotion (qui s’oppose à la chanson française promue par le personnel des Grandes Voisines), dans les manières d’investir les lieux (sans grand succès), dans les manières de s’adresser à autrui (en manifestant une forme de convivialité, qui sans être surjouée, constitue une manière de faire de la totalité des membres de l’Orchestre National Urbain que j’ai pu observer).
Jean-Charles François :
Pourtant, dans l’espace d’exposition de la BHN à l’Université Lyon II, à un moment donné informel du matin s’est déroulé un évènement intéressant :
Était exposée dans cet espace une sculpture sonore fait d’instruments de percussion et d’objets métalliques divers actionnés par un système mécanique automatisé. La sculpture était capable de développer une musique très rythmée d’une durée de 45 minutes sans répétitions de séquences. Un groupe de 5 ou 6 réfugiés s’est placé devant cette sculpture et en même temps que la musique qu’elle déroulait ils se sont mis à chanter et danser des musiques qu’ils connaissaient de leur tradition, pendant une séquence d’une dizaine de minutes.
Cette situation suscite trois commentaires par rapport à l’idée d’éviter ses propres habitudes culturelles dans des perspectives de pouvoir travailler avec n’importe qui d’autres dans l’élaboration collective d’un acte artistique :
- Il s’agit d’une situation spontanée qu’il ne faut surtout pas empêcher.
- La situation implique la confrontation à égalité de deux pratiques esthétiques différentes (la musique produite par une machine, la musique traditionnelle des réfugiés Africains) pour produire un nouvel objet esthétique qui procède des deux et qui les combinent.
- Le principe de situations évitant les pratiques instituées dans différents groupes pour créer un contexte d’égalité devant l’inconfort de l’inconnu s’applique aux rencontres initiales entre groupes hétérogènes, mais n’exclut pas forcément d’autres situations pratiques qui peuvent se développer par la suite.
Jean-Charles François, percussionniste, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (31’10”-34’54”)
Conclusion
Jean-Charles François :
Dans une société de plus en plus fragmentée en microgroupes qui affirment leur identité de manière forte, souvent à travers la disqualification des autres, toute tentative de trouver des médiations entre des univers apparaissant comme incompatibles doit faire face à des difficultés assez considérables. Pourtant la clé de la paix sociale se trouve dans les actions qui mettent en présence dans un même lieu, dans une même temporalité, et dans la même tâche à réaliser, des groupes dont les différences sont radicalement opposées. Dans ce genre de situation, il ne s’agit pas de nier les identités, mais de les ouvrir à la possibilité d’accueillir des personnes extérieures en reconnaissant les termes de leur mode d’existence, de trouver les situations de travail qui réunissent les différences. Il ne s’agit pas non plus de créer des formes artistiques passe-partout, clé en main, qui contenteraient les exigences de tout public, dans un bonheur olympique universel. Il s’agit au contraire de confronter dans des rituels les conflits fondamentaux pour les rendre manifestes et les traiter dans des pratiques communes qui ne prétendent pas les résoudre, mais qui les mettent en jeu (en entrejeu) pacifiquement.
Les actions menées durant l’automne 2023 conjointement par le Cra.p et l’Orchestre National Urbain, le département de la FEM au sein du CNSMD de Lyon, et l’Université Lyon II dans le cadre de la Biennale Hors Norme, correspondent tout à fait à cet idéal de faire se rencontrer des mondes différents. Le dispositif imaginé pour y parvenir se base sur trois conditions qui se combinent : premièrement une manière de structurer les pratiques permettant un fonctionnement immédiat commun à toute personne présente : instruments, matériaux, domaines d’action, codes-couleurs ; deuxièmement, cette structuration permet l’ouverture sur une liberté individuelle : improvisation, textes ; et troisièmement les mises en pratique sont conçues en vue de mettre tout le monde sur un plan d’égalité : situations pensées hors des rôles spécialisés, avec l’impossibilité d’utiliser les savoir-faire techniques acquis.
Giacomo Spica Capobianco, artiste musicien, directeur artistique du Cra.p, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (36’48”-41’10”)
Ceux et celles qui se lancent effrontément dans l’aventure d’établir des points de rencontre entre des groupes humains qui soigneusement évitent de se côtoyer sont bien téméraires. Ils doivent inventer des moyens de mettre en œuvre des pratiques impliquant la prise en considération d’autrui en évitant toute violence, mais sans édulcorer la réalité des tensions qui sont en jeu. Ils doivent si souvent faire face à l’inertie des professionnels installés et parfois à des refus intolérables. Leur présence admirable dans le paysage culturel et artistique, trop rarement reconnue, est d’une très grande importance.
Restitution à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo (41’11”-46’10”)
1.Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
2. Cette notion, empruntée aux sociologues Christian Bessy et Francis Chateauraynaud décrit « la rencontre entre un jeu de catégories et des propriétés matérielles, identifiables par les sens (supposés) communs ou par des instruments d’objectivation » (1992, p.105). Elle est initialement utilisée pour étudier le travail d’estimation des commissaires-priseurs dont la tâche peut être réduite au fait de rechercher des indices permettant d’articuler la perception des propriétés matérielles des objets et l’évaluation de leurs qualités par référence à un espace de circulation – en l’occurrence le marché de l’occasion. Ramenée à la situation dont il est ici question elle permet de comprendre en quoi certaines propriétés matérielles du dispositif (instrumentarium, code couleur, disposition de la salle, qualité des matériaux etc…) favorisent l’engagement des participant·e·s dans le sens où elles ne font pas obstacle à leurs dispositions physiques et perceptives – et qui permet d’expliquer, au moins dans un premier temps, les difficultés que rencontrent les « musicien·ne·s » vis-à-vis de ces mêmes propriétés matérielles.
3. Considérant le dispositif comme un « objet-composé » (Dodier et Stavrianakis, 2018), le terme ne décrit pas seulement ici l’agencement matériel du dispositif mais également le réseau d’individus, de normes et de rôles sociaux qui y sont attachés (les participant·e·s font ainsi partie intégrante du dispositif).
4. Si l’usage du terme « épreuve » peut tout à fait renvoyer à l’usage commun que l’on en fait, je l’utilise ici dans le sens qu’y investit la sociologie dite pragmatique (Lemieux, 2018), qui la définit comme « un moment au cours duquel les personnes font preuve de leurs compétences soit pour agir, soit pour désigner, qualifier, juger ou justifier quelque chose ou quelqu’un » (Nachi, 2015, p.57). Ici, je considère que ce qui est engagé par le dispositif (la crédibilité de l’Orchestre National Urbain, les enjeux artistiques et sociaux portés par les ateliers etc…) est mis à l’épreuve de sa réalisation, même si l’on peut tout autant considérer le dispositif comme une épreuve permettant de (re-) qualifier les individus qui y participent.
Références citées :
Bessy, C., & Chateauraynaud, F. (1992). Le savoir-prendre. Enquête sur l’estimation des objets. Techniques & Culture, 20, 105 134. https://doi.org/10.4000/tc.5029
Dodier, N., & Stavrianakis, A. (Éds.). (2018). Les objets composés : Agencements, dispositifs, assemblages. Éditions de l’EHESS.
Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
Nachi, M (2015). Introduction à la sociologie pragmatique. Dunod.
Conte/Conte2
Le Conte du « Conte »
Louis Clément, Delphine Descombin, Yovan Girard, Maxime Hurdequint
Textes édités et mis en page : Jean-Charles François
Mars 2024
Les quatre protagonistes ont collaboré à un spectacle « Le Conte d’un futur commun », avec :
Louis Clément, initiateur du projet, participation du public et animation des dessins.
Delphine Descombin, conteuse.
Maxime Hurdequint, dessins.
Yovan Girard, musique.
Les textes sont le résultat de quatre interviews séparées de chaque artiste réalisé en 2023 par Nicolas Sidoroff et Jean-Charles François.
Sommaire :
1. Le récit de Delphine.
2. Les études d’architecture, Louis et Maxime.
3. Le voyage en Afrique de Delphine.
4. Yovan Girard, le musicien.
5. Le retour en France de Delphine.
6. Les hésitations de Maxime entre architecture et dessin.
7. Le récit de Yovan (suite).
8. Le récit de Delphine (suite). Trapèze et conte.
9. Les récits de Louis et de Maxime (suite).
10. Le récit de Yovan (suite), le projet « Un violon pour mon école » (suite).
11. Delphine, le Conte du crâne et du pêcheur.
12. Le petit carnet des arbres. Maxime Hurdequint, Maxime Touroute et Louis Clément.
13. Le récit de Delphine (suite). Le Conte du petit poucet.
14. Delphine et le conte. Maxime, l’architecture et les dessins. Yovan et la composition.
15. Le Live Drawing Project.
16. Delphine : Deux contes.
17. Origine du « Conte d’un futur commun ».
18. Le projet immersif de l’AADN.
19. Le « Conte d’un futur commun ».
20. Louis, une année de réflexion.
21. L’écriture du Conte, Delphine et Louis.
22. Les dessins et leur animation. Louis et Maxime.
23. Une musique traditionnelle du futur ?
24. L’élaboration de la musique. Musique pré-enregistrée ou musique en direct. Louis et Yovan.
25. La musique et le conte, Delphine et Yovan.
26. La musique et le conte, Louis et Yovan.
27. Les conceptions de Yovan sur la musique et de Maxime sur les dessins.
28. Le conte et les dessins. Delphine, Maxime et Louis.
29. La sonorisation.
30. Communication par Notion.
31. Les résidences : LabLab, Chevagny, Vaulx-en-Velin, Enghien-les-Bains.
32. La participation du public.
33. La résidence d’éducation artistique et culturelle à Hennebont. Louis, Delphine et Yovan.
34. Les résidences (suite) : Paris, Nantes.
35. Écologie. Delphine.
36. Conclusion.
1. Le récit de Delphine
Delphine :
D’où vient le conte ? C’est par le conte, du coup, qu’on vient au Conte… Le Conte vient de quand j’étais au lycée et j’ai rencontré Marie Jourdain, qui est la fille de Marie-France Marbach[1].
Au lycée, j’étais en internat, elle me racontait des histoires tout le temps. J’ai rencontré sa mère et Geo Jourdain. Et j’ai adoré ces gens, qui étaient complètement différents de ce que j’avais moi comme référent dans ma famille. C’est eux qui m’emmenaient à l’école, à l’internat le dimanche soir et qui me ramenaient le vendredi soir. Et je passais énormément de temps avec Marie, qui m’a parlé de l’Afrique, qui m’a raconté plein d’histoires. Et à la suite de ça, j’ai quitté le lycée, je suis partie en Afrique. Là, j’ai entendu plein d’histoires, plein de contes. Et puis, quand je suis revenue d’Afrique, Marie-France voulait absolument que je raconte mon voyage. Et je ne voulais pas, je ne voulais pas parler, je n’étais pas prête du tout à parler devant les gens. Elle me prenait par surprise, et je venais beaucoup voir ses spectacles. Elle m’a offert des stages, elle a vraiment cru en moi, alors que moi-même, je n’y croyais pas vraiment. Donc je suis restée très en lien avec Marie-France.
L’internat, c’était à Louhans, c’était une école d’arts plastiques. C’est le seul lycée qui a bien voulu de moi, parce que j’avais de très mauvaises notes et je ne suivais pas du tout l’école. C’est ma tante qui a trouvé ce lycée qui a bien voulu m’accepter. Je restais dehors, je n’allais pas dans les cours. J’étais à l’internat, mais je restais dehors. J’étais sous les arbres, j’écoutais les oiseaux, je n’avais pas du tout envie de m’enfermer en classe. Souvent, le directeur me convoquait et on avait des discussions tout à fait philosophiques, très intéressantes. Donc il m’avait fait intégrer le cours de philosophie des premières ! Après, il me demandait ce que je voulais faire plus tard, je lui disais : « Je ne sais pas, peut-être m’occuper de chèvres, peut-être… ». Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais c’étaient des questions importantes que personne ne m’avait posées. C’est vrai que j’ai eu la chance de tomber sur de belles personnes. Et les cours d’arts plastiques me plaisaient beaucoup. Il y avait deux profs d’arts plastiques qui étaient super, qui nous emmenaient à Lyon voir des expos, on est même allé à Strasbourg voir des musées, c’était vraiment super. J’assistais à ces cours, c’étaient des créations que je faisais. Pour le reste des cours j’avais vraiment un rejet, ouais, ils m’ennuyaient beaucoup. Donc c’est pour ça qu’après, j’ai pris mon sac à dos et j’ai eu envie d’aller en Afrique. C’est un voyage qui a duré assez longtemps, je me suis arrêtée en chemin, je n’avais pas du tout d’argent. J’ai travaillé comme saisonnière dans des hôtels-restaurants, je faisais du service, et ils me logeaient en même temps. J’ai vendu des croissants, j’ai travaillé dans des boulangeries, j’ai fait toutes sortes de jobs. Et puis après, j’ai rencontré quelqu’un dans la rue qui crachait du feu, qui m’a appris à cracher du feu. Ça a été mon premier vrai métier : je crachais du feu et puis je faisais la manche. En fait, je faisais des bulles devant la boulangerie, je racontais de la poésie. J’arrivais toujours à trouver quelque chose à faire, mais je détestais tout ça, je trouvais ça insupportable.
2. Les études d’architecture, Louis et Maxime
Louis :
Mon parcours commence le 23 décembre 1986. Je ne sais pas jusqu’où je remonte, mais je pense que mes parents ne sont pas étrangers à ce qui m’a façonné. Je pense que si on remonte très loin, on va dire que ce qui m’a façonné, c’est la découverte de la lecture, et après surtout la lecture de ce qu’on appelle l’imaginaire, tout ce qui touche à la science-fiction, fantaisie, etc. Et d’un point de vue plus professionnel ou en tout cas dans mes études, j’ai passé un bac S, après j’ai fait des études d’architecture à Paris-Val de Seine et j’ai obtenu un diplôme. À partir de la fin de ma licence, j’ai commencé à me dire que l’architecture ça ne devait pas vraiment être pour moi. En fait, j’avais l’idée un peu utopiste déjà à l’époque que devenir architecte allait me permettre de concevoir des espaces pour que les gens s’y sentent bien et surtout que ça puisse les aider à réfléchir, à changer le monde, etc.
Maxime :
Mon cousin, Louis Clément a également fait des études d’architecture. Avec Louis, on a un an d’écart et en fait, on ne s’est pas spécialement concerté, on est parti sur cette voie séparément. J’étais à l’INSA à Strasbourg et lui au Val de Seine à Paris, on a poursuivi notre chemin comme ça, séparément. C’était une période de notre vie où on se voyait moins, mais on parlait un petit peu d’architecture.
Louis :
Et après je me suis confronté au Master et aux réalités de la construction, du fait que, si tu deviens architecte, tu deviens surtout constructeur. Tu bosses dans des boîtes plus ou moins de grande échelle, et au final, ton travail est extrêmement déterminé par des considérations budgétaires. Et du coup, je me suis dit que ça allait moins m’intéresser. J’ai quand même fait ma première année de Master à Anvers, ça s’est plutôt bien passé, et je commençais à me dire déjà que j’allais m’orienter du côté du spectacle, enfin de la scénographie, etc. Et après, en deuxième année de Master, j’ai un peu volé mon diplôme, mais je l’ai eu quand même, j’étais assez content de moi. Et puis j’ai eu la chance de travailler pour un architecte, alors j’ai fait mon stage de Master chez « Scène scénographie », un truc très bien. On a travaillé sur la scénographie du Musée d’Alésia, de la Grotte Chauvet II, donc j’ai eu la chance de compter les stalactites pendant des heures et des heures, c’était très intéressant ! Intéressant mais voilà… C’était marrant en tout cas de travailler sur de beaux projets.
Maxime :
En fait, pendant la terminale, je me suis présenté dans une école d’architecture, peut-être Lyon ou Grenoble, je suis arrivé les mains dans les poches en me disant : « Architecte, c’est un métier qui s’apprend, je ne vais pas apprendre avant quoi ! » Je me suis rétamé et ma seule option, c’était d’aller en classe préparatoire. Donc, je me retrouve en première année de classe préparatoire.
Louis :
Et après, quand j’ai commencé à travailler en tant qu’architecte, j’ai été pris chez François Pin, un architecte qui a également un festival de musique dans les Carrières de Normandoux[2], et qui a monté la Marbrerie à Montreuil. J’ai bossé sur le projet de la Marbrerie, ce qui était l’un des projets les plus gros, les plus intéressants que j’aurais pu faire en tant qu’architecte : c’était un truc multiprogramme, où il y avait une résidence d’artistes, une piscine, un restaurant, une agence d’architecture, une salle de spectacles et en plus j’étais chargé d’en faire les esquisses. Donc j’aurais pu vraiment m’éclater et je suis resté quasiment six mois. En fait, ça ne m’éclatait pas du tout, donc je me suis dit que si ça, ça ne m’éclatait pas, eh bien, je ne voyais pas ce que je faisais encore en architecture, parce que, je pense, je n’aurais pas pu trouver un projet plus intéressant.
Maxime :
Avec Louis, mon cousin, on s’influence mutuellement, peut-être parce qu’on se connaît très bien. C’est-à-dire que quand on a grandi, on s’est quand même vu très régulièrement, on ne s’est jamais vraiment perdu de vue. Donc c’est toujours une relation fluide entre nous, on ne s’engueule pas, on n’en a pas besoin en fait. Je pense qu’on s’ajuste parfaitement, donc c’est ça l’influence. J’imagine aussi que, comme on a tous les deux une formation d’architecte, on parle le même langage, ça nous aide à communiquer quand il y a certains concepts. Je n’ai pas besoin de lui expliquer tel ou tel projet d’architecture.
3. Le voyage en Afrique de Delphine.
Delphine :
J’ai bien mis un an, de 17 à 18 ans, pour récolter l’argent pour mon voyage en Afrique. J’ai fait les saisons d’été, les saisons d’hiver. De toute façon, ma mère n’acceptait pas de me laisser passer la frontière. Donc, à 18 ans, je passais pile la frontière d’Espagne. À 18 ans, je ne craignais plus d’en être empêchée par la police. En fait, je me suis déjà fait arrêter dans des commissariats de police et ils me suivaient, ils suivent les gens qui sont dans la rue, ils ont leurs photos et ils savent où ils sont. Ils savaient que j’étais dans la rue, c’est drôle, ça, parce qu’ils ne le savaient pas tant qu’ils ne m’avaient pas arrêtée.
Je suis descendue jusqu’en Espagne. J’ai pris le bateau à Gibraltar, je suis arrivée au Maroc et puis je suis descendue en Mauritanie, j’ai continué jusqu’à Dakar, au Sénégal. Et après, je voulais absolument aller au Burkina Faso, parce que j’avais rencontré des Burkinabés en France, je voulais vraiment les rejoindre, c’étaient des danseurs et des percussionnistes. J’ai donc pris le train pour Bamako, au Mali où j’ai repris un autre train pour Ouagadougou au Burkina Faso, en 48 heures de train, c’est très long. Et après, je suis allée jusqu’à Koudougou, ils habitaient là-bas. Je suis restée là-bas un an et demi.
Il y a eu un moment en Afrique où je me suis demandé ce que je faisais là : à quoi ça sert que je sois là ? J’étais blanche, alors, l’air de rien, je n’avais pas l’air de vivre là – pourtant je n’étais pas une touriste ! – mais quand même, j’étais là, je n’avais pas grand-chose à faire là, je pouvais simplement me laisser vivre, vivre avec les gens, mais j’avais l’impression d’être en face d’un dilemme dans ma tête. On avait de grandes discussions, c’était super chouette ce que j’ai vécu intellectuellement. Par exemple, au Burkina Faso, on était là à boire du thé et à discuter. Ce sont vraiment des intellectuels très intéressants, mais ce ne sont pas les mêmes intellectuels qu’en France, on ne vient pas de la même chose. Et j’avais un manque vital de pensée intellectuelle occidentale. C’était aussi le manque de livres, de cette nourriture-là, j’en manquais beaucoup. Et en plus, pour moi ça manquait de sens : là-bas, il y avait beaucoup de problèmes, c’est-à-dire qu’ils n’arrivaient pas à vendre leur blé parce qu’il y avait beaucoup de concurrence, il y avait des problèmes sociétaux.
Et je me rappelle une fois, j’étais dans le désert et j’entends un gars avec une toute petite radio et qui me dit : « Oui, je crois que dans ton pays, ça ne va pas très bien, il y a un monsieur qui va se faire élire. » En fait, c’était Le Pen, Le Pen contre Chirac, à l’époque. Et je me rappelle m’être dit : « Mais qu’est-ce que je fais là, alors que c’est peut-être là-bas qu’il y a la base du problème ». Tout était beau, le paysage est magnifique, la température était belle, je pense qu’il y a là-bas une manière de vivre qui est vraiment chouette par rapport à ici. Et en même temps, je me disais : « Moi, ce n’est pas ma place ici, qu’est-ce que je fais là ? » C’était un peu un dilemme. C’est pour cela que je suis revenue car ça n’avait plus de sens pour moi d’être là-bas.
Moi, ça m’a sauvé la vie de partir là-bas, ça m’a sauvé la mise. Quand j’étais en France, les gens disaient que j’étais folle, ma famille disait que j’étais folle, enfin j’étais vraiment un peu perdue. Et quand je suis arrivée en Afrique, il y avait cet esprit de famille, quelque chose de tout à fait naturel, je trouvais ça hyper sain, hyper normal. J’avais beaucoup de mal en France, et c’est vrai qu’en Afrique ce n’était pas le cas. À mon retour en France, à Montceau-les-Mines j’ai pu vivre avec une bande de copains, ça a été pour moi une famille, c’est ce que je n’avais pas. Et c’est vrai que cette bande de copains, je l’ai toujours.
4. Yovan Girard, le musicien
Yovan :
Je suis musicien depuis longtemps. Je suis violoniste à la base, donc j’ai une formation classique et de jazz. Je suis issu d’une famille de musiciens, mon père, Jean-Luc Girard, est compositeur, il a écrit pas mal de pièces, on va dire classiques, mais qui sont toujours un peu hybrides. J’ai l’impression de suivre ce chemin-là aussi, dans le sens où il écoutait aussi beaucoup de rock, et il écoutait ce qu’on jouait. Il aimait bien les compositeurs un peu extraterrestres, les Frank Zappa (je n’aime pas particulièrement Zappa), il nous a toujours fait écouter plein de musiques différentes, ce n’était pas un ayatollah du jazz ou du rock, il était assez ouvert d’esprit. Mon frère, Simon Girard, est tromboniste, et nous avons toujours joué ensemble. Simon et moi on a eu un groupe, et on a joué ensemble dans pas mal de groupes. Simon est beaucoup dans le jazz, même s’il a joué dans des groupes de musiques actuelles. Je connaissais Louis Clément depuis notre petite enfance. Les parents de Louis et mes parents se connaissaient très bien depuis longtemps.
5. Le retour en France de Delphine
Delphine :
Je suis rentrée en France et j’ai atterri à Montceau-les-Mines, c’est là où je me suis arrêtée longtemps. Déjà, je suis tombée amoureuse d’un garçon qui était tailleur de pierre et peintre, je suis restée vivre là avec toute une bande de copains dans une maison avec des matelas par terre. Le problème, c’est que, quand on s’installe et qu’on devient sédentaire, c’est là où l’on devient vraiment pauvre, parce qu’il faut payer un loyer, payer l’électricité, payer l’eau. Avant cela, je n’avais jamais eu le sentiment d’être pauvre. Mais là, c’était vraiment une réalité, je n’avais pas une thune et il fallait vivre.
Scène 1 : avec l’assistante sociale
|
Une assistante sociale : Je te propose faire une formation qui s’appelle IRFA-Bourgogne[3]. Delphine : De quoi s’agit-il ? L’assistante sociale : C’est une formation où on essaie plusieurs jobs, enfin, on essaie plusieurs corps de métiers qu’on choisit, on démarche des boîtes. Il y a une vingtaine de personnes dans cette formation, il y en a peut-être qui travaillent dans les pompes funèbres, d’autres dans la mise en rayon, dans un centre d’appels téléphoniques, il en y a qui font du ménage, de la blanchisserie… Delphine : … c’est tous des trucs qui ne me conviennent pas ! Je ne me vois pas faire ça. L’assistante sociale : Tu sais, il y a peut-être aussi d’autres trucs que ça, tu peux aller voir, je ne sais pas s’ils vont t’embaucher, mais tu peux aller voir… Delphine : Je vais essayer l’Atelier du Coin[4] de Montceau et le Gus Circus de Saint-Vallier[5]. |
Scène 2 : au Gus Circus
|
Un gars du Gus Circus : Bonjour Delphine. Delphine : Tu veux bien devenir mon ami ? Un gars du Gus Circus : Oui. Viens, tu fais du fil, tu jongles, tu peux venir tous les jours quand tu veux, la porte est toujours ouverte. Delphine : C’est bien, je vais pouvoir m’entraîner, ça me plait beaucoup. Un gars du Gus Circus : Tu sais, le Gus Circus ne veut embaucher personne. Delphine : Ça ne fait rien, je vais tout de même rester, ça va aller, ça me convient bien. J’ai déjà une fibre comme ça, dans la rue j’ai craché du feu, j’ai jonglé avec des balles. |
Delphine :
Donc ils m’ont embauché en contrat aidé, ça a été mon premier emploi, mon premier contrat à long terme, sur six mois. Et puis après, je suis restée à donner des cours aux enfants pendant à peu près trois ans. Je crois qu’ils ont renouvelé une fois le contrat, c’étaient des contrats aidés pour les associations, un truc pas cher, remboursé à 80% par l’État, donc ils pouvaient le faire. Et puis après, ils m’ont vraiment embauchée parce qu’avec une personne de plus pour travailler, cela voulait dire plus d’enfants, donc ça roulait. J’ai donc bossé au Gus Circus de Saint-Vallier pendant… Je ne sais même pas combien de temps.
On travaillait toutes les disciplines : le clown, le fil, le trapèze, la jonglerie. J’ai passé le diplôme, le BIAC[6] [Brevet d’initiation aux arts du cirque], pour enseigner les arts du cirque. Et puis après, l’association a implosé de l’intérieur. En fait, c’étaient des parents d’élèves qui étaient les patrons et ça s’est très mal passé, il y a eu des conflits d’intérêt, des conflits de pouvoir. Comme on était salariés, on ne pouvait rien dire, c’était leur décision, et du coup, ça a explosé, donc on est parti, mon ami et moi. Je me suis lancée dans une formation professionnelle de trapèze à Moux-en-Morvan, avec une trapéziste complètement folle, Nicole Durot[7], qui faisait des performances sous hélicoptère, sous montgolfière, enfin du trapèze sans sécurité. Elle a 60 ans, hein ! quand elle m’a pris en formation, elle faisait encore ce genre de truc, c’était une warrior. Je suis restée six mois chez elle en formation intensive.
6. Les hésitations de Maxime entre architecture et dessin.
Scène : la rencontre de Maxime avec le Vénérable Membre du Grand Conseil.
|
Le Vénérable Membre du Grand Conseil : Maxime, après cette année en classe préparatoire, comment vois-tu ton avenir ? Maxime : J’ai suivi le programme très sérieusement et je m’en suis tiré de façon honorable, mais maintenant je me pose des questions. Le Vénérable : Qu’est-ce qui t’intéresse ? Devenir ingénieur ? Maxime : Ah non ! je ne veux pas être ingénieur, ça ne m’intéresse pas, ce n’est pas ce que j’ai envie de faire, en fait je crois que je veux vraiment être architecte. Le Vénérable : Tu as fait du dessin ? Maxime : Comme tous les enfants, j’ai dessiné et je pense que j’ai été un peu encouragé. Le Vénérable : Peux-tu me montrer tes dessins ? Maxime : Oui, voilà. Le Vénérable : Ils sont bien tes dessins. Maxime : Le dessin a suffi à me motiver et à continuer. Je sais que mes frères dessinaient très bien, mais je ne sais pas pourquoi, il se trouve que moi, ça m’a poussé et donc j’ai persisté. Et c’est vrai qu’étant enfant, mes parents m’ont inscrit à une école de dessin, et je pense que, éventuellement, ça ouvre quand même des portes. J’allais à cette école tous les mercredis pendant une heure, et le professeur donnait des idées de dessin, ce que j’aimais bien, c’est ce qu’il disait. Le fantôme du professeur de dessin : Voilà, je ne sais pas, vous allez dessiner des personnages, et vous allez faire en sorte que les pieds touchent le bas de la feuille, la tête le haut de la feuille. Maxime : En fait, ça faisait penser aux frises grecques ou égyptiennes, et du coup, j’aimais bien cette idée de fixer une règle du jeu assez simple, et après, on y allait, et on voyait que les résultats étaient tous différents. Donc je pense que c’est ce que j’ai retenu, c’est que, voilà, on se fixe une règle vraiment totalement arbitraire, et elle vient amener plein de résultats possibles. Aujourd’hui, j’aimerais peut-être bien faire les art-décos, il y a des sections illustrations. Le Vénérable : C’est une alternative possible. Oui ça peut être bien pour toi de te diriger vers l’architecture. Quelqu’un qui passait par là : Oui ça peut être bien pour toi de te diriger vers l’architecture. Une dame : Oui ça peut être bien pour toi de te diriger vers l’architecture. Maxime : Effectivement, je pourrais partir dans cette voie-là. Le Vénérable : Ça serait bien pour toi. Tu pourras continuer à dessiner pendant tes études d’architecture. Maxime : Je n’abandonnerai jamais le dessin, mais je ne le prends pas trop au sérieux, je n’imagine pas faire carrière dans ce domaine. C’est un truc que j’aime bien faire, j’aime bien me voir progresser, j’aime bien le regarder, j’aime bien le partager, mais je ne le prends pas assez au sérieux. L’architecture est quand même assez proche du dessin. Le Vénérable Membre du Grand Conseil : En fait, on peut vraiment être un excellent architecte sans savoir dessiner. Après, c’est intéressant de savoir dessiner pour communiquer ses idées. Donc on peut finalement mal dessiner, mais bien savoir dessiner ses idées. Après, bien dessiner, ça peut quand même servir en architecture. Maxime : Oui, je pense que ça va m’aider, je ne serais peut-être pas le meilleur, mais je pense que c’est bien que je sache dessiner, ça va être un plus pour l’architecture. Le Vénérable : Il ne faut pas se faire d’illusions, finalement, assez vite, on passe sur l’ordinateur et puis ce n’est plus nécessaire de dessiner. Maxime : Ah ? Le Vénérable : Ben voilà, il existe une voie de contournement à l’INSA de Strasbourg, le recrutement se fait après un an seulement de classe préparatoire et ils ont un programme d’architecture. J’ai une collègue qui a son fils qui fait ça, appelle-le ! Maxime : Bingo ! Je vais le faire, si je rentre dans cette école, je n’aurais pas perdu un an et en fait, je pourrais être avec des gens comme moi qui ont choisi cette voie-là. Le Vénérable : L’INSA de Strasbourg a été fondée pendant la période allemande (1870-1918) et du coup, à cette époque-là, les Allemands ne faisaient pas de distinction entre architecte et ingénieur. Cette école a donc une tradition d’école d’ingénieurs, mais elle forme aussi des architectes, c’est quelque chose qu’ils ont voulu garder. Il y a 50 architectes qui sortent tous les ans, je crois que maintenant il y en a un petit peu moins. Pendant les premières années, le cursus est beaucoup plus axé sur l’ingénierie, donc le génie civil et après le génie thermique. Maxime : Je n’ai pas une volonté particulière pour aller dans cette direction. Le Vénérable : C’est une occasion à saisir. Maxime : Oui, et ça va me permettre d’être en dehors des écoles classiques. |
Maxime :
Après mes études d’architecture à l’INSA, j’ai travaillé à Strasbourg et je suis arrivé à Paris où j’ai travaillé pendant 8 ans. Entre-temps, j’avais fait des expériences à l’étranger, un stage au Danemark, un au Mexique. Puis j’ai travaillé deux mois à Tokyo au Japon, parce que c’est une culture que je voulais vraiment découvrir. Je me suis lancé, j’ai envoyé des CV et ils m’ont dit, « Ben vas-y, viens si tu veux ». J’avais déjà peut-être deux ou trois ans d’expérience, ils m’ont pris à l’essai pendant deux mois mais après il n’y avait pas la place pour rester. Je suis donc revenu, mais c’était une très belle expérience.
7. Le récit de Yovan (suite)
Yovan :
Le jazz, mon frère et moi, nous a un peu reliés. Et après la pratique du jazz, je suis allé un peu beaucoup vers les musiques actuelles parce que j’aime bien composer. Je suis dans un groupe de rap qui s’appelle Kunta, rap et musique éthiopienne, avec plusieurs instrumentistes. Avec Kunta, je joue du clavier et je rappe en anglais. En fait, je faisais un petit peu de rap de mon côté depuis longtemps et j’avais du mal à imaginer à la fois jouer du clavier et rapper. Maintenant, je le fais dans certains projets de temps en temps, mais au départ, je ne voulais pas trop mélanger les deux, c’était un peu comme deux personnalités différentes. Je jouais du clavier parce qu’on en avait besoin dans le groupe. Je me suis mis à jouer sur des gammes de musique éthiopienne, ce qu’il fallait jouer au clavier n’était pas très compliqué. Maintenant je fais vraiment les deux de manière égale, clavier et voix.
J’aime bien faire plein de musiques différentes, en fait, je ne suis pas fermé. La musique à l’image j’en avais déjà fait pas mal, notamment la musique d’un court-métrage d’un ami, Pierre Raphaël. C’est un peu comme ça que j’ai commencé. Ensuite j’ai fait la musique d’un spectacle, une version de Cartouche un peu modernisée. J’ai toujours composé depuis longtemps, ce qu’on appelle de la prod chez moi sur mon séquenceur avec des claviers, des plugins, ce que « ma génération » entre guillemets fait en home studio, faire des instrumentaux, rapper dessus, mais aussi faire des couplets, parfois des trucs plus chantés, tenter des choses, en fait faire de la musique à la maison. Ouais, voilà, ce qu’on appelle la bedroom music. J’ai toujours fait ce genre de choses, que ce soit du rap ou de la pop, j’aime bien expérimenter parce que j’écoute pas mal de trucs différents.
 |
|
Le poste de travail de Yovan
Photo: Nicolas Sidoroff
Scène 1 : Yovan avec un metteur en scène[8]
|
Le metteur en scène : Je te propose de faire la musique sur un recueil de poèmes de Rimbaud. Tu pourrais jouer du violon. Yovan : Je propose que ce soit du violon seul, sans effets, j’aime bien l’idée que ce cela soit le plus simple possible. Le metteur en scène : J’insiste pourtant pour qu’il y ait aussi des effets sur certains passages, où j’entends des couleurs différentes. Yovan : Je vais faire ce que tu me demandes. J’aime partir d’une idée simple, composer pour un projet, mais sans m’occuper du live, parce que si on doit mettre en live ce qu’on a déjà composé à la maison, c’est toujours compliqué, à moins de composer pour un groupe. Le metteur en scène : Je voudrais pourtant que tu fasses tout de suite le multi-instrument (violon et effets électroniques) sur scène. Yovan : Ça m’angoisse un peu. Non, je préfère ne jouer que du violon. Je vais écrire une pièce pour violon solo, sans rien d’autre, plutôt que de devoir tout de suite m’engager dans le couteau suisse. Le metteur en scène : J’ai pourtant besoin de ces changements de couleur à certains moments. Yovan : OK, je veux bien, je vais le faire parce que tu me le demandes. Mais je vais juste prendre un delay et une disto, parce que ce sont des effets que je connais bien, qui font deux trucs différents et qui peuvent être utiles. |
J’ai aussi composé de la musique pour les arts numériques, par exemple pour un artiste numérique qui s’appelle Minuit, Dorian Rigal[9], il fait des projections murales et pas mal de choses d’immersion. Il est aujourd’hui très demandé partout, notamment à la Fête des Lumières à Lyon. J’avais déjà fait de la musique illustrée pour sa scénographie. Et du coup, le projet du « Conte d’un futur commun », c’est un petit peu dans la continuité de tout ça, de faire de la musique à l’image, enfin de la musique de spectacle.
Scène 2 : au début du projet du « Conte d’un futur commun », Louis et Yovan
|
Louis : Bonjour. Ces deux jours qui viennent, c’est une première résidence pour commencer à travailler sur la musique du « Conte d’un futur commun ». Yovan : Ce n’est pas ce que j’avais compris, alors que le texte du conte n’est pas encore complètement écrit. Ben moi je préfère composer chez moi en amont. Louis : Non mais prends quand même quelque chose pour jouer. Yovan : Ben écoutes, si tu veux, mais ce ne sera pas exactement ce qui va se passer. Mais j’ai mon clavier analogique avec moi. Je peux commencer par faire des nappes. Tiens, j’en choisi une, pour l’intro ça pourrait être un démarrage. Louis : On va surtout beaucoup parler de comment on va procéder à partir de ça. |
8. Le récit de Delphine (suite). Trapèze et conte
Delphine :
Pour vivre du trapèze, le problème c’est de l’accrocher. Je voulais être autonome, alors j’ai construit une yourte (je l’ai encore dans mon jardin) dans laquelle je suspends un trapèze. Dans cette yourte je pouvais donner des spectacles et faire des ateliers, ça me donnait un job autonome. J’ai fait ça dans le Morvan (parce que j’habitais pas mal dans le Morvan), à La Tagnière à Saint-Eugène. La yourte, ça se démonte et ça se remonte, ça n’a pas arrêté de se démonter, de se remonter pendant quatre ou cinq ans. Ce n’étaient pas des spectacles avec des paroles, ce n’était que du trapèze, des performances impromptues avec des musiciens que je rencontrais.
Scène entre la Vénérable conteuse et Delphine
|
La Vénérable : Tu traînes pas mal avec des punks, je n’aime pas trop ça. Delphine : Je suis venue avec eux à ton spectacle. Ils ont bien aimé. La Vénérable : Tu files un mauvais coton. Delphine : Je sais que ce sont des fréquentations qui ne sont pas ce que tu souhaites, mais moi, j’aime les punks, c’est ma famille. La Vénérable : Tu traînes dans les bars. Delphine : C’est quelque chose de très fort pour moi. La Vénérable : Jamais je ne vais te laisser tomber. Delphine : Merci. La Vénérable : Tu devrais devenir une conteuse, raconter les histoires liées à ton séjour en Afrique. Delphine : Je suis incapable de raconter ce que j’ai vécu. La Vénérable : Je te propose de créer un spectacle pour les Contes Givrés[10] sous la yourte. Delphine : Je ne suis pas du tout prête à parler en public. Je peux peut-être faire un spectacle sans paroles. |
Delphine :
Ça a été mon premier spectacle sans paroles pour les Contes Givrés, qui s’appelait « Liberté ». C’était une performance de vingt minutes de trapèze accompagné à la guitare, sous la yourte. Pour la première fois c’était vraiment un spectacle qu’on avait fixé, vendu et joué. Et c’est quelque chose qui a tourné pas mal dans les festivals. Cela m’a rapprochée de Marie-France Marbach, du coup, je suis revenue m’installer dans le coin. J’ai mis la yourte à la Fabrique, un lieu de création de résidences qui est à Savigny-sur-Grosne, à Messeugne. J’ai retrouvé Marie-France, et puis j’habitais chez Pauline, qui travaille avec les Contes Givrés. Elle est partie faire un tour du monde, elle est partie un an en Orient, et du coup, elle m’a laissé tout son appartement, parce que je n’avais rien.
9. Les récits de Louis et de Maxime (suite)
Scène entre Louis et Maxime. L’architecture et la scénographie, l’architecture et le dessin.
|
Maxime : Je n’ai jamais abandonné le dessin parce qu’au fur et à mesure que j’avançais, même quand j’ai travaillé en tant que salarié en agence d’architecture, je trouvais que les projets étaient longs, donc on dessine, au début on présente des esquisses, des images 3D, des dessins, plein d’éléments comme ça, très beaux qui donnent envie d’arriver au résultat. Cette partie, là, c’est super, mais après, moi je veux arriver plus rapidement à un résultat, je ne veux pas juste faire des belles images. Et aller au résultat, c’est très long, il y a vraiment beaucoup d’embûches qui font qu’on peut basculer dans autre chose de différent de ce qu’on veut faire. Louis : En ce qui me concerne, c’était important pour moi d’être mon propre patron, donc je me suis dit que la scénographie pour l’évènementiel me semblait plus indiquée que le travail dans un cabinet d’architecture, parce que si tu es ton propre patron en tant qu’architecte, c’est beaucoup de problèmes, comme par exemple la décennale [11], et surtout j’étais confronté à la temporalité du déroulé d’un projet qui en architecture peut facilement s’étaler sur une dizaine d’années. Je préférais mener des projets sur une dizaine de semaines, même si finalement maintenant c’est un peu plus que ça. Maxime : J’aime quand même l’architecture, alors je continue à pratiquer de cette manière, parce qu’il faut deux ans pour réaliser un projet, c’est super gratifiant d’y aller, de le vivre. Mais j’avais besoin de faire des créations sur des temps beaucoup plus courts. Louis : Avec la scénographie pour de l’évènementiel, j’étais un auto-entrepreneur, voilà, petite main pour des boîtes d’évènementiel. Deux ans plus tard, je me suis lancé dans le travail de régisseur de spectacle pour l’Ensemble Aleph[12] et d’autres organisations. Et par ailleurs, j’ai commencé à découvrir ce qu’était la vidéo-projection, le mapping. Cela m’a beaucoup intéressé et j’ai commencé à en faire. Et après, le fait de rencontrer des gens qui faisaient de la vidéo-projection m’a amené vers les arts numériques et m’a conduit plus spécifiquement vers les parcours guidés par smartphones. On a un outil assez puissant dans sa poche, dont on ne se sert que pour faire pas grand-chose. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir ce qu’on pouvait en faire. Maxime : Je me souviens que le soir chez moi, les week-ends, je me disais : « Je prends deux heures et je fais au moins un dessin dont je serais content ». Et un petit rituel s’est installé : souvent j’en fais un le soir et je le pose par terre à côté de la fenêtre et le lendemain matin, c’est là où je peux le valider ou non, savoir s’il est réussi ou pas. Donc, le lendemain matin, je me disais : « Ah ! franchement pas mal ». Ou bien : « Alors, non, non, je ne suis pas allé au bout ». Ou bien, « OK, ce n’est pas ça, mais par contre, la prochaine fois, je change telle couleur, je le refais mais je le fais différemment. » C’était la grande différence avec l’architecture où finalement, même si on fait plein de tests, on ne considère jamais le résultat final. On travaille par approximation du résultat et une fois qu’il est là, franchement c’est trop tard. On ne peut plus casser les murs, on peut très peu repeindre, donc c’est assez frustrant parce qu’on se dit : « Je me suis approché, mais j’aurais peut-être changé ça si j’avais pu m’en rendre compte avant. » Alors qu’avec le dessin, ce que j’aime bien, c’est que c’est comme les chefs qui cuisinent : ils ont le plat et après, s’ils veulent changer une saveur, changer un ingrédient, ils recommencent le plat et ils arrivent de nouveau à un résultat. J’aime bien le fait que dans mon quotidien, je pratique les deux activités, le travail d’architecte très long pour arriver à un résultat définitif et le travail plutôt d’artiste assez court pour arriver à un résultat qui amène lui-même à la recherche suivante. Louis : La rencontre avec le mapping[13], cela se fait par YouTube, avec un collectif qui s’appelle1024 Architecture. Ils sont à l’origine d’un des logiciels qui s’appelle MadMapper. Je découvre ça à un arbre de Noël, où ils avaient mis du tissu de tulle sur une tour Layher, de l’échafaudage de chantier. C’est incroyable ce qui peut se passer avec juste de la tulle et de la vidéo projection. En fait, c’est aussi ce qui m’a vraiment plu dans le mapping à la base, c’était le côté holographe, hologramme, holographique. Ça prenait forme et puis ça me parlait bien avec ma formation d’architecte et le fait que ce soit contextuel. |
10. Le récit de Yovan (suite), le projet « Un violon pour mon école »
Yovan :
J’enseigne actuellement deux jours par semaine dans le cadre d’un projet intitulé « Un violon pour mon école ». C’est un projet social qui vise à réduire l’échec scolaire via l’apprentissage de la musique. Ils ont fait appel à des chercheurs en neurosciences pour faire une étude sur dix ans pour voir comment les élèves se comportent. Donc c’est un projet intéressant qui concerne des élèves jusqu’à l’âge de 16 ans qui suivent des cours de violon, c’est une fondation suisse qui finance ça, la Fondation Vareille. Dans ce programme, il y a beaucoup de professeurs, mais certainement pas assez, sinon c’est très bien, les élèves aiment faire de la musique, à jouer du violon. Ils ne font que du violon, la fondation a acheté plein de violons pour tous les élèves. Cela fait du bien aux élèves de le faire, ils sont tous en ZEP+ [zone d’éducation prioritaire +], ce qui veut dire que certains d’entre eux ont des profils un peu compliqués.
11. Delphine, le Conte du crâne et du pêcheur.
Delphine :
La première histoire que j’ai racontée, c’est une histoire de Marie-France que j’avais entendue qu’elle racontait et que j’avais adorée. C’est l’histoire du crâne et du pêcheur :
Le conte du crâne et du pêcheur
|
Un pêcheur qui trouve un crâne là. Le pêcheur : Crâne, qu’est-ce que tu fais là ? Qu’est-ce qui t’a amené là ? Le crâne : La parole. Le pêcheur n’en revient pas que le crâne parle. Le pêcheur : Crâne, c’est toi qui as parlé, qu’est-ce qui t’a emmené ici ? Le crâne déboîte sa grosse mâchoire : Le crâne : La parole. Le pêcheur court chez le roi. Le pêcheur : Ouah ! il y a un crâne qui parle là-bas. Le roi : Attends, tu me déranges pour des histoires de crâne qui parle, tu crois que je vais te croire ? Ce n’est pas possible. Je vais venir quand même, mais si ce n’est pas vrai, je te tranche la tête. Il est sûr de lui le pêcheur, donc il emmène le roi, les ministres, tout le monde. Le pêcheur : Crâne, crâne ! dis au roi qu’est-ce qui t’a emmené ici ? Le crâne : … Le pêcheur : Allez crâne, parle s’il te plaît, qu’est-ce qui t’a emmené ici ? Le crâne : … Alors le roi tranche la tête du pêcheur, la tête tombe par terre, elle roule, elle roule, et elle roule, elle arrive juste à côté du crâne. Le crâne : Tête, eh tête ! qu’est-ce qui t’a emmené ici ? La tête : La parole. |
Delphine :
Et j’aimais bien cette histoire parce que justement cette peur de parler : qu’est-ce que c’est la parole ? Qu’est-ce qu’on dit ? Qu’est-ce qu’on ne dit pas ? Est-ce qu’on a le droit de tout dire ? Est-ce qu’on va se faire trancher la tête si on dit quelque chose qu’il ne faut pas dire ? C’est peut-être ma peur de parler qui m’a fait raconter cette histoire, l’une des premières que j’ai utilisée. Et puis après, qu’est-ce que j’ai raconté ? J’ai trouvé des histoires, j’ai cherché dans les livres, j’ai une bibliothèque remplie de livres, j’ai lu, lu, lu, plein d’histoires. Et puis j’en ai choisi qui me touchaient.
12. Le petit carnet des arbres. Maxime Hurdequint, Maxime Touroute[14] et Louis Clément.
Scène 1 : Ils boivent tous les trois un café chez Louis.
|
Maxime T. : Je suis informaticien et je fais des projets artistiques de photographie. En voici quelques-unes. Et voici les logiciels que j’ai codés. Maxime H. : Ah ! Louis : Ah !… Je m’intéresse au mapping. Je le fais sur des masques. Je construis des masques africains en papier, des choses assez simples, mais sur lesquels ensuite, avec un vidéoprojecteur, j’en fais le mapping et je les mets en couleur. Maxime T. : Ah ! Maxime H. : Ah !… Voici mes dessins. Louis : Ah ! Maxime T. : Ah ! OK super, mais on ne voit toujours pas ce qu’on pourrait en faire. Louis : Il faudrait qu’on raconte une histoire. Maxime T. : Ouais… Maxime H. : Ouais… Louis : Mais non, rien à faire. Maxime H. : J’ai aussi ça qui est sympa, qui est marrant. |
 |

| 
| 
| 
|
Le carnet des arbres de Maxime
Photos: Nicolas Sidoroff
Scène 2 : quelque temps auparavant, Maxime H. et une autre personne.
|
Maxime H. : Dessine-moi un arbre sur ce petit carnet. L’autre personne : Ben non, mais moi je ne sais pas dessiner et tout, et puis franchement, un arbre, non, ce n’est pas possible. Maxime H. : Tu sais forcément le faire, et puis après, s’il est moche, de toute façon, ça reste anonyme. Dès que tu as fini ton arbre, tu peux regarder tous les autres arbres qui ont été faits avant, franchement il y en a des cools. L’autre personne : OK, je te dessine un arbre. Maxime H. : Je trouve ça drôle de voir la richesse des arbres. |
Scène 3 : lors des études d’architecture de Maxime.
|
Maxime H. : Voilà, je vous demande de dessiner un arbre, après on va accrocher tous vos dessins sur le mur, avec un petit texte imprimé de ma part sur ce que ça veut dire les arbres. Chacun, chacune dessine son arbre. Maxime H. : Une étudiante : Que faut-il observer ? Maxime H. : S’il y a des racines qui vont dans le sol, s’il y a des feuilles ou pas (parce qu’il y a beaucoup de gens qui dessinent les arbres sans feuilles), si des branches descendent, si le tronc est fin, s’il y a un trou dans le tronc – c’est un très grand classique. Finalement, il y a des trucs absurdes : si un oiseau est posé sur la branche de gauche, mais regarde à droite, ça veut dire un truc. Mais c’est impossible, ça n’arrive jamais. Un étudiant : Mais c’est justement ce que j’ai dessiné, ce truc-là. [Rire général] |
Scène 4 : en 2015
|
Un ami japonais : Maxime H. : |
Scène 5 : retour à la première scène entre Louis Clément, Maxime H. et Maxime T.
|
Maxime H. : Ça fait tilt ! Louis : C’est génial, mais ça, on pourrait faire dessiner l’arbre aux gens, mais sur leur téléphone, ils prendraient leur téléphone, ils dessineraient avec leurs doigts un arbre sur le téléphone, et après, on l’enverrait, et on pourrait faire une espèce d’herbier où tout le monde peut voir les arbres de tout le monde. Maxime T. : On va appeler cela le Live Drawing Project. |
13. Le récit de Delphine (suite). Le Conte du petit poucet.
Delphine :
C’est un ami à moi qui est comédien, Florent Fichot, qui m’a dit : « Ça pourrait être super qu’on fasse un truc où tu racontes des histoires sur le trapèze », et donc je racontais par exemple des passages de Peter Pan, le spectacle s’appelait « Souffle court ». On l’a joué au théâtre du C2[15] à Torcy en Saône-et-Loire.
Ensuite, il y a eu l’histoire du Petit Poucet sur le trapèze. Ce n’est pas l’histoire du vrai Petit Poucet, hein ! C’est le Petit Poucet (« L’Autruche ») de Prévert[16].
Le Conte du petit poucet
|
Lorsque le Petit Poucet, abandonné dans la forêt, sème des cailloux derrière lui pour retrouver son chemin, il ne se doute pas qu’une autruche le suit pour dévorer les cailloux un à un, « ram, ram ram ». Le Petit Poucet se retourne, plus de cailloux ! C’est désolant, plus de cailloux plus de maison ; plus de maison plus de retour ; plus de retour, plus de papa-maman. Puis il entend du bruit, il entend de la musique, un vacarme. Il passe sa tête à travers le feuillage et il voit l’autruche qui danse et qui chante, et qui le regarde. L’autruche : C’est moi qui fais tout ce bruit, je suis heureuse, j’ai mangé. Le petit poucet : Tu as un estomac magnifique. L’autruche : Oui, j’ai mangé plein de trucs. Viens ! monte sur mon dos, je vais très vite, je vais t’emmener loin. Le petit poucet : Mais ma mère, mon père, je ne les reverrai plus ? L’autruche : Alors, elle te frappait quelquefois ? Le petit poucet : Mon père aussi me battait. L’autruche : Ah ! il te battait ! Attends ! Les enfants ne battent pas leurs parents, pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants ? Je ne supporte pas de voir de la violence sur les enfants. Il te battait quelquefois ? Le petit poucet : Oui, père Poucet aussi me battait. L’autruche : Et tu veux que je te dise ? Père Poucet n’est pas bien. Et ta mère, au lieu de s’acheter des grands chapeaux avec des plumes d’autruche, elle ferait mieux de s’occuper de toi. Et ton père, il n’est pas bien malin non plus, la première fois qu’il a vu ta mère, tu sais ce qu’il a dit ? Il a dit : on dirait une grande bassine, dommage qu’il n’y ait pas de pont. Tout le monde a ri ! Le petit poucet : J’ai ri, mais ma mère m’a mis une baffe : « Tu ne peux pas rire quand ton père dit ça ». L’autruche : Le truc, bouh !! |
Delphine :
Et c’est à ce moment-là que je suis tombée du trapèze, je me suis cassé la main.
Je pense que je suis prise d’émotion en regardant le public. Je suis tombée du trapèze, je me suis cassé la main, du coup, je ne pouvais plus parler. En fait, le problème avec le trapèze et le conte en même temps, c’est qu’on doit être là, avec chaque partie du corps, dans les mains, dans les jambes, chaque point d’appui, on doit être concentrée. Mais là, vu que je racontais une histoire en même temps, ça m’a dispersée et je suis tombée.
14. Delphine et le conte. Maxime, l’architecture et les dessins. Yovan et la composition.
Delphine :
J’avais cassé mon poignet, ils m’ont opérée à Montceau et ils m’ont ratée à Montceau – il ne faut jamais aller à Montceau d’ailleurs, vous saurez – ils m’ont ratée, j’ai dû être réopérée, donc ça a duré un an. Du coup, il fallait bien que je gagne ma vie.
Scène : Coup de téléphone de la Vénérable conteuse
|
La Vénérable : Qu’est-ce que tu comptes faire ? Delphine : Je compte sur le conte. Je vais raconter des histoires, j’en suis capable, puisque je l’avais fait sur le trapèze. La Vénérable : Tu sais, c’est un signe, si tu arrives à ça, c’est peut-être parce que tu as autre chose à faire que du trapèze. |
Maxime :
Les arts plastiques, c’est hyper large. Je ne sais pas si c’est une règle que je me suis fixée, mais je n’ai pas beaucoup exploré en dehors du dessin, ce qui fait que des amis m’ont dit : « Ben, essaies d’ouvrir un petit peu ta pratique ». Je pense que ce n’était pas mal de prendre confiance petit à petit sur des petits formats et maintenant, j’arrive à être plus à l’aise sur des grands formats. J’ai fait beaucoup de skateboard et comme mon frère fait du skate art, il sculpte sur des planches de skate, il m’a introduit à ça, donc j’ai fait du skate art, j’ai dû faire une dizaine de skateboards et puis là, récemment, je me suis retrouvé à répondre à une commande pour faire un grand surfboard. Je pense que c’est une question de se sentir à l’aise, et qu’après, on peut aborder des formats plus grands. Avec les skateboards ce qui est super, c’est aussi d’avoir l’objet dans les mains, et de devoir bouger avec, de bouger autour, plutôt qu‘avec une feuille où il n’y a vraiment que le poignet qui est en déplacement. Là, il y a un rapport avec l’objet, ce n’est pas qu’on le façonne, mais quand même… Je découvre tout ceci progressivement, au fur et à mesure que je suis plus à l’aise dans ma démarche artistique ou d’illustration.
Yovan :
Quand je compose, j’utilise souvent une sonorité qui se développe dans un temps donné. Parfois je dois l’étirer un petit peu, rendre des choses plus longues, parfois un peu moins longues, c’est pour ça que le côté répétitif est pratique. Et il y a aussi un côté électronique. Normalement, quand je compose des morceaux, j’ai un début et une fin, je sais où je vais, et j’aime bien avoir une petite contrainte surtout pour la musique que je fais dans les projets des autres, ou dans les projets collaboratifs.
Delphine :
C’est ainsi que je me suis mise doucement à raconter des contes et aussi, du coup, à prendre un peu confiance en moi. Je trouve qu’on est vraiment tout nu quand on raconte : les lapsus, le ton de la voix, tout cela en dit long sur soi-même. Je trouvais que c’était un aspect vraiment délicat pour moi : être devant un public, avoir peur qu’on nous juge, de se juger soi-même. Je suis très exigeante, je suis très critique vis-à-vis de moi, donc j’avais très peur de ce que j’allais vivre avec moi-même. Parler devant les autres, c’est s’engager, c’est engager une part de soi. Je trouve ça très risqué, en fait.
Yovan :
Et parmi les références qui m’ont influencé dans mon travail sur le « Conte d’un futur commun », il y a un musicien, ce n’est pas tout à fait un DJ, qui s’appelle Débruit [17], qui a fait notamment un projet – KoKoKo! [18] – avec des percussionnistes de Kinshasa. C’est vraiment intéressant, parce que justement il respecte leur travail, il utilise leur musique et ajoute des petites touches électro, mais il ne déforme pas leur musique. Ce que fait Débruit m’a inspiré bien avant ce projet KoKoKo!, mais c’est un de ses projets les plus aboutis, parce qu’il y a un vrai respect de la musique traditionnelle, avec ensuite des rajouts de petites touches d’électronique pour un peu la moderniser.
Delphine :
Avec le trapèze, je gesticule beaucoup, au fil du temps de moins en moins, mais c’est vrai que je bouge beaucoup, j’engage beaucoup le corps. Et je travaille beaucoup avec un double, souvent un musicien. Au départ, le guitariste Julien Lagrange [19] a été celui avec qui j’ai formé un duo trapèze-guitare, qui est devenu un duo conte-guitare. On travaille ensemble sur le rythme, on cale du rythme, ça m’aide beaucoup, ça me pousse aussi à travailler, parce que toute seule dans la cuisine, je le fais, mais c’est moins facile que quand on se donne un rencart et qu’on travaille ensemble. Souvent, après avoir travaillé les histoires avec Julien, je les fais aussi sans la guitare. Ça me rassure de ne pas être toute seule et c’est comme cela que ça se structure.
Maxime :
Mon activité principale est celle d’architecte, mais j’estime que le dessin n’est pas simplement un hobby. Il y a des temps dans la semaine qui sont réservés au dessin, donc j’estime que ces deux activités cohabitent. Il y en a une plus importante que l’autre, mais mes dessins ont donné lieu à des expositions, j’ai eu parfois des commandes, j’ai aussi pu vendre certaines œuvres. Bien sûr la partie artistique, ce n’est pas celle qui me fait manger, mais en même temps j’ai pu avancer là-dessus. J’ai commencé par exposer différents dessins dans un café en 2020, que j’avais faits pendant et à la suite de mon voyage en Asie. Et j’avais dessiné sur des skateboards un triptyque et un diptyque de planche de skate, toujours sur ce thème-là. En 2021, il y a eu dans un restaurant une exposition partagée, où je me suis donné plutôt un thème Maya, parce que j’avais fait un voyage au Mexique. J’avais fait pour cette exposition 3 skateboards, un triptyque de 3 skates et un diptyque de 2 skateboards, avec un autre artiste évoluant dans un univers complètement différent. La même année, j’ai participé à une exposition collective de skate art à Roubaix, j’ai exposé un diptyque de deux planches de skate sur le thème du Japon, il y a des gens qui étaient intéressés qui l’ont acheté. C’était très drôle : c’est une dame qui l’a offert à son mari, qui est un ancien skateur, et elle a dit, « Il est fan du Japon, il aime le skate, j’ai senti que c’était son style. On l’a mis en bonne place chez nous dans le salon ». J’étais ravi.
Delphine :
Je me suis surtout tournée vers le jeune public, je trouvais que c’était moins jugeant. C’est plus dur parce que si ça ne marche pas, ça ne marche pas, c’est-à-dire qu’ils ne vont pas faire semblant qu’ils ont trouvé ça bien. Il y a quelque chose chez les enfants qui fait que si ça ne va pas, on le sait tout de suite, il n’y a pas de double jeu. Mais en même temps, il y a moins de jugement par rapport à des repères, par rapport à des étiquettes, à ce qui existe déjà.
Maxime :
Après on a fait une exposition collective en 2022 avec mon frère et un autre artiste, où cette fois c’étaient uniquement des skateboards qui ont été sculptés. On a décidé que pour chacun d’entre nous, il y aurait un skateboard qu’on ferait entièrement nous-mêmes, il y en aurait un qu’on partagerait avec un des deux autres artistes, et le troisième serait partagé avec l’autre artiste.
Yovan :
Moi je suis sur Cubase. Ce n’est pas évident, les gens ne comprennent pas pourquoi. Tout le monde est sur Live. Quand j’utilise mon ordinateur, je n’utilise pas souvent Live, jamais en fait. Donc c’était toujours un petit peu le combat de dire « Ben voilà, moi, je suis sur Cubase. » Et lors d’une des résidences qu’on a fait à Lyon, l’ingénieur du son m’a dit : « Ah ! mais moi je travaille sur Live, là, il faut que tu te mettes à Live. » Il était un peu perdu et puis moi aussi. En fait on a trouvé un terrain d’entente et il a vu que j’avais la dernière version de Cubase avec les mêmes fonctionnalités, il a vite compris et il m’a montré comment réadapter les morceaux en 7.1 [20] pour une spatialisation. Je n’avais jamais fait ça, au début ça m’a un peu angoissé, j’ai dit : « Ben ça, c’était intéressant à faire ».
Delphine :
Il faut beaucoup d’exigences sur ce qui est raconté et par qui : si on raconte une histoire qui a déjà été racontée par un tel ou une telle, ou qui vient de tel ou tel endroit, ça peut être mal vu. Par exemple, si on raconte des histoires écrites par Henri Gougaud, qui reprend des histoires traditionnelles, qui les met à son nom, voilà, ça ne se fait pas. Ou prendre une histoire qui est racontée par quelqu’un d’autre, on ne va pas faire du copier-coller. Il faut faire attention à ce qu’on fait, on ne peut pas raconter n’importe quoi. Il faut respecter le travail de chacun, toujours dire l’origine de ce qu’on a raconté, d’où ça vient, de quel pays, de quelle culture. Et comme tout travail, je pense que dès qu’on met les pieds dedans, on se rend compte qu’en fait, plus on travaille et plus on a du travail à faire, c’est interminable.
Maxime :
L’an dernier on a fait aussi une exposition collective de planches de surf, au City Surf Park de Lyon, vers le stade de foot de Décines. C’était le vernissage d’ouverture de ce complexe sportif, et du coup ils avaient demandé à 20 artistes de dessiner sur des planches de surf. J’ai produit l’œuvre que j’ai exposée sur un thème marocain, parce que c’est assez connu dans le monde du surf, donc je me suis inspiré des arts marocains et j’ai rajouté la mer au bout.
Delphine :
Quand je parle de rythme, c’est le rythme de la narration. Parce que souvent, il y a des moments où ça chante presque et il y a des refrains qui se répètent et puis une fin. Il faut que ça monte, il faut que ça redescende. Il y a un vrai rythme dans la création d’une histoire. C’est ce qui est difficile dans le « Conte pour un futur commun », c’est une histoire très longue, elle est donc beaucoup plus difficile à rythmer.
15. Le Live Drawing Project
Louis :
J’ai ensuite rebifurqué sur la vidéo-projection et j’ai commencé à monter ce premier projet, le « Live Drawing Project » qui était né d’une rencontre entre Maxime Touroute, Maxime Hurdequint et moi. J’ai rencontré Maxime Touroute à un atelier sur le mapping, il venait d’arriver à Lyon, et on faisait un tour de table pour se présenter, et quand il s’est présenté, il a dit qu’il bossait comme développeur pour Millumin. Maxime Hurdequint, c’est mon cousin, donc on se connaît vraiment depuis la petite enfance.
Maxime :
Tous les trois, on s’est organisé beaucoup de temps de travail ensemble. Il y a beaucoup de moments où même si on était côte à côte, chacun travaillait de son côté. Mais il n’y avait pas de distance entre nous. Avec le Live Drawing Project, le cœur de la machine reste l’informatique, c’est vraiment Maxime Touroute qui code et ensuite il y a beaucoup de tâches qui se mettent autour : toute la partie communication, toute la partie gestion de projet, préparation, installation.
Louis :
En fait, il y a trois logiciels qui existent pour faire du mapping qui marchent vraiment bien, c’est Resolume que j’utilise, MadMapper qui a été monté par des Suisses, qui est aussi très reconnu dans le milieu, et Millumin qui a plutôt essayé de se faire une place dans le spectacle vivant.
Maxime :
Ce sera très différents avec le « Conte d’un futur commun » où les branches se rejoignent vraiment juste à la fin, pendant les résidences et où le reste du temps, on n’a pas trop besoin de communiquer ensemble.
Louis :
On a pensé qu’on pouvait envisager de faire dessiner des gens pour que leurs dessins apparaissent sur un écran en direct.
Maxime :
Dans le Live Drawing, il faut savoir ce qu’on est capable de faire et de réellement coder au fur et à mesure. OK, là, Louis, tu crois qu’on va y arriver là, sur cette façade ?
Louis :
Ben non, c’est impossible, on ne peut pas.
Maxime :
Hop ! Donc il y a beaucoup plus d’échanges à faire, parce que les compétences sont beaucoup plus liées, on est constamment en ping-pong.
Louis :
Et un mois plus tard, on a participé à la Fête des Lumières à Lyon.
Maxime :
Pendant la Fête des Lumières, c’était dans un bar, le Club des Lumières. Le patron du bar avait annoncé : « Moi je file 150 balles pour 3 jours, et faites-moi un événement Fêtes des Lumières ». Donc on lui a montré notre idée, j’avais fait 3 dessins pour l’expliquer et Maxime Touroute a travaillé sur le code tous les soirs pendant dix jours et ça a très bien fonctionné. En plus, on a pensé que les gens n’allaient faire qu’un ou deux dessins, et qu’après, ce serait fini. Comme on proposait un petit thème, « dessine une fleur », « dessine un arbre », on s’est dit que les gens auraient bien assez à faire, ils feront un petit dessin, et puis c’est tout. En fait, pas du tout, il y a des gens que cela intéresse, et qui restent pendant une heure à dessiner les uns à côté des autres, à dire : « Regarde le mien, regarde le mien ! » Et puis finalement, on s’est rendu compte que plus on donnait des thèmes de dessin, plus les gens avaient des idées. Ou bien ils ne suivaient pas du tout le thème proposé. Je crois qu’on avait trouvé un outil très ouvert. Certes, on ne s’en cache pas, les gens avaient tendance à regarder leur téléphone de manière individuelle, mais parce qu’ils dessinaient côte à côte, ils échangeaient avec les autres. Et puis il y avait ceux qui ne dessinaient pas, ils regardaient l’écran où les dessins étaient projetés. On s’est rendu compte que quand on passait entre les gens, il se passait des choses, les gens papotaient, ils se montraient les trucs, ça leur donnait des idées. On s’est dit : « ouais, c’est cool, on a un truc là, qui est riche ». C’est donc cela qu’on a développé avec Maxime Touroute et Louis, le Live Drawing Project, des dessins participatifs qu’on a enrichi au fur et à mesure.
Louis :
Et après, c’était parti, là, on en est maintenant à notre 140e projection.
Maxime :
Avec le Live Drawing Project, quand on l’utilise, c’est vraiment une grosse télécommande. Maxime Touroute nous a codé plein de boutons : on a le bouton pour changer la couleur des dessins, les agrandir, les mettre plus petits, etc. On peut faire des fondus, faire des choses comme ça. Mais on ne raconte pas vraiment une histoire, simplement on anime pour éviter que le visuel soit toujours pareil. Alors qu’avec le « Conte du futur commun », avec le logiciel Resolume et le fait qu’on a une conteuse, on est vraiment très narratif.
Louis :
On a tourné un peu partout dans le monde, ça a hyper bien marché.
Maxime :
On a fait ça depuis 2018 jusqu’à maintenant. On a eu d’autres dates en 2019, en 2020. C’est progressivement devenu mieux rémunéré, on a pu acheter un vidéoprojecteur, se structurer avec une association qui nous fait toute la partie administrative. On s’est vraiment professionnalisé au fur et à mesure. On a voyagé au Canada, au Danemark. Ensuite il y a eu le confinement du Covid, donc on a développé des outils spécialement pour le confinement, en organisant des événements à distance. C’était pour nous une bonne source de revenus, on l’a fait de nouveau au Danemark, mais cette fois à distance. On a été dans plein de pays, dernièrement en Birmanie par exemple.
Louis :
Et je me suis dit à un moment donné que j’aimerais bien raconter des histoires avec ce dispositif-là, pour pouvoir faire quelque chose d’à la fois participatif et qu’on puisse surtout raconter quelque chose pour que le spectateur puisse être partie prenante dans le récit. Et du coup, on a fait une première résidence il y a quatre ans au LabLab à Villeurbanne [21]. Et là, on a commencé à se servir de cet outil pour raconter une toute petite histoire : la naissance d’une anomalie numérique. C’était un très court récit d’une quinzaine de minutes. On l’a monté en quatre ou cinq jours. Pour l’instant il n’y avait pas encore de conte. Il y avait juste du texte projeté sur l’écran, comme des sous-titres avec l’image en mouvement. Le public dessinait des trucs avant de rentrer dans la salle de spectacle, par exemple des étoiles. En fait, ce qu’on voulait tester, c’étaient différents types d’interaction avec le public, comment on pouvait les faire participer en amont, pendant, en regardant, les faire s’arrêter, etc. Cette résidence-là m’a bien aidé par la suite dans l’écriture et l’interaction avec le public. Maxime Hurdequint a participé à la création du concept de base et après il a fait de la gestion de projet, de la communication, pour aller chercher des endroits où le présenter, il a fait pas mal de templates de devis, il a fallu faire signer les gens, etc.
16. Delphine : deux contes.
Delphine :
Avec Julien, en ce moment, on raconte beaucoup « Pierre et la sorcière », c’est un conte traditionnel pour enfants. Et je parle de celui-là parce que c’est très rythmique entre ce que je dis et ce qu’il joue.
Le conte de Pierre et la sorcière
|
Dans un village, il y a une sorcière. |
Delphine :
Il y a aussi
Le conte du pain d’épices
|
C’est un bonhomme de pain d’épices fait par une femme, elle le met au four et puis il se sauve par la fenêtre et il court, il court, il court et tout le monde lui court après et puis, en fait, il court, il court, il court. Et le renard, il est au bout, il l’attend, et le renard lui fait des éloges et du coup, il fait confiance au renard, évidemment. Il monte dessus et le renard, « crrrrr », il le mange. (Là il faut qu’on soit calé au moment où il le bouffe). « Crrrr », hop !… Il l’a mangé ! |
Delphine :
Donc entre Julien et moi, on a des tops bien calés. Il joue très près de moi, on se connaît très, très bien, donc il sait comment je raconte, donc on peut improviser des choses ensembles. On travaille beaucoup ensemble en présentiel, même s’il y a aussi beaucoup de travail chacun de son côté. Je lui donne l’histoire que j’ai envie de raconter sur du papier ou dans un livre. Lui aussi apporte des histoires, il dit : « Ah ! j’aimerais bien qu’on raconte ça, je trouve ça cool, en plus j’ai un univers ». Moi je travaille un peu de mon côté, lui il travaille aussi de son côté sur à peu près comment on veut faire. Et après on se voit tous les deux, on se cale, et puis on dit : « Bon allez on y va ».
17. Origine du « Conte d’un futur commun »
Scène 1 : Chez Delphine, le téléphone sonne. C’est Louis Clément.
|
Louis : Mon nom est Louis Clément. L’association Antipode m’a donné votre nom. Je voudrais faire un spectacle dans lequel on imagine comment ce sera dans 100 ans, mais dans un monde idéal. Delphine : Eh oui, il n’y a aucun doute là-dessus, on est dans ce monde idéal. Louis : 100 ans après, ça, c’est fait. Delphine : OK, et comment on en est venu jusque-là ? Louis : Je raconte souvent des histoires, maintenant je suis un peu rodé, je l’ai fait avec plein d’élèves, parce que je fais beaucoup de résidences d’éducation artistique et culturelle, et ce dont je parle souvent, c’est le fait à mon échelle d’essayer de changer le monde : encore une fois, c’est utopique de ma part, mais voilà, c’est quelque chose qui me porte. Comment est-ce que je peux changer le monde ? Je ne peux pas inventer des énergies renouvelables très peu chères, je ne peux pas inventer un moyen de transport du futur totalement décarboné, comme le vélo-cargo par exemple. Du coup, je me suis dit que j’aimerais bien amener les gens à réfléchir sur leur avenir et surtout, à l’inverse de tout ce qui est dystopie, essayer de partir sur quelque chose où on réfléchit à un avenir où tout se passe bien et comment on y arrive. Delphine : Ce que tu dis me fait du bien. Parce qu’en ce moment je suis dans le noir, dans des trucs punks, dans des choses où le monde est… Des fois, je me dis, que je vais mettre une bombe dessus ce monde, enfin, on va faire péter des trucs, quand tu te rends compte de ce qui se passe dans le monde, c’est quand même « aaaah !… » Des fois, on dirait qu’il y a des gens à tuer, il y a des choses à faire péter, enfin il faut que ça s’arrête, quoi. Je traîne dans le milieu punk, no futur. Louis : À travers mes lectures, je me suis pas mal inspiré de récits qui disent que c’est grâce à la pensée qu’on arrive à faire les choses. Notamment Neal Stephenson qui est un auteur de science-fiction que j’aime assez, qui a sorti une théorie qui s’appelle la théorie du hiéroglyphe : c’est plutôt en rapport avec les avancées technologiques, où grâce à la science-fiction, on arrive à faire des avancées technologiques majeures. Son exemple préféré est le combustible pour les fusées, où il explique que c’est un auteur de science-fiction qui a dit que cela allait marcher de telle manière, et qu’ensuite, un chercheur s’y est penché et en se saisissant des intuitions de cet écrivain, il a réussi à créer le premier combustible pour fusée. J’aime bien raconter ça aux élèves avec qui je fais des interventions ou au public, j’aime bien insister sur le fait que, en gros, si l’on veut aller vers un futur désirable, il faut déjà y avoir pensé. Et que, du coup, la première étape pour avoir un monde qu’on a envie d’avoir, c’est juste d’y réfléchir. Delphine : En fait, c’est chouette d’imaginer ça, ça contrebalance ces idées noires. OK, en fait, on se dit que dans 100 ans on est dans un monde idéal et on fait tout pour y arriver. Ce n’est pas de critiquer tout ce qui ne va pas, de mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas, même si l’on sait que pas mal de choses ne vont pas. Non, on va dire, OK, dans 100 ans, on est dans un monde chouette. Et donc, OK. Je ne sais pas dans quoi je me lance. Ben, oui, je suis intéressée. Louis : Ben tu es intéressée, vas-y, tu le fais. Delphine : Mais, tu ne veux pas voir ce que je fais, avant ? Je joue à la médiathèque de Mâcon, tel jour, pour des enfants et le soir pour tout public. Louis : Ah ! je ne peux pas le soir, je vais venir au spectacle pour les enfants. |
Delphine :
Louis est ainsi venu me voir jouer le spectacle Jabuti à la médiathèque de Mâcon : du trapèze, justement. On avait remis le trapèze, parce que j’ai aussi une copine qui est trapéziste. Oui, j’ai un réseau trapéziste de circassiens autour de moi. Jabuti était un spectacle conte-trapèze-flûte traversière. C’était une balade : on se baladait avec les gens dans la médiathèque et on les amenait jusqu’au trapèze. Et donc, il est venu voir ce spectacle, c’est comme ça qu’on s’est vu la première fois.
Louis :
Du coup, c’est comme ça qu’on s’est croisé. Enfin, j’arrive un peu en avance avant son spectacle, on discute, je lui explique le projet, comment ça va se passer, etc. Après elle a présenté son spectacle et je devais repartir à Lyon avant la fin du spectacle, donc je n’ai pas eu le temps de lui en parler à la fin.
Scène 2 : Nouveau coup de téléphone de Louis à Delphine
|
Louis : Allo bonjour. Delphine : Bonjour. Louis : J’ai trouvé ton spectacle très bien. Ben ouais, c’est bon pour moi, si toi tu es toujours OK. Delphine : OK, on y va. Louis : C’est parti. |
18. Le projet immersif de l’AADN
Yovan :
Le projet du « Conte d’un futur commun », c’est une idée de Louis. C’est son premier spectacle en vrai, il avait des idées au début qui germaient, il savait ce qu’il voulait faire, mais il avait du mal à les mettre en forme. Et du coup, quand on a commencé à en parler, il pensait à une première équipe et surtout il cherchait d’abord les subventions, en tout cas, pour qu’on puisse avoir des lieux qui nous permettent de créer aussi tout le côté immersif du spectacle. Une première proposition a été déposée, on n’était pas loin d’aboutir, mais ça n’a pas fonctionné. Ensuite, une fois qu’on a pu avoir les subventions de l’AADN pour ce projet d’immersion dans les planétariums dans certaines villes de France, on a commencé à parler de l’écriture du spectacle.
Maxime :
C’est comme ça que tout a commencé, Louis a eu cette intuition de nous rassembler. En 2019, on avait fait une résidence pour essayer de raconter une histoire à partir du Live Drawing, c’était un spectacle de cinq minutes, avec des graphismes très, très simples, c’était très chouette. On pensait qu’il y avait moyen de raconter une histoire, mais on n’est pas allé plus loin. Ça a germé très progressivement.
Louis :
Il y a eu l’appel AADN (Arts & Cultures Numériques) [22] avec qui j’étais bénévole au Conseil d’Administration. Ils ont lancé un appel pour la création immersive. Cela m’a bien intéressé parce que j’ai commencé à aller voir des spectacles sous dôme, je trouvais ça assez fou, enfin c’était assez bluffant ! L’immersion qu’on ressentait face à ces images avait éveillé mon intérêt. Le point de vue de l’AADN était de parier sur l’immersion collective, c’est-à-dire de faire participer beaucoup de spectateurs à une expérience, plutôt que d’avoir une immersion individuelle comme avec la réalité virtuelle (avec des casques). L’idée d’aller à l’encontre des formes individuelles d’immersion me plaisait beaucoup. Ce dont on parle aujourd’hui, c’est le « métavers » [23] ce qui veut dire, en gros, qu’on peut soit s’immerger individuellement dans quelque chose de collectif, soit de s’immerger collectivement dans un œuvre : on est ensemble.
Maxime :
Donc c’est Louis qui vient vraiment avec le concept, il sait déjà ce qu’il veut faire, et qui il veut recruter. On avait trouvé une première conteuse, finalement, on n’a pas eu forcément les subventions qu’on voulait, donc on a fini par trouver une deuxième conteuse, Delphine, et il avait déjà trouvé aussi Yovan pour la musique, comme il le connaît très bien. On a décroché la subvention immersive en 2021.
Louis :
Nous avons répondu à l’Appel à projets d’AADN, et donc je prends un certain nombre de décisions. Je commence à raconter cette histoire, je trouve le nom d’un « Conte d’un futur commun », je trouve que ça parle assez bien aux gens. Après avoir trouvé ce titre, je me suis demandé comment je vais concevoir ce spectacle. Après un premier refus de l’Appel à projet immersif de l’AADN, nous redéposons un projet. Et là, on l’a obtenu et l’AADN a accepté de nous prendre en production déléguée, c’est-à-dire qu’ils vont nous aider à aller chercher des financements et à diffuser le spectacle. À partir de là, on fait des dossiers et on commence les résidences. J’avais travaillé avec Maxime Hurdequint avec le Live Drawing, il n’était pas question de se passer de ses capacités de dessinateur, et je lui ai demandé de faire les décors. Il faut un musicien, je demande bien évidemment à Yovan Girard que j’admire beaucoup, qui a fait beaucoup de musique, qui a une sensibilité qui me plaît. Il fait plutôt de la composition pour des morceaux de musique mais il avait déjà fait une pièce de théâtre avec quelqu’un. Je sais qu’il est capable en plus de le faire. On se connaît depuis la petite enfance, parce que mes parents et ses parents sont très proches, ma mère et son père étaient ensemble au lycée, je crois.
19. Le « Conte d’un futur commun »
Louis :
Donc je fais un calendrier de création, on se cale des dates, on se voit, on commence à faire des trucs ensemble. Je continue parallèlement à chercher des subventions de mon côté. Si cet Appel à projet immersif nous donne de l’argent, cela ne suffit pas vraiment pour payer tout le monde tout le temps, et en plus je demande aux gens de travailler en dehors des périodes de résidence. On a déposé je ne sais pas combien de dossiers auprès de différentes structures. Par exemple, nous avons déposé trois fois un dossier auprès de la création hybride en Auvergne-Rhône-Alpes avant d’obtenir quelque chose de leur part, et je dépose aussi un dossier auprès du CNC (Centre National du Cinéma) et on obtient cette subvention et du coup on a pas mal d’argent. Grâce à ça je respire un peu plus, parce que je vais pouvoir payer les gens correctement pour la création, donc ça c’est une très grande chance. Et après on a eu aussi une subvention de la SACEM. On a pu refaire une résidence au LabLab et payer après coup les résidences qu’on avait faites au Centre des arts d’Enghien-les-Bains. Cette résidence avait duré deux semaines parce qu’on avait la chance d’avoir l’endroit disponible, ils nous fournissaient le lieu mais ils ne nous donnaient pas d’argent.
Avant de trouver le titre du « Conte d’un futur commun », je me suis dit qu’il fallait pouvoir infléchir le déroulé de l’histoire par les réactions du public. Je me disais que si c’était écrit, on allait faire des scénarios en arborescence, avec des arbres de choix multiples, ce qui allait être potentiellement très complexe. Et puis il y avait cette idée d’une histoire racontée autour du feu, avec la participation des gens, ce genre de chose. Ce qui me plaisait bien aussi, c’était l’opposition entre le côté du conte comme l’une des plus vieilles formes « d’art » entre guillemets avec sa manière de raconter des histoires, et le côté participatif, les smartphones, la projection, il fallait trouver un équilibre entre les deux. Alors, j’ai décidé que ça pouvait être un conte.
Delphine, Maxime, Yovan et moi-même, nous avons commencé à travailler ensemble sur ce projet. J’avais vraiment déjà tout l’univers dans ma tête. La première fois qu’on s’est rencontré avec Delphine, j’avais tout le déroulé de l’histoire, je savais où ça commence, qu’est-ce qu’on va voir et jusqu’où on va. En fait, je n’avais pas vraiment le déroulé de l’histoire, mais les lieux où elle se déroule.
20. Louis, une année de réflexion
Louis :
Pendant un an, il ne s’est quasiment à rien passé, il n’y a pas eu d’autres rencontres. J’ai réfléchi tout seul de manière plutôt introspective. Rien de spécifique n’a émergé, mais j’ai lu énormément, je ne lisais quasiment plus pour mon « plaisir » entre guillemets, Je me suis fait des énormes tableaux de livres à lire. Ce sont toutes les références à des concepts, à des gens, à des penseurs et à des projets qui m’inspiraient, de la part de gens qui parlaient de comment ils écrivaient à ce sujet.
Pendant cette année de réflexion, quand il fallait prendre des décisions c’était dans ma tête, à aucun moment je n’ai écrit quoi que ce soit. Je formalise les choses dans ma tête, je me dis juste : ça, ça va être ça, enfin, on va commencer là. Et puis il y a eu cette idée d’aller visiter des endroits où il y a des communautés qui sont en harmonie avec leur milieu et ça, en fait, ce n’est pas vite-fait : je fais le tour complet du milieu, la forêt, la montagne, dans les airs, sous l’eau… Et après, je me suis dit que, par son importance, la ville n’allait pas disparaître, et qu’il fallait donc trouver une manière intéressante de l’habiter. J’ai lu plein de trucs sur le ré-ensauvagement qui étaient à la mode : Baptiste Morizot [24] par exemple, enfin tous ces gens qui parlent de comment on peut redonner une place à la nature en ville.
21. L’écriture du Conte, Delphine et Louis.
Louis
Avec Delphine donc, on se voit une première fois pendant deux jours. Au début, j’arrive avec mon histoire, mais en fait je n’ai que les lieux et Delphine, c’est elle qui va tricoter tout, les relations entre les personnages, comment ils vont se trouver, comment ils discutent, et ça m’aide beaucoup. Je présente mes idées et comment ça va se dérouler : je voudrais que l’héroïne aille là-bas, là-bas, et là-bas…
Delphine :
Je dessine, j’écris, et puis après, moi toute seule, je reprends ça, je réimagine à quoi ça ressemble et je trouve la manière de le dire. Et après, quand j’ai trouvé, je le fixe sur papier et je mets les textes sur mon ordinateur. Mais après cela, je continue à beaucoup les remodifier.
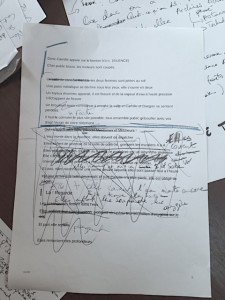
Photo: Nicolas Sidoroff
Delphine :
Quand je travaille en résidence, j’ai besoin des papiers écrits que je rature et que je rectifie directement, je suis perdue si jamais c’est trop le bastringue. Il faut aussi que ce soit clair aussi dans ma tête, c’est pour ça que j’ai écrit beaucoup, beaucoup de textes. L’écriture du conte commence toujours avec du papier, car j’ai l’habitude d’écrire à la main. Louis est dans le canap’ qui me dit « OK ».
Scène 1 : la première séance de travail, Delphine et Louis
|
Louis : OK. On commence par les arboricoles. Delphine : Il faut une héroïne. Louis : Il y a la question de savoir si ce doit être une fille ou un gars. Delphine : Ni l’une, ni l’autre, d’après moi. Louis : Faut-il utiliser le principe du « iel » ? Delphine : Pour moi, c’est assez compliqué à mettre en place, parce qu’il y a les conjugaisons derrière et que la compréhension par le public n’est pas évidente. J’ai lu des livres avec « iel », qui veut dire « il et elle », pour pas que ce soit un personnage féminin ou masculin. Beaucoup de féministes utilisent cette formule. C’est compliqué quand tu as un public qui ne sait pas, des enfants, par exemple, tu dis « iel » et ils ne vont pas comprendre. Louis : On peut décider que c’est une fille. Delphine : Oui, mais avec un nom qui peut s’appliquer aux deux genres. Au lieu d’utiliser il ou elle dans le spectacle, peut-être qu’on pourrait utiliser le prénom de la personne. Louis : Je propose Camille. Delphine : D’accord. Louis : J’ai tous les endroits que l’on va aller visiter : arboricole, après la ville, après le corail… Je voudrais que Camille aille là-bas, là-bas, et là-bas et je ne sais pas où Camille va aller à la fin. Delphine : On pourrait rajouter l’idée des « aimants » (boussoles) qu’on va voir pour déterminer qui sont les gens qui guérissent. Et aussi les prairies, les plantes, et ça peut finir sous l’eau. Louis : Il y a cette idée de Grand Conseil qui est plutôt dans la ville. Delphine : Je note tout ce que tu dis spontanément sur du papier que je garde dans un dossier. Je garde tout en vrac, même les choses que nous allons rejeter dans le spectacle. C’est la pile du « Conte d’un futur commun » tout entier. Tu vois, moi c’est du bazar, hein ! Il y a des phrases qui sont très nettes, que j’écris pour ne pas les perdre parce qu’elles me semblent justes, je les ai parfois trouvées à l’oral. Louis : Moi je décris où ça va se passer, qu’est-ce qu’on veut, où est-ce qu’on va et qu’est-ce qu’on peut trouver à chaque fois, et toi, tu vas mettre tout cela en histoire. C’est toi, après qui va écrire le texte, la majeure partie de l’histoire. Delphine : Je note : « Forêt, traversée de la forêt. La gare. Le village. La ville. La mer. La prairie. » Je te propose de mettre la prairie avant la mer. Et aussi que Camille finalement ne retourne pas chez elle. Il faut trouver quelque chose qui implique le public, qui le fasse évoluer tout au long du spectacle pour qu’on en ressorte comme si on avait fait un voyage. Je veux qu’on en ressorte chamboulé, qu’on puisse se dire, “on a fait un voyage dans un monde qu’on ne connaissait pas”, un monde qui nous a rappelé des souvenirs, qui nous a fait se poser des questions sur nous-mêmes. Louis : Ce qui me plaît, c’est cette idée de rite initiatique, enfin, c’est un voyage initiatique. Delphine : Tu vois, je vais même annoter les positions du corps : est-ce que je suis face aux gens ? Est-ce que je me retourne ? On peut aussi travailler sur la mise en scène, c’est aussi une dimension importante. |
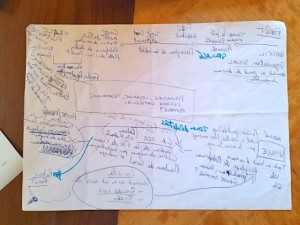
Photo: Nicolas Sidoroff
Scène 2 : les mêmes, plus tard
|
Delphine : Dans cette scène, Camille descend dans la cité sous-marine. Louis : Ouais tu vois, on pourrait avoir des bulles qui flottent à l’extérieur, et puis il y aurait des câbles qui tombent dans l’eau. Delphine : Je le dessine. |
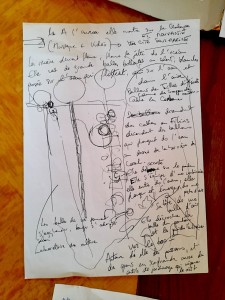
Photo: Nicolas Sidoroff
Scène 3 : les mêmes, la biocratie
|
Louis : Concernant le contrôle du climat, c’est l’idée de percer les nuages pour provoquer la pluie. Delphine : Tu vois, le « solutionnisme technologique », je sais qu’il faut qu’on le case quelque part, mais je ne sais pas où. Il y a des choses comme ça : la biocratie. Louis : Camille de Toledo [25] m’a vraiment beaucoup inspiré sur la biocratie. Je suis allé à une de ses conférences sur « Les témoins du futur », dans le cadre du « European Lab ». En fait, ce qui m’a vraiment plu, c’est qu’il parlait d’un futur où l’on allait réussir à améliorer le monde tout en le changeant, j’ai été beaucoup touché par le côté émotionnel. Et en plus, c’était quelque chose qui était très facilement réalisable dans le monde dans lequel on vit, c’était de se dire qu’on donne le droit à la nature d’être représentée comme une personne morale au même titre qu’une société. Et en gros, ça donne le droit à la nature d’attaquer les gens qui la détruisent. J’ai trouvé ça très intelligent, parce que cela se joue vraiment sur une chose minime. On a toujours tendance à se dire qu’il faut changer énormément les choses pour réussir à faire bouger le monde. Et, en fait là, non, ce ne sont vraiment que les petits détails qui comptent et on est capable de changer grâce au système qui existe déjà. Delphine : Camille de Toledo, voilà, il est là, il a imaginé que dans le futur, il y aurait des maisons qui avaient été détruites pour faire des zones de pluie à carbone. Et les gens qui n’étaient pas contents décidaient de porter cela devant les tribunaux. Son histoire est pour moi très émotionnelle. Il y a un enfant qui dit : « Mon père est revenu en pleurant. Il avait les larmes qui coulaient et je me demandais pourquoi il pleurait comme ça, pourquoi il était si triste, qu’est-ce qui s’était passé ? » En fait, il pleurait de joie en disant : « Les abeilles ont cessé de mourir. Si les abeilles cessent de mourir, ça veut dire qu’on est en train d’y arriver ». Il imagine qu’il y a un vrai changement, sur les femmes aussi. Camille de Toledo, c’est lui qui nous a donné cette idée de lancer des procès : le lac d’Annecy contre les propriétaires du lac, Danube contre la mairie de Vienne, la mer du Nord contre les tankers russes, la Haute-Méditerranée contre Canal de Suez, les Association des forêts primaires contre les producteurs de charbon. Après, moi, ça me tient à cœur, aussi, de dénoncer, même si ça m’a replongée dans le truc pas cool. C’est vrai, quand tu replonges là-dedans, aïe-aïe, tu te dis, ouais, c’est pas possible là ! Louis : Alors ça, je trouve peut-être ce que tu dis un peu trop négatif, cela implique qu’il y a quelque chose de négatif dans le monde, dans ce monde parfait. Ben « parfait » ici c’est entre guillemets, ce n’est pas parfait, mais dans ce monde désirable. |
Scène 4 : la coulée de boue
|
Delphine : Et puis, qu’est-ce que notre héroïne fait là ? Qu’est-ce qu’il lui arrive ? Quelle est la base de la technique, surtout ? Louis : Tu écris, tu vas utiliser beaucoup de papier, tu vas écrire beaucoup de choses qu’on ne va pas garder. Delphine : On n’a pas la fin, on n’a rien, on part sur quelque chose dont on connaît le début, mais on ne sait pas où on va aller. Qu’est-ce qui fait partir Camille à la fin ? Louis : Une coulée de boue. Delphine : Une coulée de boue, ça ne me paraît pas évident comme résolution du problème de la fin. Louis : Ben, on va quand même choisir ça, parce que c’est ce qui convient le mieux. |
Scène 5 : le propel stretch
|
Delphine : Il y a cette histoire du propel stretch. Écoute, qu’est-ce que c’est exactement tes propel stretches ? Louis : Le propel stretch est un tissu élastique qui se tend. Delphine : Parce que là, tu les accroches où ? Tu vois, à quoi tu les accroches ? Ça s’étire, OK, puis après ça, qu’est-ce qui fait que ça lâche ? Parce que si tu es accroché, comment tu te lâches ? Louis : Elle l’accroche à une branche, elle le tend, puis elle se lâche et ça la propulse dans le ciel et comme ça, elle peut faire 50 km quand même, hein ! Delphine : Il faut qu’elle ait un casque, il faut qu’elle ait un masque ! Louis : Peut-être qu’il ne faut rien dire, on laisse les gens imaginer les choses. Delphine : Oui, d’accord, on l’imagine et ça ne choque pas trop les gens. On ne veut pas trop d’incongru. On veut que ce soit quelque chose qui soit vraiment possible à imaginer. Il n’y a donc pas la magie qu’on trouve dans les contes. Par exemple, il n’y a pas d’animaux qui parlent, alors que dans les contes, fréquemment, un oiseau parle, un cerf parle, là, non, les animaux ne parlent pas. En tout cas, on ne comprend pas leur langage. |
Scène 6 : La zone désaffectée
|
Louis : Il y a une zone désaffectée. Delphine : J’écris « zone désaffectée » en couleur. Louis : Ce n’est pas forcément écrit, là, en projection. En fait, ça fait partie du trajet : ici c’est la ville, la prairie, et il y a la zone désaffectée, tu sais, où il y a des usines en ruines qui sont en reconversion, c’est tout ce qu’on trouve dans la ville. Tout en haut de la ville, en fait, tout est en recyclage de plateformes pétrolières. Delphine : J’écris : « Animaux, ponts de singes, hôtels à insectes ». Tout ce que dans l’imaginaire on voudrait qu’il y ait dans cet endroit. Globalement il faut qu’on touche un peu à tout sans aller à chaque fois vers les mêmes choses, parce que tu peux vite être trop répétitif. Louis : C’est un vrai casse-tête. Delphine : Par exemple, je voudrais parler quand même des femmes, d’un lieu où l’on prend soin des personnes âgées, où les enfants naissent, qu’il y ait un lieu pour ça. Ce n’est pas évident de parler de tout cela et en même temps de continuer l’histoire de la quête de Camille. C’est dense, parfois il faut faire des choix, ce n’est pas évident de tout conjuguer, d’éviter que ce soit lourd et en même temps de dire tout ce qu’on veut dire. Je voudrais parler de l’eau, je voudrais parler de toutes ces terres rares. « Pfff » je voudrais parler de l’argent « lala », le problème c’est qu’il y a tellement de sujets. Louis : On commence par se dire « on garde tout, à peu près tout ce qu’on veut » et après, il faut enlever pas mal de choses. Delphine : Mais ça, ça ne sert à rien de dire ça, on ne va pas parler d’argent. Louis : Ben oui, on enlève. Delphine : Oui, parce que cette histoire est tellement dense ! |
Louis :
C’est Delphine qui écrit le texte vu que c’est elle qui parle. Je dis « il faut dire ça », et elle l’écrit. Elle prend des notes, je lui donne les lieux et les humains, elle écrit et après elle commence à le raconter. Quand elle a le temps, elle s’enregistre et nous envoie une version, et puis après elle retravaille là-dessus et jusqu’à ce que cela l’aide à faire son chemin dans sa tête, elle a un déroulé, et ça fait qu’elle peut enlever des bouts et en rajouter d’autres. Elle envoie de l’audio ou du texte, ça dépend, et souvent les grands trucs on les fait en résidence.
Delphine :
Louis sur le canapé n’écrit pas, c’est moi qui écris. Lui, il est plutôt sur son téléphone pour chercher les choses. Par exemple, récemment on cherchait les cités sous-marines, il va chercher pour voir à quoi ça ressemble, ce qui existe vraiment, pour pouvoir peut-être s’en inspirer. Ou quand je lui dis : « Ah ! donne-moi un synonyme de ça parce que je suis en train d’écrire, je ne trouve pas le mot ». Hop, il cherche. Je lui pose des questions : « Ah ! parce que ça, tu penses qu’elle va faire comment si elle a fait ça, est-ce possible qu’elle préfère faire ça ? » Louis : « Ah oui attends, non mais c’est parce qu’elle fait comme ça tout simplement ! », et moi : « OK, ah oui, t’as raison ». Voilà.
Louis :
Après c’est une question de détail, je retouche très peu ce qu’elle fait, je donne mon avis, mais je ne vais pas lui dire : « Dis comme ci, dis comme ça ». Je sais que c’est elle qui va dire le texte. Delphine ne considère pas qu’elle improvise, il y a toujours un texte, mais elle le modifie au fur et à mesure qu’elle parle, elle considère que c’est de la mémorisation, la manière dont son cerveau mémorise ce qui va sortir, mais elle modifie un peu le texte. Après elle réécoute sa voix enregistrée en train de lire le texte et elle change des choses en conséquence. Au moment où elle l’apprend par cœur, il se modifie tout seul dans sa tête. Elle a une carte mentale qu’elle s’est faite de l’endroit où ça va, un chemin qui se déroule.
Delphine :
Je n’ai pas de problème de mémorisation parce que une fois que j’ai pris ce chemin-là, je sais que ça va tout droit et que ça roule. D’habitude, je prends un texte qui existe, je prends une histoire qui existe, que j’ai entendue ou que j’ai lue, donc j’ai un texte, j’ai quelque chose, une histoire traditionnelle de base. Après, je mets les mots que je veux, mais l’histoire existe. Parfois j’improvise autour du texte. Mais je travaille souvent l’improvisation chez moi, je garde le fil de l’histoire, je ne la trahis pas. Même si les textes sont parfois complètement écrits, si un texte est effectivement bien écrit, et que tu as un refrain, cette espèce de petite fredaine, c’est bien de le respecter, parce que ça donne du rythme à ton récit. Souvent, les histoires sont quand même bien écrites, mais après, tu peux vraiment transformer la manière dont l’histoire est écrite et la raconter vraiment autrement. Mais la plupart du temps, tu gardes le fil de l’histoire. Quand c’est moi qui écris le texte, je peux faire ce que je veux. Quand je travaille sur un texte, je cherche les mots comme si j’avais un public devant moi et quand je trouve une phrase qui tilte, paf ! je l’écris vite, hop ! OK, bon. Alors à haute voix je la répète et puis je continue. De fixer ce que je dis par écrit me permet de ne pas l’oublier, ce serait dommage quand on trouve une belle phrase qui a une belle musique. C’est quand je trouve mes mots, ma musique, qu’elle s’imprègne tout de suite, je m’en rappelle parce que ça colle bien. C’est quand je trouve les mots justes que je peux le mieux m’en souvenir.
22. Les dessins et leur animation. Louis et Maxime H.
Scène 1 : Coup de téléphone entre Maxime et Louis
|
Louis : Allo, Maxime ? On a décroché la subvention de l’Appel à projet immersif de l’AADN. Ben, ça y est, on fonce, quoi. Maxime : Cette fois-ci, on y va. Mais moi, je ne sais pas faire de la bande dessinée, je ne sais pas faire du motion design, je n’ai absolument pas les compétences pour faire ça. Franchement, je ne vois pas du tout où je vais. Ah ! Louis, si ça se trouve, il va falloir que quelqu’un m’aide parce que je ne dessine pas spécialement des personnages, en tout cas, pas des personnages animés, je fais beaucoup plus de décors. Comment on va faire ? Et en plus, on a gagné une subvention pour être immersif, donc, sous dôme. Moi, je ne sais pas faire un dessin qui se tord sous un dôme, donc, il y a quand même pas mal de défis. Mais bon, on va bien voir, on y va ! Louis : À mon avis, pour adapter le dôme au frontal, je vais avoir besoin de temps au lab. ou bien il faudrait qu’on ait encore une résidence tous ensemble. Je n’ai pas l’intention de t’intégrer dans la plupart des résidences parce que je sais que tu viens d’être papa et je sais ce que cela veut dire. Ce n’est pas la peine pour toi de venir, vu que tu ne joues rien « en direct » entre guillemets, il n’y a pas besoin forcément que tu sois là, même si pour la cohésion c’est toujours plus intéressant que tu sois là. Maxime : Les résidences, en théorie – il y a la théorie et la pratique – tout est déjà fait, puisque tous mes dessins doivent tous être prêts. Sauf que si c’est la première fois qu’ils sont projetés, ben je me rends compte que mon arbre que j’ai dessiné est trop petit, ou qu’il n’apparaît pas très bien en termes de contraste, donc il y a beaucoup d’allers-retours avec toi, Louis. Louis : En fait, j’intègre les images dans mon logiciel qui les projette. Maxime : Et au fur et à mesure que tu me les projettes, je me dis souvent, « Ah ! non, je ne vais pas laisser ce dessin, il n’est pas adapté ». Ou je fais des modifications. Donc les résidences, ça sert à ça. Il faut que je sois là vraiment dès le début pour faire les allers-retours avec toi quand tu mets en place le récit pour voir si c’est adapté au lieu. Alors comment va-ton travailler ? Louis : On travaille d’abord tous les deux séparément. Il faudrait que tu dessines une usine pour la fin du conte. Maxime : Ah ! non, je n’aime pas trop comme ça ! Louis : Ils sont où tes dessins pour les deux gros projets « Nuit Blanche » à Paris ? Tu les as faits ? Je peux passer chez toi pour les voir ? Maxime : Je vais les mettre dans la Dropbox, tu peux aller les voir régulièrement. Il y en a des nouveaux. Louis : Voilà, il faut que tu me dessines une ville où les immeubles et la nature sont entremêlés. Ils sont entremêlés, mais quand même de façon distincte, c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait des passages pour les animaux et après, il doit y avoir d’autres passages pour les humains, et voilà, vas-y quoi. Maxime : Ben, je n’ai aucune idée… Je vais te faire 3 ou 4 croquis, mais franchement, là, je n’ai aucune idée. Il faudra qu’on prenne pas mal de café ensemble. Louis : Je ne te fais jamais chier, tu fais ce que tu veux. Enfin si ! ouais, je te fais chier ! C’est bien ce que tu as fait avec le dessin de la ville, mais, hop là, je vois que tu as dessiné la ville vue d’en haut. Il faudrait qu’on la voie du dessous, comme ça, ça serait mieux, tu vois. Il faut me refaire la ville. Maxime : Ça va, je suis reparti pour 20 heures de dessin pour refaire la ville. Louis : Oui et on va voir cette image que pendant trois secondes à un moment donné, alors que je sais que ça t’a pris énormément de temps. Maxime : C’est un peu frustrant. Louis : Si tu ne le fais pas, cela ne va pas me déranger, tu peux tout aussi bien ne pas suivre mon avis. |
Maxime :
En ce qui concerne les moyens d’adapter les dessins pour pouvoir les montrer sous le dôme, au début je n’avais aucune idée de la taille, du niveau de précision dont j’avais besoin pour faire les dessins. Je ne savais pas, quand j’allais mettre mon dessin dans le dôme, s’il allait être trop petit ou trop grand, donc en fait, j’ai fait en sorte que le dessin puisse se répéter latéralement. C’est-à-dire que quand on a le dessin, si on fait une photocopie, par exemple, et qu’on le met à gauche du dessin initial, alors il se raccorde parfaitement, et donc voilà, c’est infini. Je me suis dit que si je dois dessiner une forêt, je commence à dessiner quatre arbres, et je sais qu’après, je peux reproduire le motif à l’infini. Donc je pensais pouvoir changer, de réadapter ma production en fonction, si je me rendais compte qu’il me fallait reproduire quatre fois mon dessin pour faire le tour ou s’il fallait huit fois, je pensais ainsi pouvoir me régler comme ça, sachant qu’après, si c’est vraiment trop décalé, j’aurais à étirer un peu mon dessin pour être à la bonne hauteur. En tout cas, j’ai fait ce pari de reproduire le motif.
Scène 2 : Maxime et un membre d’une équipe technique
|
Un membre d’une équipe technique : Bonjour Maxime. Tu as une question ? Maxime : Comment faire pour adapter l’image à la projection sous le dôme ? Le membre d’une équipe technique : Voilà, il faut que ce soit un rond, donc l’image qui est vidéo projetée, c’est un rond. Maxime : OK, mais moi, mes dessins, ce sont des carrés ! Et surtout, je suis incapable de prédire la déformation que je dois appliquer pour dessiner dans un rond. Le membre de l’équipe technique : Maxime : J’ai cherché hein ! j’ai cherché sur internet, j’ai fait des tests, je n’y arrivais pas du tout ! Ça me faisait une déformation trop bizarre, et j’ai fini par trouver qu’effectivement, je pouvais tordre le dessin en demi-cercle, et dans ce cas, je pouvais faire un copier-coller en symétrie, et cela produisait un cercle complet que je pouvais vidéo-projeter. Et après cela, une fois que ça, ça marche, c’est vraiment comme une machine, c’est-à-dire qu’après, quand je fais un nouveau dessin, j’utilise la même commande, et le travail se fait automatiquement. Une fois que j’ai un nouveau dessin, il est traité par la machine, et il ressort avec la bonne taille, la bonne déformation, et après, je peux éventuellement faire des petits réglages. Une fois sous dôme, c’est quand même le moment de vérité et je me dis : « J’ai bien anticipé par rapport à la dernière fois, mais peut-être que dans ce dôme-là, ça nécessitera une petite mise à l’échelle ». Donc, à chaque nouvelle résidence, il y a, avec Louis, un temps de réglage, où je dois souvent lui redonner tous les contenus un par un pour les remettre à l’échelle. |
Louis :
En fait sur l’animation des dessins, je récupère un dessin que m’a fait Maxime, qu’il a déjà inversé pour que le fond soit noir à la place d’être blanc. Quand on est sous le dôme, il a déjà traité l’image pour l’adapter au dôme. Et moi à partir de là, je les allie pour en faire ce que je veux, sachant que le but de l’animation, c’est vraiment de faire un truc très simple au début de l’histoire, et de le complexifier au fur et à mesure du récit. Je rentre une image dans le logiciel et grâce à ça je peux l’animer, la déplacer, et mettre des effets par-dessus, des effets de style. Pour animer les images il faut que je lance quelque chose, qu’elles se déplacent d’une certaine manière, à une certaine vitesse, qu’elles montent et qu’elles descendent, etc. Voilà, à la base, le logiciel n’est pas fait pour faire ça, mais je m’en sers de cette manière. Après je fais des fondus, soit un fondu au noir avec une autre image, ou bien l’autre image qui apparaît par-dessus une autre, ou d’autres options. Et je fais bouger des trucs à l’intérieur de l’image, ou je rajoute un calque, c’est-à-dire que je rajoute une autre image par-dessus la première et je la fais bouger. Par exemple, je fais monter les masques du Grand Conseil, enfin voilà, des trucs assez simples. Et pendant toutes mes premières résidences je galère à appuyer sur les manettes, à faire monter les images. Après je dois revenir en arrière : une fois qu’on a fini la boucle qu’on a fait, il faut que je reprenne tout depuis le début, que je me souvienne où sont les choses pour les remettre à zéro pour pouvoir après les relancer, pour que, quand je reclique sur le truc, ça redémarre l’animation au bon endroit
J’avais fait un clip pour Kunta, qui est le groupe de Yovan, j’ai participé avec eux à une résidence au LabLab, où je faisais la partie de projection vidéo (il y avait quelqu’un qui filmait), et c’était une galère de fou, parce que j’étais sur Resolume, et eux avaient un truc où c’est timé sur leur Medlay [26] qu’ils ont fait à la seconde près. Et du coup, le vidéaste a refait exactement le même plan sept fois pour pouvoir faire son montage à l’intérieur. Ça voulait dire que toutes mes vidéos devaient être timées au poil de millième près. Et ça nous a pris deux jours, c’était interminable. Alors je me suis dit : « Plus jamais ça, c’est vraiment trop horrible ! ».
Scène 3 : Louis, un collègue et le logiciel Chataigne
|
Un collègue : As-tu entendu parler d’un autre logiciel qui peut piloter ça, qui s’appelle « Chataigne » qui a été conçu par un lyonnais, Ben Kuperberg ? Avec Chataigne, tu aurais pu lancer, clip par clip, tes trucs et ça aurait pu être dans une timeline mais vraiment à la seconde près. Chataigne est une espèce de tableau de bord qui fait communiquer les différents logiciels entre eux. |
Louis :
Donc, je me mets sur Chataigne, je fais des tutos simples, il y a une documentation, etc. J’arrive plus ou moins à lancer mon premier clip tout seul : si j’appuie sur telle lettre du clavier ça lance le clip. Mais après, j’ai découvert qu’il valait mieux le placer sur une timeline, parce que si je dois utiliser toutes les touches de mon clavier, je risque de me tromper de touche et ça ne marchera plus. Avec la timeline, chaque fois que j’appuie sur la barre espace, je lance un truc, et je peux appuyer une deuxième fois pour l’arrêter.
Scène 4 : les mêmes plus tard
|
Le collègue : Je vais te montrer comment utiliser les cues, de sorte que le truc s’arrête automatiquement au bon moment. Louis : Mais quand j’utilise les cues, il arrive souvent que deux choses se déclenchent quand j’appuie sur espace : Ah ! non ! pas ça ! Le collègue : Ah ! oui, c’est vrai pas con ! Louis : On pourrait se servir du téléphone pour le faire ? Le collègue : Tu peux essayer, ça marche aussi. |
Louis :
Du coup, ça marche aussi, mais je ne peux pas tout faire, parce que Chataigne ça marche bien pour le Resolume, mais je n’arrive pas à récupérer les dessins, enfin je ne peux pas réadapter le Live Drawing avec Chataigne. C’est-à-dire que je ne peux pas le faire tout le temps, enfin il faut que je sois tout de même derrière mon ordinateur à certains moments, notamment quand il y a la participation du public, ne serait-ce que pour voir ce que les gens écrivent. Quand j’ai des galères, j’appelle les copains au téléphone pour savoir comment faire les choses. Dans tous les projets, c’est tout le temps comme ça.
Scène 5 : Louis et le logiciel Chataigne
|
Louis : Grâce à toi, Chataigne, j’arrive à me faire une time line. Chataigne : Oui tu me donnes des éléments. Louis : Voilà un élément, tu lances ce truc-là, tu le fais monter jusque-là. Chataigne : Tout ce que tu faisais à la main, je le fais tout seul automatiquement. Voilà cinq images de faites. Louis : Et là tu me remets la première à zéro, enfin par exemple telle coordonnée à 5000 pixels tu me la remets à zéro et tu remets une opacité de 100%. Chataigne : Oui, Louis, avec plaisir. Grâce à moi, tu topes tous tes trucs maintenant, tu n’as plus besoin de cliquer, de chercher, de déplacer les choses. Louis : Grâce à toi, je n’ai plus qu’à appuyer sur « espace », ça déroule le truc et voilà. |
Scène 6 : Louis et Maxime. Projection sous le dôme
|
Louis : Grâce à un autre logiciel, j’ai pu dépasser les contraintes qui étaient les miennes au départ. Par contre, quand on est passé sous le dôme, il y a eu vraiment un moment de flottement, parce que tous mes trucs qui étaient des travellings de gauche à droite, de haut en bas, en diagonale, sous le dôme ça ne marche pas. Parce que si tu bouges de gauche à droite, ben là tu n’as plus rien, il n’y a plus d’image et ça fait un peu bizarre. Parce que sous le dôme, l’image est carrée, 7000 par 7000 ou 8000 par 8000, où en haut, en gros, c’est le centre de l’image. Maxime : Je fais des dessins sur un format carré de 4000 par 4000 pixels, ensuite, je les balance dans mon logiciel pour en faire des cercles. Pour faire mon demi-cercle, je suis obligé de copier un deuxième dessin pour produire un rectangle de 4000 par 8000 pixels. Je multiplie ensuite le demi-cercle par deux pour obtenir symétriquement un cercle complet. Donc je sais qu’en général, quand je fais un dessin 4000 par 4000, il apparaîtra 4 fois sous le dôme. Le centre du cercle, c’est le point le plus haut de l’image dans un dôme et c’est là où la déformation est la plus forte. Donc je n’ai pas intérêt à trop m’approcher du centre, parce que sinon mes dessins, ils sont vraiment très, très écrasés. Comme on a beaucoup de scènes d’extérieur, souvent mes dessins sont rectangulaires. Et quand je les passe sur l’ordinateur, « hop », j’augmente la surface de la page en haut et ça me fait un format carré. Et il y a juste certains éléments qui m’ont obligé à changer de stratégie : par exemple, on est dans une bibliothèque, avec des livres jusqu’au plafond, j’ai fait vraiment un dessin assez petit, un motif que j’ai multiplié peut-être 50 fois, comme un papier peint et donc après, là, j’ai pu le mettre jusqu’en haut. Le motif est multiplié en largeur et en hauteur, donc le dessin doit pouvoir se superposer à lui-même à la fois verticalement et horizontalement. Louis : En fait, j’ai mis un peu de temps à comprendre comment on fait, et après de comprendre que si je voulais animer mon image, il fallait que je zoome à l’intérieur de ce carré de 7000 par 7000 pour qu’on voit un déplacement comme ceci ou comme cela. Donc je zoome et je fais des rotations, voilà. J’ai pris une suite de plug-ins d’effets sur Resolume [27] qui sont spécialement adaptés pour le dôme et qui me permettent de faire ce qu’on appelle « Fisheyes rotations ». |
Maxime :
J’aurais pu choisir une façon beaucoup plus simple de dessiner pour correspondre aux divers formats de projection. J’aurais pu, je pense, dessiner directement sur un iPad et faire tout de façon informatique. Mais je fais de l’ordinateur toute la journée quand je suis architecte, je voulais vraiment passer par le feutre. Donc déjà, je pense que j’ai fait un choix un peu archaïque : tout part d’une feuille de papier et d’un feutre. Pour que les dessins puissent se suivre, je fais mon premier dessin, ensuite, je fais comme un marque-page qui fait la même hauteur que le dessin que je viens poser à droite du dessin, donc je prolonge le dessin, je prends mon marque-page, je le passe de l’autre côté de la feuille, et là, je reprolonge et je fais en sorte que ça marche. Et c’est ce petit marque-page que je peux glisser à droite et à gauche qui va me faire la continuité des dessins. C’est vrai que là, c’est très simple à montrer, mais assez difficile à expliquer.
Parfois, j’ai travaillé avec du papier calque : au début de la pièce, il y a une forêt et ensuite, il y a une ville dans la forêt. Donc j’avais deux solutions : soit je restais archaïque, et je redessinais une deuxième fois la forêt en ajoutant la ville, soit je prenais une feuille de papier calque à l’ancienne et je dessinais ma ville par-dessus. C’est ce que j’ai fait, j’ai gagné pas mal de temps, j’ai pu plus me concentrer sur d’autres choses. Donc, il y a quelques fois où le dessin final n’existe pas vraiment, il n’est pas complètement sur un seul papier. Il n’est pas utilisable tel quel pour une exposition. À un autre moment, il y a un vaisseau volant, j’ai dessiné d’abord ce vaisseau vide, parce qu’on n’avait pas trop de temps. Et je me suis dit, ce n’est pas grave, je vais mettre une feuille par-dessus et je vais dessiner tous les personnages et comme ça, si je me rate sur un personnage, ce n’est pas grave, je ne vais pas perdre mon vaisseau, j’aurais droit à un deuxième essai. Quand je n’ai pas tout à fait confiance, je me donne cette possibilité d’avoir plusieurs épaisseurs de dessin que je peux après faire fonctionner ensemble sur l’ordinateur. C’est une liberté qui est assez agréable, quand on dessine, tout part de la main, mais après, on peut réassembler, on peut corriger, on peut gommer aussi.
Sur l’ordinateur, ça peut m’arriver que j’aie des petites jonctions qui ne soient pas toujours parfaites, étant donné ma fameuse technique archaïque de marque-page, donc ça me demande un peu de reprise. C’est ainsi que j’ai plus gommé pour faire des ajustements, que dans le cas d’avoir à refaire un dessin à cause d’une mauvaise trace, comme une goutte de café qui tombe accidentellement sur mon dessin qui est fini. En cas d’erreur, j’ai l’ordinateur qui peut me sauver.
Scène 7 : Louis et Maxime
|
Maxime : Là, le dessin est trop petit, là tu me l’as tordu, là ça ne va pas. Louis : Mais là, ce dessin-là, il ne sort pas bien, il n’est pas assez contrasté ou il est trop petit. Maxime : Je vais bosser dessus. Louis : Non mais là ça ne va pas, c’est trop petit, c’est moche. Je devrais le modifier. Maxime : Mais je ne pensais pas que tu arriverais à trouver autant d’effets différents pour que ce ne soit pas ennuyeux et que ce soit logique avec le fil du récit. |
Maxime :
Les croquis sont réalisés en noir et blanc et de façon très lâche, c’est-à-dire que je laisse un peu le poignet guider et quand le croquis commence un peu à prendre forme, je passe en couleur pour distinguer un peu les différents éléments.
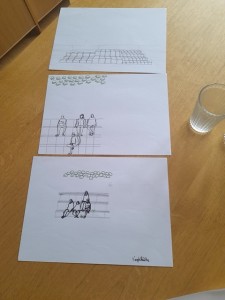
Maxime :
Ma façon de dessiner est basée sur des motifs qui se répètent. Dans les croquis, j’essaie d’abord de trouver les ingrédients de la recette et puis après, je cuisine les choses à partir de là. Par exemple, il y a beaucoup d’arbres dans les dessins, donc, je trouve un peu la bonne forme d’arbre.

Maxime :
Ensuite, si c’est une ville, je trouve le motif de façade et dans le cas de la ville, il y a des passages pour les animaux. J’ai trouvé une solution : ils sont suspendus sur des ballons. Et après, tout s’est un peu assemblé et je fais en sorte que ce soit toujours enchevêtré, mais si on voit bien que ça s’enchevêtre, pourtant ça ne se cogne pas. C’est un peu comme ça que je fais mes dessins, pour avoir une espèce d’harmonie entre plein d’ingrédients.
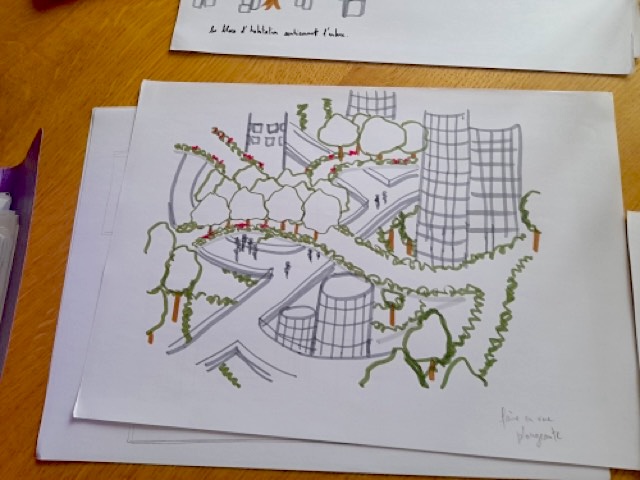
Maxime :
Mes premiers croquis, c’est au stylo, pas au crayon de papier. Et après, quand j’en arrive vraiment au dessin final, j’utilise le crayon de papier pour tirer un peu les grands axes, c’est-à-dire que cela donnera la silhouette des grands éléments. Et après, je les dessine tout de suite au feutre. Et à la fin, je gomme mes petites silhouettes que j’avais faites au début. Donc il y a bien quelques lignes qui structurent le dessin.
En général, je fais mon dessin au crayon de papier et je le gomme à la fin, j’ai assez peu besoin d’y revenir. J’ai juste fait quelques dessins où, d’habitude, j’essaie de faire abstraction des règles de perspective, je les respecte un petit peu, mais je suis assez libre. Il y a quelques scènes qui sont en intérieur et j’avais envie d’avoir de bonnes proportions, donc là, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a quelques dessins où vraiment, j’ai passé je pense 2 ou 3 heures juste sur le crayon de papier à dessiner, gommer, dessiner, gommer jusqu’à ce que j’aie vraiment trouvé le dessin et pour le coup, je redessine entièrement au feutre, mais c’est presque plus un travail de mise en couleur. Pourtant, il y a beaucoup de dessins où il s’agit d’une ébauche très lâche qui devient tout de suite un dessin achevé. Dans mes dessins, j’utilise différentes démarches.
Il y a une partie de la pièce où l’animation des images est prédominante et au début, je ne sais pas comment on va faire. Je fais plein de dessins, mais je ne sais pas comment on va faire pour les animer. Je fais confiance à Louis, en me disant qu’il saura comment on fait la transition quand on passe, disons, de la forêt à la ville, il va faire un fondu au noir, ou bien il va faire apparaître l’image progressivement, donc c’est lui qui fait de la vraie création artistique en liant les choses. Il y a donc des personnages, des éléments à intégrer dans l’image, c’est lui qui va les positionner et les faire se déplacer (parce qu’on a des objets qui se déplacent).

23. Une musique traditionnelle du futur ?
Scène 1 : Louis et Yovan
|
Louis : Je veux que tu me fasses de la musique traditionnelle du futur. Yovan : C’est compliqué, car la musique traditionnelle est déjà pleine de codes, ça ne correspond pas à ma façon de travailler. Louis : Je dis ça, parce que je suis sous l’influence de Super Parquet, un groupe qui mixe de la musique électronique avec de la musique traditionnelle du centre de la France, que j’ai vu en concert et qui m’a vraiment beaucoup plu, j’aime bien ce côté un peu musique traditionnelle du futur. Yovan :L’idée est plutôt d’avoir une électronique qui ne soit pas que synthétique, et surtout, et je ne connais pas assez la pratique d’une musique traditionnelle. Laissons les auditeurs imaginer des choses. On peut s’inspirer de beaucoup de différentes sources, ça correspond plus à ma façon de penser. Louis : Si j’ai mentionné l’idée de la musique traditionnelle du futur, c’était pour t’orienter un peu. Yovan : La musique traditionnelle pourrait peut-être me rassurer en prenant l’idée qu’on va essayer de la moderniser, cela pourrait vraiment devenir une base pour mon travail, vu que je n’ai pas trop de règles et que je ne sais pas par où commencer. Mais je préfère dire que je pars d’une musique électronique qui est aussi un peu organique. Louis : Concernant la musique traditionnelle, j’avais parlé aussi avec Jacques Puech [28] grâce à l’Ensemble Aleph et il m’avait expliqué que la musique traditionnelle est en fait une musique beaucoup plus vivante que toute la musique écrite, parce qu’elle évolue continuellement au fur et à mesure du temps. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant effectivement d’aller voir de ce côté-là. Yovan : Ouais, j’aime bien, je vais reprendre des boucles de musiques traditionnelles africaines, ou bien des boucles de je-ne-sais-pas-quoi. Louis : On n’est pas vraiment sur la fonction sociale de la musique traditionnelle, ni sur comment elle est écrite et comment elle se fixe. Yovan : C’est plutôt quelque chose du genre : « Je vais reprendre des bouts de ci, et puis je vais les adapter à ma sauce ». Louis : Et de toute façon, connaissant ta musique, je ne m’attends pas du tout à ce que tu ais une approche de musique traditionnelle. |
24. L’élaboration de la musique. Musique pré-enregistrée ou musique en direct. Louis et Yovan.
Scène 1 : Louis et Yovan
|
Louis : Il s’agit de faire un spectacle immersif avec un musicien sur scène. Yovan : J’aime bien avoir une trame bien définie pour comprendre ce que tu veux. Louis : Je voudrais que tu improvises tout en faisant ta propre musique. Yovan : Je ne veux pas faire ça, pour moi ça ne veut rien dire. Si tu veux que je compose des productions musicales comme des morceaux de musique électronique ou tout ce que je peux faire d’autre, eh bien, il faut le définir dans notre dossier de subventions, il faut qu’on arrive à le mettre en mots. Il faut expliquer les choses, donner des références de musique traditionnelle. Louis : C’est un conte sur l’écologie, sur la planète, sur la nature. Yovan : Alors, il faut peut-être quelque chose de plus que l’électronique, avec aussi des instruments organiques. Mais si tu veux, je peux ne faire que de la musique live avec du violon et des effets. Louis : Mais non, moi j’aimerais que tu composes parce que tu as l’habitude de composer pour d’autres projets, que ce soit de l’électro, de la pop, ou d’autres choses. Yovan : Dans ce cas-là, autant que j’essaye déjà de timer ce qui se passe avec la conteuse pour que la musique corresponde avec des bruitages. C’est plus simple de ne mettre qu’un petit peu de musique live, mais surtout d’avoir une vraie écriture musicale où j’ai plus de liberté pour composer, pas juste de jouer du violon. Louis : Ça serait bien d’avoir plusieurs instruments. Yovan : Je vais essayer de faire quelque chose qui suit un peu la conteuse et ce qu’elle raconte, et après je verrai ce que je peux jouer en live, on verra au fur et à mesure. Vu que je suis tout le temps sur ma souris à être sûr d’envoyer le bruitage au bon moment avec Delphine, alors je ne vais pas tout jouer en live, il faut que je fasse des choix. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vont être pré-écrites, avec cette idée d’avoir des morceaux électroniques, et à un moment donné, comme tu veux du violon, oui, je peux me lever. Mais au début, je reste dans le noir. Louis : Non, il faut qu’on te voit. Yovan : C’est vrai que c’est important qu’on me voit, alors je te demande, est-ce que c’est important qu’on me dessine aussi ? Il faut choisir. Louis : Bon, ben voilà, à un moment il y a du violon, c’est bien. Yovan : D’accord, on voit bien que d’avoir un violon sur scène rajoute quelque chose au spectacle. Louis : Il faut l’assumer. Yovan : Tiens ! là, on est sur quelque chose de différent, on se laisse porter par les images, il y a de la musique en live et je pense que ça donne une respiration dans le spectacle. Et puis c’est toujours bien pour le public de voir un instrumentiste jouer sur scène, c’est plus agréable que de l’avoir dans le noir. C’est petit à petit, au fur et à mesure qu’on se rend compte de ce qu’il faut faire dans la pièce. |
Yovan :
Le dossier de subvention a été écrit en reprenant ces idées et après, évidemment, dans la réalisation ça a pris une forme un petit peu différente. Avant de soumettre le dossier à AADN, Louis m’avait demandé de composer un morceau. Par rapport à ce qu’on avait mis sur le cahier des charges de la musique dans le dossier, j’étais parti sur une instrumentale à partir d’un échantillon de percussion africaine et j’avais réalisé un petit morceau. C’était juste une question d’avoir un peu de musique et après cela a complètement changé. Cet échantillon de percussion africaine a été réutilisé pour un morceau dans le spectacle, c’est le premier segment que j’ai fait, justement quand elle survole la forêt au début. Après cela, j’ai fait le morceau d’intro, avec des sons d’oiseaux et de forêt, parce qu’au début, elle présente la forêt.
Louis :
Franchement, je ne m’attendais pas à ce qu’il utilise sa voix. Il faut savoir que Yovan est en ce moment chanteur et qu’il ne fait quasiment plus que ça. Yovan joue du violon en direct, mais sa voix reste enregistrée, car il a utilisé une superposition de sa propre voix pour produire un effet de chœur, il s’enregistre sur pas mal de trucs. Quand j’ai reçu les premiers morceaux qu’il m’a envoyé, j’ai d’abord pensé que ce n’était pas du tout ce que je voulais, mais au final j’adore. Effectivement, cela n’a rien à voir avec la musique traditionnelle du futur, ce n’est pas ce qu’il fait.

25. La musique et le conte, Delphine et Yovan.
Yovan :
Et ensuite Delphine est arrivée et une fois qu’elle a mis l’histoire en mots, il s’agissait de trouver les moments où j’aurais des espaces pour la musique. J’ai demandé à Delphine de s’enregistrer pour que je puisse écouter ce qu’elle racontait.
Delphine :
J’ai donc envoyé un enregistrement audio de mon texte à tout le monde et ils l’ont écouté chez eux en boucle. Avec Yovan, on a créé un peu ensemble et puis on a eu de la chance parce qu’on s’est tout de suite bien entendu. Il a pré-enregistré de la musique sur ce qu’il avait entendu de moi et on a tous les deux essayé des choses ensemble pour voir comment ça collait. Il y avait des choses qu’il avait faites qui n’allaient pas. Parce qu’une fois que je racontais l’histoire pour de vrai, ça ne marchait pas. Je lui avais envoyé le texte, mais en fait une fois qu’on racontait l’histoire, ça n’allait pas. Il a dû changer et faire un gros boulot d’adaptation à la présence d’une conteuse.
Yovan :
Delphine est surtout celle qui a le plus influencé le résultat sonore final, parce que j’écoute sa manière de raconter l’histoire.
Scène : Delphine et Yovan.
|
Yovan : Tiens, là, ce serait bien de couper un petit peu. Voilà, là, je propose de couper la narration et de mettre de la musique. Tiens, pendant que tu dis ça, ça ce serait bien qu’il y ait un peu de musique derrière pour donner du rythme. Delphine : J’aime bien le fait que tu apportes une musique qui me donne aussi un rythme. Ça m’aide, ça donne un ton, un rythme. Yovan : Ce qui est le plus simple pour moi, c’est de trouver le rythme en fonction de ton texte. Souvent toi et Louis, vous êtes vraiment axés sur l’écriture du conte, alors que moi, je suis plus préoccupé par le rythme [il frappe des coups réguliers sur la table avec sa main], comme ça… voilà, comme ça… Le rythme du spectacle : quand on raconte notre histoire, peu importe combien de temps ça dure, est-ce qu’il y a du rythme ? Delphine : Il faut se demander si ce n’est pas un peu ennuyeux à certains moments ? Yovan : Oui. Dans deux des compositions, je joue du violon. Ce sont vraiment deux moments. L’un des deux correspond à la séquence de la balade, c’est improvisé, j’ai écrit quelque chose de simple, quelque chose que j’ai commencé par jouer, que j’ai développé en improvisant et que maintenant j’essaie de garder tout le temps. C’est lié au rythme du spectacle. Delphine : Je pense que tu es d’accord pour prendre en compte ensemble les variations qui pourraient se produire. Yovan : Oui, tout à fait. Delphine : Si tu entends que je dis quelque chose qui veut dire la même chose que ce que je dis d’habitude, mais pas avec les mêmes mots, il y a toujours un silence qui signale que j’ai fini, alors, tu balances la musique. Yovan : Je vais essayer de faire quelque chose qui suit un peu ce que tu racontes, et après je vois ce que je peux jouer en live, on verra au fur et à mesure. Delphine : Ouais, j’essaye de respecter ce que tu fais, on jongle tous les deux, c’est réciproque. C’est quand même plus moi qui m’adapte à toi, mais tu dois aussi le faire avec moi. Yovan : Pile quand tu dis ça, paf ! je balance cette musique et paf ! tu dis ça. Delphine : Je ne connais pas encore le texte par cœur. Yovan : À ce moment-là, quand tu dis ça, après, il y a un silence, je vais caser cette musique. Delphine : Je suis conteuse, moi ! Comment tu veux que je me rappelle ? Yovan : Il faut aussi trouver des bruitages, parce qu’on en a besoin à certains moments. Delphine : Ils doivent être synchronisés entre toi et moi. Par exemple, à un moment donné où un talisman tombe par terre, il dévale 4 ou 5 marches et puis il s’arrête aimanté à un livre. Là, il faut qu’on soit exactement ensemble, c’est vraiment un bruitage précis. Mais après c’est facile dans le sens où je sais qu’à partir du moment où je commence à déballer ce que je dis, c’est-à-dire le talisman qu’elle a dans sa poche, qu’elle sent dans sa poche, il tombe à terre, ça-y-est c’est parti ! tu l’envoies. Elle sent que dans sa main le talisman bouge et toi, ça-y-est, tu sais qu’il faut que tu envoies le bruitage. Yovan : Les bruitages doivent parfois être fabriqués : par exemple, à un moment il y a une luciole électronique, c’est forcément un cliché. J’ai en tête un son dans Star Wars, où il y avait une espèce de papillon sur Tatooine, une espèce de personnage volant. Tiens, le bruit des ailes, je me souviens de ça, alors on peut essayer de le retrouver – comme Louis adore Star Wars, il connaît peut-être la référence – ce n’est pas évident d’y arriver. |
26. La musique et le conte. Louis et Yovan
Louis :
Ce n’est pas parce que la musique de Yovan a été écrite avant, qu’elle est totalement fixée. Il y a plein de moments où il joue des boucles et il fait pas mal de bruitages aussi pour correspondre à l’action sur scène.
Yovan :
Par la suite on a trouvé d’autres solutions : par exemple, contre un mur, un mur acoustique où il y a des trous (c’est plein de petits carrés dans le mur), et du coup on a mis nos doigts dedans, « Brrlrrlrrlrrlrrlrrlrrl », ça faisait un peu le bruit des ailes, ça fait une espèce de bruit de luciole électronique. J’ai fabriqué ce genre de sons. Sinon je suis aussi allé sur Splice où il y a des samples de sons, la Sonotec. Les sons qu’on a utilisés sont souvent des sons de la nature, après ça dépend des situations. À un moment donné, il y a une histoire de mousqueton quand Camille s’accroche à un câble, il faut trouver un son de mousqueton. Quand on ne peut pas le trouver en ligne, il faut le fabriquer, c’est encore un autre type de travail. À un autre moment, il y a les chasseurs d’éclair qui entament un chant, c’est ce qui est vraiment là dans le texte, donc j’ai fait un chant pseudo-grégorien, ce n’est pas vraiment ça, mais c’est quelque chose d’épique.
Scène 1 : Delphine, Louis et Yovan
|
Yovan : Louis : Yovan : Delphine : Yovan : |
Yovan :
Je chante aussi un peu, j’utilise ma voix pour avoir des chœurs dans mes compositions (en réenregistrant ma voix) ou juste une voix, mais je ne me considère pas comme un chanteur.
Scène 2 : Delphine, Louis et Yovan
|
Louis : Pourquoi ne pas faire chanter le public ? Yovan : Oui, mais à ce moment-là, est-ce qu’on ne va pas perdre la chose ? En fait, on va regarder en l’air et on va voir les chasseurs qui s’élancent pour chasser et je trouve que ce passage est bien comme ça. Delphine : Louis et moi, on voudrait faire chanter les gens. Yovan : Ben voyons ! il faudrait trouver un autre moyen, à un autre moment dans le spectacle. |
Yovan :
Pour moi, c’était beaucoup trop d’idées, c’est ce qui a été difficile, en tout cas au début : décider de ce qu’on allait en faire. C’est que le rôle de Louis était d’imaginer les choses, c’était vraiment une bonne chose, parce que l’univers qu’il a voulu développer est très intéressant, mais il a amené tellement de choses en plus du scénario, l’idée de parler d’écologie, les dessins, la conteuse, la musique, la musique en live, plusieurs instruments (etc.), qu’il a fallu tout simplement faire des choix à un moment donné.
Scène 3 : Louis et Yovan.
|
Yovan : Tiens, ça pourrait être intéressant qu’à certains moments où Delphine raconte l’histoire, il y ait un interlude musical pendant telle ou telle promenade. Louis : On peut essayer d’imaginer ces moments-là. Yovan : Alors j’aurais au moins quelque chose sur lequel je puisse m’appuyer. |
Yovan :
Donc, les choses se mettent en place petit à petit, parce qu’il fallait penser à tout, c’était notre premier spectacle, on n’y avait pas trop réfléchi. Louis avait ses concepts mais il n’avait peut-être pas toutes les clés de ce projet ambitieux. Mais c’est bien, au moins on a appris beaucoup de choses, on a découvert le monde des bruitages, et tout ça.
27. Les conceptions de Yovan sur la musique et de Maxime sur les dessins.
Yovan :
Je connaissais Maxime un petit peu avant. Je n’avais pas vu beaucoup de ses dessins, mais je savais qu’il travaillait dans l’architecture. Je le connaissais aussi via le Live Drawing Project de Louis. Les dessins de Maxime donnent tout de suite l’ambiance, un peu comme un roman graphique géant, c’est ce que j’ai bien apprécié. La question est alors de savoir comment doser le conte, la musique et les dessins. Parce qu’une fois qu’on a les dessins, certains disent : « Tiens, il en faudrait plus », et d’autre disent : « Il en faudrait moins, parce qu’on ne regarde pas la conteuse ». C’était très ambitieux parce qu’il y a tellement de choses, c’est la façon normale de travailler à faire un spectacle. Je n’ai pu voir les dessins que pendant les résidences, parce que Louis les reçoit et il doit adapter leur format pour les projeter dans l’espace dans lequel on travaille. Je me suis dit parfois : « Tiens ! ce serait bien qu’il y ait quelque chose un peu comme une scénographie dans un concert d’électro, où il y a telle image qui apparaît pendant la musique, enfin des calages ». Finalement, ça s’est transformé en tops : « Tiens là, je lance cette musique avec l’apparition des dessins, ce serait bien que tout de suite on soit dans la nouvelle ambiance ». Il y a quelques tops comme ça. Moi, j’aurais bien aimé que ça communique un peu plus, ça communique un petit peu quand même, mais je pense qu’on pourrait aller encore plus loin avec ça à l’avenir.
Maxime :
Ce que j’aime bien dans le conte et ce que je trouve hyper étonnant, c’est vraiment la construction hybride du projet. En fait, on ne se marche jamais sur les pieds et c’est la façon dont Louis a construit l’équipe. C’est lui qui arrive avec un récit qu’il construit au fur et à mesure, avec assez d’informations pour nous permettre d’inventer des choses. Parfois, quand il nous donne des infos, j’ai l’impression qu’il n’a pas vraiment l’image en tête. Alors, je me dis : « OK, je ne sais pas où je vais, mais je vais te montrer un truc, on va voir ». Je pense que c’est la même chose pour Yovan et pour Delphine, où en fait, on apporte nos idées, et après, dans l’échange, on fait légèrement évoluer les choses. Louis est quand même très souple sur ce qu’il veut. C’est-à-dire qu’il sait ce qu’il veut, mais il n’a pas besoin de contrôler la forme de ce qu’il veut. Parfois, je l’ai emmené là où il n’avait pas prévu d’aller, mais il a dit : « OK, ça va dans le sens de ce que je racontais ». Je pense qu’il a bien établi des liens entre nous et qu’on a chacun pu avoir notre « couloir » (entre guillemets) d’expression, qui, du coup, s’additionne sans se gêner, vraiment en s’amplifiant. C’est ça que j’aime bien dans ce projet, c’est qu’on travaille un peu chacun dans notre coin, moi, sur mon bureau, Yovan, je ne sais pas où, Delphine, j’imagine, sur son ordinateur pour écrire les textes et à la fin, on s’additionne et ça donne quelque chose d’encore mieux.
Yovan :
Le format de la composition était un petit peu comme dans la musique électronique, avec l’aspect répétitif qu’il peut y avoir dans la techno, dans la musique électro, et du coup il y a souvent un beat répétitif. La direction que j’ai prise, c’est de partir de quelque chose qui est basé sur un instrument organique, par exemple un instrument chinois qui ressemble à un banjo. Bref, l’idée est de partir d’un instrument de musique traditionnelle, et d’avoir en même temps cet aspect électronique. Je savais que de toute façon les morceaux ne pouvaient pas être trop longs, parce que on s’en est vite rendu compte que quand Delphine racontait l’histoire, et par rapport à tous les mondes que Louis voulait explorer, il serait impossible de s’attarder. Pendant la semaine de composition, je me suis dit : « Tiens ! ça serait bien que j’aie ces trois morceaux, parce que tout simplement je n’aurais pas le temps de faire le reste avant la première résidence où je suis censé avoir tout écrit. Je ne vais pas m’étaler trop sur chaque composition, et éventuellement comme il y a un côté très répétitif, ce sont des choses que je peux faire évoluer sur la longueur ».
Maxime :
Pour moi, c’est Louis qui est au centre du projet, j’ai eu moins d’interactions avec les autres, mais ça n’a pas forcément posé problème. Je trouve que les musiques marchent très bien avec les dessins et je pense que Louis a donné de belles indications. J’ai peu eu les sons à l’avance, donc je ne peux pas dire que les sons que j’ai reçus ont influencé ma façon de dessiner et je ne sais pas dans quelle mesure Yovan a été influencé par les dessins en cours que j’ai envoyés au groupe.
Yovan :
Avec les dessins de Maxime, à un moment donné il est question de vélocité, où en gros il y a un tour de vélo. J’ai regardé les images de Maxime et je me suis dit : « Ben là, ce serait bien qu’on arrive à faire comme avec une soirée électro où il y a la sono qui monte progressivement : au début, il y a le kick et la basse et puis petit à petit des choses se construisent », et ça m’a poussé à proposer cette idée.
Maxime :
Je pense aussi que certains dessins impliquent que la musique est très présente à certains moments caractéristiques : par exemple, à un certain moment, l’histoire se passe dans les nuages, avec des éclairs, c’était assez clair qu’il fallait représenter les choses pour le public. Donc, je dessine les nuages, les éclairs, et lui il a fait des sons d’éclairs, il y a ajouté une mélodie, je l’ai fait à ma façon graphique, lui l’a fait à avec ses sons et on s’est retrouvés au même endroit. Ensuite, il y a une marche dans la forêt, c’est pareil : moi, je vois bien ce que je dois dessiner comme forêt et lui, il voit bien ce qu’on attend aussi d’une forêt. La question à laquelle on doit tous les deux répondre est la même, on arrive à un résultat à peu près bien synchronisé.
Yovan :
J’essaie d’introduire des éléments musicaux, des samples ou des chants : à un moment donné, il y a un chant de musique grecque, à un autre il y a une espèce de cithare chinoise, pour chaque segment de musique, j’essaie de penser un petit peu de cette manière en mélangeant des instruments acoustiques à de l’électronique. C’est quand même assez libre, le postulat de base s’est vite transformé en quelque chose d’autre, car il s’agit vraiment de penser en termes d’illustration sonore de ce que Delphine raconte. Quand elle présente un univers particulier, j’essaie de coller un petit peu à cet univers, comme dans la musique de spectacle ou de film, d’illustrer par rapport au conte. La musique ne doit pas prendre le dessus sur la narration, même s’il y a des moments de musique qui viennent prendre le relais, pour qu’on sente que : « Tiens ! il y a un moment où on peut écouter de la musique avec des dessins c’est sympa », quelque chose comme ça. Il s’agit vraiment de ne pas penser uniquement à la cohérence d’utiliser une gamme ou un concept, mais en plus de se dire : « Tiens ! en fait, il faut surtout que ces différents moments de narration et de musique soient bien dosés ».
Maxime :
J’ai très peu d’échanges en direct avec Yovan, on n’en a pas le besoin. Je pourrais l’appeler, il n’y a pas de soucis, mais on n’a pas besoin de le faire. Alors qu’avec Delphine, il va y avoir plus d’échanges.
Yovan :
En gros, j’ai ma trame, j’ai une session Cubase. J’ai l’impression que ça me fait un petit peu ma conduite de spectacle. Je mets la conduite sur papier, c’est vraiment comme une setlist, j’écris très gros pour pouvoir la voir sur scène. C’est écrit sur une petite feuille discrète et j’ai tous mes éléments principaux sur cette setlist. C’est une automation des évènements, mais le problème, c’est qu’à chaque fois qu’on change d’endroit, parfois on est en 7.1, ou bien on va être en 4.1, donc je suis obligé de changer les choses. Avec mes automations, on va être au milieu, là, on va être tout à droite, là, on va être au milieu, au milieu à gauche, là tout à gauche. Avec la pluie par exemple, il y a d’autres bruitages, voilà, je les mets à gauche… Toute cette introduction, là, [il diffuse un court extrait] je la double au Sequential OB-6 (un synthétiseur analogique) parce qu’une fois que c’est dans les enceintes, ça manque de vraie présence analogique. Il y a des choses que je ne fais qu’au clavier où il n’y a que du bruitage [il joue un autre extrait]. Je presse sur les différentes touches pour déclencher différents effets sonores, c’est vraiment le bazar, je sais à peu près où je dois aller : je vais par-là, après je sais que je dois aller en bas pour déclencher les bruitages qui sont là.
28. Le conte et les dessins. Delphine, Maxime et Louis.
Scène 1 : Delphine, Louis et Maxime
|
Louis : Ben écoutes, Maxime, voilà, il faut que tu me dessines une forêt, c’est parti, avec des animaux dans la forêt, après il faut que tu me dessines des nuages, après il faut que tu me dessines… Maxime : Ah ! oui, là, quand Delphine dit ça, il faut que je rajoute ça. Puis là, il faut absolument que je fasse la machine à la fin. Et puis il faut que je fasse un tableau de commande. Louis : Là, il faut qu’il y ait des bulles qui s’agglomèrent à un câble. Delphine : Ces bulles, je pense que ce sont des espaces de vie. Maxime : J’ai dessiné les bulles avec du corail autour. Delphine : Mais je ne comprends pas pourquoi il y a du corail autour ? Puis, qu’est-ce que tu as mis dedans ? Les bulles sont des lieux de travail pour le corail, il faut qu’on soit d’accord sur ce qu’on raconte, il faut qu’on raconte la même chose, toi en dessin, moi avec le texte. Maxime : Cela ne veut pas dire qu’il faut dire et montrer les mêmes choses en même temps. Delphine : Oui. Si tu dessines ça, ben du coup, je ne le raconte pas, on ne va pas faire deux fois la même chose. Et puis moi, ça m’allège, parce que je dis déjà beaucoup de choses. Dessine les chasseurs, l’éclair, il faut que tu les fasses, qu’on les voie, même si j’en parle dans le texte. Maxime : On est tout le temps en train de se dire : qu’est-ce qu’on illustre et qu’est-ce qu’on n’illustre pas ? Delphine : En général, dans le conte, rien n’est illustré visuellement, il n’y a pas de dessins. Ce que je raconte est laissé à l’imaginaire du public. Louis : J’ai envie que les gens gardent un imaginaire, je n’ai pas envie qu’on leur donne tout. Le conte doit se baser sur l’imaginaire. Delphine : Si on commence par tout leur balancer dans les dessins, alors je ne sers à rien, je ne parle plus : c’est un conte en dessin. Il faut que les gens puissent encore imaginer des choses. Donc on est toujours en train d’essayer de trouver un compromis sur ce qu’on doit illustrer. Maxime : Parfois je me demande : « Ah ! je n’ai pas dessiné ça, c’est dommage, j’aurais bien voulu le faire. » Delphine : Ouais ! Louis : Ben oui, mais plus on en dessine, et plus les gens en veulent. Delphine : Tu vois, ce n’est pas facile de trouver un compromis. Qu’est-ce qu’on dessine ? Qu’est-ce qu’on laisse à l’imagination des gens ? Maxime : Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dessinées. |

Scène 2 : Delphine et Maxime, lors d’une résidence
|
Delphine : Louis m’a demandé de dire à ce moment précis : « des grosses bulles blanches ». Maxime : Delphine : Maxime : Delphine : |

Scène 3 : Delphine et Maxime
|
Maxime : Delphine, tu m’as envoyé au début cinq minutes de texte du spectacle et j’ai fait des dessins dessus. Mais il y a eu d’autres parties où tu n’avais pas vraiment écrit les choses et où j’avais pris de l’avance sur les dessins. Delphine : C’est dans ce cas que je me suis inspirée des dessins pour des petits détails de narration, d’accroche, ce genre de choses. Maxime : À un moment donné, il y a une ville et ce n’est pas évident de décrire une ville si on ne la visualise pas, donc, je pense que ça t’a aidé que je la dessine. Delphine : J’ai pu mieux accrocher des petits détails à l’histoire. Maxime : Il faut que je dessine une route, Camille avance à vélo sur cette route et elle dit qu’il faut qu’elle évite les racines. Pas de bol, je n’ai pas de racines narratives ! Moi, je ne peux pas te dessiner tes racines, à la place je vais dessiner une poule. Il va falloir que tu changes un peu ton texte. À un autre moment, il y a un vaisseau avec des bonbonnes, des paniers qui descendent, des choses comme ça, et je pense que comme tu n’as pas encore écrit le texte et que j’ai fait le dessin, tu peux directement baser tes descriptions dessus. Delphine : Pour la ville, il y a des patios. Maxime : Il faut plutôt parler de coursives ou de choses comme ça. Il est nécessaire de réadapter le vocabulaire de cette manière. |
Maxime :
Mes dessins font partie du décor, ils viennent souvent appuyer la narration, mais souvent la narration et le dessin ne disent pas la même chose. Donc Delphine va passer beaucoup de temps à décrire les actions qui vont se passer et finalement elle n’aura pas trop besoin de décrire le décor puisque ce serait déjà une redite. Donc quand on arrive dans un amphithéâtre, elle va dire : « Voilà on est dans un amphithéâtre ». Mais finalement ça ne m’a pas spécialement contraint dans ce que je devais dessiner. Et ensuite, vu que l’amphithéâtre apparaît, les gens le voient et elle n’a plus du tout besoin de faire une description précise, elle va tout de suite raconter ce qui se passe dans cet amphithéâtre. Parce qu’on a aussi choisi de ne pas représenter l’héroïne du spectacle et de représenter très peu de personnages, sauf quand visuellement c’était assez fort ou que ça permettait d’enlever certaines ambiguïtés. Au départ on avait vraiment presque envie qu’il n’y ait aucun personnage, mais on s’est dit que c’était une règle qui était trop stricte et que, finalement, il n’y avait pas de raison d’être aussi dur à se l’imposer, que ce n’était pas grave, il pouvait y avoir des dessins de personnages. Donc Delphine et moi, on est côte à côte et le résultat est une amplification qui s’additionne sans jamais faire baisser la qualité, on s’est bien mis dans des rails qui ne se gênent pas.
Par exemple, à un moment donné, on a une femme géante qui apparaît et du coup j’ai fait un dessin géant. C’est quelque chose qui visuellement est assez beau parce que quand on est sous un dôme, je peux vraiment mettre un personnage très, très grand. Et ça marche très bien puisque dans ce cas-là, la conteuse finit par incarner l’héroïne qui est petite. J’aime bien cette ambiguïté, je ne sais pas dans quelle mesure elle est prévue à la base puisque la conteuse est censée être la narratrice. Mais forcément il y a des moments où je pense que le public la perçoit un peu comme le personnage principal, car elle parle parfois au nom de l’héroïne. Je pense que c’est aussi le rôle d’une conteuse : personnifier un peu tous les personnages et être en même temps narratrice. Le fait de ne pas mettre trop de personnages, le fait de ne pas représenter le personnage principal, ça a fait que le public ne sait pas si la conteuse est le personnage principal ou le narrateur, alors qu’en fait elle est les deux à la fois, en jouant avec cette ambiguïté. Je ne sais pas dans quelle mesure avec Louis, c’est assumé, mais je trouve que c’est bien.
On a eu un débat pour savoir s’il fallait ou non montrer les personnages. Concernant la figure géante on a testé avec le public et on a eu de bons retours là-dessus. À un moment on l’a enlevé et on a trouvé que c’était moins bien, on aimait bien quand elle apparaissait.

29. La sonorisation
Yovan :
En général, on joue avec un sonorisateur et on travaille sur cet aspect. À Nantes, on avait un excellent ingénieur du son, l’équilibre a été fait sur une semaine, on travaillait tous les jours. Dans certaines résidences on nous a dit au dernier moment : « On vous prête cette salle-là, par contre, vous n’avez pas de sonorisateur ». Delphine peut être tendue parce qu’on manque de temps avant la performance en public. Le son dans ce cas n’est pas très bon. L’équilibre entre la voix de Delphine et la musique est essentiel, s’il n’est pas très bon, ça peut porter préjudice au spectacle. On a donc beaucoup travaillé sur ce point.
Delphine :
Avant le « Conte d’un futur commun », ma voix n’avait jamais été amplifiée. Le guitariste avec lequel je jouais avait une guitare acoustique. L’amplification me fait un effet très bizarre, très étonnant, cela a changé ma relation au public : je peux parler tout doucement, je peux chuchoter, ça dépend aussi de la qualité de l’amplification, qui a été très bonne, par exemple, quand on a eu un bon ingénieur son et très mauvaise à d’autres moments.
Yovan :
Le problème, c’est qu’à chaque fois qu’on change de salle et d’équipements, et qu’on n’a pas d’ingénieur du son attaché au groupe qui sait déjà exactement ce qu’il faut faire en deux minutes, on doit s’adapter. Mais quand il y a un bon ingénieur du son, j’ai été bien aidé, notamment j’ai appris à me servir de Dante pour le mixage en 7.1. C’est une carte-son numérique qui est intégrée sur les tables de mixage des ingénieurs du son aujourd’hui et ça permet de ne pas avoir à prendre de carte-son dans son ordinateur, mais de passer par un câble ethernet et d’avoir directement sa balance en fonction du lieu. Avec Dante, on peut communiquer directement avec la table de mixage. Donc, j’arrive avec ma configuration 7.1, j’appuie dessus et si j’arrive dans une nouvelle salle qui a également Dante qui est en 4, parce qu’il n’y a que 4 enceintes, alors je n’ai qu’à changer ma configuration, je n’ai même pas besoin de faire de balance. Donc ça, c’est pratique, mais dans toutes les résidences on n’a eu ce système que deux fois malheureusement, il y a beaucoup de lieux qui n’ont pas Dante. J’ai maintenant installé ma carte-son numérique dans mon ordinateur pour pouvoir faire la balance quand ils n’ont pas Dante. En tout cas, à chaque fois, on se tire les cheveux pendant au moins une journée de préparation technique sonore et puis aussi la nuit avant de pouvoir commencer à travailler sur le spectacle.
Delphine :
Si l’amplification n’est pas bonne, ça peut être très pénible, parce que je trouve qu’il y a quelque chose d’intime dans ce spectacle. Si mon micro marche bien, je n’ai pas besoin de parler fort et pour moi, c’est un effort, parce que j’ai tendance à avoir de la gouaille.
Louis :
Delphine n’a pas encore l’habitude de parler dans un micro, c’est souvent un problème technique de retour audio. Elle ne s’entend pas bien, c’est un problème avec la sonorisation, il faut qu’elle s’entende aussi bien que le public l’entend. Il est clair que ce n’est pas la même situation que dans la tradition du conte. Si les gens du milieu du conte viennent voir ça, ils trouvent que ce n’est pas un conte du tout, parce que déjà, dans un conte on ne montre jamais d’images, il y a rarement de la musique et en général c’est une personne seule qui raconte son histoire face à un public, il n’y a pas de mise à distance avec le public. Le micro la met à une certaine distance du public, mais c’est aussi une autre situation qui est à double sens : d’une part, elle se met à distance dans sa façon de raconter le récit et d’autre part, après, elle revient très fortement vers le public quand elle va aller les chercher pour leur poser des questions.
Yovan :
À chaque résidence, il faut se réadapter, avec l’électronique, il y a toujours des soucis. Souvent, on ne sait pas pourquoi, il y avait deux enceintes qui marchaient sur quatre, enfin finalement on les a, c’est bon. Il y a l’image et le son à gérer. Quand il n’y a pas d’ingénieur du son et qu’il y a tous ces bruitages qui passent normalement dans 8 enceintes, mais que là il n’y en a que 4, ce ne sont plus les mêmes réglages. J’ai donc trois configurations, j’ai 5 points, 4 points et 7 points, et à chaque fois je dois me réadapter. Par rapport aux bruitages, il y a deux ou trois morceaux où j’ai fait ce qu’on appelle des Stems [29] , c’est-à-dire que j’ai séparé la basse de la batterie, des accords et des voix pour les mixer un petit peu. Tu peux faire passer la basse ici, la batterie là, pour que ça soit plus immersif. Mais en fait, ça ne me plaisait pas sur tous les morceaux, parce que parfois, je trouvais que ce n’était pas très intelligible, je préférais avoir une source qui sortait en stéréo, avec les bruitages derrière, sinon je trouvais que c’était trop éparpillé. C’est l’ingénieur du son qui m’a initié à Dante qui connaissait très bien tout ça. Il a essayé de remixer des morceaux, je lui ai envoyé les Stems de mes morceaux.
Delphine :
Mais quand on a joué à Paris, Marie-France Marbach est venue me voir à la fin et m’a dit : « Écoute, il faut que tu fasses une formation sur la voix, tu ne peux pas continuer comme ça ». Depuis, je fais une formation à Lyon, avec une dame qui s’appelle Mireille Antoine, qui est extra. Une dame avec un charisme incroyable et en même temps une grande humilité. Elle me fait bosser la voix qui a tendance à être toute en force. La voix est en fait très intime, donc elle voit tout de suite un peu tout ce que j’ai raconté tout à l’heure, elle me dit : « En fait, tu es toute dans la force, tu es une guerrière, tu as bâti tout, ton garant c’est la force, tu as mis tellement de soutènement, tu as tellement mis de carapace pour t’assurer de ne plus jamais être vulnérable. Et du coup, il va falloir qu’on fasse tomber les murs pour que ta voix vienne du ventre pour ne pas bloquer l’émotion. » Parce que ses propres émotions, ça ne sert à rien, ce sont les gens qu’on veut emporter. Et en plus c’est dangereux, parce que je me donne à corps perdu et après, mince, je me fais mal. Et ça peut être désagréable pour le public aussi parce qu’ils n’ont pas à porter ce poids-là. Donc c’est vraiment un travail de poser sa voix et aussi mettre une distance avec ce que je raconte, pour laisser résonner la voix et pas m’emporter. Gros boulot, mais c’est très intéressant.
Yovan :
Par exemple, un ingénieur du son a parlé à Delphine : « Là, tu parles beaucoup trop fort dans ton micro, il n’y a pas besoin de faire ça ». Mais elle a l’habitude de s’exprimer en acoustique, il l’a mis moins fort et elle a fait plus attention. Quand elle est un peu stressée, elle a tendance à parler plus fort, et puis, parfois la musique est trop forte par rapport à la voix, ce sont des choses que je peux contrôler. À Nantes, ça s’est très bien passé, il y avait un rythme qui fonctionnait, on avait une semaine pour répéter chaque scène, donc on était dans un équilibre qui fonctionnait mieux. Parfois, on s’aperçoit que dans une salle on est moins à l’aise, c’est le spectacle vivant. De toute façon, c’est comme ça.
Delphine :
J’ai tendance à parler fort, donc j’ai vraiment un effort à faire pour baisser la voix. Mais c’est vrai que la présence de l’ingénieur du son fait qu’il y a une responsabilité qui ne m’incombe pas, dans le sens où, l’air de rien, si le son de ma voix ressemble à une marchande de tapis, ça peut vite être perçu comme celui utilisé pour vendre de la lessive sur le marché. Donc dans ce cas, je n’y peux rien, j’aurais beau ne pas parler fort, essayer de mettre peut-être plus de musique dans ma voix, dans ce que je raconte, il y aura toujours ce son. Tu as beau parler moins fort, essayer de « na na na », le son est pourri.
30. Communication par Notion [30].
Maxime :
Nous utilisons Notion, un logiciel qui permet de partager les choses entre plusieurs participants. Par exemple, Louis me dit : « Là, avec Delphine, on a écrit un texte. Elle doit le remettre au propre et elle le met sur Notion et c’est ce lien-là. » Du coup, je clique dessus et je vois qu’effectivement, elle l’a mis à jour il y a une journée et que c’est la dernière version du texte. Et si jamais une semaine après, je veux reprendre le texte, si ça se trouve elle l’a modifié. Comme ça j’ai la version mise à jour, ça me permet de toujours travailler sur la dernière version.
Delphine :
Avec Louis, ce qui est bien, c’est qu’on communique avec l’application plateforme Notion, je peux écrire dessus et il peut y accéder de manière immédiate. Donc parfois, quand j’ai des questions, j’écris et puis je l’appelle, je lui dis : « Regarde ce que j’ai fait. Qu’est-ce que tu en penses ? »
Yovan :
Louis utilise Notion pour communiquer une série de ressources, des textes qui m’ont inspiré, notamment sur la biocratie. On en avait déjà parlé ensemble. Il faut interroger Louis sur la biocratie parce que c’est un concept qui l’a beaucoup inspiré, notamment pour les grands procès inclus dans le spectacle qui permettent à la nature, à une rivière, à un arbre, d’avoir les mêmes droits que les êtres humains et donc de pouvoir mettre en procès une entreprise comme Total. Ce concept correspond bien à l’idée du spectacle d’êtres humains qui se reconnectent à la nature. Il a mis beaucoup de ressources à ce sujet sur Notion.
Maxime :
J’ai tous mes dessins sur ordinateur et je les partage avec Louis sur Dropbox. Comme ça, je sais si Louis les aime bien – parce que moi, je ne le sais pas forcément, – mais effectivement, il a une petite notification à cet effet. Quand j’ai mis un nouveau dessin, je l’appelle, je suis fier de moi.
Scène 1 : Maxime et Louis
|
Maxime : Écoute, franchement, j’ai bossé, j’ai fait trois nouveaux dessins. Louis : Oui, je sais, j’ai vu la notification sur Dropbox avant-hier. Maxime : Ah ! oui, OK. Louis : Oui, je l’ai regardé, c’est bon, nickel ! OK ! |
Maxime :
Et après, dans la façon de travailler, c’est vrai qu’avec Louis, on aime bien les outils participatifs, les logiciels participatifs, donc des espèces de to-do list que l’on peut consulter tous les deux, et de se dire : « Ah ! ça, je le coche, comme ça, il va voir que je l’ai fait ». Donc, je pense que déjà, ces outils-là améliorent grandement les choses. J’aime bien aussi le coup de téléphone informel pour parler de ceci et de cela, on peut aller beaucoup plus loin dans les choses. Je pense qu’il y a des éléments de messages qui sont importants, surtout quand j’envoie des dessins en cours pour avoir des remarques avant de les avoir finis. Les messages sont très utiles lorsqu’ils m’indiquent dans quelle direction je dois aller ou me donnent la possibilité de dévier le sens du courant. Et après, quand on est plus dans des phases de prospection, avec Louis, on va se voir ou on va s’appeler. J’estime que quand on ne sait pas quelque chose, ça ne suffit pas d’être juste sur WhatsApp, sur un groupe de conversation pour faire un projet. Ça passe forcément par se voir à certains moments. Mais une grande partie du temps de travail se fait en solitaire. Donc, c’est très hybride, il y a les temps forts pour discuter et après, il y a tous les temps individuels.
Yovan :
En fait, j’ai constaté que, dans les groupes avec lesquels je joue, on dit souvent : « On n’est pas sur Messenger, on n’est pas sur WhatsApp, on est sur Signal, c’est mieux. » Du coup, je reçois plein de liens et on me dit : « C’est vrai, on ne va plus sur ce genre de choses. » Notion est intéressant, oui, Louis aime bien tous ces moyens de communication, je ne suis pas tant allé dessus, mais c’est là où l’on s’envoie les choses et où l’on peut voir ce qui a été changé. Je pense qu’il y a plein de ressources intéressantes, mais pour moi c’est une question de temps. S’il y avait eu une année avec moins de trucs à faire, j’aurais eu plus de temps pour aller dessus. Et puis, comme on en parle déjà, et que je n’ai besoin que de quelques éléments pour écrire la musique, il me suffit d’y penser.
Maxime :
Pour ce qui est des logiciels que nous utilisons, c’est vraiment Notion, WhatsApp et Dropbox. Pour des formes de discussion, ça va vraiment être soit le groupe WhatsApp, soit moi qui appelle Louis et parfois ça peut m’arriver d’appeler Delphine pour le conte, mais finalement, moins, parce que c’est surtout Louis qui est en contact avec elle. C’est vraiment Louis qui maîtrise le flux des choses avec tout le monde. Et du coup, quand on l’appelle, il peut repasser les informations aux autres. C’est lui qui est au centre, les choses gravitent autour de lui. C’est pour ça qu’on l’appelle « le créateur » qui pilote un peu tout. Il n’écrit pas, il n’y a pas de contenu vraiment visible, même s’il crée le contenu et met en mouvement mes dessins.
31. Les résidences : LabLab, Chevagny, Vaulx-en-Velin, Enghien-les-Bains
Louis :
Je prévois mon planning de résidences à la minute à la minute près : le matin, on parle de ça, après chacun se présente, puis on fait une pause, on va marcher ensemble, après on revient, puis on travaille sur le début de l’histoire, etc. Je le fais quasiment dans toutes les résidences, qu’est-ce qui va se passer heure par heure. Et mine de rien, ça nous a bien servi de nombreuses fois où tu te retrouves perdu, tu es dans le dur, tu es en train de faire les choses, et là tu as la page blanche, tu ne sais plus quoi dire, quoi faire. Alors tu te dis : « Ah ! on avait prévu une balade dans la forêt », hop, balade dans la forêt, voilà. J’avais ce genre d’idées : le fait d’aller se balader, vu qu’au début l’histoire se passait dans la forêt, je voulais les emmener dans les arbres, faire de l’accrobranche et même dormir dans les arbres, mais je ne l’ai jamais fait. Là, j’ai retrouvé un de ces calendriers :
10h-11h : Présentation de nous et de notre univers.
11h-midi : Présentation du projet.
12h-13h30 : Pause déjeuner.
13h30-15h : Exploration libre du monde de demain, où on va.
15h-17h : Et surtout avec qui on y va.
17h-17h30 : Bilan de la journée, qu’est-ce qu’on fait demain ?
Si on ne sait pas quoi faire : demain, tour du village pour parler.
Abordons maintenant les résidences d’écriture, je les appelle « résidences émergences ». C’est d’abord le 6 et 7 janvier 2022. Après on s’est revu le 5 mai et le 6 mai 2022. On a eu une résidence musique avec Yovan et moi qui a finalement fini par une visio-conférence le 27 janvier 2022 avec nous quatre.
Après il y a eu une résidence « Déroulé du conte » les 23 et 24 juin 2022. Cette résidence était encore au LabLab, à Lyon. Nous avons beaucoup utilisé ce lieu. On est tous les quatre. Voici le planning préétabli :
10h. : Présentation des avancées de la trame narrative et retour, présentation de la musique et retour, présentation des dessins et retour, présentation du Live Drawing et retour.
11h30 : Identification des zones de contact entre musique et dessins, conte et participation du public.
12h. : Repas.
13h. : Installation, setup dessins et musique..
13h30 : Première scène.
15h30 : Deuxième scène.
16h30 : Pause.
17h. : Troisième scène.
C’était un peu ambitieux, je crois qu’on n’a pas réussi à finir le programme fixé. On a fini à 18h30. Et puis arrive le vendredi :
9h. : Retour sur le jour 1.
10h. : La scène 0 qui est l’accueil du public, on a beaucoup réfléchi à comment on allait accueillir le public, parce que cela faisait vraiment partie de l’immersion et de montrer les outils, comment ça allait se passer.
11h. : Enchaînement, scène 1, 2 et 3.
13h. : Présentation publique.
À la fin de la résidence, il y avait une présentation publique et après des retours, on était supposé retravailler un petit peu avant que tout le monde s’en aille. Mais on a pas du tout retravaillé après la représentation, on était épuisé. Donc, je me suis dit qu’il ne fallait plus jamais envisager de retravailler après une représentation.
En août 2022, notre première réelle résidence a eu lieu où à la fin, la totalité du conte va être présentée. C’était dans le cadre du festival « Chevagny Passions » [31], grâce à Antipode et à Chevagny Passions. C’est la première fois qu’on était payé. On a passé un jour avec Antipode, et au début, le mardi, mercredi et jeudi, on ne se voit qu’avec Delphine, et le vendredi Yovan arrive et on a travaillé tous les trois ensembles. Et on a joué une fois le samedi et deux fois le dimanche. Et là on arrive à présenter quasiment 20 minutes du spectacle, un peu plus. On a des retours hyper positifs du public, on joue pour chacune des trois représentations devant entre 60 et 80 personnes.
Maxime :
On avait fait une première résidence sans dôme à Chevagny-sur-Guye, et c’est là qu’on a pu tester l’idée d’avoir des dessins avec une conteuse, avec du son et avec un public qui a réagi assez favorablement à l’outil de participation. Finalement, on est quatre personnes, plus l’outil participatif qui amène les gens dans le récit.
Louis :
Les représentations étaient dans l’église, et j’avais récupéré le vidéoprojecteur du Live Drawing qui nous a permis de projeter les images sur tout le mur du fond de l’église. Tous les bancs de l’église avaient été enlevés et remplacés par des chaises longues, des poufs, des tapis. On a été très bien reçu.
La planification ça m’aide, parce que ça me sécurise. Disons que je ne me perds pas, et vu que je dirige une équipe, il vaut mieux ne pas avoir de blancs. Enfin, je sais qu’il ne faut pas que je me pointe en disant : « Ah ! ben là je ne sais pas ce qu’on fait ». Je sais que ça les déstabiliserait et ça ne leur ferait pas plaisir.
Ça marche, on est content et c’est juste un mois avant la résidence au Planétarium de Vaulx-en-Velin, où là on a deux semaines de travail. Le but était de faire 30 minutes de spectacle jusqu’au « Grand Conseil ». C’est la première fois qu’on adaptait les visuels pour le dôme, cela a pris énormément de temps. On a adapté la musique pour une spatialisation sonore et on a avancé sur l’histoire, en terminant la « chasse aux éclairs », en créant « la ville » et « le Grand Conseil ». On a également parlé du budget et du déroulé des interventions pédagogiques qu’on avait décidé de faire.
Maxime :
Il faut à chaque fois s’adapter au lieu, parce que si on change de salle, on change de taille d’écran, certains dessins se retrouvent un peu écrasés ou bien un élément du dessin est un peu trop important, il se trouve un peu trop sur le côté. Parfois quand on est sous un dôme, on peut voir des images derrière soi. Le public est soit orienté dans la même direction, soit les gens sont orientés tous vers le centre de la salle. Par exemple, il y a un moment où les gens doivent regarder deux chemins possibles et décider s’ils doivent prendre le chemin de droite ou celui de gauche. Mais si les gens sont face à face, il y a ce genre d’absurdités où pour la moitié des gens le chemin de droite, c’est le chemin de gauche. Heureusement, le gérant de la salle nous avait prévenu, il était venu à Paris, il nous avait dit : « Faites attention, cette image-là, elle ne marchera pas ». Donc j’avais fait en sorte qu’il y ait une flèche blanche sur le panneau de droite et une flèche noire sur le panneau de gauche, et on pouvait dire : « Bon voilà, vous prenez la flèche noire ou la flèche blanche ». Il y a plein de choses comme ça qui peuvent varier.
Louis :
La résidence suivante de 10 jours, s’est déroulée au Centre de arts d’Enghien-les-Bains.
Maxime :
Le temps de résidence, c’est super, parce que c’est le moment où l’on découvre vraiment ce qu’ont fait les autres. Yovan, il a très peu envoyé les sons préparés à l’avance, je les ai souvent découverts pendant les résidences. J’apporte mes dessins et ça peut m’arriver de prendre un calque et de redessiner un élément que je vais ensuite incruster dans le dessin. Je viens en résidence avec mes crayons au cas où il peut se passer quelque chose. J’utilise le logiciel Photoshop pour éditer les images dans la plupart des cas, mais je suis parfois obligé de les faire à la main. Lorsque je montre un dessin, il n’y a généralement pas beaucoup de réactions, tout le monde semble satisfait. Mais Delphine m’a dit un jour :
Delphine :
Ouais, ton dessin, c’est bien, mais en fait, ça manque de fleurs. T’es un peu tristoune, là, il faudrait mettre des fleurs.
Maxime :
Ben, t’as raison, je vais aller dans ton sens, ça ne m’arrange pas, mais… t’as raison, je vais mettre des fleurs ».
Donc j’ai dessiné plein de fleurs pour pouvoir les prendre une par une et après les intégrer dans le dessin. Et c’est mieux, c’est beaucoup mieux, donc ça m’a pris du temps mais… Maintenant qu’on est presque au bout, j’ai une liste de retouches comme ça à faire sur différents dessins où il faut que je rajoute des fleurs, que j’enlève des arbres, ce genre de choses.
Une fois que le spectacle commence, par contre, je n’ai pas grand-chose à faire, parce que mes dessins sont déjà produits, c’est Louis qui les anime. Je m’occupe alors de la gestion de la partie participative (les gens qui vont dessiner et tout cet aspect), ou bien de la mise en lumière. On avait fait un filage ensemble, une personne du lieu m’avait aidé, elle m’avait dit : « Tu vois, là, tu l’allumes, là, tu l’éteins ». Pour que ça ait du sens vis-à-vis du récit, il fallait que la conteuse soit parfois mise en avant par rapport aux dessins, et par contre, à d’autres moments, de l’éteindre pour que les dessins reprennent vraiment toute l’attention du spectateur. Ça, c’est un aspect intéressant que j’ai découvert, je trouve que ça enrichit bien le spectacle de pouvoir monter ou descendre la présence de la conteuse.

|
 Photo: Nicolas Sidoroff |

|
32. La participation du public
Louis :
Et puis, il y a l’importance de l’interaction avec le public, comment on se sert de ce qui existe et qu’on maîtrise déjà, pour faire participer le public. À la base, ce n’était pas seulement pour leur faire faire des choses comme créer le décor, mais aussi que les gens puissent vraiment faire passer leurs idées par le dessin. Dans le Live Drawing, on leur pose des questions pour donner des thématiques de dessins et après ils dessinent. On s’est aperçu qu’au début, pour que les gens commencent à dessiner, il faut être très simple, mais après, on peut aller très loin, les gens vous suivent et ils te sortent des trucs stupéfiants. Quand j’étais en train de créer le « Conte », j’ai toujours pensé que les évènements réalisés avec le Live Drawing pouvaient m’aider à trouver comment faire participer le public pour le conte, par exemple en proposant des thématiques de dessins comme : comment tu vois le transport du futur, comment tu vois les choses…
Maxime :
Il y a la question du mur qui existe entre la scène et le public et comment tenter de partiellement le supprimer. J’ai l’impression que le mur n’existe pas, mais je me rends compte qu’on a quand même un petit filtre, un calque, il y a quand même entre les deux un écran. Quand on a cherché à faire des projets en numérique, nous avons vu beaucoup de choses qui dépendaient d’une seule télécommande, il fallait des queues de 50 personnes qui attendaient pour accéder à l’outil technologique. On a pensé que le Live Drawing était une bonne idée parce que cette fois-ci, c’était vraiment participatif, c’était tout le monde qui faisait des choses en même temps. Donc d’un côté on a toujours un mur des plus fins, puisqu’on utilise le téléphone, mais on a quand même au moins rendu le truc accessible à tous. On a poussé cette idée, parce que c’est ce que les festivals attendaient de nous. Ils nous ont dit : « Ce qui nous a plu, c’est le fait que tout le monde fasse les choses en même temps, l’année dernière il y avait 50 personnes qui attendaient, c’était hyper frustrant pour tout le monde ». Alors on a dit, « Ah ! Banco ! » Il y a toujours une limite, c’est que c’est anonyme : les gens dessinent, mais ils peuvent complètement se mettre dans un canapé, dessiner dans leur coin, ou faire des dessins sans intérêt pour être projetés sur le mur en Live Drawing qu’on est obligé de supprimer sans savoir qui l’a fait. De cette manière, on casse le mur puisque tout le monde est proactif de l’œuvre, mais en même temps il y a encore un petit filtre dans le sens où les gens étant anonymes, ils ne sont pas complètement tenus responsables de leurs actes. Et en même temps c’est ce qui les débride aussi, je leur disais : « Allez-y, de toute façon si vous faites un dessin pourri, personne ne saura que c’est vous qui l’avez fait, vous n’aurez pas à le montrer à votre fils à côté de vous, il ne le saura pas, et au moins vous aurez essayé ».
Louis :
Concernant la participation du public et le Live Drawing, j’ai fait des allers-retours avec Maxime Touroute et Rémi Dupanloup. Entre-temps on avait fait un autre projet intitulé « la Bulle du personnel », un projet institutionnel pour un hôpital où on voulait créer un mur de cartes postales interactives. Maxime Toutoute et Rémi, qui ont développé ce projet, ont repris le Live Drawing et y ont rajouté de nouvelles briques à l’intérieur : notamment la possibilité d’insérer du texte. Et du coup, je me suis dit : « Ça serait très intéressant que les gens puissent écrire au lieu d’utiliser uniquement le Live Drawing ». J’ai adapté mes envies de participation du public en fonction des outils que j’avais. Je n’ai pas pu changer, je n’ai pas pu repartir de zéro, parce que j’avais trop de contraintes, mais j’ai quand même réussi à faire écrire les gens, notamment sur les grandes lois du futur.
Delphine :
Je ne me sens pas si loin des gens présents dans le public, parce que je leur demande leur avis. Je sens la présence du public, je sais qui est là. On les aide à se connecter, on leur demande s’ils sont bien installés. Et après quand je leur demande justement leur avis, est-ce qu’on prend le chemin de gauche ou de droite, souvent je prends vraiment le temps de dire « C’est bon vous êtes tous d’accord ? Quelqu’un n’est pas d’accord ? » Et l’air de rien j’ai envie de tisser cette relation.
Louis :
Le but de ce projet, ce n’est pas forcément de faire participer les gens, le but du projet c’est de les projeter dans un avenir désirable et de les amener à y réfléchir. Et pour qu’ils y réfléchissent, je leur propose de participer pendant le spectacle, et de commencer à les engager dans ce processus. Pour cela, j’utilise une graduation dans la participation :
- Avant le début du spectacle, ils dessinent des étoiles sur leur téléphone pour les introduire à la situation.
- Après, ils voient leurs étoiles apparaître sur le mur, donc ils comprennent que ce qu’ils font sur leur téléphone, ça va servir dans l’histoire.

- Ensuite, je leur fais dessiner la pluie, c’est le même principe, mais là, ils voient que leur image s’anime et qu’elle interagit avec le scénario.
- Et après ils choisissent un chemin, donc là ils sont vraiment dans une participation en disant oui ou non, un choix simple qui va faire évoluer l’histoire.
- Et après, on leur a posé des questions en direct, en leur disant par exemple : « Voilà, dans le monde du futur, que fait-on des gens qui ne respectent pas les règles ? ». Donc là, on commence déjà à avoir une interaction plus profonde et surtout qui va les mettre en réflexion sur comment ça se passe effectivement quand il y a un conflit, quand il y a quelqu’un qui ne respecte pas les règles, comment ça pourrait se passer alors, dans un futur désirable (on le reprécise bien à chaque fois), surtout quand on a des élèves, qui veulent pendre les gens.
- Puis, après le Grand Conseil – là, c’était vraiment ce qui me tient le plus à cœur et c’est ce que j’essaie de conserver – on leur demande d’écrire une loi qui pourrait aujourd’hui nous servir à atteindre ce futur désirable.
Maxime :
Avec le « Conte d’un futur commun », on est allé un peu plus loin en demandant aux gens de participer à un véritable débat, en s’adressant directement au public : « Là, qu’est-ce qu’on fait, comment on avance dans l’histoire, allez-y proposez-nous des choses ». Donc, il y a une période où le public doit assimiler ce qu’on leur raconte, il y a des temps ouverts où ils sont sur leur téléphone anonyme, et il y a au moins une période où on rallume même la salle pour avoir un débat. Cela veut dire que le mur de séparation entre la scène et le public constamment monte et descend, il y a plusieurs couches, mais on ne peut pas dire que le mur s’enlève complètement. Mais je pense que si on ouvrait trop, on ne pourrait pas raconter notre récit avec les valeurs que Louis voulait porter.
Louis :
Et je pense que le Grand Conseil, quand on explique la biocratie et au moment où on les fait participer, c’est vraiment au cœur de ce que je voulais faire. Je pense effectivement qu’on pourrait aller plus loin dans la participation, et on pourrait le faire différemment, mais en tout cas, je me dis que s’ils arrivent à penser à une loi dans le cadre de notre société démocratique actuelle pour que le monde devienne meilleur, ça veut dire qu’on ne va pas faire une révolution par la violence, mais plutôt une révolution plus bienveillante. C’est vraiment un truc qui me motive et j’ai envie de montrer aux gens que le système a certes ses défauts, mais que l’on pourrait trouver à l’intérieur de ce système des solutions pour réussir à évoluer de manière positive.
Delphine :
Même si le téléphone portable est un appât à adolescent, parce que quand on dit aux gamins « Vous allez pouvoir dessiner sur votre téléphone », ils disent « Ah bon ? » ils veulent aller voir ce spectacle. C’est dingue hein ! Alors qu’en fait, ils ne font pas grand-chose dessus : ils dessinent la pluie. À la fin du spectacle à Nantes, une dame est venue me voir et elle m’a dit : « Dites donc, c’est un peu de la triche votre utilisation des téléphones, c’est un peu pour attraper les jeunes, parce que personne ne choisit rien du tout dans cette histoire ». J’ai dit « oui », parce que je n’allais pas lui dire le contraire, elle avait tout vu.
Maxime :
On doit faire attention à comment on communique notre histoire, parce que si on vend trop le côté participatif du conte plutôt que la narration, les gens risquent d’être déçus. Au départ on avait un peu vendu le spectacle en disant « C’est un jeu vidéo, vous êtes actifs sur l’histoire ». Il me semble que ce n’est pas un jeu vidéo où à tout moment le public prend un joystick et déplace des choses. On a décidé qu’il ne fallait pas trop baser la communication sur cet aspect, parce que les gens risquaient d’être déçus par quelque chose ne correspondant pas exactement à ce qu’on fait. Quand on commence une création, on a beaucoup d’ambitions et une fois que la création a jailli, il faut se dire que même si on aime bien ce qui a été créé, ça ne correspond pas à l’ambition de base du projet. Il faudrait que ça corresponde à ce qu’on veut faire. On a donc beaucoup travaillé sur ce côté participatif, mais maintenant c’est plus un des ingrédients que l’élément fondateur du spectacle.
Concernant la question d’une contradiction possible dans les relations avec le public entre le caractère intime du conte et les technologies utilisées, ce qui est intéressant c’est de prendre vraiment le problème dans l’autre sens. Dans l’appel à projets immersifs, il y avait beaucoup de gens qui postulaient des choses très technologiques, leurs lignes de pensée ne quittaient pas vraiment l’ordinateur. Et le fait d’introduire l’idée du conte veut dire qu’on amène un élément archaïque dans l’univers très technologique des arts numériques. On a proposé un projet qui n’est pas technologique et pareil pour les dessins qui sont faits à la main. Donc, plutôt que d’avoir entre guillemets « numérisé » le conte et les dessins, on a rendu plus humain les arts numériques. En tout cas, moi je ne m’attendais pas à ça, mais les gens qui nous ont soutenus nous ont dit : « C’est ça qu’on a apprécié dans votre dossier, c’est le fait que vous nous proposez des univers qu’on ne pensait pas pouvoir faire cohabiter. » C’est encore le fait de Louis d’avoir eu cette intuition de rafraîchir un peu les arts numériques en montrant qu’ils peuvent être appliqués de plein de façons différentes. C’est vrai que dans le « Conte d’un futur commun », on est dans une tension, parce qu’on veut raconter une histoire, et en même temps on veut faire participer les gens. Donc l’équilibre à trouver est très délicat. On a trouvé un équilibre où peut-être on pourrait ouvrir encore plus à la participation du public, et en même temps, à partir du moment où on s’est fixé un récit, on va forcément plus ou moins d’un point A à un point B, où en tout cas on n’a pas 10.000 entrées. Cela referme un peu la question de la participation.
33. La résidence d’éducation artistique et culturelle à Hennebont. Louis, Delphine et Yovan.
Louis :
Une autre forme de participation a été expérimentée dans la résidence dans les écoles d’Hennebont (Bretagne), c’était une résidence EAC (Éducation artistique et culturelle – Affaires Culturelles) [32] qui a duré 10 jours dans le cadre collège-lycée-primaire avec Delphine et moi. Nous avons travaillé tous les deux quasiment huit heures par jour pendant cette période dans plein de classes différentes. La participation du public s’est inscrite dans une autre forme de temporalité : avec le « Conte d’un futur commun », le public n’est là que pendant une heure, c’est sûr que le spectateur d’une heure va potentiellement moins réfléchir que les élèves des écoles primaires et secondaires qui travaillent à ce projet artistique pendant toute l’année et qui est en plus encadré par les professeurs qui en parlent avant notre arrivée. Cela veut dire que quand c’est bien fait, comme à Hennebont, ils ont déjà passés quatre mois à réfléchir à ça dans différents cours, en tout cas en arts plastiques. Et après, j’en remets une couche, je demande aux élèves : « Qu’est-ce que vous aimeriez dans le futur concernant votre habitat, qu’est-ce que vous aimeriez comme moyen pour vous déplacer ? » Et je leur montre les éléments du spectacle : « Nous, on a pensé que ça serait comme ci ou comme ça, mais vous, comment vous le voyez ? » Et généralement, si on montre aux gens quelque chose sur laquelle ils peuvent réfléchir, le niveau de réflexion remonte à l’évidence. Les deux situations de participation, se produire devant un public et enseigner dans les écoles, sont tout aussi importantes pour moi. Peut-être que les élèves ont plus de temps pour y penser.
Delphine :
Il y a eu cette résidence à Hennebont dans les écoles primaire et secondaires. Ils ont dessiné des choses qui ont ensuite été projetées pendant le spectacle. Pour lier tout cela à notre spectacle, je résume brièvement l’histoire du spectacle qu’on va présenter. De toute façon, au départ, on fait toujours une présentation générale avec Louis.
Scène 1 : Delphine et Louis. Introduction devant les élèves.
|
Louis : Voilà, on a un spectacle qui s’appelle « Conte d’un futur commun ». Delphine : On imagine un futur qui soit désirable, na-na-na-na… Louis : Vous allez travailler sur du conte avec Delphine, puis vous allez faire du numérique avec moi. |
Delphine :
Du coup, après, on se retrouve et puis, selon les situations et les classes, on décide de notre ligne, de notre objectif, qu’est-ce qu’on attend d’eux à la fin de la journée : est-ce qu’on veut qu’ils racontent quelque chose, qu’ils produisent des choses ?
Louis :
Avec les classes de SES [Sciences Économiques et Sociales] j’ai travaillé sur les modes d’organisation de la planète pour la prise de positions collectives dans le futur, quels modèles économiques, quels types d’échanges commerciaux et diplomatiques entre les communautés, quels types de travail et d’emploi. Dans toutes mes interventions généralement, je parle de comment on va habiter dans le futur (surtout avec les petites classes), et comment on va se déplacer, se transporter entre les endroits. Je m’intéresse à l’Intelligence Artificielle et j’ai donc pas mal parlé de la génération d’images par l’IA qui n’était pas très en rapport avec le projet du Conte, mais qui m’intéressait à ce moment-là.
Delphine :
Avec une classe, on avait produit des procès. Ils travaillaient en petits groupes, ils avaient le droit de prendre leur téléphone, mais pas pour aller là où ils vont d’habitude, mais pour aller sur des moteurs de recherche, à la recherche de procès. Donc il fallait une victime, un coupable et un procès, une cause. Et il y a des filles très bien fringuées, qui sont venues pour faire le procès de Zara, H&M et ASOS, génial ! Et je leur disais, « Vous le direz à vos copines ». Elles ont découvert (et je l’ai appris d’elles) que ce sont les Ouïgours de Chine qui font toutes ces fringues dans une pauvreté extrême et tout le monde ici les achète. « Moi, tu vois, j’achète les fringues sur Vinted et il y a plein de fringues à acheter, c’est dingue ! [Murmuré :] Et en fait tout le monde achète ses fringues là-dessus quoi. [Voix forte :] Ç’est à très bas prix. » Donc elles ont découvert ça, et je trouve ça chouette aussi que les gosses se mettent en petits groupes et cherchent sur leur téléphone, parce que c’est un outil qu’ils ont tout le temps. Tout le monde a un téléphone, quand on dit « Prenez votre téléphone », il n’y a pas un qui dit, « Mais moi, je n’ai pas de téléphone ». Par contre ils ne sont jamais allés chercher ce genre de choses, ils sont juste sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas s’en servir pour autre chose.
Louis :
A certains moments, Delphine et moi étions ensemble devant une classe, mais la plupart du temps en solo avec les classes. Et c’étaient des interventions très courtes, les plus longues duraient trois heures. Donc j’ai fait un aller-et-retour : je suis resté une semaine, et je suis retourné à Lyon, six heures de train, puis je suis retourné là-bas pour deux jours pendant lesquels on a fait cinq représentations, un marathon de fous. Yovan nous a rejoints à ce moment-là. Lors des performances, j’ai intégré tous les dessins que les élèves avaient faits.
Delphine :
L’éducation artistique m’intéresse beaucoup. Avec les enfants du primaire, je n’ai fait que de leur raconter des histoires, parce que c’est qu’ils voulaient. J’ai essayé de reprendre les bases du spectacle. Ils ont fait quand même du dessin, ils adorent les dessins, les gamins. En fait, on ne leur raconte pas tant que ça. J’ai commencé par leur demander : « Si vous deviez faire de grands procès pour que le monde soit meilleur demain, qu’est-ce que ça serait ? Qu’est-ce qu’on peut imaginer ? »
Louis :
Les élèves avaient essentiellement à dessiner des choses. En amont, les professeurs avaient travaillé sur le projet, sur les avatars du futur, leur habitat, les élèves avaient déjà commencé à décrire ces choses, ils ont dessiné leur habitat du futur, leurs personnages du futur (etc.) et je les ai intégrés dans les dessins de Maxime. Ça m’a donné énormément de travail ! Je ne le referai plus jamais ! Ça m’a pris dix heures de détourage, je ne sais pas combien de milliers de dessins, c’était insupportable. Enfin « insupportable », ce n’était pas insupportable, mais ça m’a vraiment fatigué. Après, ça m’a permis de recalibrer mes interventions, en me disant : « Ah ! Un seul dessin par classe ! »
Delphine :
Alors, on a eu toute cette discussion sur la peine de mort, ça a été terrible ! Ils étaient tous pour la peine de mort. C’est compliqué, hein ! Du coup on a passé une séance entière à discuter de ça. En fait, aujourd’hui on ne parle plus de la peine de mort dans les écoles, les profs m’ont dit qu’ils ne le faisaient plus. Moi à l’école, on m’a bassiné sur la peine de mort. On en parlait beaucoup, on a lu des textes, “na-na-na na-na-na”, Victor Hugo, “ta-ta-ti ta-ta-ta”. Aujourd’hui on n’en parle plus, donc les gamins, ils écoutent des émissions à la télé.
Scène 2 : dans une classe avec Delphine
|
Une élève : J’ai vu à la télé un gars qui racontait qu’une fille avait été violentée, et que le coupable, on ferait mieux de le pendre. Une élève : Il a raison. Un autre élève : Oui, il a raison. D’autres élèves : Il a raison ! Une autre élève : Il y en a qui font de la prison, ça ne sert à rien, ils sont trop heureux en prison. Delphine : Ah ! oui comment tu sais qu’il est bien en prison ? T’es déjà allé en prison ? L’élève : Non mais je veux dire, en prison il a à manger, il a à boire, il a un toit. Delphine : Et toi si tu étais accusé d’avoir violenté quelqu’un mais que ce n’était pas toi, mais que tout le monde dit que c’est toi, et que t’allais en prison ? Un élève : Ah ben non ! mais pas moi, ça ne peut pas m’arriver ! Delphine : Ah oui ? L’élève : Non. Delphine : Ça ne peut pas arriver à toi, hein, ça n’arrive qu’aux autres ! Une élève : Les autres, ce n’est pas grave si ça arrive aux autres. |
Delphine :
Les professeurs m’ont dit par la suite qu’en fait, ça a fait du bien d’en parler parce que ce sont des choses qu’ils gardent pour eux. Donc ils ne disent rien à personne, ils sont sûrs d’eux, ils sont sûrs de leurs petites conceptions. Et du coup, d’en discuter, ça bouge les choses. Mais du coup c’est difficile à amener parce qu’il ne faut pas non plus juger ce qu’ils disent, justement un espace de parole c’est un espace où on laisse parler. Et il y a des perles dans ce qui est dit comme : « Non, mais ils devraient s’arrêter à l’iPhone X et après ça ils devraient arrêter d’en faire. » J’ai dit : « Oui d’accord. »
Le fait que je n’ai pas aimé le lycée, d’avoir été en marge, est la cause que je n’ai pas d’a priori sur les élèves. À la limite, parfois je trouve ceux qui sont en marge les plus intéressants, pourtant ce sont tous les élèves qui m’intéressent. Comme je n’ai pas une grande estime de moi, je n’ai pas de préjugements comme en ont parfois les intellectuels face à ceux qui n’arrivent pas. Et à cela, j’y tiens beaucoup. Ce que je retiens du cirque, c’est la position du corps : c’est que déjà, on s’assied, on met les pieds sur le sol, on a tous le dos droit et puis on est là tous ensemble. On n’est pas comme ça [elle montre une position avachie], s’il y en a qui veulent vraiment rester comme ça, ce n’est pas grave. Mais, je veux dire qu’on est là, présent, avec son corps et puis il y’a le travail de respiration, le travail de rester le dos droit, de lancer ce qu’on veut dire là où on veut le dire – [murmuré] parce que si on parle comme ça, personne ne comprend rien – [voix normale] et du coup, ça leur sert aussi à l’école après, parce que quand ils passeront l’oral, le grand oral, ils sauront parler. Au départ, on va juste dire leur prénom et puis leur demander s’il y en a qui sont gênés pour parler en public, parce qu’il y en a qui le sont et d’autres qui ne le sont pas du tout. Il ne faut pas laisser parler tout le temps ces derniers alors que ceux qui ne parlent pas restent silencieux, donc il faut gérer cet aspect et puis fixer des règles. Je mets des règles dès le départ : on ne se moque de personne ici, on a le droit de dire ce qu’on veut, ça ne sort pas de cette salle, ça reste entre nous. On peut discuter, mais on n’est pas là pour dire n’importe quoi, c’est un espace de liberté, on respecte les autres, pas de moquerie, je ne le supporte pas. C’est plutôt le cirque qui m’a apporté cette posture qui implique beaucoup le travail du corps, et c’est aussi le conte où le travail du corps est lié à la parole. Et puis, je leur raconte des histoires et je leur demande ce qu’ils en pensent. Évidemment, je ne vais pas raconter les mêmes histoires aux ados et aux primaires.
On a travaillé avec les partenaires, les instits. Par exemple, on a bossé avec une professeure d’espagnol. Donc je les ai mis en cercle et puis on a cherché des mots pour imaginer en espagnol, par exemple, le Propel Stretch. Je leur ai expliqué ce que c’était et puis ils ont commencé à chercher dans le dictionnaire, ils se sont éclatés. Moi je ne sais pas du tout parler espagnol, donc ils essayaient de prononcer des choses, et je leur disais : « Comment ça se dit ? Ça je ne connais pas ». Donc les gosses essayaient de le dire. Et là, la prof m’a dit : « Les cours d’espagnol n’ont jamais été aussi bénéfiques que celui d’aujourd’hui ». Parce que c’est une autre approche, on a cherché un vocabulaire pour des habitats du futur en espagnol. Tout est possible en fait.
Maxime :
Il y a eu une résidence à Hennebont avec des lycéens, je n’y étais pas, et je pense que ça a dû avoir une influence sur l’écriture, parce que Louis en est revenu en me disant : « Ils ont lâché des idées incroyables, ça nous a donné plein de pistes ». Donc, ça a peut-être orienté un petit peu l’histoire, mais ils ont aussi beaucoup dessiné. Et cela ne correspondait pas complètement à ma pratique, parce qu’il ne faut quand même pas oublier que le dessin est une pratique solitaire qui se fait avant de pouvoir se retrouver en collectif. Je pense que les musiciens ne sont pas aussi solitaires, parce qu’il y a des temps de répétitions, il y a effectivement des temps de pratique personnelle, mais je pense que le collectif intervient plus souvent. Je travaille en solitaire avant d’apporter de nouvelles briques au travail collectif de l’équipe.
34. Les résidences (suite) : Paris, Nantes.
Louis :
La prochaine résidence a eu lieu à Paris, à la Cité des Sciences. C’était une résidence de cinq jours et je n’avais fait un planning que pour le premier jour :
9h. : Installation
10h.: Internet test
11h.: Video test
12h. : Lighting test
13h. : Pause déjeuner
…
Ah ! oui et là, il y avait Émilie Baillard qui est une metteuse en scène, je lui ai demandé d’avoir un regard extérieur sur les déplacements de Delphine sur scène. Elle est venue, et ça nous aurait demandé une résidence entière alors qu’elle n’est restée qu’une journée et on avait plein d’autres trucs à faire. À Paris on n’arrive à montrer que trois minutes ou quatre minutes de plus.
Scène 1 : Delphine et Louis
|
Louis : Bon ! Il va falloir qu’on avance, hop ! Delphine : Oui, allons-y. Louis : Il va falloir qu’on avance un peu, parce que c’est chaud là, on n’a pas réussi trop à avancer depuis la dernière fois, il faut qu’on finisse l’histoire pour Nantes. C’est notre dernière résidence dans le cadre de l’Appel à projets immersifs de l’AADN. Delphine : On peut se revoir avant d’aller à Nantes. Louis : Il faudrait envisager deux résidences d’écriture de deux jours à Lyon. Delphine : Je peux venir à Lyon parce que je prends des cours. On peut essayer d’arriver à la fin de l’histoire. |
Louis :
À Nantes, Yovan, Delphine et moi sommes présents tout le temps. Et là, les journées n’étaient pas organisées très précisément, comme d’habitude je crois que j’avais fait un planning un peu complet. Et là on enchaîne bien le conte de bout en bout, parce qu’on arrive à la fin. Les deux derniers jours on fait deux restitutions publiques le jeudi soir et le vendredi soir, avec la totalité du spectacle, même s’il nous manque encore des dessins, même si Delphine lit son texte. Peut-être que je ne l’ai pas mentionné jusqu’à présent, mais il faut souligner le travail énorme qu’a fait Delphine. À Nantes, les journées de travail ne se terminaient pas à 18 h. mais bien plus tard dans la soirée. Il y a beaucoup de moments où Delphine et Yovan ont travaillé ensemble, pendant que je suis en galère avec mes dessins, et du coup je n’ai pas le temps de faire des choses avec eux. Ce qui est super avec Yovan, en tant que musicien, c’est qu’il a un sens du rythme, et du coup, il peut dire à Delphine :
Yovan :
Là, tu vois, quand je joue ça, toi il faut que tu dises ça.
Louis :
Et il fait beaucoup d’allers-et-retours avec Delphine là-dessus. Il y a beaucoup de moment où il doit caler des trucs.
Yovan :
Ah ! non, c’est là ! exactement !
Louis :
Ils se font des enchaînements de la pièce tous les deux. Pendant les répétitions, je travaille souvent sur des dessins qui n’ont rien à voir avec ce qu’ils sont en train de faire. Souvent, je travaille beaucoup tout seul, j’ai beaucoup de moments où je dois caler des choses qui ne marchent pas, je refais, ça ne marche pas, je refais… ça ne marche pas ! Au bout d’un moment, ça finit par marcher.

|
|
Le poste de travail de Louis pendant la perormance
Photos: Nicolas Sidoroff
Louis :
De temps en temps j’appelle Maxime. Et je dois m’occuper de tout le reste aussi : l’animation des dessins, la vidéo, tout ce qui fait partie de la participation du public, je cale à chaque fois ce qui va apparaître sur les téléphones portables, ce qui va apparaître sur l’écran, tous les changements que cela implique, parce que ça change tout le temps au fur et à mesure, il faut changer les questions adressées au public, il faut changer l’interface, etc. Il y a plein de choses à changer avec le Live Drawing que je connais maintenant très bien. Et je fais aussi la lumière. Ça fait beaucoup de choses à faire, et c’est moi qui gère la technique, par exemple c’est moi qui gère le son de Yovan quand ça ne marche pas. Enfin lui, il regarde, il fait des choses, mais généralement c’est moi qui vais mettre les mains dedans.
Yovan :
Louis met aussi la main à la pâte, sinon ça ne marcherait pas. On le sait maintenant que pour un spectacle comme ça, il faut quelqu’un qui soit un permanent pour s’occuper des aspects techniques du son et de la musique, au fond ce n’est pas trop demander. Ce projet m’a permis d’apprendre beaucoup de choses à la fois et franchement, c’est ce qui pour moi était intéressant. Tout l’enjeu à chaque fois c’était de se dire : « Ah ! là, ça n’a pas marché ! » Ça prend une journée de préparation et puis le lendemain, on se remet dans le rythme du spectacle. En fait, à chaque fois, il faut se familiariser avec le lieu, une fois qu’on est bien dans le lieu, qu’on a nos équilibres sonores, tout va bien se passer.
Louis :
Puis voilà, à la fin, je me retrouve souvent tout seul à désinstaller. C’est à moi de remettre les choses en ordre, mais j’ai un peu l’habitude, ça fait partie du rôle du régisseur au début et à la fin après que tout le monde est parti.
Yovan :
On a fait vraiment le truc à trois, parce que le spectacle était toujours en cours d’écriture, enfin, il s’écrivait au fur et à mesure, ce n’était pas une situation genre « bon voilà j’ai écrit ça, maintenant débrouille toi ». Au départ c’est comme ça que j’ai vraiment fait avec le texte de Delphine en composant la musique dessus. C’était une bonne façon de faire mais au bout d’un moment, il devenait urgent de se rencontrer. Les résidences ont été l’occasion de travailler ensemble, notamment à Nantes où le texte n’était pas encore complètement écrit. Delphine ne m’avait rien envoyé avant la résidence, parce que Louis avait l’idée mais il fallait qu’ils se mettent encore d’accord sur ce qui allait vraiment se passer. Louis n’est pas écrivain, il n’est pas auteur, mais il est le responsable du concept du spectacle et il avait besoin de Delphine pour mettre l’histoire en mots. Et vu que je n’avais pas non plus décidé de la musique, j’ai dit : « Je préfère composer avec vous ». Donc, pour la fin du spectacle à Nantes, j’ai travaillé avec eux, je faisais les bruitages avec eux. Et quand ils me demandaient : « Tiens là, par contre, ce serait vraiment bien qu’il y ait un moment de musique », je savais très vite comment produire quelque chose que je réécrirai plus tard à la maison. On a ainsi appris à mieux se connaître. Le projet de Louis, dès le départ, était quand même très ambitieux, parce qu’il avait beaucoup d’idées qu’il a fallu démêler. Et je pense que maintenant qu’on se connaît, on sait ce qui a bien fonctionné et pour un éventuel prochain projet, on saura ce qu’il ne faut pas faire en tout cas, pour gagner du temps.
Louis :
Donc, à la fin de la résidence à Nantes, on est extrêmement content, parce qu’on a réussi à à présenter le spectacle complet au public, avec des retours très positifs.
Scène 2 : après le spectacle, Delphine, Louis, l’amie d’Amandine, une personne du public
|
Une personne du public : Je suis super contente d’être venue parce qu’on voit que c’est possible de changer les choses et ça nous donne envie de faire. Louis : C’est exactement ce que je voulais. Je suis très content. L’amie d’Amandine : J’ai trouvé ça super. Mais j’ai voulu inviter plein de collègues, mais ils n’ont pas voulu venir, ils ont dit que c’étaient des trucs écolo. Delphine : Ah ! bon, comment savent-ils que c’est un truc écolo ? L’amie d’Amandine : Ben tu as vu la présentation du spectacle ? Delphine : C’est moi qui ai écrit la présentation. Louis : Voici le texte : « Ce spectacle est un voyage participatif dans un futur désirable, c’est un conte immersif interprété par une conteuse, le public contribue au déroulement de l’histoire avec les outils numériques, des discussions, des réflexions. Cette œuvre crée des espaces propices pour aborder des thématiques sociétales qui aujourd’hui nous préoccupent : l’injustice, l’écologie et la guerre. » Delphine : S’il n’y avait eu que la guerre ils seraient venus ! Bon, je ne trouve pas que le texte de présentation soit si évident. L’amie d’Amandine : Pour quelqu’un qui est écolo, oui ça ne paraît pas écolo, mais pour quelqu’un qui ne l’est pas… Delphine : D’accord. Et en même temps, je ne comprends pas comment aujourd’hui, à notre époque, on ne peut pas être touché par l’écologie. Je ne comprends pas comment tu peux dire qu’on n’en a rien à foutre. Je suis atterrée par les gens qui disent « Oh ! encore un truc écolo ». Oh je veux dire, t’as vu comment on vit ? T’as vu ce qui risque de nous tomber sur le coin de la figure ? Enfin t’as des enfants ? Même sans avoir d’enfant ? T’aimes les animaux ? T’aimes les fleurs ? Comment peux-tu être aussi indifférent à ça ? Ça me semble vraiment compliqué, ça me semble fou. Après, gauchiste, moi je suis anarchiste depuis longtemps, je fais un spectacle de gauche, bon. Ben c’est vrai que ce sont les riches qui polluent le plus, hein ! Des délires de luxe, là ! Et plus tu grattes, et plus tu… Pour les abeilles, les lobbyistes viennent faire des faux dossiers pour dire « Non, non, non, les pesticides c’est pas du tout mauvais pour les abeilles, il n’y a aucun souci ». Tout le monde sait que c’est faux, que c’est juste une question de pognon et en fait ils continuent avec leurs pesticides contre les abeilles, ils défoncent trop, ils tuent tout. |
35. Écologie. Delphine.
Delphine :
Aujourd’hui, finalement, je suis peut-être une bourgeoise par rapport à ce que j’étais avant et peut-être que je ne suis pas « tout écolo ». C’est clair. Mais j’essaye de faire le plus que je peux. Mais c’est vrai que je pense que les très riches, c’est à un autre niveau : ce sont des concours de fusée, des bateaux énormes, des avions tous les jours, enfin c’est puant, quoi. Je pense que déjà on pourrait arrêter un peu d’utiliser les pesticides. On ferait juste un peu, déjà ça serait déjà pas mal. Je dénonce Total dans le spectacle. En Ouganda et en Tanzanie, là, c’est terrible, ils défoncent tout. C’est un paradis terrestre la Tanzanie. Il y a des girafes, des éléphants, « prrrrrou gré grog trac troc pèl ». Il y en a qui se rebellent, ils les enferment dans le noir pendant six mois. Et Macron soutient. Et tout le monde soutient, BNP Paribas finance, non mais où est le problème les gars ? C’est affreux. C’est affreux, mais bon ça continue. Après il y a des gens qui dénoncent, moi, j’ai appris ça en regardant l’émission Investigation machin : une fille blonde, les cheveux très courts qui fait des investigations à la Tintin, je ne sais pas comment on dit ça, ce n’est pas écrit quelque part ? [Bruits de pages qui tournent] Bref, du coup, il y a quand même des journalistes qui dénoncent, il y a quand même des choses qui se passent. Je pense que ça va bouger, enfin j’espère.
Le problème c’est que les riches n’en ont justement rien à faire. Étonnamment, ils veulent rester dans leur luxe et ont tellement peur de perdre leur argent. Pourquoi ? C’est dingue. On ne leur demande pas de se retrouver au RSA, hein ! et d’aller balayer le trottoir, comme on demande aux gens au RSA aujourd’hui. Ouais, c’est vrai que moi je viens de très bas, Je viens de pas-de-thune, et peut-être que j’ai cette empathie ou cette compréhension que d’autres n’ont pas parce qu’ils sont nés dans le luxe et qu’ils ne comprennent pas qu’un jour, s’ils n’ont plus ça, ça peut quand même aller, ça peut être une très belle vie sans tout ça. On a presque envie de leur faire des câlins à ces gens : « Ça va bien aller, t’inquiètes pas ! »
J’ai découvert des architectes qui sont incroyables, comme Ferdinand Ludwig. On a cherché des exemples d’architecture, comme l’architecture vernaculaire , c’est-à-dire tous les bâtiments qui sont construits avec des arbres et des plantes. Je n’étais pas trop d’accord avec ça. On en a beaucoup parlé avec Maxime parce que, pour moi, si tu fais des bâtiments avec des arbres, il faut qu’ils soient enracinés dans la terre et souvent dans les bâtiments qu’on voit, les arbres sont dans des pots. Moi qui aime les arbres, qui ai beaucoup lu, je sais que les arbres communiquent par les racines, du coup c’est raté si tu fais ça : ils ne peuvent pas communiquer. Les arbres se protègent de certaines maladies par les racines, par le mycélium, ils s’envoient des informations, s’il y a une bête qui attaque. Un arbre envoie le message : « Vite, protège-toi ! », du coup il meurt, mais pas les autres à côté. Je trouve donc dommage de les mettre dans des pots. Mais de toute façon, ils vont être obligés de mettre des plantes, de la végétation dans les villes, sinon trop de gens vont mourir. C’est clair.

36. Conclusion
Louis :
J’ai monté une équipe de gens qui font bien ce qu’ils font, sinon je n’aurais pas travaillé avec eux. Donc, à partir de là, quand ils proposent quelque chose, je pars du principe qu’ils savent mieux que moi ce qui est bien, parce que c’est leur job. Yovan pareil, je ne l’embête pas sur la musique, je ne vais pas lui dire ce qu’il doit faire… Oh ! si d’ailleurs, je le fais un peu !
Yovan :
Dans ce projet, les personnes n’avaient pas d’exigences particulières, elles me faisaient confiance et m’ont laissé libre de développer mes propres choses. Ça m’a permis de m’exprimer et de continuer à évoluer. J’ai pu adapter la musique à différentes situations, si c’était trop long ou trop court, de décider de ce qui marche et de ce qui marche moins bien. Et après, parfois, Louis et moi, on n’était pas d’accord, il me disait : « Tiens ! là j’aimerais qu’il y ait plus de ça, j’aimerais bien que ça tu le joues en live » ou des choses comme ça. Mais c’était toujours en vue de trouver un terrain d’entente entre nous.
Louis :
Je les titille tous un peu, c’est tout de même un peu mon rôle. Je donne mon avis, puis ils le suivent ou ne le suivent pas. À la base, je donne de grandes directions. Mais globalement je leur laisse 100% de liberté.

Maxime :
Quand je dessine, j’ai cette idée toujours d’aller un peu contre ma pratique de l’architecture, il y a vraiment peut-être un, deux ou trois croquis en noir et blanc qui me prennent je dirais deux minutes et après, quand j’en tiens un, j’en fais un croquis en couleur en peut-être cinq minutes et puis, en général, je ne reviens pas trop en arrière. Comme je sais que j’ai un temps limité, je ne fais pas trop de recherche. Assez vite, je me dis : « Là, j’ai vraiment beaucoup de dessins à faire, il faut avancer » et j’aime bien ce côté instinctif. Pas trop de tergiversations, mais aller comme ça, à l’instinct.
Yovan :
Ce que je retiens du travail collectif, c’est que même le négatif nous apprend des choses. À certains moments on se tire les cheveux, mais c’était intéressant en tout cas de travailler dans un planétarium et tout ce que cela implique. J’ai rarement visité ce genre d’endroits, ce ne sont pas des lieux qu’on fréquente tous les jours, je parle pour moi, mais c’était intéressant de voir que ce sont des lieux qui sont très équipés pour le son et la musique (mais aussi du côté du visuel). Et du coup, il y a beaucoup de choses à faire, notamment avec les arts numériques qui est quand même une pratique assez nouvelle. J’ai pas mal d’amis qui se mettent aux arts numériques, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer avec ça. Le phénomène va au-delà des performances des artistes numériques, ce sont des choses qui se développent aujourd’hui aussi dans les concerts, dans les concerts de musique électronique, même dans les concerts de rock et de rap, on est dans les textures, dans les lumières, etc. J’ai appris que pour caler à un spectacle qui va peut-être ne durer qu’un quart d’heure, ça va être beaucoup de travail et encore heureux, on n’était que sur des dessins fixes et pas sur des dessins animés. J’ai bien apprécié de découvrir ce genre de travail très minutieux et qui prend un temps très long. Par contre, je pense que l’idéal aurait été d’avoir un maximum de choses déjà posées avant la première résidence, notamment dans l’écriture du conte, pour qu’ensuite, une fois qu’on est dans la phase de création, on puisse aller un maximum dans le détail pendant les répétitions et d’élaguer les choses. On n’a pas eu assez de temps pour faire cela par rapport à ce qui n’allait pas, pour aérer le spectacle. Mais cela va nous servir pour la prochaine fois, c’était plein de découvertes et puis à la fois aussi, de ce qui peut aller mieux, mais c’est le cas dans tous les projets de toute façon. Donc, franchement, il y a en majorité des aspects positifs dans tous les sens, maintenant, et maintenant voilà le spectacle, en espérant que ça tourne un petit peu et qu’on puisse continuer à le peaufiner.
Delphine :
Ce sont de belles rencontres, je suis contente de les avoir rencontrés tous les trois. C’est vraiment chouette d’être avec eux, c’est une équipe qui fonctionne vraiment bien. C’est d’autant plus chouette que ce n’est pas évident de pouvoir travailler avec tout le monde, c’est vrai, ce n’est pas toujours aussi simple. Et là, on s’entend tous très bien, même au niveau de la créativité.
Je relis maintenant mes notes, ça me fait rire. Ce n’est plus du tout ce que je dirais aujourd’hui. C’est drôle.
Le « Conte d’un futur commun » a été présenté pour la première fois le 18 juin 2023 au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains.
Le Conte d’un futur commun choisit d’explorer de manière collective un futur désirable et les manières d’y parvenir. Spectacle participatif, c’est à l’aide de son smartphone et de sa voix que le public va participer à l’histoire à la manière d’un jeu vidéo. Cette histoire se construit comme une improvisation collective, où chaque participant peut à tout moment la faire dévier ou bifurquer, la bousculer, l’augmenter, la détourner.
Co-production : AADN – Arts & Cultures Numériques à Lyon, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, Stereolux, Planétarium de Nantes, association Antipodes, Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus.
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée et de la SACEM cda95.fr/fr
1. Marie-France Marbach est une conteuse, directrice artistique du festival Contes Givrés et glotte-trotteuse. Geo Jourdain est le président fondateur de l’association Antipodes et un agitateur d’idées. L’association Antipodes, menée par Geo Jourdain et Marie-France Marbach se trouve à Saint-Marcelin-de-Cray (Bourgogne). https://www.association-antipodes.fr
2. « On retrouve François Pin dans son habit de président de l’association La Carrière de Normandoux, où tout a commencé, sur le lieu qu’il a acquis sur un coup de cœur en 2004 à Tercé, à 20 km de Poitiers ». lejdd.fr/Culture/L-etonnante-carriere-de-Monsieur-Pin-
3. IRFA-Bourgogne is a Training organisation in the Region Bourgogne Franche-Comté since 35 years.
4. L’Atelier du Coin, à Montceau-les-Mines, est un atelier chantier d’insertion. atelierducoin.org
5. Gus Circus de Saint Vallier, Fjep, école de cirque. koifaire.com
6. BIAC : Brevet d’Initiation aux Arts du Cirque, un diplôme pour enseigner les arts du cirque. Voir ffec.asso.fr
7. Nicole Durot. Voir « La Bulle verte » : En 2005, Nicole Durot crée La Bulle verte, une école de cirque réunissant jeunes et adultes valides et handicapés.labulleverte.com
8. Il s’agit de Laurent Fréchuret. Les paroles qui lui sont attribuées ici sont une fiction. Voir Laurent Fréchuret
10. Les Contes Givrés est un festival organisé par l’association Antipodes. association-antipodes.fr
11. Les architectes qui exercent la maîtrise d’œuvre sont tenus responsables des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination pendant les dix années qui suivent la réception des travaux. architectes.org
12. L’Ensemble Aleph est un groupe de musique contemporaine basé à Paris qui a existé de 1983 à 2022. ensemblealeph.com
13. Mapping : « le mapping vidéo est une animation visuelle projetée sur des structures en relief ». fr.wikipedia.org
14. Maxime Touroute : maximetouroute.github.io
15. Théâtre C2 à Torcy en Saône-et-Loire. 71210torcy.fr
16. Jacques Prévert, « L’Autruche », Contes pour enfants pas sages, Illustrations de Laurent Moreau, Paris : Gallimard-jeunesse – Folio Cadet, les classiques N°8, 2018. artpoetique.fr
17. Débruit ((Xavier Thomas) : limitrophe-production.fr
18. « KoKoKo! est un projet né à la faveur d’un tournage documentant la scène contemporaine du Kinshasa underground ». limitrophe-production.fr
19. Julien Lagrange, guitariste, enseigne à l’École de Musique (EMDT) du Clunisois (Saône-et-Loire) la guitare et les ateliers handicap. enclunisois.fr
20. Google : « Avec le format sonore 7.1, un canal central arrière est généré en plus de ces canaux et réparti sur deux autres enceintes (appelées centres arrière). Ce canal, codé dans les canaux d’effets stéréo, permet de mieux localiser les effets et les signaux musicaux directement derrière la position assise. » google.com
21. Laboratoire artistique, le LabLab offre un espace de recherche et de création intégralement équipé pour de nouvelles expériences audiovisuelles, immersives et interactives. polepixel.fr
22. AADN (Arts & Culture Numériques) est une association créée en 2004, elle porte des projets artistiques et culturels qui bousculent les imaginaires et suscitent le désir de fonder une société post-numérique sensible, solidaire et responsable. aadn.org
23. Métavers : « par définition un métavers est un monde virtuel. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une version futuriste d’Internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont accessibles allant au-delà du monde réel. » wikipedia.org
24. Baptiste Morizot est un philosophe français qui enseigne à l’université d’Aix-Marseille. Ses recherches portent principalement sur les relations entre l’humain et le reste du vivant. wikipedia.org
25. Camille de Toledo est un essayiste et écrivain français vivant à Berlin. Il est aussi plasticien, vidéaste et enseignant à l’ENSAV (La Cambre) à Bruxelles. wikipedia.org
26. Medlay est un concept de média hybride permettant de créer un artefact multimédia pour raconter une histoire et/ou communiquer une idée sur le Web. ranbureand.github.io
27. Resolume Wire est un environnement de patch modulaire basé sur des nœuds pour créer des effets, des mixeurs et des générateurs vidéo. resolume.com
28. Jacques Puech est un chanteur et joueur de cabrette de la musique traditionnelle du Massif Central en France, voir la Novia : la-novia.fr
29. Stems : « Ce qu’on appelle les «Stems», ce sont les différentes pistes sources dans votre projet de production, mais regroupées par section. » loreille.com
30. Notion est une application de prise de notes, de gestion de projet et de collaboration développée par Notion Labs Inc. Wikipédia fr.wikipedia.org
31. Chevagny-Passions est un festival des arts qui a lieu une fois par an à Chevagny-sur-Guye (Saône et Loire). fr.wikipedia.org
32. EAC, Ministère de la Culture : « L’éducation artistique et culturelle (EAC) a pour objectif d’encourager la participation de tous les enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, un rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture, une pratique artistique ou culturelle. » culture.gouv.fr
Gilles Laval – Talking
Access to the texts associated with Gilles Laval:
A. Gunkanjima by Noemi Lefebvre : English translation
B. Edges – Gilles Laval : Lisières – English translation
Accéder aux textes originaux en français :
A. Gunkanjima : Gunkanjima
B. Réflexions sur quelques murs d’incompréhension entre pratiques musicales : texte original en français
C. Lisières – Gilles Laval : texte original en français
Extract from a Talk between Gilles Laval
and Jean-Charles François
Reflections on some walls of misunderstanding between musical practices
In a recent workshop that I conducted in an institution of higher education, I realized that there were problems I did not suspect at first. That is, after the students were given assignments, some misunderstanding occurred, which in my opinion is due to the fact that under the same words people do not hear the same things. And in this context, I also asked for an exercise that involved transcribing a recorded piece of music, but the listening varies according to the aesthetics of the world one comes from. We don’t use the same entries to listen and explain what we’re hearing.
This means that people who are competent in their field of analysis or writing music are completely lost in the face of music that is foreign to them.
In a way it is the opposite of what Giacomo says: (see Encounter with Giacomo Spica Capobianco in the present edition) “when you go to a neighborhood where there is nothing left, it’s a no man’s land, there are only no law zones, even the cops don’t go there. You’re going to try to install things culturally, but there’s a gap that’s widened so much, such a big divide, that makes some people wonder why we come, they don’t see the point.” And you can turn the thing around a bit by saying: in a neighborhood with a classical music institution, everything is provided, it’s not a no man’s land, it’s just an area with full rights. But it’s basically the same problem: if things are introduced that are culturally unrecognized, there’s a gulf that has grown so wide, a fracture that is so great, that some people wonder why one comes there.
Return to the other texts by Gilles Laval.
Gilles Laval – Conversation
Accès aux textes liés à Gilles Laval :
A. Gunkanjima par Noemi Lefebvre : Gunkanjima
B. Lisières : contribution de Gilles Laval : Lisières
Access to the English translations:
Gunkanjima – English
B. Reflections on some walls of misunderstanding between musical practices : Gilles Laval – English
C. Edges – Gilles Laval : Lisières – English
Extrait d’une conversation entre Gilles Laval
et Jean-Charles François
Réflexions sur quelques murs d’incompréhension entre pratiques musicales
Retour aux autres textes de Gilles Laval.
Gilles Laval
Gilles Laval – Trois textes
A. Gunkanjima par Noémi Lefebvre
Texte publié dans la première édition 2016 de paalabres.org : Gunkanjima
Text published in the 2016 edition of paalabres.org : Gunkanjima – English translation
B. Extrait d’une conversation entre Gilles Laval et Jean-Charles François
Réflexions sur quelques murs d’incompréhension entre pratiques musicales : Conversation
Reflections on some walls of misunderstanding between musical practices : Gilles Laval – English
C. Lisières : contribution de Gilles Laval
Version en français Lisières – français
English translation : Edges – Gilles Laval – English
Jules Ferry Primary School
Project with the children of Jules Ferry Primary School in Villeurbanne
2018-20
Philippe Genet, Pascal Pariaud and Gérald Venturi
This project is part of a program of the French Institute of Education. The Jules Ferry elementary school in Villeurbanne is an « associated educational institution », a partnership between a research laboratory and schools. The project developed over the last three years by Philippe Genet, Pascal Pariaud and Gérald Venturi is being carried out in collaboration with the sociologist Jean-Paul Filiod and the teachers of the Jules Ferry school.
The four members of the research team have been working on identifying learning of musical (vocabulary, culture…) and psychosocial (self-esteem, cooperation…) nature. This involves musical listening and sound manipulation workshops.
Here are two examples of sound files realized by the children in this project:
1. Projets 2019-20.
2. Projet June 2019.
Ecole Jules Ferry
Projet avec les élèves de l’école primaire Jules Ferry de Villeurbanne
2018-20
Philippe Genet, Pascal Pariaud et Gérald Venturi
Ce projet fait partie d’un dispositif de l’Institut français de l’éducation. L’école Jules Ferry de Villeurbanne est un lieu d’éducation associé (LéA). Il s’agit d’un partenariat entre un laboratoire de recherche et des établissements scolaires. Le projet développé depuis trois ans par Philippe Genet, Pascal Pariaud et Gérald Venturi se déroule en collaboration avec le sociologue Jean-Paul Filiod et les enseignants et enseignantes des classes de l’école Jules Ferry.
Les quatre membres de l’équipe de recherche travaillent sur des repérages d’apprentissage de nature musicale (vocabulaire, culture…) et psychosociale (estime de soi, coopération…). Il s’agit d’ateliers d’écoute musicale et de manipulation sonore.
Voici deux exemples d’enregistrements des productions réalisées par les élèves :
1. Projets 2019-20.
2. Projet juin 2019.
Cécile Guillier : Text 3 – English
Free Immured-Art: Murmurs
Cécile Guillier
One of the most enjoyable experiences I had playing music was free improvisation. After overcoming a blockage that prevented me from doing so for many years (all during my studies at the conservatory and a few more afterwards), it became a joyful experience for me. On the initiative of a jazz piano teacher, with a few volunteer colleagues and adult jazz students, we would play for a few minutes, with or without instructions (when there were, it was sometimes structural constraints). My great pleasure was in this alternance of play and discussion afterwards. The discussion was free, that is to say not aimed towards progress or assessment, it was only the moment to talk about how far we had come, how each person had heard it, had been surprised, interested, disconcerted, left out… And I was quite at ease playing or singing, I had the impression that one was playing directly with sound matter (idiomatic or not) and with human relationships (what do I hear from others, do I answer them…). I think I was the only one to view it that way, and the others were surprised by my enthusiasm. I was struck by the power of free improvisation on a group, to connect individuals and create a common culture. The colleague who had organized this was careful not to make value judgments about the sound result and the choices made by each participant. I still have a kind of nostalgia for having caught a glimpse into what I would like to do much more often, and with much more diverse people, whether or not they are already musicians. Having said that, it takes a certain amount of courage to go beyond the usual musical rules of the game, and I don’t always have it. When we talk about walls, it’s mostly there that I see them, in our heads (like a drawing I studied in German class in college that said “the wall is still in our heads”). I get the impression that I have to cross a similar wall every time I play in the street, so outside a concert hall: the moment when I switch from a person who walks with a violin, like everyone else, to a person who is preparing to play in front of others. It’s a small psychological wall to cross.
Another experience, different, of the notion of a wall: during my violin apprenticeship at the conservatory, my teachers often pointed out my defects, my failures. I imagined them as walls that I had to overcome, and with a lot of effort and willpower, I hoped to overcome them. But I believe that the effort and the will focused me on the walls to overcome rather than on the interest to overcome them. I think that if my teachers had told me instead, this is what I enjoy doing, this is why I find interest in doing it, I might have found a quicker way to get over those walls. The pleasure and interest in being a musician, the nature of what a musician is, often remains unquestioned, unshared. It’s often a world of phantasms and individual projections, when it could be a world of shareable experiences.
Access to the three texts (English and French)
Texte 1, Faire tomber les murs : mûrs ? Français
Texte 1, Walkabout Wall Falling [Faire tomber les murs : mûrs ?] English
Texte 2a, Interlude Français
Texte 2b, Interlude English
Texte 3b, L’art-mur de la liberté : murmures Français
Cécile Guillier : Texte 3
L’art-mur de la liberté : murmures
Cécile Guillier
Une des expériences les plus agréables de jouer de la musique qu’il m’a été donné de faire a été l’improvisation libre. Après avoir dépassé un blocage qui m’en a empêché pendant de nombreuses années (toutes celles de ma scolarité au conservatoire et encore quelques autres après), c’est devenu pour moi une expérience réjouissante. Sur l’initiative d’un professeur de piano jazz, avec quelques collègues volontaires et des élèves adultes en jazz, nous jouions quelques minutes, avec ou sans consigne (quand il y en avait c’était parfois des contraintes de structure). Mon grand plaisir était dans cet enchaînement de jeu et de discussion ensuite. La discussion était gratuite, c’est à dire pas orientée vers un progrès ou une évaluation, c’était seulement le moment de parler du chemin qu’on avait parcouru, de la manière dont chacun l’avait entendu, de ce qui l’avait surpris, intéressé, décontenancé, laissé de côté… Et j’étais assez à l’aise pour jouer ou chanter, j’avais l’impression que l’on y jouait directement avec de la matière sonore (idiomatique ou pas) et avec des rapports humains (qu’est-ce que j’entends des autres, est-ce que je leur réponds…). Je crois que j’étais la seule à voir les choses comme cela, et les autres étaient surpris de mon enthousiasme. J’ai été frappée par la puissance de l’improvisation libre sur un groupe, pour relier les individus et créer une culture commune. Le collègue qui avait organisé cela prenait bien garde à ne pas formuler de jugement de valeur sur le résultat sonore et les choix des uns et des autres. Je garde une sorte de nostalgie d’avoir aperçue ce que j’aimerais faire beaucoup plus souvent, et avec des gens bien plus divers, déjà musiciens ou non. Cela dit, il faut un certain courage pour dépasser les règles de jeu musical habituel, et je ne l’ai pas toujours. Quand on parle de murs, c’est surtout là que je les vois, dans nos têtes (comme un dessin que j’avais étudié en cours d’Allemand au collège et qui disait « le mur est encore dans les têtes »). J’ai l’impression de devoir franchir un mur semblable les fois où je joue dans la rue, donc en dehors d’une salle de concert : le moment où je passe d’une personne qui marche avec un violon, comme tout le monde, à une personne qui se prépare à jouer devant les autres. Cela constitue un petit mur psychologique à franchir.
Une autre expérience, différente, de la notion de mur : durant mon apprentissage du violon au conservatoire, mes professeurs me signifiaient souvent mes défauts, mes manques. Je les imaginais comme des murs à franchir et à force d’efforts et de volonté, j’espérais y parvenir. Mais je crois que les efforts et la volonté m’ont focalisé sur les murs à franchir plutôt que sur l’intérêt à les franchir. Je crois que si mes profs m’avaient dit plutôt, voilà ce que j’ai plaisir à faire, voilà pourquoi je trouve de l’intérêt à le faire, j’aurais peut-être trouvé plus rapidement comment franchir ces murs. Le plaisir et l’intérêt à être musicien, la nature de ce qu’est un musicien, reste souvent non questionné, non partagé. C’est souvent un monde de fantasmes et de projections individuelles, alors que ça pourrait être un monde d’expériences partageables.
Accéder aux trois textes (français et anglais)
Texte 1, Faire tomber les murs : mûrs ? Français
Texte 1, Walkabout Wall Falling [Faire tomber les murs : mûrs ?] English
Texte 2a, Interlude Français
Texte 2b, Interlude English
Texte 3b, Free Immured-Art: Murmurs [L’art-mur de la liberté : murmures] English
Cécile Guillier – Texte 1 – Français
Faire tomber les murs : mûrs ?
Cécile Guillier
En Mai de l’année 2018, j’ai participé à un spectacle co-construit par 3 collègues (alto, violoncelle, percussion), un danseur de hip-hop et moi-même, violoniste. En effet, dans le cadre de la saison professionnelle de notre établissement, il est accordé un financement à quelques projets artistiques (environ 3/4 par an) réunissant des enseignants et des artistes extérieurs au CRD [Conservatoire à Rayonnement Départemental]. L’idée venait du professeur de violoncelle, appelons la F., qui avait rencontré V. (danseur et enseignant de hip-hop dans des structures privées). Elle a proposé de monter un trio à cordes (avec A. à l’alto) et d’y ajouter un percussionniste (M.) et de travailler avec V., pour un unique concert à la Chaise Dieu.
Le projet me tentait mais malgré l’ambiance plutôt détendue et le plaisir de jouer ensemble, nous avons eu (selon moi) des difficultés à formuler des enjeux artistiques, à avoir un regard critique sur nos productions, et à mettre en place une démarche de création. Il faut mentionner avant tout des contraintes de financement (nous n’étions rétribués que pour quelques répétitions, un concert et un concert scolaire, et nous avons tous donné bien davantage). Mais nous avions aussi, au moins les trois instrumentistes à cordes, des angles d’entrée et des manières de faire différentes : A. souhaitait travailler plutôt avec une partition écrite devant les yeux, et F. proposait de construire un spectacle original avec mise en scène, mais en utilisant des œuvres classiques. Ses envies allaient plutôt (je crois) vers les performances d’artistes qui interprètent des suites de Bach pendant qu’un artiste hip-hop danse sur cette musique, tout en faisant parallèlement la promotion de la musique de chambre. Cela m’apparaissait à priori comme un pseudo choc des cultures organisé pour un public habitué du classique. J’aurais voulu questionner les rapports et les spécificités du travail des mouvements et de celui des sons, mais je n’avais pas forcément le temps et les moyens pour mener au bout un tel chantier. Et surtout pas l’habileté relationnelle à provoquer un réel travail sur ce sujet, étant donné les mises en causes individuelles qu’il n’aurait pas manqué de soulever : le milieu classique, celui des enseignants encore plus, a tant besoin de légitimer sa compétence que l’exploration, la création, la prise de risque sont parfois extrêmement difficiles entre collègues. Le danseur de hip-hop lui, nous demandait de monter nos morceaux en répétant qu’il inventerait des chorégraphies dessus. A présent que je regarde les rushes de la seule vidéo de répétition que nous avons, il me parait clair qu’il tentait d’adapter sa pratique de la danse à ce qu’il percevait et projetait de notre pratique « classique ». Visionner l’ensemble (se filmer et analyser) aurait été essentiel mais nous ne l’avons pas fait (la seule vidéo est celle d’une répétition que nous n’avons pas pu visionner avant le spectacle). Et la posture du percussionniste a plutôt été de suivre les initiatives des uns et des autres. (Il faut dire que le groupe était vraiment disparate dans ses aspirations, il valait peut-être mieux qu’il n’y ait pas une cinquième ambition différente).
Je pense que chacun a fait des concessions, des efforts, que nous avons fait du mieux possible mais que nos conceptions des enjeux de la création étaient multiples et pas toujours explicites, la cohérence artistique du spectacle n’était pas totale, le travail sur les représentations des uns et des autres un peu ambigu.
J’ai eu la possibilité de glisser dans le spectacle un interlude théâtralisé que j’avais écrit et qui reprenait ce qui me semblait constituer un fil, un lien entre nous, du moins entre la musique et la danse. Le texte de cet interlude est présenté dans ce site :
Interlude.
A travers ce début de réflexion, je souhaitais aussi m’interroger sur la démarche de production artistique. Il me semble que dans d’autres conditions, on aurait peut-être pu organiser un temps d’expérimentation, d’analyse des pratiques des uns et des autres, et de formulation des éléments essentiels que l’on voulait « représenter », et qu’ensuite, le medium, le choix du répertoire, des instruments, la question de la mise en scène, du rapport au public auraient pu réellement être abordés. Peut-être n’est-ce pas un préalable, mais bien un aller-et-retour qu’il faudrait parvenir à installer. Ou peut-être n’est-ce possible que sur un temps long de travail en commun ?
« Faire tomber les murs », ce spectacle en avait l’ambition mais j’en garde un souvenir ambivalent : à la fois un moment où l’on a voulu sincèrement explorer nos domaines artistiques, mais un moment où l’on a aussi pas mal évité de prendre ce risque.
Accéder aux trois textes (français et anglais)
Text 1, Walkabout Wall Falling [Faire tomber les murs : mûrs ?] English
Texte 2a, Interlude Français
Text 2b, Interlude English
Texte 3a, L’art-mur de la liberté : murmures Français
Texte 3b, Free Immured-Art: Murmurs [L’art-mur de la liberté : murmures] English

