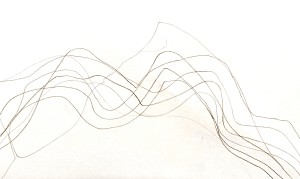The Metronome Episode
Karine Hahn
Extract from the Part III of her doctoral thesis
“The (Re)sonant Practices in the Dieulefit Territory, Drôme:
Another Way for Making Music”
Translation from French
and General introduction by
Jean-Charles François
Sommaire :
Part I: General Introduction
Part II: The Metronome Episode
Taking a metronome out during a rehearsal, is it an accident?
The off-beat uses of this heteronomous tool
The agency of the metronome
Internal Time and External Time
The Situation of Rhythmic Work Confronted to the Sculpture of a “Soft Metronome”
Part III: Reaching Agreement, in and through Musical Practices, within a Territory
Metronome Gap Made Possible
Coordinating and Adjusting to Create a Common Ground in the Dieulefit Surroundings
A choice of observation of actions that are situated, but taken in a temporal density
General Introduction
In October 2023, Karine Hahn brilliantly defended her doctoral thesis in sociology at the École des Hautes Études en Science Sociale, on “Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit, Drôme: une autre manière de faire la musique” [“(Re)sonating Practices on the Dieulefit (Drôme) Territory: Another Way of Making Music“.] Karine Hahn is a harpist, sociologist, Director of the “Formation à l’Enseignement » at the Lyon CNSMD, and a member of PaaLabRes collective since its foundation. In the perspectives of this 4th Edition, Karine’s thesis represents a particular important text for its meticulous investigation of everyday musical practices in a specific environment, and their critical analysis. Our intention is to publish large extracts of the thesis in this 4th Edition in serial form.
As a first installment in this process, e are publishing here an extract from the third part of the thesis: “La mise en accord des musiciens avec leur territoire : construire en commun, une expressivité démocratique“ [“Tuning musicians to their territory: building in common, a democratic expressivity”], and more precisely “the Metronome Episode”, a significative moment when one of the an ensemble’s leading members proposes the use of this tool to find a solution to the problems of rhythmic collective accuracy.
Karine Hahn’s thesis is focused on the history and current practices at Dieulefit’s music school, the Caem [Carrefour d’Animation d’Expression Musicale], in existence since 1978, and its inscription in the geopolitical context of the town of Dieulefit, a high-place of resistance, and its surroundings.
In her general introduction, Karine describes the Caem in this way:
The Caem displays a) a commitment for civic engagement based on an awareness of social and cultural inequalities; b) a determination to share with no exclusion; c) an involvement of all partners in the everyday life of the music school; d) an absence of normativity, and the idea of a constant invention of practices. For Karine “what’s intended is (…): to provide a space, instruments, and teaching, to make accessible for all a practice that you have developed yourself” (p. 3).This music school, founded in 1978 in the small town of Dieulefit, in the Drôme department, by parents with the wish to “to welcome everyone who wants to come to make music”, was presided at its foundation by Josiane Guyon. (p.2)
As part of her research, Karine Hahn decided to join in 2013 one of Caem’s ensembles, the Tapacymbal fanfare [Tapacymbal: phonetically “do you have a cymbal”], “playing flugelhorn for two years, then the small tuba.” The Tapacymbal fanfare is one of around twenty ensembles withing the Caem, part of the music school’s emphasis on “the extremely strong development of collective practices” (p. 108), and an affirmed link between music teaching/learning and the various existing ensembles. Initially Tapacymbal was “a collective workshop for citizen animation” (p. 151), then evolved into a more autonomous status as the “Fanfare Dieulefitoise issue du Caem” [“Dieulefit Fanfare issued from Caem”]. Karine describes its functioning in the following manner:
In Tapacymbal, certain characteristics of a fanfare are clearly present – the importance given to a repertoire implicitly inherited from the “orphéon”[1] coupled with the development of a festive, even carnivalesque dimension. But the musical elaboration is done with other strong characteristics, some shared with other Caem ensembles and pedagogical periods: the presence of conductor is forbidden who might assume an authoritarian role; the importance for all to speak up, both musically and verbally; the handling of musical information by participants; the continual reactivation in new discussions of choices previously made; a focus on rhythmic elements. (p.152)
To introduce the third part of her thesis, Karine proposes to pay attention to the description of “musical moments” in which a way of making sound is collectively fabricated:
The ways of doing things reveal a musicians’ ability to tune into and with their territory, with modalities and according to criteria that are unique to them. The question of the rhythmic setting up offers a particularly dense means of questioning the relationship between the individuation and the collective. Moreover, these musicians are committed to making differences possible by circumscribing them, through their ways of doing things, to something that can take place in their functioning, a form of revendication (in the sense of claim, Laugier, 2004) of their common practice. More generally, the translation, and adjustment operations, the spaces for debates and the circulation of the different musical components create the foundation of a committed musical theory, which creates in the Dieulefit surroundings the conditions for a democratic form of expressivity. (p.42)
The section of the thesis entitled “Metronome Episode” which we publish below, is a particularly interesting example of tensions in the realm of practice between a) multiple levels of ability that exist in a given ensemble that need to be combined; b) a relationship to available tools that varies a lot among members of an ensemble; c) very diverse representations of music in its everyday practice by a group. On this last point, the most obvious tension analyzed by Karine Hahn can be found in the reference music education institutions dominated by “classical” music and the amateur practices more open to a variety of aesthetics that meet the expectations of those who participate in it. Karine, in her simultaneous role deliberately divided between critical investigation of the Tapacymbal fanfare practices and her committed participation in this ensemble, becomes herself one of the people to be observed and analyzed. Her own conception of musical practices (and its application in the case of metronome use) is thus only one of the possible representations within an ensemble in which each person expresses a slightly different point of view.
The object-metronome makes a drastic intrusion in the practice of a group that usually resists rather vehemently any external authoritarian imposition. Its sudden appearance triggers a cluster of contradictory elements, which will be positively resolved in solutions that don’t quite correspond to institutionalized norms. The metronome episode is for Karine a particularly significant moment of the encounter between a theory embodied in an object and its more or less effective influence on the practical solutions it is supposed to incarnate.
Part II: “The Metronome Episode”
Karine Hahn
The scene took place during one of the rehearsals of the Tapacymbal fanfare, in the old college hall, in March 2017. Tapacymbal was working on the rhythmic setting of Sydney Bechet’s Egyptian, in an arrangement proposed by Christian, the band’s clarinet and soprano saxophone player. To put together this piece represents for the group a certain challenge, especially at the level of its rhythmic setting. For a while these rhythmic issues occupied the essential part of the rehearsals. However, for some time then, no new materials or ideas came to me to enrich my analysis, which seems to me to indicate a stability of these ingredients and a saturation of the terrain of my field research. I had already noted that the rhythmic complexity, or the setting of polyrhythms were not impeding either the assertion of musical discourse or the ensemble cohesion. The plurality of the relationships to pulsation and the various attempts to reach a common pulsation had already definitively emerged during the different rehearsals and performances – whether as part of the fanfare’s daily practices, or in other Caem activities, such as the project with Miss Liddl.
But during this rehearsal on the evening of Thursday March 9, after several attempts at playing, “rien ne va plus”. And if this assessment is first expressed in these terms by Vincent, taken on by Helen on snare drum and then by several other musicians, it was also for me, at that moment, that “nothing’s going right”: Vincent, the rehearsal’s referent saxophonist, takes out his portable phone with a downloaded free application of a metronome, announcing by this gesture that a working session with this substitute metronome will take place. And, as we will not be able to hear the sound of this metronome while playing, he plugs it on the bass amp present in the room, after setting it on a table, so that the loudspeaker will be high enough that the musicians could not fail to hear it.
I’m bewildered by this imposition of an object that I considered representative of a music world against which the actors involved in the Dieulefit musical practices seemed to have taken a stand, and therefore suddenly seemed to me to call into question the whole theoretical construct in the process of being stabilized, stemming from my field research analyses. What I considered initially as an “accident” forced me to move once more my gaze, to pursue the inquiry starting with this “metronome” object, to realize that the use of this tool had not necessarily the same significance in Dieulefit, as the one assumed by me. As this “metronome episode” unfolds in front of me, as I observe the musicians with whom I’m experimenting how to play together not reacting as I’d expected while elaborating this piece of music, their common ground, I have to build up a new way of distancing myself once more as a musician-teacher. It requires a form of reflexivity on academic approaches embedded in me, sharpening in a new way my ethnographic concerns. And, once this distancing becomes effective, the “metronome episode” might no longer be one as such, adding a temporal density that makes its use no longer an issue of usage, but of valuation. The analysis proposed here follows the meandering path of my conceptions.
Taking a metronome out during a rehearsal, is it an accident?
Taking out a metronome, even before being used, is an act. It is preceded by Vincent’s declaration that “nothing’s going right”, confirmed and relayed by other musicians, verbally or showing signs of exasperation. In summoning the tool, by taking it out of his pocket, Vincent conveys the fact that the group isn’t playing rhythmically together (or not enough). After having experimented several working modalities, he expresses the need for outside aid – here, a technological accessory. This “metronome scene” is both an event and, taken in its temporal density, an “episode” of the Dieulefit rhythmic issues.
The lack of any negative reactions to this proposal, apart from a few sighs and two or three negative expletives [Oh! no…], in an ensemble accustomed to expressing its opinions almost in continuity with the notes that are being played, underlines the fact that the proposal is approved. Vincent’s initiative is even accompanied by:
Wait a minute, we’ll not hear it… take the amp, there…
Yes, you’re right… we’ll put it on the table, to hear it better… Someone has a cable?
Wait, there, yes, I think there is one in the cupboard.
Here’s a “metronome” application set up on a portable phone, connected to a bass amp: three objects – the phone, the metronome, the bass amp – that refer to different functionalities, uses, and representations. The use of the phone probably changes the representation of the metronome that some or the others have – you can consider, without too much fear of extrapolation, that its characteristic as a familiar and personal object decreases both its authoritarian and school-related dimensions. But this interpretation of mine at the time was not confirmed by what the actors had to say: in ensuing discussions, they always made reference to “the metronome”.
What’s more, the use of the object metronome was associated here to another object on which it is connected, the bass guitar amplifier, that has a different and multiple intentionality. In the fanfare rehearsal room, this amp is used in rehearsals to amplify the bass in popular music groups and in the “bœuf” [jazz jam session] workshop. So, there are also representations in the mind of the fanfare’s musicians that are linked to this use, especially on the side of freedom and creativity, that can counterbalance an authoritarian representation of the metronome. Here too, however, this interpretation refers above all to my own need to minimize the normative dimension of the metronome, both in its use and in the interactions occurring in the situation, so that I can understand how it might fit in.
The metronome object, to keep the focus on this object in the mentioned tryptic, confront you to a bundle of intersecting intentionalities. On the one hand, to what extent the use of the tool, in its primarily school meaning, differs from the way it was initially thought – that is to give to the performers a reference for pulse duration in relation to indications of expressive intents through the tempo, corresponding to the wish of the romantic composer for the performer to be as close as possible to his or her intention (Barbuscia, 2021).[2]. On the other hand, the strong representations linked to the metronome, and the relationships the users have or haven’t to this tool, differ with each of the musicians in presence – which means that they find themselves in different relationships to each other with this object. As for my own relationship to the metronome, as a professional musician observing the situation, while participating in it as an amateur tubist, the metronome is like a “repository of constraint in the world”.[3]
The off-beat uses of this heteronomous tool
The affordance theories (Gibson 1979), by proposing to closely observe what comes from the environment when an agent undertakes an action, enable us to take into consideration the different relationships to an object that various people have in order to envision the potential meanings they might invest. In the environment in which I evolve professionally on a daily basis, the use of the metronome is for me foremost an imposition external to the playing context, that is necessarily normative. As a support object par excellence for primarily a pedagogical practice, the metronome corresponds to a propaedeutic conception of musical teaching. Extremely normative and prescriptive, it’s difficult to escape it.
In addition, the metronome is more than just a working tool, it carries of certain values stemming from the context in which ir appeared. While the regular division of time is a culturally recent phenomenon[4], in music, the metronome instigates, as early as 1815, an equal relationship in musical time, which presupposes that you can divide it in a regular manner, creating the “illusion of objectivity in music” (Barbuscia, 2012, p.54). The use of the metronome soon imposed itself. “Promoted by composers as the only efficient ‘remedy’[5] to a default that the musical art had never been able to obviate, the metronome passed, without any difficulty or intermediary phase, from an accessory making a few happy to the indispensable object of any musical practice” (Ibid., p.58). This is consistent with a very strong rationalization of practices, notably towards republican equality – the revolutionary project of the Paris Conservatoire (Hondré, 2002). Equal beats organize the music. The metronome is then the egalitarian instrument par excellence: it is the physical proclamation of political equality. At the same time, it posits a relation to values: you must be with the metronome, assimilating the rhythmically normative performance to a moral issue. Aurélie Barbuscia also underlines the dimension of control conveyed by the instrument (Barbuscia, 2012, p. 63),[6] developing the idea that transgression can be found among the professionals (Ibid., p.67), as a mark of distinction, while amateurs and beginners must remain within the respect of a norm.
While my relationship to this tool is necessarily built with this background,[7] the other musicians in Tapacymbal don’t belong to the same environment, or not exclusively. They potentially refer to other kinds of metronome use, some of them considering it as a simple tool. Of course, the tool, necessarily normative because it is institutional, prescribes a certain use. The action aimed by its use is indeed, in all the different cases, to work towards achieving a common rhythm. But the way in which the actors use it, precisely in the choosing when to produce their sound in relation to the proposed beat, doesn’t necessarily fabricate the same meaning from one ensemble of musicians to another. While globally the use is the same, its application differs, and the valuation is not the same.
The percussionists here consider the metronome as a propaedeutic object, a tool on which to rely, but less for themselves than for others. Jean-Louis, on the bass drum, often mentions the fact that he must “play the role of a metronome”, similar to the measuring stick[8] that this new tool partially replaces, while waiting for Hélène, at the snare drum, to “gain in stability”, so that he could “drop this role and enjoy a bit more”. In this case, the physical metronome replaces the snare drum and the bass drum, allowing these musicians to concentrate on other musical aspects. Likewise, Vincent, in a deadlock over the working methods to play the piece, proposes a tool he hopes to lean on, in the sense that the other musicians will potentially be able to take reference from it. But unlike the percussionists, this doesn’t allow him for all that to turn his musical attention on other things: the focus then is on appraising whether or not the musicians are in sync with this external reference. Vincent, who as the fanfare referent feels particularly concerned by the choices of working methods, finds himself in a new, self-created constraint. While he practically never plays the role of timekeeper for the group, by bringing this telephone-metronome, this object forces him to be the referent appraising whether or not the musicians correctly play the impacts of the beats at the same time with it.
But in fact, it’s not the way it works. For most of the instrumentalists present, their use of the metronome is neither on the side of the normative imposition of an off-the-ground pulsation, nor on the side of a tool proposing a reference for playing in homorhythm. When the group begins to work with the metronome, all the fanfare musicians concentrate in a new way on rhythmic issues, and, after about half an hour of constant trial and error with the metronome, they succeed in playing together on a common pulsation, but not with the metronome pulsation that continues its regular scansion beats out of the bass amp. Here, the musicians use the metronome to find their own way of playing this new piece rhythmically together – the application isn’t uniquely set in motion as a “make believe” of playing with a metronome.[9] But they use it as a mediation tool, an external reference that helps them to focus on rhythmic issues, letting of course it play its role to the full, but in a certain way out of sync with the imposed norm – in a certain way that doesn’t stick to the metronome pulse, and without aiming to do so. The metronome thus has the same significance for action than in the institutional framework of a music class or an ensemble rehearsal – that is to help with rhythmic accuracy, eventually within an ensemble. And at the same time, it will be used to avoid using it. The valuation they attribute to the object and to what it enables them to do is different from that attributed to this object in a normative framework.
Thus, the use of the metronome, if prescribed by the object, doesn’t indicate the status and the power, the powers, granted to it – the metronome, conductor or reference point, the tool allowing to work towards being collectively with its beats, or to find a common pulse, eventually aside from the metronomic pulse. It undoubtedly doesn’t have the same significance for all the musicians present, and it can be considered as one of the playing and interacting spaces in-between the musical Dieulefit practices and the “under-layer” of the musical institutionalized practices on the national territory. This metronome implies different types of musical conceptions, which are as many constraints that are then discussed and negotiated in situation.
The Agency of the Metronome
The metronome, with its various intentionalities it carries here, is therefore also an object that makes people do something. This tool is mobilized for its intended purpose (to provide a fixed and repeated reference point of time divisions), it also has a power of agency, a capacity to generate one or more actions.[10] By replacing the bass drum musician, the metronome assumes the function of a person. A unique and collective reference point, chiming a regular pulse from which the musicians cannot escape, the object becomes a form of embodiment of a conductor – but referring to a figure of the conductor who would act like this object, only “beating time”,[11] even as this figure of a conductor is rejected. This leads during the rehearsal time to a form of double bind, to which the musicians will have to resolve, through their playing, and particularly through their discussions. The metronome is thus able to “make the musicians to do something”, to incite them to find solutions for playing together rhythmic settings. Here, it is accepted as mediation enabling of “finding a collective pulsation”, that will allow the musicians to play during perambulation, while at the same time not appearing as an authoritarian figure who would oblige the musicians to be at the same time with the metronome.
The object-metronome, during this Tapacymbal rehearsal, also makes people do something other than just repeating the same musical phrases attempting to get as close as possible to the amplified pulsation and/or to a common pulse. On the one hand, it triggers some sense of humor, which is both a safeguard and a sign of a possible drift that shouldn’t be overlooked, particularly that of the military band marching beat. In this way, Christian comments the starts of each playing sequence with the metronome by “Ein, zwei, drei, vier!”, a trait he reinforces when the musicians succeed in playing rhythmically together by calling out “Third Reich!” Christian is beside me, the most professionalized of the musicians present, having played in improvisation collectives, and perhaps because of that, the one for whom this tool most embodies the figure of the authoritarian conductor. But during the rehearsal break, in discussing the metronome, he insists, still with the tone of a joke, that “even so, it does allow you to play with each other…” These humoristic touches symbolically mobilize a particularly evocative universe for the Dieulefit residents. The form of saying marks a limit or a vigilance. It indicates that emerges a form of relationships to rhythmic accuracy that can be interpreted differently from the meaning intended by the musicians present at this rehearsal. They can be analyzed as a regulator of the use of the object metronome. On the other hand, the use of the metronome provokes a debate: it triggers a discussion that initially took place during the rehearsal break, and then continued into a collective debate at Vincent’s home, with the quasi-totality of the musicians.
Internal Time and External Time
[During the rehearsal break, in the same room.]
Vincent [reacting to a remark by a musician that I didn’t hear]: And the metronome, among other things, allows you to… to… it’s the thing that we all have experienced, you plug in the metronome and you have the impression that it’s irregular.
Luc : hum hum, yes, …
Vincent : Because we’ve integrated, we’ve integrated a regularity in relation to what we felt, and we have to adapt this regularity to the others.
Christian : Sometimes it’s the fault of the batteries too… [Laughs]
Cathie : Which means that the metronome, it’s completely inhuman…
Vincent : It’s inhuman, but makes you aware of your perception of time, and of the fact that it’s not always exactly the same as those you’re playing with. All the discussions where you say “but it’s you who’s speeding, but no it’s you, it’s you who’s irregular, but no it’s you”, it’s just the work to achieve a time perception that would be the same at a given moment. And after all, to make music, it’s just to get into the same irregularity. We don’t give a damn about the metronome. Except that it’s the tool that allows us to become aware of this.
Christian [slightly ironically, now getting out of his other parallel conversation]: but it even allows you to play with others…”
Vincent, who develops in his musical practice a strong reflexivity, is particularly interested in this kind of exchanges. The question of an individual perception of time, in relation to a metronomic reference perceived as fluctuating and plural, according to individuals, is a subject that motivates him and that he has already discussed outside the Tapacymbal context. It can also be interpreted in the light of the tension noted by Alfred Schütz (2006 [1984]) between internal time and external time, and the forms of communication created by the fact of playing together – a musician facing a work, or potentially a group of musicians:
In our problematic, it is essential to have a better understanding of the time dimension in which music takes place. […] [I]nternal time, the duration, is the very form of music’s existence. Of course, playing an instrument, listening to a record, reading a page of music, all these events take place in an external time, the time that you can measure with metronomes and clocks with which the musician “counts” to ensure the right “tempo”. […] [W]e consider internal time to be the very vehicle where the musical flow takes place. One can measure external time; there are minutes and hours, and the length of the sound grooves that the phonograph needle has to travel. There is not such measure for the dimension of internal time in which the listener live; there is no equivalence between its parts, if there are parts. (p.23)
“To make music, it’s just to get into the same irregularity” is an answer to this tension.[12] Observing musicians “making music together” then consists in identifying how the flows of internal times are linked, and how their synchronization (including in a choice of heterochrony) is ordered in a external, common time.
Alfred Shütz:
It seems to me that all possible communication presupposes a relationship of “syntony” between the one who makes the communication and the receptor of communication. This relationship is achieved through the reciprocal distribution of the experience unfolding in the internal time of the Other, through the experience of a very strong live present shared together, through the experience of this proximity in the form of an “We”. (p.27)
The Situation of Rhythmic Work Confronted to the Sculpture
of a “Soft Metronome”
After the rehearsal, the discussion continues over a drink in Vincent’s home, which is also the site of his carpentry workshop. On the upright piano, at the entrance to the living room, near some objects and an open black mechanical metronome, there is a solid wooden sculpture that represents a mechanical that seems to have the same characteristics as Dali’s “soft watches”[13] — a kind of “soft metronome”, in proportions quite similar to a traditional metronome, with a larger base. This artistic object that diverts a mechanical object, and which a certain number of the fanfare musicians know well as they fairly regularly pay a visit to Vincent, also possesses a certain agency: the capacity to propose a re-reading of the metronome, of which it is a subversive representation, just after a rehearsal animated with this tool by the one who owns and displays this sculpture to the view of all the invited fanfare musicians. This diversion repositions the metronome as an object and not any more as a tool – a parallel that could be drawn to the telephone, which, during the rehearsal, was diverted into a metronome, shifting it then from object to tool. Above all, this representation of a soft metronome, that evokes an improbable beat, necessarily irregular and nonchalant, out of time, and at the same time frozen in its fluctuating movement in wood, brings about a subversive dimension to the object it diverts.
In the moment of this discussion during the “coup à boire” at Vincent’s, this object doesn’t arouse much reaction, perhaps because it’s already familiar to most of the musicians. It’s also in a part of the living room a little set back from where we’re sitting. When, moving over, I discover it and exclaim, in an already high sound level ambiance, only a few react, and these interventions are relayed only by laughter – Vincent’s in particular, who quickly returns to his discussion:
Valérie: “Yes, yes, I know it!”,
Christian: “No wonder we can’t play in rhythm!”
Benjamin: “Hey, say, Vincent, that’s the one you should bring to rehearsal!”
Like Christian’s jokes, the display of this “soft metronome” can perhaps be read as an adjustment that enables the mobilization of the metronome object, but with a shift, leading either to not taking it seriously, or to breaking down rigid representations that are frequently assigned to it, and enter into dissonance with the Dieulefit “common higher principles”.
Thus, what the metronome makes the Dieulefit fanfare do is 1) a common work on pulsation, allowing them to “get into the same irregularity”; 2) some humor, ensuring an adjustment between what the tool imposes and its use in the Tapacymbal context (strolling together, yes, marching in step together, no); 3) a deflection of its tool dimension into an artistic object; 4) a collective discussion on what is to feel a tempo and search together a common pulsation. Besides, two characteristics of the way of making music in Dieulefit, already encountered, emerge strongly from this situation. On the one hand, discussion and debate are essential and constitutive procedures in the construction of musicality. On the other hand, even in this very constrained and situated rehearsal situation, facing a metronome, a heteronomous tool par excellence, and as the objective is to create some common ground, the relationships to the object, as well as what its use provokes, are as heterogeneous as the musical forms present in the Dieulefit territory.
Part III : Reaching Agreement in and through Musical Practices,
within a Territory
Metronome Gap Made Possible
So, at the Dieulefit fanfare, this metronome may be for some musicians “just a metronome”, for others it’s at the same time a normative object, a tool it would be a pity to do without, the possibility of a working method among others, an object that can be associated with other ones, and even deflected and subverted. If it is used here, it’s because it doesn’t represent a danger in the eyes of the musicians – who know how to protect themselves from the metronome “fateful consequence[s]” developed by Jacques Bouët (Bouët 2011).[14]
For all that, the use of the metronome, in the situation described above, can also by read as a gap between what engenders adhesion reactions, that is to do what Vincent proposes, and even to help him in making his proposal possible, and to realize that in a certain manner. The collective creates the possibility of this gap by circumscribing it, through their manners of doing, to something that can take place in their functioning. Group playing, humor, definition of limits, discussion and debate mark the refusal to consider the metronome as the ultimate referent and reduce it to what it also is: an object and a tool enabling a form of experimentation.
Coordinating and Adjusting to Create a Common Ground in the Dieulefit Surroundings
In Dieulefit, the issue of “reaching an agreement” among musicians appears to be really central. It’s done in ways, and according to criteria, that are specific to the actors involved in these practices. The desire of “reaching agreement” between musicians to play together cannot be taken for granted. While it can be considered as a musical necessity arising from the musical contexts played, or as a social evidence in certain contexts of normative practices, some collectives defend playing contexts that allow for an absence of reaching agreement, at least prior to periods of common artistic practices.[15] Moreover, the way Tapacymbal operates that makes it possible to join a group before knowing how to play, or to perform an instrumental solo without having mastered its rhythmic framework, indicates that its neither the musical stakes of the repertoires played, nor the norms implicit in group formats, that animate this desire of “reaching an agreement”, to find an adjusted manner of practicing music in Dieulefit.
My hypothesis is that musicians here decide to reach agreement, and on what they might agree, not only according to the modalities that fit them, but according to the ones that enable them to put into practice and to nurture “what they hold on to” and “that hold them on” (Bidet & al. [Dewey], 2011). These practices participate notably to give substance to some “common higher principles” identified in this article as the manners of making the Caem, Tapacymbal, the Festival 4th Résonnants, and which can also be found in spheres other than musical, particularly in the Dieulefit residents’ relationship to history, and in a few various tales told here and there. Reaching agreement among musicians is therefore done in and with their territory. The choice on which the musicians coordinate together to create a common ground, the modalities of adjustment, debate and circulation, are a way of building a territory of the music of Dieulefit surroundings, while at the same time fabricating some musical practices.
A Choice of Observation of Actions that are Situated, but taken in a Temporal Density
What remains to be seen, then, as close as possible to musical fabrication, is how and what is at play in this agreeing process among musicians as they construct their music. The profusion of musical practices in Dieulefit, paired with a terrain that developed over several years, provides a very dense analytical material that I treated in the two first parts of this thesis. Because this way of reaching agreement is depends on actions that are situated (Ogien & Quéré, 2005), but situated in dense temporal layers, this third part draws on situations that are described and then analyzed as events chosen among other possible actions, because identified at the end of my analyses as characteristic to the ways of making music in this territory.
Let’s pause for a moment to consider the temporal density of situated actions. Each situation, very closely observed, reveals “events” – as for example the fact of taking out a metronome. The metronome is an event in relation to my observations, because from where I stand in the understanding of how the group functions at this precise moment, coupled at the same time with the density of my representations of the tool, the metronome is for me unexpected, out of step with the identified and expected ways of doing things. While working on the rhythm has been a constant feature of the fanfare at least since I joined it, the first approaches to rhythmic work methods were far from the normativity of this tool. During my first interview with Jean, before joining the fanfare, told me[16] how he and his drummer friend Nico had spent at least one hour with Dédé to turn around an iron barrel hammering in rhythm, getting this trumpetist to feel the rhythmic turn that he had to play in Libertango.
Bringing out the metronome in a rehearsal is also an event, because it can be identified as triggering certain actions. Bringing it out during rehearsals is not part of the group’s habits, and the gap with the normal proceedings provokes exchanges that are themselves transformed. But rhythmic preoccupations on the one hand, and discussions on musical preoccupations on the other hand, are part of Tapacymbal usual way of doing things. To analyze the scene with the metronome as an “episode” is therefore above all a construction of the onlooker, due in part to the constitution of my own eye, to the intermittence of the ethnographic eye, and to the form of the setting of the enigma. But this reading of events is articulated with a very thick temporal density, brought to light by at the same time the duration of the field survey, the diversity of the contexts in play I was able to observe, and the indices that really occurred during the rehearsals.
So, whether it’s Egyptian, whcih Tapacymbal has been working on for a few months, here with the help of the metronome, or even more so Oye Como va, which the fanfare has been playing for several years, and which was often experienced in concert situations, the rhythmic issues have been structuring the rehearsals since their first reading. Moreover, the pieces are constantly revisited, with a concern for finding together a common rhythm that is constantly retried and tested. Likewise, the Thursday night’s rehearsals only show intermittently the musical practice of the Tapacymbal’s instrumentalists. The playing time between rehearsals, that varies a lot from one instrumentalist to another, can be very substantial – the working session at Valérie’s home, described in the first part of the thesis, shows that there are procedures in operation that only take place during this actual time, and impact the playing during collective rehearsal. In another rehearsal, Christian addresses the group to suggest a rhythmic element that had not been identified on the score, because he feels he can do so in view of the way the ensemble is playing the piece: a manner of playing that “functions” becomes a problem because he feels it’s possible to institute it as such. In these situations of synchronization, the issue of listening is central – both for the musicians playing, and for the description that can be made of them in observation situation (Weeks, 1996).
Here, the process of reaching agreement among musicians in and with their territory is negotiated for the most part around rhythmic adjustments, in situations that were transcribed and analyzed in the first part of this article. These rhythmic adjustments produce something other than a simple rhythmic set-up. They say something of the relation to a norm, to some outside references, whether or not carried by a conductor. Apart from the fact that these musicians consider the musical parameters in the way they interact (the flutist in Miss Liddl changes the attack of a note, then its pitch to match what is rhythmically expected), the rhythmic question, like the metronome, is solved in such a way as to allow for discussions and circulations and the possibility of a strolling that draws the audience into this process of reaching agreement.
Moreover, the process of reaching agreement through musical practice with and within its territory is achieved here through circulations – of musical elements, of roles, of voices – and through translation operations and adjustments, so that each voice counts and can be heard, carried, claimed (in the sense of claim, Laugier 2004), and participate in the common way of doing things. Some of these operations are described in the second part of the thesis, the analysis of which has made possible to throw some light on these ways of doing. The analysis of these musical practices shows that these ways of doing things concern and are supported by a committed music theory, which creates in the Dieulefit surroundings the conditions and the sound of democratic forms of expressivity.
Conclusion
(Extracts from “In Conclusion – Renewing One’s View to a Situation of Rehearsal”, p. 397)
To understand Tapacymbal through the logic of Dewey’s inquiry enables to consolidate us in our view of musical practices as an opportunity for investigations and experimentations, as instrumentalists, at the same time, fabricate music in ways they define in the course of their practice. Here, the constant problematization puts musical constructions back into play on a daily basis. Ways of coordinating and adjusting are elaborated in such a manner that plurality is guaranteed and visible, thus working through music on meanings that are what the musicians hold on to, and what holds them.
Observing and analyzing the implementation of Tapacymbal practices while participating in them, led me in the second part of the thesis to consider the actors of the Dieulefit’s musical practices as a community of investigators. The constitutive elements of their way of doing things, identified at the time, can be found here in the very precise forms of musical constructs, caught up in very dense temporal thicknesses. The way they are committed in structuring their music school, their ensembles and the festival, is also constitutive of their musical practices, and at the same time reinforce them. To identify these manners of doing things in closely observed musical practices, at the core of the fabrication of music wasn’t immediate, and referring to Dewey allowed me to strengthen an intuition that could not easily get rid of a reading of the situation as a simple problem of rhythmic setting up[17]. Thus, the duration and recurrence of my participation to Tapacymbal’s rehearsals and performances enabled me to consider anew these ways of doing things and their meaning, especially as I saw questions that, as a musician in the ensemble, seemed to me settled, being constantly brought back into play opening up new lines of investigation – something I wouldn’t have been able to identify in a shorter time span. The difficulty in sharpening my eye mainly resided in the strength of the highly integrated rhythmic isochrone approach, which constituted a screen for listening to rhythm other than in relation to a normative reference, with time sliced in isochrone pulsations. While this didn’t prevent me from thinking beyond various time organizations, as in this case by patterns and polyrhythms, nor from theoretically making it possible to consider them otherwise, it remain for a long time in my feelings and in my playing, and therefore in my listening, a background that was difficult to ignore, and I had to draw on my musician’s experiences to get rid of it. (…)
This music-social isochrone representation doesn’t only correspond here to my musician’s profile trained in specialized music education institutions: it’s also effective within Tapacymbal, as constitutive of one part of their repertoire. But it’s only one of several conceptions at work. A clearly differentiated practice would undoubtedly have obliged, and therefore allowed, to find other ways of observing rhythmic issues.
The idea there was to both listen with an isochronous approach, partly constitutive of the practices, and to construct the hypothesis that these musicians perhaps also had other manners of considering their own rhythmic set-up, opening ways to other kinds of listening. The “metronome episode” was in this sense a turning point[18] in my own investigation, leading me to consider that isochronous, or even heteronomous, pulsation was for these fanfare musicians one way among others to envision rhythmic issues, but that, with safeguards in place, it didn’t exclude other ways of doing things and should therefore be considered in the midst of a plurality. What I read as a double infringement of the technical object, that is summoning the metronome when nobody is forcing them to use it, and not to obey to the regularity of the metronome even though they do use it, is a form of hijacking of the object and appropriation of the tool.
1. In France, “orphéon” originated at the beginning of the 19th Century, in the form of workers’ choral ensembles. It gave rise later to local brass bands.
2. The following development is largely based on Aurélie Barbuscia’s article, “la pratique musicale, entre l’art et la mécanique. Les effets du métronome sur le champ musical du XIXe siècle” [Musical practice, between art and mechanics. The effects of the metronome on the musical domain during the 19th century.], Revue d’histoire du XIXe siècle, n°45, 2012.
3. Quoted by Gaspard Salatko, seminar Dynamique de la culture & anthropologie des activités artistiques et patrimoniales on the issue of « Agency in questions », co-animated by Emmanuel Pedler and Gaspard Salatko, Centre Norbert Elias, EHESS Marseille, February 25, 2021.
4. The rationalization and the levelling of time relations exceed the sole musical issues, which is imbedded in a global movement of society. Notably, the decimalization time units dates from the end of the 18th Century (Souchier, 2019), and fifty years after, the rail traffic implement the first unifications of timetables (Baillaud, 2006). But the fact that musical practices were very quickly influenced by this movement is not insignificant.
5. Report written in 1815 by Henri Montant Berton, member of the music section of the Académie Française, quoted by Barbuscia, 2012, p.58
6. « The subject-creator ambitions to reinforce his control over the very manner to interpret his work, by increasingly exerting his authority over the performer, who is invited to restitute as closely as possible his original intentions.” (Barbuscia, 2012, p. 63; see also Menger, 2010).
7. On the one hand, this background involves a form of unconsciousness among musicians – in the sense of a practice so integrated that it achieves the status of evidence for the musicians who convene this support object as soon as a rhythmic issue is raised. On the other hand, it contains a form of necessary conscientization – a relationship to rhythm and pulsation, built with a logic corresponding to that of the metronome, being indispensable during the academic studies.
8. It is indeed the object “metronome” that Jean-Louis invokes here – an object that seems here to have obliterated the other models of reference – cf. infra the development at the end of the chapter.
9. This refers to certain uses of scores and parts, discussed in the chapter on the fanfare, where certain musicians who cannot decipher the musical codes written on the score or part declare that they need them in order to play (Cheyronnaud, 1984).
10. This analysis is based on the seminar Dynamique de la culture & anthropologie des activités artistiques et patrimoniales on the issue of « Agency in questions », co-animated by Emmanuel Pedler and Gaspard Salatko, Centre Norbert Elias, EHESS Marseille, February 25, 2021.
11. The composer Hector Berlioz proposed such an image of the conductor in its short story Euphonia, “a utopia that describes a city completely devoted to music, thanks to the benefits of a ‘despotic’ government” (Buch, 2002, p. 1006): “An ingenious mechanism that could have been found five or six centuries earlier, if you had taken the trouble to look for it, and which endures the impulse of the movements of the conductor without being visible to the audience, marking, in front of the eyes of each performer, and very close to him, the beats of the measure, also indicating in a very precise manner the various degrees of forte or piano.” Hector Berlioz, “Euphoria ou la vie musicale”, Revue et Gazette musicale de Paris, 11-17, April 28, 1844, pp.146-147. Buch (2002, p.1007) gives the precision that « this text was reprinted by Berlioz, with slight modifications, in Les soirées de l’orchestre; you can find a separated edition in Editions Ombres, Toulouse, 1992.”
12. Vincent’s conclusion that “To make music, it’s just to get into the same irregularity. We don’t give a damn about the metronome” can also be read more simply as a form of response to the double constraint he imposed on the group when he took out his phone with this application. Vincent didn’t anticipate that, with this tool, the group would succeed to find a common pulse but not exactly with the metronome – and he’d doubtlessly have trouble, like me, to determine precisely why the group succeeded to stabilize in this way. Once the goal attained, he drops the tool, even if the tool itself hasn’t been used in an expected and normative manner: what matters now is to be able to play this piece together in a common rhythm, for strolling.
13. « The surrealist oil-on-canvas by Salvatore Dali, La persistence de la mémoire (The Persistence of Memory), painted in 1931, represents liquefying watches, playing with the contrast rigidity/passage of time, a preoccupation of the artist as intimate as it was linked to the questioning of modern physics (Dali, 1951).
14. « This ingenious marriage between physical time and musical time arranged by Maëtzel [in reality invented by Winkel (Barbuscia, 2012)] was a little forced. In fact, it had a fateful consequence that the homo metronomicus is no longer aware nowadays: the irregular pulsation oscillations were excluded from musical time, except in rubato and the like. (Bouët, 2011). Brouët’s thesis of “recovered pulsations [… from] before the metronome era” is developed further in the analysis of working on rhythm.
15. I think in particular of the “Voice, Music Body” encounters animated by Giacomo Spica Capobianco – even if it could be argued that participation in such encounters is already a form a prior agreement. See the article « Creative Nomad Creation » in the present PaaLabRes Edition
16. This part of the interview is recounted in the third section of the first part of the thesis concerning Tapacymbal, when Jean tells me about the instrumentalists of the ensemble before I joined the group.
17. It’s also a problem of rhythmic set-up, but to consider it only on this angle doesn’t allow to see what is otherwise at play, and the way it is being played.
18. It’s why I kept this title to emphasize a way of “setting the enigma” of my thesis
Quoted Publications
Barbuscia Aurélie, 2012, « La pratique musicale, entre l’art et la mécanique. Les effets du métronome sur le champ musical au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°45, pp. 53 – 68.
Baillaud Lucien, 2006, « Les chemins de fer et l’heure égale », Revue d’histoire des chemins de fer n°35, pp. 25 – 40.
Bidet Alexandra, Louis Quéré et Gérôme Truc, 2011, « Ce à quoi nous tenons. Dewey et la formation des valeurs », in John Dewey, La formation des valeurs, Paris, La Découverte, pp. 5 – 64.
Bouët Jacques, 1997, « Pulsations retrouvées. Les outils de la réalisation rythmique avant l’ère du métronome », Cahiers d’ethnomusicologie, n°10, pp. 107 – 125.
Buch Esteban, 2002, « Le chef d’orchestre : pratiques de l’autorité et métaphores politiques », Annales. Histoires, Sciences sociales, n°4, pp. 1001 – 1028.
Cheyronnaud Jacques, 1984, « Musique et Institutions au village », Ethnologie française, n°3, pp. 265 – 280.
Gibson James, 1979, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Houghton Mifflin Company.
Emmanuel Hondré, 2002, La Marseillaise, Éditions Art et culture.
Laugier Sandra, 2004, « Désaccord, dissentiment, désobéissance, démocratie », Cités, n°17, pp. 39 – 53.
Menger Pierre-Michel, 2010, « Le travail à l’œuvre. Enquête sur l’autorité contingente du créateur dans l’art lyrique », Annales, Histoire, Sciences Sociales, Éditions de l’EHESS, pp. 743 – 786.
Quéré Louis et Albert Ogien, 2005, Le vocabulaire de la sociologie de l’action, Paris, Ellipses.
Schütz Alfred, 2006 [1951], « Faire la musique ensemble. Une étude des rapports sociaux », Sociétés, n°93 pp. 15 – 28.
Weeks Peter, 1996, « Synchrony lost, synchrony regained: The achievement of musical co-ordination », Human Studies n°19. Kluwer Academic Publishers. Netherlands, pp. 199 – 228.
L’Épisode du Métronome
L’épisode du métronome
Karine Hahn
Extrait de la Partie III de sa thèse de doctorat
« Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit, Drôme :
une autre manière de faire la musique »
2023
Introduction générale de
Jean-Charles François
Sommaire :
Partie I: Introduction générale
Partie II: L’épisode du métronome
Sortir un métronome en répétition, un accident ?
Des usages décalés de cet outil hétéronome
L’agency du métronome
Temps interne et temps externe
Confronter la situation de travail rythmique à la sculpture d’un « métronome mou »
Partie III : Se mettre en accord, dans et par des pratiques musicales, avec le territoire
Rendre possible l’écart du métronome
Se coordonner et s’ajuster pour faire commun dans le pays de Dieulefit
Un choix d’observation d’action situées, mais prises dans une épaisseur temporelle
Introduction générale
En octobre 2023, Karine Hahn a soutenu brillamment une thèse de doctorat en sociologie à l’École des Hautes Études en Science Sociale, portant sur « Les pratiques (ré)sonnantes du territoire de Dieulefit, Drôme : une autre manière de faire la musique ». Karine Hahn est une harpiste, sociologue, directrice de la Formation à l’Enseignement de la Musique au CNSMD de Lyon et membre depuis sa fondation du collectif PaaLabRes. La thèse de Karine est particulièrement importante pour PaaLabRes, par son enquête minutieuse sur les pratiques musicales au quotidien dans un environnement spécifique et sur leur analyse critique. Notre intention est de publier de larges extraits de cette thèse dans la quatrième édition, sous la forme d’un feuilleton.
En guise de première livraison dans ce processus, nous publions ici un extrait de la troisième partie de cette thèse (« La mise en accord des musiciens avec leur territoire : construire en commun, une expressivité démocratique »), et plus précisément « l’épisode du métronome », un moment significatif où l’un des membres importants de l’ensemble propose l’utilisation de cet outil en vue de trouver une solution à des problèmes de mise en place rythmique.
La thèse de Karine Hahn est centrée sur l’histoire et les pratiques actuelles de l’école de musique de Dieulefit, le Caem, Carrefour d’Animation d’Expression Musicale, en existence depuis 1978 et de son inscription dans le contexte géopolitique de la ville de Dieulefit, haut-lieu de résistance, et de ses environs.
Dans son Introduction générale, Karine décrit le Caem dans ces termes :
Le Caem affiche a) une volonté d’engagement citoyen à partir de la prise de conscience des inégalités sociales et culturelles ; b) une volonté de partager sans exclusion ; c) une implication de tous les partenaires dans la vie quotidienne de l’école de musique ; d) une absence de normativité et l’idée de l’invention constante des pratiques. Pour Karine « l’intention active est (…) : se procurer un espace, des instruments, des enseignements, rendre accessible à tous une pratique que l’on a soi-même développée » (p. 3).Cette école de musique, créée en 1978 dans la petite ville de Dieulefit, dans la Drôme, par des parents ayant la volonté « d’accueillir tous ceux qui veulent venir faire de la musique », est présidée à sa fondation par Josiane Guyon. (p. 2)
Dans le cadre de sa recherche Karine Hahn a décidé de se joindre en 2013 à l’un des ensembles du Caem, la fanfare Tapacymbal, « au bugle pendant deux ans puis au petit tuba ». La fanfare Tapacymbal est un ensemble au sein du Caem parmi une vingtaine d’autres faisant ainsi partie de l’accent mis par cette école de musique sur « le développement extrêmement fort des pratiques collectives » (p.108) et une liaison affirmée entre l’enseignement de la musique et les différents ensembles existants. Au départ Tapacymbal est « un atelier collectif d’animation citoyenne » (p.151), puis évolue vers un statut plus autonome de « Fanfare Dieulefitoise issue du Caem ». Karine décrit son fonctionnement de la manière suivante :
Pour introduire la troisième partie de sa thèse, Karine se concentre sur la description de « moments de musique » où se fabrique collectivement une manière de faire du sonore :Dans Tapacymbal, certaines caractéristiques d’une fanfare sont bien présentes – importance donnée au répertoire, héritage implicite de l’orphéon doublé du développement d’une dimension festive voire carnavalesque. Mais l’élaboration musicale s’y fait avec d’autres caractéristiques fortes, pour certaines partagées avec d’autres ensembles et temps pédagogiques du Caem : l’interdit d’un chef qui endosserait un rôle autoritaire ; l’importance des prises de paroles, et musicales et verbalisations ; la manipulation des informations musicales par les participants ; la réactivation continue des choix opérés remis à discussion ; une centration sur les éléments rythmiques. (p.152)
Les manières de faire mettent au jour une mise en accord des musiciens dans et avec leur territoire, avec des modalités et selon des critères qui leur sont propres. Notamment, la question de la mise en place rythmique offre une prise particulièrement dense pour interroger les rapports d’individuation et de collectif. Par ailleurs, ces musiciens s’attachent à rendre possible les écarts en les circonscrivant par leurs manières de faire à quelque chose qui peut prendre place dans leur fonctionnement, forme de revendication (au sens de claim, Laugier, 2004) de leur faire commun. Plus largement, les opérations de traduction, d’ajustement, les espaces de débat, et la circulation de différentes composantes de la musique fondent une théorie musicale engagée, qui crée dans le pays de Dieulefit les conditions d’une expressivité aux formes démocratiques. (p. 42)
La partie de la thèse intitulée « Épisode du métronome », que nous publions ici, est un exemple particulièrement intéressant de tensions dans le domaine d’une pratique entre a) des niveaux de capacités multiples au sein de l’ensemble qu’il convient de combiner, b) d’un rapport aux outils mis à disposition qui varie fortement entre les membres de l’ensemble, c) de représentations très diverses par rapport à la musique dans sa mise en pratique quotidienne par un groupe. Sur ce dernier point, la tension la plus évidente analysée par Karine Hahn, se trouve entre les institutions d’enseignement de la musique de référence dominées par la musique « classique » et la pratique des amateurs plus ouverte à des formes variées d’esthétiques répondant à l’aspiration de ceux et celles qui y participent. Karine, dans son rôle simultané volontairement partagé entre l’enquête critique des pratiques de la fanfare Tapacymbal et sa participation engagée dans cet ensemble, devient elle-même, une des personnes qu’il convient d’observer et d’analyser. Sa propre conception des pratiques musicales (et sa mise en application dans le cas de l’usage du métronome) n’est donc qu’une des représentations possibles au sein d’un ensemble où chaque personne exprime un point de vue sensiblement différent.
L’objet métronome fait une irruption drastique dans la pratique d’un groupe qui résiste d’habitude plutôt avec véhémence à toute imposition autoritaire extérieure. Son apparition soudaine déclenche un faisceau d’éléments contradictoires qui va se résoudre positivement dans des solutions qui ne correspondent pas tout à fait aux normes instituées. L’épisode du métronome est pour Karine un moment particulièrement significatif de la rencontre d’une théorie incorporée dans un objet et de son influence plus ou moins effective sur les solutions pratiques qu’il est censé incarner.
Partie II: L’épisode du métronome
Karine Hahn
La scène se situe lors d’une des répétitions de la fanfare Tapacymbal, dans la grande salle de l’ancien collège, en mars 2017. Tapacymbal travaille à la mise en place d’Egyptian de Sydney Bechet, dans un arrangement proposé par Christian, clarinettiste et saxophoniste soprane à la fanfare. Monter cette pièce représente un certain défi pour le groupe, notamment au niveau de ses enjeux rythmiques et de sa mise en place. Depuis quelques séances, cette question rythmique constitue le cœur des répétitions. Pour autant, depuis quelques temps ces séances ne m’apportent plus de nouveaux matériaux ni de nouvelle accroche dans mon analyse, ce qui m’apparait alors l’indice d’une stabilité de ces ingrédients et d’une saturation de mon terrain. J’avais déjà repéré que la complexité rythmique, ou la mise en place d’une polyrythmie, n’étaient un frein ni à la prise de parole musicale, ni à la tenue de l’ensemble. La pluralité des rapports à la pulsation et les formes de recherche d’une pulsation commune avaient déjà émergé très nettement de différents temps de répétitions et de prestations — qu’il s’agisse de la fanfare dans ses pratiques quotidiennes, ou d’autres activités du Caem, comme le projet avec Miss Liddl.
Mais en cette répétition du jeudi 9 mars au soir, après quelques tentatives de jeu, « rien ne va plus ». Et si ce constat est d’abord exprimé en ces termes par Vincent, repris par Hélène à la caisse claire puis par quelques autres musiciens, c’est aussi pour moi, à ce moment-là, que « rien ne va plus » : Vincent, saxophoniste référent de la répétition, sort son téléphone, une application gratuite de métronome préalablement téléchargée sur son portable, annonçant par ce geste un travail avec ce métronome de substitution. Et, comme on ne pourra pas entendre le son sortant de ce téléphone tout en jouant, il le branche sur l’ampli basse présent dans la salle, après l’avoir monté sur une table, afin que l’enceinte soit à une hauteur telle que les musiciens ne pourront s’en extraire.
Je suis déboussolée par cette imposition d’un objet pour moi représentatif d’un monde de la musique contre lequel les acteurs des pratiques musicales à Dieulefit semblaient positionnés, et qui donc me parait d’un coup remettre en cause toute la construction théorique en train de se stabiliser, issue de mes analyses de terrain. Ce que j’ai d’abord regardé comme un « accident » m’a obligé à déplacer une nouvelle fois mon regard, à poursuivre l’enquête à partir de cet objet « métronome », à repérer que l’utilisation de cet outil n’avait pas nécessairement, à Dieulefit, la même signification que celle que j’y investissais. À mesure que se déploie devant moi cet « épisode du métronome », observant les musiciens avec lesquels je suis en train d’expérimenter comment jouer ensemble ne pas réagir comme je l’imagine pour construire, en fabriquant ce morceau de musique, leur commun, je réalise une nouvelle mise à distance de mon regard de musicienne-enseignante. Elle nécessite une forme de réflexivité sur les approches académiques que j’ai intégrées, affûtant d’une nouvelle manière mon attention ethnographique. Et, une fois cette mise à distance opérée, « l’épisode » du métronome n’en est peut-être plus un, se doublant d’une épaisseur temporelle qui fait de son utilisation non plus une question d’usage, mais de valuation. L’analyse proposée ici suit ce cheminement du regard qui a été le mien.
Sortir un métronome en répétition, un accident ?
Sortir le métronome, avant même son utilisation, est un acte. Il est précédé de la déclaration de Vincent évaluant que « rien ne va plus », confirmée et relayée par d’autres musiciens, verbalement ou montrant des signes d’exaspération. Convoquant l’outil, en le sortant via son téléphone de sa poche, Vincent pose le fait que le groupe ne joue pas en place, ou pas ensemble, ou pas assez. Après avoir expérimenté plusieurs modalités de travail, il manifeste le besoin d’une aide extérieure — ici, un accessoire technologique. Cette « scène du métronome » est à la fois un évènement, et pris dans une épaisseur temporelle – un « épisode » de la question rythmique à Dieulefit.
L’absence de réactions négatives à cette proposition, à part quelques soupirs et deux- trois exclamations négatives [« oh non… »], dans cet ensemble habitué à s’exprimer quasi en continu entre les notes jouées, signe le fait que la proposition est acceptée. L’initiative de Vincent est même accompagnée :
Attends, on ne va pas l’entendre… prends l’ampli, là.
Oui, t’as raison… on va le monter sur la table, on entendra mieux… Y en a pas un de vous qui aurait un câble ?
Attends, là, si, je crois qu’il y en a un dans le placard.
Voici donc une application « métronome » mise en route sur un téléphone portable, branché sur un ampli basse : trois objets — le téléphone, le métronome, l’ampli basse — qui renvoient à des fonctionnalités, des utilisations et des représentations différentes. L’utilisation du téléphone change sans doute la représentation que les uns et les autres se font du métronome — on peut sans trop craindre d’extrapoler considérer que sa caractéristique d’objet familier et personnel minimise la dimension tant autoritaire que scolaire de l’objet. Mais cette interprétation que je fais alors n’a pas ensuite été confortée par les propos des acteurs : dans les discussions qui ont suivi, il a toujours été fait référence « au métronome ».
Par ailleurs, l’utilisation de l’objet métronome a été ici associée à un autre objet sur lequel il est branché, l’amplificateur de guitare basse, qui a lui des intentionnalités différentes et multiples. Dans la salle de répétition de la fanfare, cet ampli sert à sonoriser la basse dans les groupes de musiques actuelles et l’atelier bœuf qui viennent y répéter. Il y a ainsi chez les musiciens de la fanfare des représentations liées à cette utilisation, notamment du côté de la liberté et de la créativité, qui peuvent contrebalancer une représentation autoritaire du métronome. Mais là aussi, cette interprétation renvoie avant tout à mon besoin de minimiser la dimension normative du métronome, tant dans l’utilisation de l’objet que des interactions qui sont en train de se jouer en situation, pour que je comprenne comment il peut y prendre place.
L’objet métronome, pour garder le focus sur cet objet dans le triptyque évoqué, nous met ici face à un faisceau d’intentionnalités croisées. D’une part, ce à quoi sert l’outil, dans son utilisation scolaire actuelle première, diffère de ce pourquoi il est initialement pensé — à savoir donner aux interprètes un repère de durée de pulsations par rapport à des indications d’intentions expressives via le tempo, répondant à la volonté du compositeur romantique que l’interprète soit au plus près de son intention (Barbuscia, 2012)[1]. D’autre part, les représentations fortes liées au métronome, et les rapports d’utilisateur ou non à cet outil, diffèrent chez chacun des musiciens en présence — ce qui fait qu’ils se retrouvent dans des relations différentes les uns les autres à cet objet. Quant au rapport que j’entretiens au métronome, en tant que musicienne professionnelle observant la situation, tout en y prenant part en tant que tubiste amateur, le métronome s’apparente à un « dépôt de contrainte dans le monde »[2].
Des usages décalés de cet outil hétéronome
Les théories de l’affordance (Gibson, 1979), en proposant d’observer de près ce qui provient de l’environnement quand un agent engage une action, permettent de prendre en considération les différents rapports à l’objet des uns et des autres pour envisager les significations qu’ils y investissent potentiellement. Par l’environnement dans lequel j’évolue professionnellement au quotidien, l’utilisation du métronome est pour moi avant tout une imposition extérieure au contexte de jeu, nécessairement normative. Objet par excellence d’étayage dans une pratique avant tout pédagogique, le métronome correspond à une conception propédeutique de l’enseignement de la musique. Extrêmement normé et normatif, il est difficile de s’y soustraire.
Par ailleurs, plus qu’un instrument de travail, le métronome est porteur de certaines valeurs issues de son contexte d’apparition. Si la division régulière du temps est un phénomène culturellement récent[3], en musique, le métronome instaure, dès 1815, un rapport au temps musical égal, qui suppose que l’on peut le découper de manière régulière, créant l’ « illusion d’objectivité en musique » (Barbuscia, 2012, p.54). L’utilisation du métronome s’impose très vite. « Promu par les compositeurs comme le seul « remède »[4] efficace à un mal auquel l’art musical n’a jamais su obvier, le métronome passe, sans difficulté ni phase intermédiaire, de l’accessoire faisant le bonheur de quelques-uns à l’objet indispensable à toute pratique musicale » (Ibid., p.58). Ce qui va dans le sens d’une très forte rationalisation des pratiques, notamment vers l’égalité républicaine — projet révolutionnaire du conservatoire (Hondré, 2002). Les temps égaux organisent la musique. Le métronome est alors l’instrument égalitaire par excellence : il est la proclamation physique de l’égalité politique. Dans le même temps, il pose un rapport aux valeurs : il faut être avec le métronome, assimilant l’exécution rythmiquement normée à une question morale. Aurélie Barbuscia souligne elle aussi la dimension de contrôle véhiculée par l’instrument (Barbuscia, 2012, p.63)[5], développant l’idée que la transgression se situe alors du côté des professionnels (Ibid., p.67), comme une marque de distinction, là où les amateurs et apprentis doivent se situer dans le respect d’une norme.
Si mon rapport à cet outil est nécessairement construit avec cet arrière-fond[6], les autres musiciens de Tapacymbal ne se situent pas, ou pas exclusivement, dans ce même environnement. Ils se réfèrent potentiellement à d’autres types d’usage de ce métronome, certains le considérant comme un simple outil. Certes l’outil, nécessairement normatif puisqu’institutionnel, prescrit un usage. L’action visée par son utilisation est bien dans les différents cas de travailler à se mettre dans un rythme commun. Mais la manière dont les acteurs s’en servent, précisément, dans le choix du moment où émettre leur son par rapport à la battue proposée, ne fabrique pas nécessairement la même signification d’un ensemble de musiciens à un autre. Si l’usage est globalement le même, son utilisation diffère, et la valuation n’est pas la même.
Ainsi, les percussionnistes ici envisagent le métronome comme un objet propédeutique, un outil sur lequel prendre appui, mais moins pour eux-mêmes que pour les autres. Jean-Louis, à la grosse caisse, évoque souvent le fait qu’il doive « jouer le rôle de métronome », qui ici s’apparente au bâton de mesure[7] que ce nouvel outil vient partiellement supplanter, en attendant qu’Hélène, à la caisse claire, « gagne en stabilité », pour pouvoir « lâcher ce rôle et [s’] éclater un peu plus ». Là, le métronome physique prend le relais de la caisse claire et grosse caisse, et permet à ces musiciens de se concentrer sur d’autres aspects musicaux. De même Vincent, dans une impasse sur les modes de travail de la pièce, propose un outil sur lequel il espère se reposer, dans le sens où les autres musiciens vont potentiellement pouvoir prendre référence dessus. Mais contrairement aux percussionnistes, cela ne lui permet pas pour autant de porter son attention musicale ailleurs : elle se focalise ensuite sur le fait de distinguer si les musiciens sont calés ou non avec ce repère extérieur. Or Vincent, qui en tant que référent de la fanfare se sent ici particulièrement concerné par le choix des méthodes de travail, se retrouve dans une nouvelle contrainte qu’il se crée lui-même. Alors qu’il ne constitue pour ainsi dire jamais le repère rythmique du groupe, en convoquant ce téléphone — métronome, cet objet lui impose la place de référent pour discerner si oui ou non les musiciens arrivent à jouer les impacts des temps en même temps que lui.
Mais de fait, ce n’est pas ce qui se passe. Pour la plupart des instrumentistes en présence, l’usage qu’ils font du métronome ne se situe ni du côté de l’imposition normative d’une pulsation hors-sol ni du côté d’un outil proposant une référence sur laquelle se caler en homorythmie. Lorsque le groupe commence à travailler avec le métronome, l’ensemble des musiciens de la fanfare se concentre d’une nouvelle manière sur la question rythmique, et à force de tâtonnements, après une grosse demi- heure de travail avec le métronome, ils arrivent à jouer ensemble sur une pulsation certes commune, mais à côté de la pulsation du métronome qui continue à scander régulièrement ses temps sortants de l’ampli basse. Ici, les musiciens utilisent bien le métronome pour trouver leur manière de jouer rythmiquement ensemble ce nouveau morceau — l’application n’est pas uniquement mise en route pour « faire comme si » on allait tenter de jouer avec un métronome[8]. Mais ils s’en servent comme d’un outil faisant médiation, une référence extérieure qui aide à porter son attention sur la question rythmique, lui faisant certes jouer pleinement son rôle mais d’une certaine manière, en décalage avec la norme imposée — d’une certaine manière qui ne colle pas à la pulsation du métronome, et sans chercher à le faire. Le métronome a donc à la fois la même signification pour l’action qu’il ne l’aurait, par exemple, dans un cadre institutionnel de cours de musique ou de répétition d’un ensemble – à savoir aider à une mise en place rythmique, éventuellement au sein d’un ensemble. Et dans le même temps, il va servir à ne pas s’en servir. La valuation qu’ils attribuent à l’objet et à ce qu’il permet de faire diffère de celle attribuée à cet objet dans un cadre normatif.
Ainsi, l’utilisation du métronome, si elle est prescrite par l’objet, ne dit pas le statut et le pouvoir, les pouvoirs, qu’on lui accorde — le métronome chef ou repère, l’outil permettant de travailler à être collectivement, chacun et chacune, avec ses battements, ou à trouver une pulsation commune, éventuellement à côté de la pulsation métronomique. Il n’a sans doute pas la même signification pour l’ensemble des musiciens en présence, et peut être regardé comme un des espaces de jeu et d’interaction entre les pratiques musicales dieulefitoises et la « sous-couche » des pratiques institutionnalisées de la musique sur le territoire national. Ce métronome implique différents types de conceptions musicales qui sont autant de contraintes qui sont alors discutées, négociées, en situation.
L’agency du métronome
Le métronome, avec les différentes intentionnalités qu’il porte ici, est donc aussi un objet qui fait faire quelque chose. Outil mobilisé pour ce à quoi il sert principalement (fournir un repère fixe et répété de division du temps), il a aussi un pouvoir d’agency, une capacité à engendrer une ou plusieurs actions[9]. En se substituant à la place du musicien à la caisse, le métronome prend la fonction d’une personne. Repère unique et collectif, scandant une pulsation régulière et à laquelle les musiciens ne peuvent se soustraire, l’objet devient une forme d’incarnation du chef d’orchestre — mais renvoyant à une figure du chef qui agirait comme cet objet, ne ferait que « battre la mesure »[10], et ce, alors même que cette figure de chef est refusée. Cela amène dans le temps de la répétition une forme de double contrainte à laquelle les musiciens, par le jeu, et notamment par la discussion, vont devoir répondre. Le métronome est ainsi à même de « faire faire quelque chose », d’inciter les musiciens à trouver des solutions de mise en place rythmique. Ici, il est accepté comme médiation permettant de « trouver une pulsation collective », qui va permettre le jeu dans la déambulation, tout en ne figurant pas une figure autoritaire qui obligeraient les musiciens et les musiciennes à être en même temps que le métronome.
L’objet métronome, pendant cette répétition de Tapacymbal, fait faire aussi autre chose que la répétition de mêmes phrases musicales en tentant de se rapprocher de la pulsation sonorisée et/ou d’une pulsation commune. D’une part, il déclenche de l’humour qui est à la fois un garde-fou et signifie une possibilité de dérive à ne pas occulter, notamment celle de la battue de l’orchestre militaire. Ainsi Christian commente les départs à effectuer avec le métronome d’un « Ein, zwei, drei, vier ! », trait qu’il renforce lorsque les musiciens arrivent à marcher ensemble en rythme, lançant un : « Troisième Reich ! ». Christian est, à mes côtés, le plus professionnalisé des musiciens en présence, ayant évolué dans des collectifs d’improvisation, et par la même peut-être celui pour qui cet outil incarne le plus la figure d’un chef autoritaire. Mais à la pause de la répétition, dans la discussion autour du métronome, il insiste, toujours sous le trait de la plaisanterie, sur le fait que « ça permet, quand même, de jouer avec les autres… » Ces traits d’humour mobilisent symboliquement un univers particulièrement évocateur chez les habitants de Dieulefit. La forme du dire marque une limite, ou une vigilance. Elle indique que l’on arrive à une forme de rapport à la mise en place qui pourrait être interprétée autrement que le sens visé par les musiciens présents à cette répétition. Ils peuvent être analysés comme un régulateur de l’utilisation de l’objet métronome. D’autre part, l’utilisation du métronome amène à un débat : elle déclenche une discussion qui a lieu dans un premier temps avec quelques instrumentistes pendant la pause de la répétition, et se poursuit ensuite en débat collectif chez Vincent, avec la quasi-totalité des musiciens.
Temps interne et temps externe
[À la pause de la répétition, dans la même salle.]
Vincent [réagissant à une remarque d’une musicienne, que je n’ai pas entendue] : Et le métronome entre autres permet de… de… c’est le truc qu’on a tous vécu, tu branches le métronome et t’as l’impression qu’il est irrégulier.
Luc : humhum, oui, …
Vincent : Parce qu’on a intégré, on a intégré une régularité par rapport à ce qu’on sentait, et qu’il faut adapter cette régularité aux autres.
Christian : Parfois c’est à cause des piles aussi… [Rires]
Cathie : Ce qui veut dire que le métronome, c’est complètement inhumain, quoi…
Vincent : C’est inhumain, mais ça permet de prendre conscience de ta perception du temps, et de prendre conscience qu’elle n est pas forcément exactement la même que ceux avec qui tu joues. Tous les débats où on se dit “ mais c’est toi qui accélères, mais non c’est toi, c’est toi qui es irrégulier, mais non c’est toi ”, c’est juste le travail d’arriver à une perception du temps qui soit la même à un moment donné. Et après tout, faire de la musique, c’est juste se mettre dans la même irrégularité. On s’en fout du métronome. Si ce n’est que c’est l’outil qui nous permet de prendre conscience de cela.
Christian [un peu ironique, sortant pour l’occasion de son autre conversation parallèle] : mais ça permet, quand même, de jouer avec les autres, quand même…
Vincent, qui développe dans sa pratique musicale une forte réflexivité, est particulièrement intéressé par ce type d’échanges. La question d’une perception individuelle du temps, par rapport à un repère métronomique perçu comme fluctuant et pluriel, selon les individus, est un sujet qui l’anime et qu’il a déjà débattu en dehors du contexte de Tapacymbal. Elle peut se lire aussi au regard de la tension repérée par Alfred Schütz (2006 [1964]) entre temps interne et temps externe, et les formes de communication engendrées par le fait de jouer ensemble – musicien face à l’œuvre ou potentiellement groupe de musiciens :
Dans notre problématique, il est essentiel d’avoir une meilleure compréhension de la dimension temporelle dans laquelle la musique a lieu. […] [L]e temps interne, la durée, est la forme même de l’existence de la musique. Bien sûr, jouer d’un instrument, écouter un disque, lire une page de musique, tous ces évènements ont lieu dans un temps externe, le temps qu’on peut mesurer par des métronomes et des horloges avec lesquels le musicien “compte” pour s’assurer le “tempo” qui convient. […] [N]ous estimons le temps interne comme étant le véhicule même où le flux musical a lieu. On peut mesurer le temps externe ; il existe des minutes et des heures et la longueur des sillons sonores que doit traverser l’aiguille du phonographe. Il n’existe par une mesure telle pour la dimension du temps interne où vit l’auditeur ; il n’y a pas d’équivalence entre ses parties, si parties il y a. (p.23)
« Faire de la musique, c’est juste se mettre dans la même irrégularité » est alors une réponse à cette tension[11]. Observer les musiciens « faire la musique ensemble » consiste alors à repérer comment les flux des temps internes se lient, et comment s’ordonne leur synchronisation (y compris dans un choix d’hétérochronie) dans un temps externe, commun.
Alfred Shütz:
Il me semble que toute communication possible présuppose un rapport de “syntonie” entre celui qui fait la communication et le récepteur de la communication. Ce rapport se fait par la répartition réciproque du flux de l’expérience dans le temps interne de l’Autre, par un vécu d’un présent très fort partagé ensemble, par l’expérience de cette proximité sous la forme d’un “Nous”. (p.27)
Confronter la situation de travail rythmique à la sculpture d’un « métronome mou »
Après la répétition, la discussion se poursuit autour d’un verre dans la maison de Vincent, qui est aussi le site de sa menuiserie. Sur le piano droit, à l’entrée du salon, à quelques objets près d’un métronome mécanique noir ouvert, une sculpture en bois plein représente un métronome qui semble avoir les mêmes caractéristiques que les « montres molles » de Dali[12] — une sorte de « métronome mou », dans des proportions assez similaires à un métronome traditionnel, avec une base plus large. Cet objet artistique qui détourne un objet mécanique, et qu’un certain nombre de musiciens de la fanfare connaissent pour passer assez régulièrement chez Vincent, possède lui aussi une certaine agency : la capacité à proposer une relecture de l’utilisation du métronome, dont il est une représentation subversive, à la sortie d’une répétition animée avec cet outil par celui qui possède et expose cette sculpture à la vue des musiciens de la fanfare invités. Ce détournement replace le métronome comme objet et non plus comme outil — ce que l’on pourrait mettre en parallèle avec le téléphone, qui, pendant la répétition, a été détourné en métronome, le déplaçant alors d’objet à outil. Surtout, cette représentation d’un métronome mou, qui évoque un battement improbable, nécessairement irrégulier et nonchalant, hors temps, et en même temps figé dans son mouvement fluctuant dans du bois, amène une dimension subversive à l’objet qu’il détourne.
Dans le moment de cette discussion lors du « coup à boire » chez Vincent, cet objet ne suscite pas de larges réactions, sans doute parce qu’il est déjà familier à la plupart des musiciens. Il est aussi dans une partie du salon un peu en retrait par rapport à là où nous sommes attablés. Lorsque, me déplaçant, je le découvre et m’exclame, dans une ambiance sonore au niveau déjà élevé, seuls quelques-uns réagissent, et ces interventions ne sont relayées que par des rires — ceux de Vincent notamment, qui retourne vite dans sa discussion :
Valérie : « oui oui je le connais ! »,
Christian : « tu m’étonnes qu’on n’arrive pas à jouer en rythme ! »
Benjamin : « Hé, dis, Vincent, c’est celui-là que tu devrais nous amener en répétition ! »
Comme les blagues de Christian, l’exposition de ce « métronome mou » peut être lue comme un ajustement permettant la mobilisation de l’objet métronome mais avec un décalage, menant soit à ne pas le prendre au sérieux, soit à faire tomber des représentations rigides qui lui sont fréquemment attribuées et entrent en dissonance avec les « principes supérieurs communs » de Dieulefit.
Ainsi, ce que le métronome fait faire à la fanfare de Dieulefit, c’est (1) un travail commun de pulsation permettant de « se mettre dans la même irrégularité » ; (2) de l’humour, assurant un ajustement entre ce qu’impose l’outil et son utilisation dans le contexte de Tapacymbal (déambuler ensemble, oui, marcher au pas, non) ; (3) un détournement de sa dimension d’outil en objet artistique ; (4) une discussion collective sur ce qu’est ressentir un tempo et chercher ensemble une pulsation commune. Par ailleurs, deux caractéristiques des manières de faire la musique à Dieulefit, déjà rencontrées, ressortent avec force de cette situation. D’une part, la discussion et le débat sont des procédures essentielles et constitutives de la construction du musical. D’autre part, même dans cette situation très restreinte et très située de répétition, face à un métronome, outil hétéronome par excellence, et alors qu’il s’agit de faire commun, les rapports à cet objet, ainsi que ce que son utilisation provoque, sont aussi hétérogènes que les formes musicales présentes sur le territoire de Dieulefit.
Parie III : Se mettre en accord,
dans et par des pratiques musicales, avec le territoire
Rendre possible l’écart du métronome
Ainsi, à la fanfare de Dieulefit, ce métronome peut n’être pour certains des musiciens « qu’un métronome », pour d’autres à la fois un objet normatif, un outil dont il serait dommage de se priver, la possibilité d’une méthode de travail parmi d’autres, un objet que l’on peut associer à d’autres, et même détourner, subvertir. S’il est utilisé ici, c’est qu’il ne représente pas un danger aux yeux des musiciens — qui savent se prémunir des « conséquence[s] funeste[s] » du métronome développées par Jacques Bouët (Bouët, 1997)[13].
Car pour autant, l’utilisation du métronome, dans la situation décrite ci-dessus, peut aussi être lue comme un écart, qui engendre des réactions d’adhésion, à savoir faire ce que Vincent propose, et même l’accompagner dans la mise en place de sa proposition, mais d’une certaine manière. Le collectif fonde la possibilité de cet écart en le circonscrivant, par leurs manières de faire, à quelque chose qui peut prendre place dans leur fonctionnement. Jeu en groupe, humour, pose de bornes, discussions et débat, marquent le refus de poser le métronome comme ultime référent, et le ramènent à ce qu’il est aussi : un objet et un outil permettant une forme d’expérimentation.
Se coordonner et s’ajuster pour faire commun dans le pays de Dieulefit
À Dieulefit, la question d’une « mise en accord » des musiciens apparaît bien centrale. Elle se fait avec des modalités, et selon des critères, qui sont propres aux acteurs de ces pratiques. La volonté d’une « mise en accord », entre musiciens pour jouer ensemble, ne va pas de soi. Si elle peut paraître une nécessité musicale issue des contextes musicaux joués, ou une évidence sociale dans certains contextes de pratiques normées, des collectifs défendent des contextes de jeu permettant une absence de mise en accord, en tous cas préalable, à des temps de pratiques artistiques communs[14]. Par ailleurs, le fonctionnement notamment de Tapacymbal, qui rend possible de venir jouer au sein du groupe avant de savoir jouer, de proposer en prestation un solo instrumental sans en maîtriser la carrure rythmique, indique que ce ne sont ni les enjeux musicaux des répertoires joués, ni les normes implicites aux formats de groupe, qui animent cette volonté de « mise en accord », de trouver une manière ajustée de pratiquer la musique à Dieulefit.
Mon hypothèse est qu’ici les musiciens décident de se mettre en accord, et de ce sur quoi ils s’accordent, non seulement selon des modalités qui leur ressemblent, mais selon celles qui leur permettent de mettre en œuvre et d’alimenter « ce à quoi ils tiennent », et « qui les tient » (Bidet & al. [Dewey], 2011). Notamment, ces pratiques participent à donner corps aux « principes supérieurs communs » dégagés, dans les deux premières parties, des manières de faire le Caem, Tapacymbal, le festival des 40èmes Résonnants, et que l’on retrouve aussi dans d’autres sphères que le musical, notamment dans le rapport des habitants de Dieulefit à l’histoire, et dans quelques récits épars rapportés çà et là. La mise en accord des musiciens se fait ainsi dans et avec leur territoire. Les choix de ce sur quoi les musiciens se coordonnent pour faire commun, les modalités d’opération d’ajustement, de débat, de circulation, sont une manière de faire territoire, cependant qu’ils fabriquent des pratiques musicales, de la musique du pays de Dieulefit.
Un choix d’observation d’action situées, mais prises dans une épaisseur temporelle
Reste ainsi à observer, au plus près de la fabrication du musical, comment se joue et ce qui se joue dans cette mise en accord des musiciens, cependant qu’ils construisent leur musique. La profusion des pratiques musicales à Dieulefit, couplée à un terrain qui s’est déroulé sur plusieurs années, offre un matériau d’analyse très dense mobilisé dans les deux premières parties de la thèse. Parce que cette mise en accord se joue sur des actions, situées (Ogien & Quéré, 2005), mais qui se situent dans des épaisseurs temporelles denses, cette troisième partie prend appui sur des situations décrites puis analysées comme des évènements, convoquées parmi d’autres actions possibles parce que repérées à l’issue de mes analyses comme caractéristiques des manières de faire la musique sur ce territoire.
Arrêtons-nous un moment sur la question de l’épaisseur temporelle des actions situées. Chaque situation, regardée de très près, donne à voir des « évènements » – comme le fait de sortir un métronome. Et il en est un au regard de mes observations, à la fois parce que de là où j’en suis dans la compréhension du fonctionnement du groupe à ce moment-là, couplé à l’épaisseur de mes représentations de l’outil, le métronome est pour moi inattendu, décalé par rapport aux manières de faire repérées et attendues. Si le travail autour du rythme est une constante de la fanfare au moins depuis que je l’ai rejoint, les premières approches de méthode de travail rythmique sont éloignées de la normativité de cet outil. Lors du premier entretien que j’ai avec lui avant de rejoindre la fanfare, Jean me raconte[15] comment avec son ami batteur Nico, ils ont passé au moins une heure avec Dédé à tourner autour d’un tonneau en fer pour le marteler en rythme, et faire ressentir à ce trompettiste la tourne rythmique qu’il devait jouer dans Libertango.
Sortir le métronome en répétition est aussi un évènement parce qu’il peut être identifié comme déclenchant certaines actions. Le sortir en répétition n’est pas dans les habitudes du groupe, et l’écart avec le déroulé provoque des échanges qui sont eux-mêmes transformés. Mais la préoccupation rythmique, d’une part, et les discussions autour des préoccupations musicales, d’autre part, sont, elles, dans les manières de faire habituelles de Tapacymbal. Instruire la scène avec le métronome comme « épisode » est donc avant tout une construction de regard, dû pour partie à la constitution de mon propre regard, à l’intermittence du regard ethnographique, et à la forme de la mise en énigme. Mais cette lecture évènementielle s’articule avec une épaisseur temporelle très dense, mise au jour à la fois par la durée de l’enquête de terrain, la diversité des contextes de jeu que j’ai pu observer, et les indices en présence sur le temps même des répétitions.
Ainsi, qu’il s’agisse d’Egyptian que Tapacymbal a abordé depuis quelques mois, travaillé ici à l’aide du métronome, ou plus encore de Oye Como va dont il est question ensuite, que la fanfare joue depuis plusieurs années et qui a été très souvent éprouvé en situation de concert, la question rythmique est structurante des répétitions depuis leur première lecture. Par ailleurs les morceaux sont constamment remis en chantier, avec une préoccupation de se retrouver sur un rythme commun qui est constamment rejoué et éprouvé. De même, les répétitions du jeudi soir ne font voir la pratique musicale des instrumentistes de Tapacymbal que par intermittence. Le temps de jeu entre les répétitions, très variable d’un instrumentiste à l’autre, peut être très conséquent — la séance de travail chez Valérie, décrite en première partie de la thèse, montre qu’il y a des procédures à l’œuvre qui ne se passent que dans ce temps-là, et influent sur le jeu en répétition collective. Dans une autre répétition, Christian fait une remarque au groupe pour suggérer un élément rythmique qui n’avait pas été identifié sur la partition, parce qu’il évalue pouvoir le faire au regard de la manière dont l’ensemble joue alors le morceau : une manière de jouer qui « fonctionne » devient un problème parce qu’il évalue qu’il est alors possible de l’instituer comme tel. Dans ces situations de synchronisation, la question de l’écoute est centrale — à la fois pour les musiciens en situation de jeu, et pour la description que l’on peut en faire en situation d’observation (Weeks, 1996).
Ici, la mise en accord des musiciens dans et avec leur territoire se négocie pour beaucoup autour de réglages rythmiques, dont des situations sont retranscrites et analysées en première partie de ce chapitre. Ces ajustements rythmiques fabriquent autre chose qu’une simple mise en place. Ils disent quelque chose du rapport à une norme, à des repères extérieurs, portés ou non par un chef. Outre le fait que ces musiciens considèrent les paramètres musicaux dans leur interaction (on voit la flûtiste de Miss Liddl changer l’attaque d’une note puis sa hauteur pour correspondre aux attendus rythmiques), la question rythmique, comme le métronome, est réglée de sorte qu’elle permette des discussions, des circulations, rende possible une déambulation qui embarque du public dans cette mise en accord.
Par ailleurs, la mise en accord par la pratique musicale avec et dans son territoire se fait ici par des circulations — d’éléments musicaux, de rôles, des voix —, des opérations de traduction et d’ajustements, faisant en sorte que chaque voix compte et puisse être entendue, portée, revendiquée (au sens de claim, Laugier 2004), et participer au faire commun. Certaines de ces opérations, dont l’analyse a permis de mettre à jour ces manières de faire, ou d’en confirmer certaines déjà mises à jour, sont décrites en seconde partie. L’analyse de ces pratiques musicales montre que ces manières de faire portent et sont portées par une théorie musicale engagée, qui crée dans le pays de Dieulefit les conditions et le son d’une expressivité aux formes démocratiques.
Conclusion
(Extraits de « En guise de conclusion – Renouveler son regard pour lire une situation de répétition », p.397)
Lire Tapacymbal en mobilisant la logique d’enquête de Dewey permet de consolider le regard porté sur les pratiques musicales comme occasion d’enquêtes et d’expérimentations, ce faisant que les instrumentistes fabriquent de la musique selon des modalités qu’ils définissent dans le temps même de la pratique. Ici, la problématisation constante remet en jeu, au quotidien, les constructions musicales. Les manières de se coordonner et les ajustements sont élaborés d’une manière à ce que la pluralité soit garantie et visible, travaillant ainsi par la musique des significations qui sont ce à quoi ces musiciens tiennent, et ce qui les tient.
L’observation participante et l’analyse de la mise en œuvre du festival des 40èmes Résonnants ont mené dans la deuxième partie de la thèse à considérer les acteurs des pratiques musicales à Dieulefit comme une communauté d’enquêteurs. Les éléments constitutifs de leurs manières de faire repérés alors se retrouvent ici dans des formes très précises de la constitution du musical, prises dans des épaisseurs temporelles denses. Les engagements qu’ils mettent en œuvre dans la structuration de leur école, de leurs ensembles, du festival, sont également constitutives des pratiques musicales observées, qui dans le même temps les renforcent. Repérer ces manières de faire dans les pratiques musicales observées de très près, au cœur de la fabrication du musical, n’a pas été immédiate et convoquer Dewey m’a permis de muscler une intuition qui peinait à se défaire d’une lecture de la situation qui la considérerait comme un simple problème de mise en place[16]. Ainsi, la durée et la récurrence de ma participation aux répétitions et sorties de Tapacymbal m’ont permis d’envisager à nouveaux frais ces manières de faire et leur sens, notamment parce que j’y voyais des questions qui, en tant que musicienne de l’ensemble, me semblaient réglées, être constamment mises en chantier, de nouvelles enquêtes ouvertes — ce que je n’aurais pas pu repérer sur un temps plus restreint. La difficulté à affûter mon regard a résidé principalement dans la force de l’approche rythmique isochrone très intégrée, qui constituait un écran pour écouter le rythme autrement que par rapport à une référence normée, avec un temps découpé en pulsations isochrones. Si elle n’empêchait pas de penser par-dessus des organisations du temps variées, comme ici par cellules et polyrythmies, ni d’élaborer théoriquement la possibilité de les envisager autrement, elle est restée longtemps dans mon ressenti et dans mon jeu, et donc dans mon écoute, un arrière-fond dont il m’a été difficile de faire abstraction, et il m’a fallu puiser dans mes expériences musiciennes pour m’en défaire (…).
Cette représentation musico-sociale isochrone ne correspond pas ici uniquement à mon profil de musicienne formée dans les institutions de l’enseignement spécialisé de la musique : elle est également effective au sein de Tapacymbal, constitutive d’une partie de leur répertoire. Mais elle ne l’est que parmi d’autres conceptions à l’œuvre. Une pratique nettement différenciée aurait sans doute obligé à, et donc permis, de trouver d’autres manières d’observer la question rythmique.
Il s’est agi ici à la fois d’écouter avec une approche isochrone, pour une part constitutive des pratiques, et à la fois de construire l’hypothèse que ces musiciens avaient peut-être aussi d’autres manières d’envisager leur mise en place rythmique, pour se rendre disponible à une autre écoute. « L’épisode du métronome » a en ce sens constitué un tournant[17] dans ma propre enquête, m’amenant à considérer que la pulsation isochrone, voire éventuellement hétéronome, constituait pour les musiciens de la fanfare une manière parmi d’autres d’envisager la question rythmique, mais que, des garde-fous étant posés, elle était ici non excluante d’autres manières de faire et devait de ce fait être considérée au sein d’une pluralité. Ce que j’ai lu comme une double infraction de l’objet technique, à savoir convoquer le métronome alors que personne de les oblige à s’en servir, et ne pas se plier à la régularité du métronome alors même qu’ils s’en servent, est une forme de détournement de l’objet et d’appropriation de l’outil.
1. Le développement qui suit prend largement appui sur l’article d’Aurélie Barbuscia, « La pratique musicale, entre l’art et la mécanique. Les effets du métronome sur le champ musical au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°45, 2012.
2. Cité par Gaspard Salatko, séminaire Dynamique de la culture & anthropologie des activités artistiques et patrimoniales autour de « L’Agency en questions », coanimé par Emmanuel Pedler et Gaspard Salatko, Centre Norbert Elias, EHESS Marseille, 25 février 2021.
3. La rationalisation et le nivellement des rapports au temps dépassent la seule question musicale, qui est prise dans un mouvement de société global. Notamment, la décimalisation des unités de temps date de la fin du XVIIIe siècle (Souchier, 2019), et une cinquantaine d’années après le trafic ferroviaire met en place les premières unifications des horaires de trajets (Baillaud, 2006). Mais le fait que les pratiques musicales aient été très rapidement influencées par ce mouvement n’est pas anodin.
4. Rapport rédigé en 1815 par Henri Montant Berton, membre de la section musique de l’Académie française, cité par Barbuscia, 2012, p.58.
5. « le sujet-créateur ambitionne de renforcer son contrôle sur la manière même de son travail en exerçant davantage d’autorité sur l’interprète, invité à restituer le plus fidèlement possible ses intentions originelles » (Barbuscia, 2012, p.63 ; voir aussi Menger, 2010).
6. Cet arrière-fond revêt d’une part à une forme d’inconscient musicien – dans le sens d’une pratique tellement intégrée qu’elle accède à un statut d’évidence pour les musiciens qui convoquent cet objet d’étayage dès que se pose une question rythmique. D’autre part, il contient une forme de conscientisation nécessaire – un rapport au rythme et à la pulsation construit avec une logique correspondant à celle portée par le métronome étant indispensable dans un parcours académique.
7. C’est bien l’objet « métronome » que Jean-Louis convoque ici – objet qui semble ici avoir effacé les autres modèles de référence.
8. Cela renvoie à certaines utilisations des partitions, dont il a été question dans le chapitre consacré à la fanfare, certains musiciens ne sachant pas déchiffrer les codes musicaux inscrits sur une partition déclarant en avoir besoin pour jouer (Cheyronnaud, 1984).
9. Cette analyse prend appui sur le séminaire Dynamique de la culture & anthropologie des activités artistiques et patrimoniales, « L’Agency en questions », co-animé par Emmanuel Pedler et Gaspard Salatko, Centre Norbert Elias, EHESS Marseille, 25 février 2021.
10. Le compositeur Hector Berlioz propose une telle image du chef d’orchestre dans sa nouvelle Euphonia, « utopie qui décrit une ville entièrement consacrée à la musique, grâce aux bienfaits d’un gouvernement « despotique » (Buch, 2002, p.1006) : « Un ingénieux mécanisme qu’on eût trouvé cinq ou six siècles plustôt [sic], si on s’était donné la peine de le chercher, et qui subit l’impulsion des mouvements du chef sans être visible au public, marque, devant les yeux de chaque exécutant, et tout près de lui, les temps de la mesure, en indiquant aussi d’une façon très précise les divers degrés de forte ou de piano. » Hector Berlioz, « Euphonia ou la vie musicale », Revue et Gazette musicale de Paris, 11-17, 28 avril 1844, pp.146 147. Buch (2002, p.1007) précise que « ce texte a été repris par Berlioz, avec de légères modifications, dans Les soirées de l’orchestre ; on en trouve une édition séparée aux Éditions Ombres, Toulouse, 1992 ».
11. La conclusion de Vincent, « faire de la musique, c’est juste se mettre dans la même irrégularité. On s’en fout du métronome » peut aussi être lue plus simplement comme une forme de réponse à la double contrainte qu’il a imposée au groupe en sortant son téléphone avec cette application. Vincent n’avait pas anticipé qu’avec cet outil, le groupe allait réussir à trouver une pulsation commune mais à côté du métronome — et il aurait sans doute du mal, tout comme moi, à préciser ce qui fait précisément que le groupe a réussi à se stabiliser ainsi. Il lâche l’outil une fois l’objectif atteint, quand bien même l’outil n’a pas été utilisé de manière attendue et normée : ce qui importe est de pouvoir maintenant jouer ce morceau ensemble, dans un rythme commun, pour déambuler.
12. L’huile sur toile surréaliste de Salvador Dali, La persistance de la mémoire, peinte en 1931, représente des montres se liquéfiant, jouant du contraste rigidité/écoulement du temps, préoccupation de l’artiste autant intime que liée aux questionnements de la physique moderne (Dali, 1951).
13. « Ce mariage ingénieux entre temps physique et temps musical arrangé par Maetzel [découvert en réalité par Winkel (Barbuscia, 2012)] fut un peu forcé. Il a eu de fait une conséquence funeste à laquelle l’homo metronomicus ne songe plus maintenant : les oscillations pulsationnelles irrégulières ont été exclues du temps musical, excepté dans le rubato et assimilé. » (Bouët, 1997). La thèse des « pulsations retrouvées […d’] avant l’ère du métronome » de Bouët est mobilisée plus loin dans l’analyse du travail rythmique.
14. « Je pense notamment aux rencontres « Voix Musiques Corps » animées par Giacomo Spica-Capobianco – et bien que l’on puisse arguer que la participation à de telles rencontres est déjà une forme d’accord préalable. Voir l’article dans la présente édition « Création collective nomade ».
15. Cette partie de l’entretien est relatée dans le troisième de la première partie de la thèse consacrée à Tapacymbal, lorsque Jean me parle des instrumentistes de l’ensemble avant que je ne rejoigne le groupe.
16. C’est aussi un problème de mise en place, mais ne l’envisager que sous cet angle ne permet pas de voir ce qui se joue par ailleurs, et la manière dont cela se joue.
17. D’où le maintien de ce titre, marquant un moment de la « mise en énigme » de ma thèse.
Ouvrages cités
Barbuscia Aurélie, 2012, « La pratique musicale, entre l’art et la mécanique. Les effets du métronome sur le champ musical au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°45, pp. 53 – 68.
Baillaud Lucien, 2006, « Les chemins de fer et l’heure égale », Revue d’histoire des chemins de fer n°35, pp. 25 – 40.
Bidet Alexandra, Louis Quéré et Gérôme Truc, 2011, « Ce à quoi nous tenons. Dewey et la formation des valeurs », in John Dewey, La formation des valeurs, Paris, La Découverte, pp. 5 – 64.
Bouët Jacques, 1997, « Pulsations retrouvées. Les outils de la réalisation rythmique avant l’ère du métronome », Cahiers d’ethnomusicologie, n°10, pp. 107 – 125.
Buch Esteban, 2002, « Le chef d’orchestre : pratiques de l’autorité et métaphores politiques », Annales. Histoires, Sciences sociales, n°4, pp. 1001 – 1028.
Cheyronnaud Jacques, 1984, « Musique et Institutions au village », Ethnologie française, n°3, pp. 265 – 280.
Gibson James, 1979, The Ecological Approach to Visual Perception, Boston, Houghton Mifflin Company.
Emmanuel Hondré, 2002, La Marseillaise, Éditions Art et culture.
Laugier Sandra, 2004, « Désaccord, dissentiment, désobéissance, démocratie », Cités, n°17, pp. 39 – 53.
Menger Pierre-Michel, 2010, « Le travail à l’œuvre. Enquête sur l’autorité contingente du créateur dans l’art lyrique », Annales, Histoire, Sciences Sociales, Éditions de l’EHESS, pp. 743 – 786.
Quéré Louis et Albert Ogien, 2005, Le vocabulaire de la sociologie de l’action, Paris, Ellipses.
Schütz Alfred, 2006 [1951], « Faire la musique ensemble. Une étude des rapports sociaux », Sociétés, n°93 pp. 15 – 28.
Weeks Peter, 1996, « Synchrony lost, synchrony regained: The achievement of musical co-ordination », Human Studies n°19. Kluwer Academic Publishers. Netherlands, pp. 199 – 228.
Atelier de L’Autre musique
Situation de mise en pratique collective en vue d’ouvrir un débat significatif
L’atelier du séminaire de l’Autre Musique,
« Partitions #3 « Donner-ordonner » (2018)
Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff
2019-2025
Sommaire :
Introduction
Description du dispositif de départ de l’atelier
Déroulement de l’atelier
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Conclusion
Ouvrages cités dans cet article
Introduction
Cet article présente le récit d’un atelier concernant les partitions graphiques, que les deux auteurs ont animé en 2018. Ce récit sera accompagné de commentaires critiques. Il s’agit ici, par cet atelier et cet article, de proposer une alternative au format normatif des rencontres professionnelles du monde de la recherche universitaire. L’objectif est de sortir de la simple juxtaposition (et souvent de la superposition) des présentations de recherche, en vue d’un échange plus direct fait d’élaborations de pratiques collectives permettant l’ouverture de débats plus substantiels.
Dans le domaine de la recherche artistique, les rencontres professionnelles sont pour beaucoup de raisons aujourd’hui complètement formatées dans des formules qui favorisent la communication juxtaposée ou parallèle des projets de recherche au détriment d’un réel travail collectif débouchant sur des débats autour d’enjeux fondamentaux. Le format normatif qui s’est peu à peu institué dans le cadre de ces rencontres (colloques, séminaires) consiste à permettre à la totalité des personnes sélectionnées de présenter leurs travaux sur la base d’une égalité de temps de parole. Pour arriver à ce résultat un temps de présentation de 20 minutes s’est imposé dans les colloques avec une période de 10 minutes pour des questions venant de la salle. Lorsque le nombre des participants dépasse les capacités temporelles de la durée totale du colloque, des sessions parallèles sont organisées. Ce morcellement tend à encourager des groupes autonomes ayant des intérêts particuliers et donc à éviter toute confrontation entre des pensées considérées comme appartenant à des catégorisations étrangères les unes aux autres. Ou bien tout au contraire des sessions parallèles peuvent comporter la description de démarches similaires qui auraient tout intérêt à se confronter entre elles.
La principale raison de l’organisation des colloques internationaux dans ce type de format normatif, doit être mise en relation avec les règles d’évaluation des enseignants-chercheurs des universités en cours dans les universités anglo-saxonnes et généralisées à la totalité du monde : « publish or perish ». La participation à des colloques prestigieux est reconnue comme la preuve de la valeur d’une recherche, elle donne en plus accès dans le meilleur des cas à des publications dans diverses revues. En conséquence la participation personnelle à un colloque est conditionnelle à la présentation formelle de sa propre recherche. La monnaie d’échange est devenue la ligne de CV universitaire.
La période laissée à la fin de chaque présentation à l’appréciation des personnes présentes dans la salle doit se faire sur la forme de questions plutôt que sur la formulation d’un débat, non seulement à cause du manque de temps, mais aussi surtout sur l’idée que la recherche tend à être évaluée en termes de résultats prouvés. Si ce qui est présenté est dans le vrai, cela ne mérite aucune discussion. L’objet des discussions peut concerner la preuve dans des joutes de pouvoir ou l’éclaircissement de ce qui reste peu clair, mais il ne concerne pas la construction d’un débat entre la spécificité de la recherche et son inscription dans la complexité du monde. La présentation des éléments problématiques du sujet abordé est laissée aux prestigieuses personnalités invitées, du haut de leurs longues expériences, dans la phase initiale d’une « key note address » (conférence initiale de référence). Pour le reste, les débats ont bien lieu lors des nombreuses pauses, repas, cafés, et autres activités non formelles, le plus souvent dans de très petits groupes d’affinité. Les éléments de débat n’émergent pas dans ces conditions en tant qu’expression démocratique plus approfondie que celle d’un tour de table informatif équitable.
On peut considérer que la forme des colloques universitaires qui vient d’être présentée constitue une pratique qui consiste à juxtaposer des informations toutes très pertinentes et d’assurer des formes d’interactions entre les personnes présentes. Les présentations de recherche décrivent elles-mêmes des pratiques et des aspects théoriques qui leurs sont liés et en même temps permettent des rencontres effectives. On peut pourtant se demander si cette pratique d’échange d’informations, dans ces temps de difficultés de transports liées à la crise climatique et aux pandémies, ne peut pas être limitée aujourd’hui aux vidéo-conférences. S’il y a de plus en plus de difficulté à se rencontrer en présentiel, alors les occasions rares de rencontres effectives devraient ouvrir la voie à d’autres types d’acitivité, impliquant de mettre l’accent sur une mise en commun des problèmes auxquels nous devons faire face, dans des formes de pratiques beaucoup plus collectives et uniques par rapport au déroulement quotidien des activités de chaque entité de recherche.
L’idée d’atelier semble à première vue appropriée car liée à la nécessité d’une présence effective des membres qui y participent pour créer à travers une pratique particulière collective quelque chose qui fait sens et dont on peut manipuler les éléments théoriques. Mais le format usuel des ateliers (comme aussi celui des « master classes ») est en principe centré sur une pratique inconnue des personnes qui y participe et qui leur est maintenant inculquée par les responsables de son animation. On peut d’une manière alternative envisager des formules d’atelier où le dispositif n’est là que pour susciter collectivement l’émergence d’une pratique, et en même temps l’émergence de débats sur cette pratique. Dans ce type de dispositif, il y a une proposition de départ avec des consignes assez claires pour commencer une pratique collective, puis peut s’installer une alternance entre : faire-discuter-inventer de nouvelles consignes, etc. C’est précisément ce que nous avons tenté de mettre en place au cours de l’exemple que nous présentons dans cet article.
L’atelier dont il est question s’est déroulé le 14 mars 2018 dans le cadre de la 3e journée d’études, « séminaire-atelier » organisée par Frédéric Mathevet et Gérard Pelé au sein du groupe de recherche en art sonore et musique expérimentale L’Autre musique (Institut ACTE – UMR 8218 – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – CNRS – Ministère de la Culture), sous le titre de Partitions #3 « Donner-ordonner ». Trois journées d’études avaient été organisées à Paris dans le courant de l’année 2017-18 dont l’intention était définie de la façon suivante :
Ces séances questionnent la pertinence de la notion de « partition » par rapport aux nouvelles pratiques du sonore et du musical et, plus largement, en ouvrant à toutes les formes de créations contemporaines.
– laboratoire, lignes de recherche, Partitions #3.
Les journées d’études ont donné lieu à une publication par L’Autre Musique Revue #5 (2020).
Dans ce cadre nous avons animé un atelier d’une durée de deux heures, avec la présence d’une vingtaine de personnes travaillant dans les domaines de la danse, de la musique et de la recherche artistique.
Description du dispositif de départ de l’atelier
La situation de départ de l’atelier exigeait une approche particulière, afin d’arriver au plus vite a) à une pratique collective, b) qui susciterait une continuation sur la base de la participation effective des personnes présentes, et c) qui serait susceptible de provoquer des débats, de faire ressortir les affinités, les différences et les antagonismes. Pour parvenir à ces objectifs, il fallait que cette situation de départ se plie à plusieurs nécessités :
- Pouvoir être décrite oralement en peu de mots et comprise par tous.
- Définir une pratique que tout le monde peut faire immédiatement, sans préalable d’aptitudes particulières.
- Développer une pratique qui soit au centre des préoccupations du séminaire, dans ce cas précis, la pratique des partitions graphiques, tant du point de vue de leur élaboration que de leur interprétation.
- Développer une pratique ouverte sur des questionnements, des problématiques, et non pas s’imposant de toute pièce comme une solution définitive.
Voici la description de la situation de départ :
Dans un même mouvement simultané produire individuellement une action ayant trois éléments en cohérence :
- Un graphisme avec un crayon sur une feuille de papier.
- Un geste qui inclut le graphisme ; un geste qui peut commencer en dehors du graphisme, inclure le graphisme, puis continuer après le graphisme.
- Une séquence sonore produite avec la voix ou la bouche, l’appareil vocal.
L’action ne doit pas excéder cinq secondes. L’action doit pouvoir se répéter exactement dans les mêmes configurations.
Cette action qui allie arts plastiques, musique et danse doit être pensée individuellement de manière cohérente comme une « signature ». Elle définit en quelque sorte la personnalité particulière de celui ou celle qui la produit, elle doit permettre à toute personne extérieure de reconnaître une individualité.
Chaque membre présent réfléchit quelques instants pour préparer sa « signature ». Les protagonistes sont disposés en cercle autour d’une très grande table. Dès que tout le monde est prêt, chaque signature est présentée l’une après l’autre plusieurs fois. Puis une improvisation a lieu dont la règle est que l’on n’a le droit que de reproduire à des moments choisis sa propre signature (et ceci autant de fois qu’on veut). L’idée d’improvisation ici ne concerne que le placement de sa signature dans le temps. Il est possible après un temps de commencer à faire des variations sur cette signature.
Déroulement de l’atelier
L’atelier se déroule dans une salle de séminaire avec une grande table centrale, des chaises pour s’assoir autour, mais peu d’espace pour circuler ou faire de grands mouvements du corps.
L’atelier commence par une introduction sur le collectif PaaLabRes auquel les deux co-auteurs appartiennent et sur l’objectif général de l’atelier qui ne concerne pas comme dans un atelier normal la présentation d’une pratique originale, mais est complètement tourné vers la possibilité d’un débat sur les partitions graphiques à partir d’une mise en pratique collective. Il s’agit tout d’abord de se mettre en situation, puis d’en débattre.
La description qui suit est basée sur l’enregistrement audio de l’atelier. Quelques moments sont décrits sans la présence du verbatim. Sinon les propos ont été retranscrits comme tels, et légèrement modifiés, lorsque l’expression orale n’est pas claire ou parfois en partie inaudible[1].
Phase 1
Le dispositif de départ sur les « signatures » est exposé oralement. Parmi les personnes présentes il y a des difficultés à comprendre qu’il s’agit de réaliser une seule action ayant trois tâches simultanées et non pas trois éléments réalisés séparément.
|
P :
« C’est quelque chose qu’on adresse aux autres ? »
La réponse est affirmative, on doit aussi pouvoir transmettre sa signature. » P :
« Les autres vont pouvoir le reproduire ? »
Pour l’instant ce n’est pas le cas, mais il doit y avoir la possibilité de le faire dans l’avenir. |
Un temps est donné pour que tous les participants puissent expérimenter leurs signatures. Cette phase initiale a duré 15 minutes (la présentation générale d’atelier incluse).
Phase 2
On compare les signatures. Chaque signature est produite deux fois lors de deux tours de table.
Une improvisation est lancée. On n’a le droit que de produire exactement sa propre signature. Pas celle des autres. L’improvisation concerne seulement le placement dans le temps de sa signature. Essayer de placer sa signature à des moments où cela pourrait être entendu et où cela pourra contribuer à ce qui se passe.
|
P :
« Peut-on la faire en continu ? »
La réponse est oui, mais on peut aussi n’en faire qu’un fragment. P :
« On ne peut la faire qu’une seule fois en tout ? »
Non, on peut la faire autant de fois que l’on veut. À chaque fois la signature doit pouvoir être reconnue. P :
« Il faut continuer à faire le geste ? »
Oui, et aussi le dessin sur le papier. P :
« Faut-il garder le même rythme, le même tempo ? »
Oui dans cette première improvisation, après on verra. |
Improvisation 1. Durée : 2’ 32” :
Deuxième improvisation proposée par les animateurs : maintenant on a le droit de faire des variations autour de sa propre signature, soit en changeant des éléments (faire plus vite, faire plus long, plus fort, plus piano, etc.), soit en enrichissant, en ornementant avec d’autres éléments.
Les différents graphismes produits lors des deux premières improvisations sont montrés à tout le monde. On fait le constat que ce sont bien des partitions graphiques.
Un premier débat est proposé.
|
Pz :
« On peut continuer à expérimenter. On échange nos dessins. » P :
« En faisant les sons des autres ? » Pz :
« On garde une partie de notre signature, mais on joue la partition d’un autre. (…) Il faut prendre une partie au moins de notre signature… » P :
« Avec le son tu veux dire ? » Pz :
« A partir de la signature de l’autre, on réinterprète sa propre signature. » P :
« On prend notre son, pas le son de l’autre ? » Pz :
« En fait on se sert de cette partition pour jouer notre propre signature. [Brouhaha] Tu peux changer ton mouvement. On va dessiner par dessus. » P :
« Je ne dessine pas sur sa partition, je prends un papier à côté, parce qu’on redessine. » |
Voici quelques exemples de signatures[2] :
|
|
|
 |
|
Commentaire 1[3]
Après les deux improvisations dont les règles ont été déterminées par les animateurs, le seul élément tangible qu’on a à disposition est constitué par les dessins sur le papier. Les sonorités se sont envolées en fumée et les gestes peuvent être identifiés en partie dans les dessins qu’ils ont produits, mais sont aussi des éléments flous qui perdurent dans les mémoires. Dans ces conditions l’objet papier prend immédiatement la forme d’une partition, lieu privilégié de ce qui perdure d’une manière stable dans le temps. La partition écrite sur du papier est le lieu qui détermine dans la conception moderniste la présence d’un auteur. A-t-on la même attitude par rapport aux sons et aux gestes ? Ce n’est pas du tout certain. Dès le début des échanges d’impression après les improvisations, on voit qu’il existe dans l’atelier un sens du respect de la propriété d’autrui : on ne dessine pas sur la partition d’une autre personne. Une partition c’est sacré, donc on ne va pas réécrire dessus. Les sons et les gestes ne sont pas dans ce milieu culturel mis au même degré de propriété intellectuelle que ce qui constitue l’immuabilité de ce qui est écrit sur une partition.
Dans l’improvisation, il ne semble pas qu’il y ait interdiction de reproduire exactement ce qu’une autre personne est en train de produire, même si c’est impossible de le faire de manière absolument précise. Bien sûr il y a affirmation d’identité personnelle dans les échanges au cours d’une improvisation, mais pas au point de ne pas accepter les influences que cela produit sur les autres personnes présentes. On n’est pas dans une situation où la reproduction exacte d’un objet sonore ou gestuel entraîne la mort culturelle du modèle. On se rappellera l’anecdote d’un tromboniste dont le projet était d’apprendre le didjeridoo dans une communauté aborigène isolée dans l’Australie des années 1970. Les ethnologues lui avaient dit de ne jamais reproduire ce qu’il entendait des productions par les joueurs de didjeridoo, car c’était comme de leur voler leur âme et leur enlever leur raison de vivre. Dans nos propres pratiques, nous sommes très loin d’en être là.
L’idée de l’autonomie de la partition graphique par rapport à toute forme d’interprétation, liée à la séparation entre le compositeur et l’interprète, a donné lieu historiquement à sa double fonction : la partition graphique peut être considérée comme un objet suscitant une interprétation musicale (ou autre) ou bien peut être montrée dans un musée ou une galerie comme un objet appartenant au domaine des arts plastiques. Elle peut être bien sûr les deux à la fois.
|
Pz :
« En fait c’est comme si on avait une manière d’interpréter ça, avec notre vocabulaire, on interprète notre vocabulaire. On n’a que juste une syllabe, un son et un geste, mais là on a une partition graphique qui va nous emmener ailleurs, parce que ce n’est pas la même. » |
Chaque feuille de papier dessinée, devenue maintenant partition, est donnée à la personne placée à droite.
Improvisation 3 à partir de la proposition de Pz. Durée 3 mn.
Phase 3
Lors de la discussion précédant l’Improvisation 3, un participant avait proposé une autre situation :
|
Pa :
« Rejouer l’improvisation et il faut que chacun fasse sa partition de la totalité [de ce que vous entendez]. Pour tester la thèse sur la réversibilité [du graphisme à l’écoute, de l’écoute au graphisme]. Il s’agit de rejouer [l’enregistrement de l’Improvisation 2], de faire une partition en fonction de ce qu’on entend jouer. Rejouer ce que nous avons fait et dessiner d’après ce que nous entendons ». |
[Par ce biais, on peut tester la réversibilité des signatures : peut-on retrouver le geste et le dessin par rapport aux sons qu’on entend ?]
|
Pa :
« Dessiner la partition correspondant aux sons que vous entendez. Forcément tous les sons en même temps. » P :
« On dessine ce qu’on entend, en fait ? » P :
« On dessine ce qu’on veut. » Pa :
« Ce qu’on entend. » P :
« On n’est pas obligé de rester dans les codes de ce qu’on avait fait ? » Pa :
« Non. C’est un des premiers cours que j’ai effectué ici même en 1979, cela s’appelait “approche sensorielle”, on devait mettre la main dans un sac, et on devait dessiner tactilement… » |
On rejoue l’enregistrement de l’improvisation 2 et en même temps de nouvelles productions graphiques sont réalisées par rapport à ce qu’on entend.
Les graphismes circulent pour être examinés par tout le monde. La lecture des graphismes donne lieu à de nombreux commentaires.
|
P :
« Il y en a qu’on peut garder ? » P :
« Qui c’est qu’a fait ça ? L’étoile ! Oh-là là ! » Pa :
« La preuve est faite, je crois, … » P :
« Le langage… » P :
« C’est clair… » P :
« Pourquoi faudrait-il que les choses soient… ? » P :
« Elles ne le sont pas ? » |
Le processus de lecture des partitions continue avec des commentaires variés.
|
P :
« Ici on voit nettement un début et une fin » |
Se pose la question d’une représentation du déroulement temporel versus une représentation globale sans début ni fin.
|
Pn :
« Je n’ai pas pensé en ligne[4] de temps en fait. Et ça m’a même frappée de voir des choses qui avaient un début et une fin… Ah, ça existe ! » JCF :
« C’est la déformation des musiciens ! » Pn :
« Du coup, justement, cela m’a questionné, parce qu’on prenait naturellement le papier dans ce sens-là comme une barrière… Du coup une écriture spatialisée… Mais bon j’étais parti sur un truc… » P :
« Tu étais bloquée pourquoi ? » Pn :
« La ligne temps. En fait ce sont des processus, on pourrait les isoler peut-être. Pouvoir circuler de l’un à l’autre, pouvoir faire marche arrière. » Pa :
« Il existe peu de représentations qui se soient affranchies de cette ligne de temps. » P :
« Le son c’est du temps, enfin. » Pa :
« Il en existe malgré tout. Je pense au travail de T., où il n’y a plus de time line. » JCF :
« Mais ce n’est pas le cas de la première improvisation. L’expérience du temps est complètement différente. Quand on improvise et qu’on fait le geste, c’est comme si on joue sur un instrument, il n’y a pas de ligne de temps. Enfin, le temps c’est maintenant. Donc, c’est dans la réversibilité, qu’on trouve une situation très différente. » |
Commentaire 2
Deux questions ont émergées:
a) On peut garder la partition, c’est un objet tangible de mémoire.
b) Il y a le choix entre une représentation à partir d’une ligne de temps, ou bien une représentation globale hors-temps.
D’une part, les productions graphiques tendent à être considérées comme des objets ayant un caractère définitif, qu’on peut conserver si elles sont jugées dignes de l’être. Les productions graphiques tendent à être considérées comme des représentations figées des sons qui sont réalisés dans le temps. Le modèle dominant est celui des partitions musicales qui dans les perspectives occidentales constituent l’objet privilégié d’identification d’une œuvre. Et avec une représentation du temps allant comme dans les textes écrits de gauche à droite. Dans ces conditions tout dessin, toute image peuvent être considérés comme des partitions graphiques à condition de déterminer précisément des codes et des modes de lecture.
D’autre part se pose la question d’une représentation du déroulement temporel versus une représentation globale de tous les éléments mis en jeux, sans début ni fin. Il y a une prise de conscience que les musiciens notamment sont formatés par la représentation linéaire des sons dans le temps. On constate que la grande majorité des productions graphiques réalisées sont régies par une ligne du temps. Quelques exceptions montrent des formes de représentations globales (comme des sortes de topographies ou bien des cosmologies présentant simultanément des éléments diversifiés).
La question est de savoir si la conception du temps représenté sur une partition reste la même dans le cas des musiques improvisées parfois pensées comme un présent éternellement renouvelé sans se soucier de ce qui vient de se passer et de ce qui va émerger. La question de la réversibilité des choses dépend directement de la présence d’une organisation visuelle linéaire. Si seul l’instant présent compte on ne peut rien renverser ou inverser.
|
P :
« Est ce qu’on peut essayer – parce que moi j’ai le cerveau formaté – est-ce que c’est possible de refaire, pour ceux qui ont pensé au temps d’être hors temps et ceux qui ont pensé hors temps d’être dans le temps ? Parce que je suis vraiment formatée, donc ça m’intéresse de faire sans pensée linéaire. » P :
« Oui, pareil. » [Tout le monde parle en même temps] JCF :
« La possibilité pour ceux qui le souhaitent de le faire les yeux fermés. » P :
« De la main gauche. » |
|
P :
« Quand j’étais en linéaire, moi ça m’a tendue vraiment. Je me suis sentie tendue, coincée dans la ligne, alors que la première fois c’était beaucoup plus tranquille ».
P :
« Moi ce n’était pas tendu, mais j’ai trouvé que cela donnait autre chose. [La première fois correspondait] à ce que je ressentais, mais c’était complètement illisible. Linéaire, cela ressemble à quelque chose, c’est plus facile à transmettre. »
P :
« Du coup, je m’étais dit que quand ce n’est pas linéaire, je vais plus écouter globalement, et je me suis rendu compte que je n’arrivais pas à écouter globalement. Dès que j’entendais un truc, je voulais dessiner et je n’arrivais pas à être dans l’intégralité du truc, j’étais prise par les détails, quelque part il y avait encore du linéaire, donc ça restait linéaire. »
P :
« Je pense que quand ce n’est pas en linéaire, tu acceptes plus facilement le fait que de toutes façons ton interprétation sera partielle, subjective, tu mélanges les éléments, c’est plus agréable, tu te laisses emmener. »
P :
« Du coup j’ai travaillé comme ça, en aigu-grave, et ça a ouvert l’espace à l’intérieur. Ça a été vraiment très agréable d’écouter et de dessiner en fonction des hauteurs. »
JCF :
« J’ai trouvé qu’on pouvait se concentrer sur le geste de ce qu’on entendait, plutôt que l’identification des sons. En tout cas, ce qui me paraît très frappant, c’est que dans la signature initiale, il y a réellement une cohérence entre le visuel, le geste, et le son, qu’on retrouve en partie dans la présentation temporelle, mais seulement en partie, mais qu’on ne retrouve plus du tout dans la représentation non linéaire… On perd l’identification des signatures. »
Pa :
« Par exemple la durée de la séquence : ce qu’on vient de faire, ce qu’on vient d’entendre, on écrit (décrit ?) combien de temps ça dure. »
[Tout le monde parle en même temps] |
Comment perçoit-on la durée de l’enregistrement qui vient d’être joué ?
|
P :
« Il faut que cela soit vraiment précis ? » [Brouhaha]
P :
« Tu vas pouvoir vérifier. On s’en fout de vérifier le temps, la question est de savoir qui est le plus juste. Il faut l’écrire sinon on va s’influencer les uns les autres ».
P :
« On l’écrit. »
|
On écrit sur une feuille de papier la durée estimée de l’enregistrement de l’improvisation 3.
Résultats : 3’, 3’30”, 1’30” (rires), 2’41”, 2’27”, 4’, 1’40”, 2’… La réponse était 2’.
|
NS :
« La question, c’est qu’on est à peu près tous d’accord pour penser que ça commence à partir du premier son et ça se termine sur [il produit un son vocal]. Sauf, que, en fait, quand on a dit : « qu’est-ce qu’on entend ? », moi j’ai déjà commencé [avant l’écoute de l’enregistrement de l’Improvisation 3]. Une situation de variation… Du coup quand est-ce qu’on décide que ça commence et quand est-ce qu’on décide que ça finit ? Autant un papier en linéaire tu peux le lire comme ça, ou comme ça [bruits de papier en le faisant pivoter sur tous les angles]. Puis, après, celui-là, tu le retrouves dans la rue, c’est pas du tout évident que cela se lise comme ça ou comme ça. Et après, par où tu entres ? Ce n’est pas si évident que ça. Dans un concert, c’est assez clair, qu’il y a le noir, il y a le machin, là oui là ça y est, ah ça y est, ça commence. Et sur scène cela se détend, ah c’est fini. Il y a un vrai truc autour de l’implicite de la fin. »
|
Phase 4
La proposition est adoptée avec les précisions suivantes : on forme des groupes de trois avec une seule partition à réaliser en commun.
|
NS :
« Quelles sont les consignes que vous vous êtes donnés, comment avez-vous travaillé cela ? »
P(g1) :
« On a partagé la partition en quatre parties. Voilà on a partagé cette partie-là [il montre]. Trente secondes, là… On s’est mis d’accord sur des attaques… »
P(g1) :
« Des attaques et des oiseaux. »
|
|
P(g2) :
« D’abord c’est la merde parce qu’on est trois et il y a à peu près quatre lignes. On s’est dit que la quatrième ligne serait une sorte de réservoir… »
P(g2) :
[En anglais] « Sometimes I used the score, sometimes I improvised… »
P(g2) :
« Donc chacun avait une ligne et chacun son mode de jeu, et puis de temps en temps on piquait dans la quatrième, on improvisait quoi… »
P :
« Ah ouais ! Organisé ! »
P :
« Vous vous êtes mis d’accord pour improviser ! »
P :
« Je ne fais que ça. Chacun sa technique ! ». [Rires]
|
Commentaire 3
Au-delà de l’ironie, qui dénote qu’il ne faut pas prendre les prises de paroles trop au sérieux, on peut constater qu’il y a des difficultés à considérer qu’il peut exister des voies moyennes entre la composition, c’est-à-dire ici les choses fixées avant la performance, et l’improvisation, qui doit rester libre de toute préparation. Cette conception vient peut-être du fait qu’on a tendance à considérer la prestation sur scène comme absolue, dont les diverses médiations nécessaires à son apparition sont absentes. Que cette prestation soit une composition ou une improvisation ne change rien à l’affaire, la « cuisine » doit rester dans les coulisses, sinon le mystère de la production présentée sur scène pourrait en pâtir. L’improvisation en particulier, parce qu’elle implique la non-préparation des évènements précis, est souvent considérée comme n’ayant pas résulté d’évènements préalables, comme l’éducation des artistes, leur travail technique, l’élaboration de leur propre sonorité ou style de danse et répertoire d’intervention, leur parcours dans leur carrière, les interactions qu’ils ont pu avoir dans le passé avec leurs collègues, ou même l’organisation de répétitions.
|
P(g3a) :
« On n’a pas usé d’une traduction. On a pris le truc tel qu’il était. » JCF :
« Sans discussion ? » P(g3a) :
« On a simplifié, on a simplement dit : on a trois catégories de registres, trois types, on a lu directement là. » |
Groupe 4 performance. Durée 1’10”, un extrait de 47“ :
|
P(g4) :
« Ben nous, notre procédure, on s’est juste dit qu’on commençait toutes là. » [Rires] P(g4) :
« Moi, je m’étais dit que cela ressemblait à des paroles. En fait c’était vraiment comme une écriture d’une langue. » P(g4) :
« Oui on s’était dit que c’était par là qu’il fallait faire ça ». P(g4) :
« Moi j’ai pensé à une émission de radio, sur Radio Campus Paris… » P(g4) :
« Mais n’empêche, moi j’ai trouvé cela très agréable à faire. Je voulais continuer. » P :
« Mais vous avez pris une partition qui n’était pas la vôtre. » P(g4) :
« On a fait exprès. On a choisi de ne pas prendre la nôtre, malgré la consigne. » P(g4) :
« Moi je ne voyais pas ça. Je pensais qu’il valait être mieux toutes les trois neutres. » Px :
[participant externe au groupe 4, celui dont la partition a été utilisée] :
« Cela m’a un peu perturbé, parce que j’avais une idée très précise… » P(g4) :
« Et donc c’était ta partition. » Px :
« Oui, je ne pensais pas qu’on pouvait faire des trucs aussi bien. C’est terrible. A cause de vous je vais présenter un peu partout mes projets, faire des bides monumentaux… » P(g4) :
« Il n’y a pas que la partition, il y a les interprètes ! » |
Commentaire 4
On est au cœur des difficultés concernant les partitions graphiques. Leur lien principal en termes de créativité relève-t-il de la composition sur partition ou bien de l’interprétation des graphismes ? Sont-elles réellement le lieu d’une négociation entre graphistes et interprètes sur les codes de lecture ou sur les limites des rôles respectifs ? Si la balle est complètement dans le camp de l’interprétation des partitions, laissée au monde des instrumentistes, vocalistes, artistes sonores et artistes de la danse (etc.), alors tout résultat est acceptable, y compris toute lecture aberrante du graphisme (jouer « Au clair de la lune » par exemple). Le graphisme ne compte pas, si l’on ne peut relier les interprétations possibles aux signes visuels. Dans ce contexte, le philosophe Nelson Goodman (1968, p. 188) avait analysé une partition graphique de John Cage (tirée du Concert for piano and orchestra, 1957-58) comme ne pouvant en aucun cas constituer un système de notation, garant selon lui de la capacité de reconnaître une œuvre musicale chaque fois qu’elle est jouée, par rapport aux signes présents dans la partition originale.
Historiquement, les compositeurs pionniers des partitions graphiques (notamment Earl Brown, Morton Feldman) ont été plutôt peu satisfaits des résultats sonores, lorsque leurs compositions étaient dénuées de codes particuliers qui auraient obligé les interprètes à les respecter. Ceci se passait au moment même où les interprètes n’avaient pas encore la possibilité de vraiment comprendre ce qui était en jeu, de voir clairement ce qui leur était demandé. Plus tard, alors qu’il était lui-même interprète de sa propre musique et collaborant avec de nombreux instrumentistes, Cornelius Cardew a développé une partition graphique, Treatise (1963-67) ressemblant à une anthologie de signes graphiques, version utopique d’une liberté totale laissée aux interprètes (voir paalabres.org, deuxième édition, région Treatise). D’après John Tilbury qui a été un des interprètes importants de Treatise, l’instrumentiste est mis devant une double contrainte entre respect de la codification des signes et improvisation ignorant les signes écrits. L’interprète placé devant l’absence de code donné par le compositeur se trouve dans d’une part dans l’impossibilité d’être pédant en assignant à chaque signe de la partition une sonorité particulière (ceci sur 193 pages !) et d’autre part dans l’impossibilité morale d’ignorer totalement le contenu de la partition. Telle était la situation d’un Eddie Prevost qui, s’immergeant complètement dans les sons de la musique au fur et à mesure de son déploiement, s’était mis à improviser en prenant de moins en moins en compte les aspects visuels contenus dans la partition (Tilbury 2008, p. 247).
Performance du Groupe 5 formé par les deux animateurs. Durée : 1’23”.
|
JCF :
« L’idée, c’était de traverser la partition, d’avoir seulement des chuchotements, de traverser et d’avoir un silence avant et après. » NS :
« En fait on s’est dit ça, mais on avait complètement oublié qu’il y avait un 4’ 15” là. Du coup, il fallait faire ça. Et après je me suis dit : ben non … cela ne marche pas bien, alors pourquoi pas faire un geste. » P :
« Mais l’histoire du silence, c’est que vous avez peut-être mal lu, c’était à quatre temps. » |
Commentaire 5
Grâce à ce récit, se pose la question de la propriété de ce qui vient d’être performé. On peut détailler la « dissémination du droit d’auteur » (Citton, 2014) associée aux dernières performances.
Reprenons le récit des performances de l’atelier à l’envers. Si on cherchait à raconter les choses chronologiquement, comment faudrait-il déterminer un début ? Et pourquoi à ce moment-là et pas un peu avant ?
Voici le récit en remontant le temps :
• [Phase 4] 3 (ou 2) personnes ont inventé collectivement pour jouer au départ…
• [Phase 3 :]… de signes sur un papier tracés par une personne différente, au départ…
• [Phase 2 :]… d’un enregistrement réalisé par le groupe entier, au départ…
• … d’une proposition d’une personne d’expérimenter une deuxième fois après…
• … discussions et partages des réalisations de chacune…
• … d’une première proposition d’une autre personne sur le fait de représenter sur le papier ce que le
groupe venait de faire au départ…
• [Phase 1 :]… d’un protocole initial de 2 personnes, les animateurs de l’atelier, au départ…
• … d’essais-bonifications (au pluriel multiples) en différentes situations de cette même idée de protocole…
Si on essaye de dresser la liste de toutes les fois où on a utilisé ce protocole de signatures, celle-ci dépasse la dizaine de situations et de beaucoup la cinquantaine de personnes impliquées de différentes façons dans de telles expérimentations. Toutes les propositions exprimées nous ont influencés pour déterminer le contenu de l’atelier de ce jour de mars 2018. Il est même arrivé qu’un de nous deux ne soit pas présent aux expérimentations effectuées, mais en a eu un compte-rendu : c’est une autre forme d’influence…
Ce déjà long parcours insiste sur des actions qu’on peut cataloguer comme artistiques. Mais il faudrait considérer aussi, par exemple : la taille et forme de la salle (organisation, architecture), l’agencement des meubles (en fonction de ce qui s’est passé avant et va se passer après dans cette salle), les circonstances du repas de midi, le style de papier et des stylos, feutres, crayons disponibles, les bouts de vie que chaque personne amène avec elle en entrant, etc.
Après ce petit récit-panorama conduisant à ces performances, comment répondre à la question : à qui appartient-elles ? Si on considère la question comme intéressante, il est sûr qu’elle est énormément complexe. Mais on peut aussi considérer ce récit-panorama (et tant d’autres) comme faisant exploser la notion de droit de propriété. Pierre-Joseph Proudhon[5] a montré il y a déjà longtemps en détail « Comment la propriété est impossible » (en 10 propositions, son chap. IV, 2009).
Phase 5
Le débat est ouvert.
|
NS :
« Dans les questions du début, moi j’avais noté la question de la notation, on n’a pas arrêté de noter des trucs, on a plein de papiers bien remplis. J’ai dévalisé ma tante avec des vieux papiers des années quatre-vingt. En me disant : je vais prendre ça et on verra bien, mais en fait, du coup, tout a été utilisé ! Donc on a beaucoup monté, en fait, c’était la notation par rapport à la création, à l’interprétation, etc. Peut-être on peut revenir sur ce que chacun a vécu ce moment-là sur ce truc-là, et après il y a l’idée d’une partition “donnée, ordonnée“, qui était le thème de la journée du séminaire. Donc comment comprenez-vous l’idée de “donné-ordonné” vis-à-vis de ce qu’on a fait, ce que chacun a vécu dans ce qu’on a fait. On peut peut-être faire un tour de table, sans obligation de parler. On peut faire un tour avec un dialogue. » P :
« Moi, je suis absolument convaincu par ce qu’on a fait. J’ai l’impression que je n’ai pas suffisamment de recul pour pouvoir mettre des mots justes sur ce qui s’est passé. En fait il s’est passé plein de choses très différentes. En tout cas, c’est un chouette moment déjà en termes de temps et d’échanges. Pour ce qui est “ordonné”, on a tous été obligés de mettre de l’ordre dans ce qu’on avait, en tout cas faire des choix. Tout le monde devait traverser le graphisme, surtout dans la dernière partie. En tout cas, sur la forme, sur la présentation, sur la méthode, je trouve que c’est plutôt vraiment convainquant. Ou alors il faudrait peut-être plus de temps, pour qu’on puisse vraiment faire apparaître tout ce qui vient de se passer. » P :
« Je te passe mon tour ! » P :
« Mais non, mais c’est vachement cool. La question que je me pose, c’est : comment pourrait-on passer de ce genre d’expérimentation à une création dans le sens d’un spectacle, d’une représentation publique ? C’est ultra intéressant à faire, à pratiquer, et je suppose que cela donne plein de matière à expérimenter… pour que chacun puisse proposer des choses. Après, autour de la table il y a un certain nombre d’entre nous qui ont déjà l’habitude des partitions graphiques et de les avoir interprétées. Ensuite, ce que je me demande, c’est comment tu fais à partir de là pour en faire une œuvre. Et aussi, il y avait un des points avec Frédéric (Mathevet) qui disait que la partition graphique, c’était bien, parce que cela pouvait nous permettre de nous décaler un peu quand on faisait de l’impro et d’inventer de nouvelles choses. En fait, je me demande si cela permet vraiment d’inventer de nouvelles choses. Ici, malgré tout, quoi qu’il en soit, on se retrouve toujours dans le même genre de truc… » |
Commentaire 6
De nouveau on doit faire face à l’ambiguïté de la signification dans le cadre de l’utilisation des partitions graphiques, entre la présence d’une partition qui constitue dans les perspectives occidentales du modernisme une « œuvre », et la multitude des interprétations possibles qui souligne leur ouverture sur l’expérimentation et l’improvisation. Pour le participant qui vient de s’exprimer, l’expérimentation devrait déboucher sur une œuvre achevée pour pouvoir être présentée sur scène. Mais en même temps, pour lui, l’expérimentation en elle-même, paraît une activité séduisante.
La première question qui se pose dans ce contexte, c’est celui de la nouveauté : la valeur de l’œuvre ne se trouve pas dans la répétition de l’existant, dans le plagiat des partitions déjà écrites, mais dans l’apport d’éléments nouveaux. Du côté de l’expérimentation et de l’improvisation le concept de nouveauté est peut-être plus modeste : ce sont les micro-variations d’éléments déjà-là qui s’inscrivent dans un contexte de production collective immédiate. Ce contexte est susceptible de produire des moments non pas tellement créateurs de nouveautés mais plutôt de situations toujours renouvelées. Dès lors, on se demandera quelles sont les valeurs liées spécifiquement à l’interprétation des partitions graphiques ? N’ouvrent-elles pas un espace de liberté, loin des considérations d’évaluation qualitative des œuvres reconnues du patrimoine et des exigences qui entrent en jeu au niveau de leur interprétation ? En quoi les prestations réalisées au cours de l’atelier ont-elles moins de valeur que beaucoup de prestations sur scène ?
La deuxième question est relative à l’hégémonie de la scène publique, dans ce qu’on appelle le « spectacle vivant », survivance très marquée de ce qui a été développé depuis le 19e siècle. Non seulement l’existence d’une partition n’a de sens que si elle est interprétée sur scène, en présence d’un public qui a possibilité d’accéder à sa publication, mais dans le cas de l’improvisation, le seul élément intangible est bien la performance « sur scène » en présence, dans le temps présent, seul espace où le jeu improvisé prend tout son sens. Mais dans le cas de l’improvisation, il y a une inquiétude, car il y a souvent le sentiment que le public n’est pas inclus dans le processus, qu’il conviendrait en quelque sorte de développer des situations où tout le monde est partie prenante de ce qui est produit collectivement. C’est là où le plaisir de l’expérimentation en tant que telle peut paraître une situation alternative à la scène et à l’élaboration d’une « œuvre », à condition d’y inclure le public comme membres actifs dans le processus, et de sortir des logiques qui séparent les professionnels des amateurs.
Jean-Charles François précise le contexte dans lequel la situation du départ a été élaborée :
|
« Simplement un des contextes dans lequel on a fait ça, était qu’on faisait une rencontre entre des musiciens et des danseurs (2015-17 au Ramdam près de Lyon). L’idée de cette rencontre, c’était le développement de matériaux en commun entre musiciens et danseurs. D’où l’idée de gestes et de sons reliés ensemble. Et alors un jour, un plasticien est venu se mêler à ce groupe. L’idée était qu’est-ce qu’on va faire pour que lui puisse entrer dans le jeu. Et donc c’est cette situation qu’on a développée. Mais en fait le projet réellement était l’improvisation, c’est-à-dire de développer des situations dans lesquelles on peut développer des matériaux en vue d’improvisations, sur le long terme. Donc, c’est dans ce contexte-là, plutôt que dans l’idée de réaliser une œuvre graphique, de faire une pièce autour des situations graphiques. » |
Un participant demande des éclaircissements sur les situations développées dans ce contexte.
|
JCF :
« On avait énormément de protocoles d’entrée dans une improvisation dans lesquels danseurs et musiciens avaient à faire quelque chose en commun. Ensuite, à partir des matériaux élaborés, on leur demandait de les développer librement. On a fait cela sur 5 week-ends et il y a un certain nombre de situations. L’idée des signatures était celle qu’on a fait au départ, parce que c’est un bon moyen pour prendre contact les uns avec les autres, prendre connaissance des gens qui sont là. » P :
« Est-ce que cela a pu produire beaucoup de variété ? Des choses très différentes ? De quel point de vue ? Des gestes, des sons ? » NS :
« Aujourd’hui, dans la situation des signatures gestes-graphismes-sons, on a peu développé le geste. Mais au Ramdam, les danseurs nous ont aidé à faire toutes ces choses-là. Même en partant d’une table, à la fin tout le monde jouait sur la chaise où tout le monde était autour de la table, on bougeait. Et ce qui est intéressant c’est qu’ils nous ont aidés à faire des trucs sur du son aussi, dans le sens où l’intelligence dansée, en fait, est déjà multiple. J’ai essayé de le faire, mais j’étais limité, en essayant de balancer, de faire des grands gestes, tout cela en essayant de se lâcher un peu. Et aussi la question de la spécialisation entre danse et musique : quand on travaille là-dessus, justement avec ces danseurs-là, la distinction entre danseurs et musiciens est un truc qui ne tient pas longtemps, même s’il y a une direction de la musique et une direction de la danse. En réalité, dans la vraie vie, ça ne tient pas si longtemps que ça et tous les protocoles qu’on a faits reviennent à questionner régulièrement ces choses-là. » P :
« Et par rapport à ce que j’ai dit ce matin [elle avait fait une présentation dans le cadre du séminaire] moi, c’est du geste… avec le son dont vous parlez. Même pour Laban, il travaille vraiment le son. Là, quand je suis en train de parler, je peux le noter en termes d’effort, de sa poussée : “p… p…” ; lancer, cracher, frapper, enfin c’est du geste vocal en fait. Et après l’histoire des stylos (etc.) c’est du geste avec, même si ça produit du son, donc en fait, on voit qu’il y a une espèce de congruence entre gestes et sons. Et c’est vrai que moi j’ai tendance à ne parler seulement que de gestes. En même temps c’est super d’amener le son du geste. Là, j’ai adoré ton dernier geste, parce qu’il a un son, un vrai son. On ne l’a pas vu, on l’a entendu dans l’enregistrement, mais en fait c’est un vrai son. Et en même temps, je trouve que c’est bien de parler en même temps du son et du geste, et aussi parce quelque part on décortique pour donner deux matières qui… Mais finalement ce n’est pas indigeste. » P :
« Du coup, il y a quelque chose qui est de l’ordre de la performance aussi, qui se joue dedans. Pour moi la performance c’est quelque chose de physique, qui n’est pas joué comme un comédien joue, mais qui est de l’ordre de la mise en jeu simplement du corps, et c’est un état commun qu’on peut trouver dans des tas de formes de performance. Tu peux avoir dans le son ici, sur l’effort, tu peux avoir un geste, cela sur des histoires, des capacités que tu peux faire sur une espèce de production, tel mouvement de la bouche, de la langue, tu produis du son… » P :
« Cela me fait penser aux difficultés, quand on a travaillé par exemple sur le son avec des chorégraphes, des plasticiens, des gens qui ne sont pas des musiciens, de comment communiquer avec l’autre. Cela me fait penser à un travail avec un chorégraphe, il disait : “moi je veux un son frais”. En fait qu’est-ce que c’est pour lui qu’un son frais, c’est pas du tout ce que fait l’autre. Du coup d’utiliser soit le geste, soit le son, en fait, on a des images très différentes de ce qu’est un son, de ce qu’est un geste, et du coup tout ça, cela permet de communiquer entre artistes qui sont différents. On comprend des choses complètement différentes. » P :
« Moi, j’ai vécu un truc pareil avec des architectes, ils parlaient d’une image Riclès. Riclès, c’est frais ! » P :
« Du chewing gum ! Moi ce que j’ai trouvé intéressant, c’est quelque chose que j’ai déjà pratiquée, de noter, puis de retraduire, de reprendre, de repasser, tout ça… Mais en danse on a beaucoup de partitions comme ça, où franchement la chorégraphe arrive avec ses propres partitions. Et puis on les regarde et on ne comprend rien. C’est pareil aujourd’hui, là on ne comprend rien, cela reste abscond quand même. Mais moi, là, j’ai trouvé que c’était bien de s’approprier un texte… Parce qu’avec les partitions des chorégraphes, on n’ose pas le faire, je n’ose pas. Oui, on travaille tous avec des partitions, mais faire n’importe quoi à partir de partitions c’est vachement intéressant. Mais là je trouve que cela m’a intéressée de se dire que : “oui, ben, c’est illisible, je ne sais pas ce que c’est, mais je le fais”. » |
Commentaire 7
Ici, on est en présence d’un élément important lié en particulier aux partitions graphiques : elles permettent de « faire », d’accéder à une mise en action. Les personnes ayant l’habitude de fonctionner à partir d’éléments écrits, visuels, sont souvent bloquées quand il s’agit d’improviser, donc de se passer de ce qui constitue la base de leur mode de fonctionnement. La partition n’est que le prétexte (texte avant le « texte ») pour faire quelque chose, en mettant l’accent sur le « faire ». La partition est l’entrée qui permet de passer à l’action en dépassant la peur que son absence suscite. Une fois cette peur maîtrisée, une fois l’action commencée, la partition graphique peut être jetée ou ignorée (voir le groupe 2 ci-dessus) car elle devient peu importante par rapport à l’action qu’elle a suscitée. Que la partition soit « illisible » importe peu eu regard à la réalisation d’un « faire » qui prend toute sa signification.
A ce sujet, il faut noter que les partitions graphiques prennent très souvent tout leur sens dans des perspectives d’apprentissage des pratiques improvisées. Elles constituent, en tant qu’outil pédagogique, des transitions commodes entre les habitudes de lecture solfégique des partitions et le fait de se passer de tout support écrit dans l’improvisation. Comme dans le cas des pratiques de « sound painting » ou de direction gestuelle des improvisations, cette pratique d’enseignement tend à ne pas du tout libérer ceux et celles qui se lancent dans l’improvisation de l’hégémonie du visuel sur le sonore. La difficulté principale n’est pas entre le passage de la partition traditionnelle à la partition graphique, mais bien avec ce qui va se passer après, si l’objectif est d’accéder à la situation de communication orale/aurale mettant l’accent essentiel sur l’écoute et le sonore (et/ou le mouvement du corps) dans l’improvisation. Cela vaut ici pour le monde de la musique et c’est peut-être très différent dans le domaine de la danse.
|
P :
« Tu peux t’autoriser à interpréter sans la pression de l’auteur, le détachement de la question de l’auteur, et donc même pour les chorégraphes, c’est quelque chose qu’on pourrait faire. Certainement on ne se l’autorise pas, mais il faut derrière pouvoir s’en emparer et aussi d’une certaine manière si c’est dessiné comme ça, c’est pour qu’on puisse derrière s’en emparer. Cela dépend dans quelle démarche cela a été fait. Si c’est transmis, tu vas quelque part pouvoir t’en emparer. » P :
« Je ne sais pas. C’est aussi pour faire œuvre. » |
Commentaire 8
On en revient encore à la nécessité de « faire œuvre » s’il s’agit de présenter quelque chose de professionnel à un public. Il convient pour cela de développer des dispositifs qui garantissent le développement de pratiques inaccessibles aux amateurs. L’expérimentation dans des ateliers collectifs peut-être fortement encouragée à condition qu’à un moment donné un créateur démiurge (terme qui peut être décliné au féminin) qui va sérieusement reprendre les aspects intéressants des moments d’expérimentation pour déboucher sur un objet artistique. Celles et ceux qui ont participé à la phase d’expérimentation jouent maintenant le rôle de petits soldats obéissants.
Dans l’expérience professionnelle, il continue d’y avoir une tendance à sacraliser celui ou celle qui assume la pleine responsabilité artistique d’un spectacle. Dans le cadre du présent atelier il est dit à ce sujet combien « s’autoriser sans la pression de l’auteur » est une transgression délicieuse, mais qu’on ne peut faire que hors du cadre d’un travail professionnel débouchant sur une prestation scénique. Pourtant, l’impression de faire complètement partie du processus de création perdure, et c’est ce qu’on peut écrire dans les notes de programme.
Après l’écriture de ces propos un peu trop ironiques, on peut aussi prendre au sérieux la proposition suivante : une pratique donnée peut-elle accéder au statut d’œuvre achevée tout en respectant les règles d’égalité et de démocratie au sein d’un collectif, dans une co-construction du résultat final ? Un processus d’expérimentation peut-il se développer sur le long terme dans une continuité entre situations expérimentales et présentations publiques ? Pour travailler dans un tel contexte, toute « méthode » déterminée (de nature compositionnelle) ne conviendra pas. Il va être nécessaire de varier continuellement les modes d’interaction selon l’évolution du travail, comme cela a été particulièrement le cas lors du présent atelier sur une durée très courte. Les outils de support ne peuvent pas se limiter à une seule situation, comme dans les exemples qui suivent : improvisation, écriture sur partition, support audio ou vidéo, images, narrations, grilles, définitions de protocoles, etc. Les divers supports vont être convoqués au fur et à mesure des besoins du collectif. Sans oublier d’inclure dans les processus tous les éléments « domestiques » liés au travail proprement artistique : la cuisine, le ménage, les enfants, les aspects administratifs, les rapports aux institutions, l’organisation des lieux, des horaires, chercher des subventions, etc. Un autre élément indispensable à considérer : il va falloir beaucoup plus de temps à un collectif pour arriver à un résultat probant, que pour un compositeur travaillant en solitaire avec l’utilisation exclusive des plans écrits à l’avance. Mais l’achèvement complet restera sans doute inaccessible et donc restera l’élément saillant d’une démarche, qui comme dans l’improvisation, recommence éternellement.
|
P :
« Si cela ne peut pas être interprété, si on te donne quelque chose qui n’est pas quelque part interprétable… » P :
« C’est là où la partition, ce n’est pas un don, ce n’est pas pour donner quelque chose. » P :
« En fait ce qui est donné c’est ce moment où, ensemble, dans un groupe, on a appris à construire ses propres signes. On s’est donné son propre mode d’emploi, et du coup on construit ensemble, collectivement une lecture définie avec les gens en présence. » Pe :
« Après ce ne sont pas que des signes. On ne sait pas ce que c’est qu’un signe, mais selon les choses dont parlait Tim Ingold, il n’y avait pas forcément quelque chose de l’ordre du signe, il y avait quelque chose de pratique, qui procédait du mouvement. On ne joue pas le signe mais on le rejoue, enfin on le reparcourt… » P :
« … on traduit… » Pe :
« … on a repris le même chemin, quoi… » P :
« … c’est un prétexte pour… » Pe :
« … un point d’entrée. Et aussi par rapport à ce que tu disais, sur cette idée que cela ne puisse pas être interprété et tout. Cela étant, il y a des partitions qui sont quasiment injouables, mais quand on les regarde, ça nous met dans un certain univers. On ne va pas pouvoir les transformer en son peut-être, ce sera un truc purement visuel, mais si on regarde en détail, tu vois des foules de partitions, tu peux imaginer des choses, après tu seras capable de les jouer, cela vaut vraiment le coup de les jouer. Déjà – devant un détail – tu te dis c’est une musique qui te donne quelque chose, là. Tu peux aussi imaginer que cette musique, c’est un dessin. Les trucs de Cage où la marge d’interprétation… » JCF :
« Dans les années 1950-60, on a un peu vécu cela, c’est-à-dire, un grand nombre de compositeurs qui produisaient des partitions graphiques, et ils étaient aussi très frustrés par rapport aux résultats, parce que par exemple, les interprètes avaient tendance à produire des clichés, car il n’y avait rien de prescrit. Du côté des interprètes il y avait aussi une certaine frustration, car ils se trouvaient en quelque sorte dans un espèce d’univers médian dans lequel il y avait à la fois imposition d’une graphie, mais non-imposition quant à son interprétation : il fallait que l’interprète invente tout à partir d’une donnée qui n’avait pas été choisie. C’était à la fois imposé, et il fallait tout inventer. C’est à cette époque que beaucoup d’interprètes de la musique contemporaine se sont tournés plutôt vers l’improvisation, c’est-à-dire de prendre réellement les choses en main complètement sans l’aide d’un compositeur. Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est qu’il y a tout de même un intérêt très grand, qui est réapparu ces dernières années pour les partitions graphiques – cela n’avait jamais disparu en fait – mais peut-être dans un autre contexte. » Pg :
« Le terme de partition graphique fait certainement référence à quelque chose de précis. Moi, par exemple, mes partitions représentent un réel travail graphique. D’ailleurs je n’utilise pas un logiciel d’édition de partition, j’utilise un logiciel de graphiste. Par exemple, je prends une page blanche et je crée quelque chose de graphique, et quelque fois je fais des choix à partir de la base de la grammaire, mais surtout je fais un choix graphique pour que l’œil soit satisfait, pour qu’il y ait un équilibre, une dynamique, etc. Pour moi, c’est une partition graphique qui est très codée. » JCF :
« Il y a un ouvrage des années 1970 de l’architecte Lawrence Halprin, RSVP Cycles (1970), je ne sais pas si vous connaissez ? » Pg :
« On en a parlé… » JCF :
« Votre démarche me fait penser tout à fait à cela. » P :
« J’ai beaucoup apprécié cette journée. Dans votre méthodologie, vous avez dit qu’on devait reconnaître physiquement – ou alors je n’ai pas très bien compris – on devait se reconnaître les uns et les autres, je ne sais pas quelle est l’intention qui est derrière. » JCF :
« L’intention première, c’est qu’on ne se connaît pas et c’est un moyen de… » P :
« …se présenter. » P :
« La signature, plus physiquement… » JCF :
« Oui c’est cela, de faire une connaissance non-verbale, mais enfin bon…, c’est juste un début quoi… » P :
« Moi je n’avais jamais fait ça. Je voudrais faire ça par rapport à l’expérience de la marche. Et de discuter, de sélectionner le son, quels sons on garde, quels sons on va transmettre. Les sons choisis, qu’on soit attiré plus par des sons. Le travail, on harmonise des choses. Mais dans ce que j’ai vécu, je ne peux pas transcrire tous les sons à la fois, il faut que je choisisse… » |
Frédéric Mathevet, organisateur : « On se fait un petit quart d’heure de pause. Après on reprend à 4 heures et demie, on a la journée jusqu’à sept heures. Ça va imprimer dans la tête. Pour la table ronde. »
[Fin de l’enregistrement et de l’atelier.]
Conclusion
Dans l’espace de deux heures, il a été possible de se mettre dans des situations réelles de pratiques, déjà familières pour les personnes présentes à l’atelier, suscitant des discussions animées. Ces discussions ont porté à la fois sur les modalités immédiates des situations pratiques, sur l’invention de variations autour de ces situations, et un débat sur l’esthétique et l’éthique que ces pratiques ont pu évoquer sur le moment. De ce débat est ressorti les aspects majeurs des problématiques liées à l’usage des partitions graphiques :
- L’interprétation des objets visuels dans le domaine de la danse et de la musique, les relations entre les « créateurs » (composition, chorégraphie, mise en scène, direction d’ensemble) et les « interprètes ».
- La question de la propriété intellectuelle des partitions graphiques.
- Les fonctions multiples des partitions graphiques, entre production artistique et outil particulier au sein d’un processus plus général.
- Les situations expérimentales par rapport à la présentation professionnelle sur scène.
- Les méandres des situations expérimentales par rapport à l’élaboration précise d’une « œuvre » achevée.
- La présence corporelle, permettant un double accès aux mouvements dansés et à la production sonore, permettant une mise en relation signifiante danse-musique par rapport à un objet visuel assimilé au domaine des arts plastiques.
Il est bien évident que les expressions passagères lors des discussions ne pouvaient pas impliquer un approfondissement des concepts abordés, ni une prise de conscience immédiate de toutes les personnes présentes sur leur signification. C’est pourquoi il a été nécessaire de reprendre les propos de l’atelier dans des commentaires les interprétant. L’interprétation des propos des personnes qui les ont tenues nous aident à penser, mais n’est en aucun cas un moyen d’analyser ou d’expliquer ce que ces personnes pensent ou font. L’objectif d’une ouverture d’un débat à partir d’une pratique commune et de l’historique particulière de chaque participant a été complètement atteint. On ne peut prédire ce que cette première approche collective aurait pu produire si l’atelier avait été prolongé sur une durée de deux ou trois jours, mais nous sommes en présence d’un début assez prometteur.
Il est évident que toutes les questions concernant les partitions graphiques n’ont pas pu être abordées lors de l’atelier, les débats n’ont pas réussi à faire le tour de la question.
En conclusion, le dispositif pratique que nous venons d’exposer paraît une alternative crédible à développer dans le cadre des rencontres professionnelles liées à la recherche (notamment artistique). La juxtaposition des idées, compte-rendu de recherche, communications diverses, peut se faire par visio-conférence (moyen synchrone) et d’autres outils numériques (asynchrones). La rareté de plus en plus grande des rencontres internationales en présentiel liée aux évolutions climatiques ou pandémiques, implique l’invention de situations où la rencontre effective autour des pratiques et le débat sur la base d’éléments mis en commun devient une condition très importante de notre survie artistique et intellectuelle.
1. Dans ce texte P = participant ou participante à l’atelier. Lorsqu’une personne prend la parole plusieurs fois dans un temps très court, on l’identifie par P+une lettre (Pz par exemple). Seuls sont identifiés les deux animateurs de l’atelier : JCF = Jean-Charles François. NS = Nicolas Sidoroff.
2. Il faut noter que les papiers sur lesquels les participantes et participants à cet atelier ont produit leurs signatures ont été perdus. Les exemples qui sont donnés proviennent d’une situation similaire réalisée à Budapest en janvier 2023.
3. Les échanges dans le cours de l’atelier entre les moments de pratique permettent d’expliciter un certain nombre d’éléments à même la situation, et un deuxième temps est nécessaire pour pousser plus loin les idées qui se sont exprimées. C’est la fonction des commentaires encadrés, écrits après coup par les deux auteurs.
4. Voir Tim Ingold (2007, 2011) sur la notion de « lignes ». Il se trouve que Tim Ingold, dans le cadre de ce séminaire, a fait une communication dans la session qui a immédiatement précédé notre atelier.
5. « Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) est un polémiste, journaliste, économiste, philosophe, homme politique et sociologue français. Précurseur de l’anarchisme, il est le seul théoricien révolutionnaire du XIXe siècle (…) à être issu du milieu ouvrier. » (wikipedia)
Ouvrages cités dans cet article
L’Autre Musique revue, #5 Partitions, 2020. Voir L’Autre Musique.
Cage, John (1957-58). Concert for Piano and Orchestra. Editions Peters, Londres, New York.
Cardew, Cornelius (1963-67). Treatise. The Gallery Upstairs Press, Buffalo, N. Y. 1967.
Citton, Yves. (2014). /Pour une écologie de l’attention/. Paris : Éd. du Seuil, coll. La couleur des idées..
Goodman, Nelson (1968). Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1968. 2nd ed. Indianapolis: Hackett, 1976.
[Langages de l’art : Une approche de la théorie des symboles, tr. fr. J. Morizot, Paris, Hachette, 2005.]
Halprin, Lawrence (1970) The RSVP cycles: creative processes in the human environment, G. Braziller, 1970. [« Les cycles RSVP. Dispositifs de création dans le champs des activités humaines », in De l’une à l’autre.- Composer, apprendre et partager en mouvements, Bruxelles, Contredanse, 2010, pp. 8-38.]
Ingold, Tim (2007). Lines, A Brief History. Routlege. [Une brève histoire des lignes. Zones sensibles, trad. Sophie Renaut, 2011.]
Proudhon, Pierre-Joseph (2009).
Tilbury, John (2008). Cornelius Cardew (1936-1981), A life Unfinished. Matching Tye, near Harlow, Essex: Copula.
Djely Madi Kouyaté
Interview de Djely Madi Kouyaté
par Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff
en présence d’Olivier François
Le 29 octobre 2022 au Petit Bistrot, Paris
Le 20 décembre 2023, à la Bidule, Paris.
Édition 2023-2025
Jean-Charles François et Nicolas Sidoroff.
Sommaire :
1. Enfance et adolescence au village
2. Les Kouyatés, une famille de griots.
3. Partir à l’aventure
4. L’électricité, l’amplification, les technologies
5. La Côte d’Ivoire
6. Le jeu du balafon
7. La vie en France et en Europe
8. Conclusion
1. Enfance et adolescence au village
Jean-Charles François :
Notre idée c’est un peu de retracer votre parcours depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui, mais aussi de décrire en détail les pratiques que vous avez pu développer au cours de votre vie.
Djely Madi Kouyaté :
OK, on commence ?
Nicolas Sidoroff :
Si vous voulez, sinon on va chercher un café…

Photo Nicolas Sidoroff.
[Interruption du cafetier pour prendre les commandes]
Ah mais ça coupe quand il y a quelqu’un qui demande… [rires].
Alors je peux continuer ?
Olivier François :
On ne porte pas trop attention aux enfants, on les surveille mais de loin. Ils écoutent une répétition ou une fête et se mettent ensemble, prennent des boîtes de conserve et tapent dessus, quand ils veulent et ils apprennent comme ça.
Et quand j’arrive enfin à faire cela, je commence à porter le balafon moi-même. Alors c’est comme ça qu’on se perfectionne jusqu’à un certain âge, quinze ans. Comme ça, je joue, je joue, je joue et les gens commencent à parler de moi : « Ah ! Il y a le petit là, à Kamponi (mon village), il joue très bien, s’il y a un mariage, on va aller le chercher ». Parce que, à l’époque, dans le village où je suis né, il n’y a pas d’école, il n’y a pas de téléphone, il n’y a pas d’activités comme dans les grandes villes. Maintenant, cela fait deux ou trois ans, il y a une école.
Exemple du Boté (tambour et cloche)
[Vidéo des enfants qui jouent sur des balafons]
Là, ce n’est pas moi qui ai montré cela. Le plus grand a écouté quand je joue et il a aussi joué. Ici il commence à jouer pour son petit frère.
[Fin de la vidéo]
C’est comme ça, les enfants, quand ils s’intéressent, eh bien, quand ils ont grandi, on voit quelque chose de bien. Tu vois, ça va être joué une fois ou deux, il écoute, il comprend, il joue. Et ceux qui l’écoutent, ils viennent, ils jouent. Voilà, c’est comme ça.
2. Les Kouyatés, une famille de griots.
3. Partir à l’aventure
4. L’électricité, l’amplification, les technologies
5. La Côte d’Ivoire
Au début, je jouais le balafon dans le groupe, mais le balafon n’était pas bien accordé. Il y avait deux autres balafonistes dans le groupe, c’était moi le troisième. Moi j’écoute et je dis : « Ah ! le balafon, l’accord n’est pas bon, moi à l’oreille je le sens ». Alors ils ont dit « Non, non, non c’est comme ça ». Alors j’ai dit « Bon ! » Mais une fois, le directeur m’a dit qu’il fallait accorder le balafon. J’ai dit : « Oui ». Lui, il a dit : « Bon ! tiens ! il y a deux balafons ici, tu vas l’accorder et tu me l’amènes dans une semaine ». J’ai dit « OK ». Je prends les deux balafons, je les amène dans ma maison, je commence à accorder le balafon. À l’époque il y a un diapason, on entend le son, comment ça sonne. Alors j’ai accordé le balafon en do majeur. Le balafon a sept notes. Bon, je trouve que ça devait être comme ça. J’ai accordé l’autre balafon, pareil, bien accordé. Je l’ai amené à la répétition. On a commencé à jouer, il était loin le directeur Souleymane Koly, il est venu, il a regardé, il a regardé. Quand la répétition a été finie il m’a appelé, il a dit : « C’est toi qui as accordé le balafon ? », j’ai dit « oui ». Il a dit : « C’est vrai ? », j’ai dit « oui ». Il a dit « OK ». Après, il m’a appelé, il a dit : « Bon ! tu es retourné dans le groupe, tu ne dois pas bouger ». Des fois, je venais à la répétition, des fois je ne venais pas, parce mon intention n’était pas de rester dans le groupe, je ne voulais pas rester dans le ballet. Mais il m’a forcé à rester dans le groupe. Il a dit : « Voilà, écoutes, tu dois venir aux répétitions tout le temps ». J’ai dit « OK ». Alors, il a gardé les deux balafonistes dans le groupe. Il m’a demandé d’être le leader du groupe. Et voilà comme on est resté dans le groupe. On a fait des tournées, des tournées, des tournées. À la fin, je me suis dit qu’il fallait que j’évolue pour toujours connaître d’autres choses. J’ai quitté le groupe et je suis venu m’installer à Paris vers 1988-89.
6. Le jeu du balafon
Après il peut y avoir des changements, et quand tu commences à changer, ce n’est pas seulement que vous allez vous regarder, mais c’est de comprendre ce qui va changer. Et c’est facile de se rattraper sans se tromper, sans se tromper de notes, et voilà. Tu commences à comprendre, quand tu commences, ou bien tu fais un clin d’œil comme ça, tu fais, et l’autre sait que tu vas changer. Et même sur scène, on fait comme ça souvent, avec les yeux on se regarde. Ce n’est pas la peine de parler, mais avec les yeux comme ça on se parle.
Voix : ti titi ti titi
Mains : x x x x
C’est ça, c’est le « ti titi ti titi » qui donne le tempo.
Des fois, je joue des choses que je n’ai jamais entendues, mais tout en écoutant je dois tout de même jouer. Même au studio, quand parfois on m’appelle pour venir jouer, je demande seulement la gamme des morceaux, c’est ça qui m’intéresse. Quand j’arrive, j’écoute et je joue direct sans perdre de temps. Le balafon est un peu limité par le nombre de notes par rapport à la guitare ou au saxo. Le balafon a sept notes seulement, et non pas douze. Donc, je cherche à savoir quelles notes vont être jouées, et comme ça je sais si c’est mineur ou majeur, je sais comment je peux m’adapter pour jouer. Et s‘il y a des demi-tons chromatiques, quand j’arrive au studio je dis : « Ben ! vous faites tourner la musique » et je joue après avoir écouté pour me donner le temps de m’adapter à ce que jouent les autres.
7. La vie en France et en Europe
Je me rappelle bien que j’ai dû jouer aussi avec pas mal de groupes différents qui sont connus en Afrique, comme celui de Youssou Ndour. J’ai joué avec lui et Kandia Kouyaté, Oumou Kouyaté et Diaba Kouyaté. Il y a aussi Ami Koïta. J’ai joué avec Manfila Kanté pendant longtemps, on a beaucoup joué ensemble en Hollande, en Belgique.
8. Conclusion
2. Wikipedia.fr : griots. « Organisation sociale des griots mandingues. Chaque famille de djéli accompagne une famille de rois-guerriers nommés diatigui. Il n’est pas de djéli sans diatigui, il n’est pas de diatigui sans djéli, les deux sont indissociables et l’un ne vaut rien sans l’autre. » wikipedia
3. african-avenue.com : « Le Bazin riche est un type de tissu très populaire en Afrique : notamment pour la confection des tenues africaines originales, des vêtements traditionnels en Afrique de l’Ouest, en particulier au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il s’agit d’un tissu luxueux et unique qui se décline en différentes couleurs et motifs (…). » african-avenue.com
4. Soundiata Keïta aussi appelé, selon la tradition orale, Mari Diata Konaté (et couronné sous le nom de Mari IerDiata ), né le 20 août 1190 à Dakadjalan au royaume du Manding et mort en 1255, dans l’empire du Mali, est un souverain mandingue de l’Afrique de l’Ouest, présenté par la tradition comme le fondateur de l’empire du Mali au xiiie siècle. L’histoire de Soundiata est essentiellement connue à travers une épopée aux tonalités légendaires racontée de génération en génération jusqu’à nos jours par les griots. wikipedia
5. Yankadi : « Le yankadi est l’une des danses traditionnelles soussou bien connu et souvent utilisé par les artistes pour mieux toucher la sensibilité des amoureux. Comme tous les autres rythmes traditionnels de la Guinée, la danse yankadi obéit à des techniques de chants et de danses spécifiques. » wikipedia
6. Sékou Camara Tanaka, ou Sékou Camara Cobra est un griot de la tradition Malinké. Il chante et joue de la guitare. Il est aussi acrobate, chorégraphe et compositeur. iro.umontreal.ca.
7. Le groupe Kotéba est une compagnie de théâtre de Côte d’Ivoire, basée à Abidjan, fondée en 1974 par Souleymane Koly. Souleymane Koly (1944-2014) est un producteur, réalisateur, metteur en scène, dramaturge, chorégraphe, musicien et pédagogue guinéen. Voir wikipedia et Souleymane Koly, wikepedia.
8. Fodéba Keïta (1921-1969). Voir wikipedia.
9.« Famoudou Konaté est considéré par ses pairs comme l’un des plus grands batteurs de l’ethnie malinké ». wikipedia.
10. Mory Kanté a popularisé la Kora avec le tube planétaire Yéké Yéké, en 1986.
11. George Momboye, « chorégraphe d’origine ivoirienne, initié très jeune à la danse africaine puis plus tard à la danse jazz, classique et contemporaine. » Centre Momboye.
12. Philippe Monange : formé au piano classique puis jazz parallèlement à des études de philosophie, aujourd’hui passionné de musiques africaines il se produit actuellement avec le Bal de l’Afrique enchantée, Debademba, Vincent Jourde quartet, créateur de l’Akrofo system. linkedin.com.
Lukas Ligeti
Instruments secrets, Destinations secrètes
Lukas Ligeti
2007
Traduction de l’anglais : Jean-Charles François
Article publié en 2007 dans Aracana II, Musicians on Music, Ed. John Zorn,
“Secret Instruments, Secret Destinations”,
p. 122-149, Distributed Art Publisher.[1]
Sommaire :
Une invitation à aller en Afrique
La musique de cour du Buganda
La composition Pattern Transformation
Approche personnelle au jeu sur la batterie
La composition Groove Magic
Voyage en Côte d’Ivoire
L’ensemble Beta Foly
Le CD Lukas Ligeti & Beta Foly
Voyage au Zimbabwe et en Mozambique
Burkina Faso
La batterie et les moyens électroniques – La musique électronique et l’Afrique
Conclusion
Une invitation à aller en Afrique
À une heure indue du matin en 1992, j’ai été réveillé par un coup de téléphone. À l’autre bout du fil j’ai entendu une voix qui me disait avec un accent résolument allemand, « Bonjour, ici c’est le Goethe Institute. ‘Es geht im Africa’. » En allemand cela veut dire, « C’est au sujet de l’Afrique », ou de manière plus inquiétante, « L’avenir de l’Afrique est en jeu ».
Je faisais alors des études de composition à l’Université de Musique de Vienne en Autriche. La veille au soir, avant de recevoir ce coup de téléphone inattendu, j’étais allé à un concert donné par des musiciens allemands, je m’y suis ennuyé, donc j’ai lu les notes de programme. Le saxophoniste avait fait une « tournée en Afrique de l’Ouest pour le Goethe Institute ». Bon sang, je me suis dit, une petite tournée en Afrique de l’Ouest, ça serait sympa ! Mais ce n’est pas ce qui va m’être offert. Le Goethe Institute, c’est pour les Allemands et je ne suis pas allemand, point final.
Et le lendemain matin il y a eu ce coup de téléphone. J’ai pensé que j’étais encore en train de rêver ou que quelqu’un était en train de se moquer de moi. J’ai raccroché. Le téléphone a de nouveau sonné. « Excusez-moi, nous avons été déconnectés, je travaille au Goethe Institute. Nous voulons vous envoyer en Afrique ».
Flashback. Étant donné mon nom de famille, beaucoup de monde pensait que j’étais destiné à devenir musicien depuis l’âge de cinq ans. Mais, à part quelques leçons de piano de temps en temps, c’est à dix-huit ans que j’ai commencé des études musicales avec la percussion, en me limitant après deux ans à peu près, à la batterie et à la composition. Je suis parti, pour ainsi dire, d’une feuille blanche. Je n’avais pas écouté beaucoup de musique depuis l’âge de huit ans ; j’ai commencé à écouter un grand nombre de musiques. Mon père et moi nous échangions parfois des enregistrements, et il écoutait alors des musiques traditionnelles africaines, et il en copiait certaines pour moi. J’ai aussi assisté à des conférences à l’Université de Vienne, et les plus intéressantes étaient de loin celles de l’ethnomusicologue Gerhard Kubik[2]. Ses analyses de la musique de cour du Royaume de Buganda, qui fait partie de ce qui est maintenant l’Ouganda, ont complètement changé mes conceptions du monde.
J’ai été à l’écoute des tambours des musiques de Cuba et du Ghana, à celle du Kwela (dans les townships de l’Afrique du Sud, il s’agit de l’équivalent du big band du jazz américain), et aussi d’autres styles. Les formes, rythmes et mélodies de l’Afrique ont trouvé leur place dans mes premières compositions, et en 1988, quelques mois après avoir commencé mes écoutes de la musique africaine, j’ai écrit une pièce que j’ai appelée Pattern Transformation. Écrite pour quatre exécutants et deux marimbas, c’était une première approche pour le développement de ma propre voix en tant que compositeur. En utilisant des techniques de la musique de Buganda que j’ai adaptées, j’ai construit un paysage poly-métrique assez dément, construit à partir de hoquets et d’imbrications complexes entre les musiciens. Mais, évidemment, il n’y avait pas de musiciens formés à la musique occidentale ayant une pratique de cette approche de la métrique, tandis que les musiciens africains ne lisaient pas la musique, j’ai donc pensé que la pièce était impossible à jouer. C’est alors que j’ai entendu parler d’un ensemble hongrois appelé Amadinda Percussion Group. L’amadinda est un xylophone utilisé dans la musique du Buganda, et en tout cas, ces musiciens hongrois ont été séduits autant que moi par cette musique, et ils avaient acquis la maîtrise de ses techniques spécifiques d’interactions. Ils ont participé à la création de Pattern Transformation en 1990 et l’ont joué depuis à travers le monde entier ; le Goethe-Institut avait entendu parler de ma musique influencée par l’Afrique et il m’a invité à aller travailler avec des musiciens traditionnels en Côte d’Ivoire.
Si j’ai été à l’écoute de beaucoup de musiques africaines, je n’en avais jamais joué moi-même, et la possibilité réelle d’aller là-bas m’avait paru si peu probable que cela ne m’était jamais venu à l’esprit. Tout à coup, une opportunité m’était offerte pour y aller. J’ai pensé que les musiciens africains ne seraient pas mieux préparés à jouer ma musique que je ne l’étais à jouer la leur. Comment envisager dans ces conditions une collaboration avec eux ?
L’approche la plus réaliste semblait être d’essayer de trouver un type de musique qui ne pouvait pas avoir été pensée ni par eux, ni par moi, une musique exigeant la combinaison de nos parcours et de nos capacités : quelque chose de nouveau. Et cette idée me convenait tout à fait. En 1992, mes études universitaires touchaient à leur fin et je réfléchissais aux perspectives de faire quelque chose de nouveau ; mon plan était de travailler dans la musique électronique, en soulignant en particulier l’importance de la performance vivante, pour voir ce qui pourrait se passer si j’appliquais mes techniques de batterie récemment acquises aux percussions électroniques, un champ d’investigation qui à cette époque avait été négligé par le milieu de la musique électronique, ce qui est encore le cas aujourd’hui, et qui continue encore aujourd’hui de m’intriguer. L’idée d’utiliser des percussions électroniques en Afrique semblait prometteuse. La difficulté tenait dans le fait que, à part des formes de collages de bandes magnétiques dans les studios de musique électronique, je n’avais jamais travaillé dans l’électronique, j’ai donc dit au Goethe-Institut que je voulais m’adjoindre quelqu’un spécialisé dans la musique électronique. Ils m’ont dit qu’il fallait que ce soit un Allemand, mais je ne connaissais personne dans ce cas. Je leur ai demandé de me faire une proposition ; ils ont été surpris d’apprendre que je n’avais jamais entendu parler de Kurt Dahlke, alias Pyrolator.
En fait, il s’est avéré que j’avais déjà écouté certaines de ses musiques. Pendant ma dernière année de lycée, j’ai de temps en temps mis la radio pendant que je faisais mon travail scolaire et j’étais toujours heureux d’écouter de la Neue Deutsche Welle (NDW), un style allemand de « new wave » ou de « synthi-pop » dans sa version première, une mixture DIY de punk et de disco avec l’électronique bricolée à la maison et des paroles originales en allemand. Kurt avait été un membre fondateur du nouveau groupe NDW Deutsch-Amerikanische Freundschaft (D.A.F) à la fin des années 1970 et, après avoir quitté cet ensemble, il a co-fondé Der Plan, probablement le groupe le plus expérimental dans le genre, réellement un collectif de performance-art influencé entre autres par les Residents, Genesis P. Orridge et la scène artistique de Düsseldorf. En 1979, Kurt et ses amis ont créé le studio d’enregistrement et le label AtaTak, et, au cours des années qui suivirent, il a produit des tubes tels que Fred vom Jupiter de Andreas Dorau, des groupes de rock comme Fehlfarben (qui en ce moment tente un retour avec Kurt jouant des claviers), et des expérimentateurs du glitch-electronica comme Oval. Il est aussi devenu un habile manipulateur en temps réel de plusieurs instruments électroniques tels que le Thunder et le Lightning de Don Buchla. J’ai pris contact avec Kurt à un studio d’enregistrement à Arnhem en Hollande ; nous avons décidé qu’un travail en commun était viable, et à partir de ce moment, nous n’avons pas cessé de collaborer.
En 1993 j’ai acheté mon premier ordinateur et un instrument de percussion électronique appelé DrumKat, et j’ai élaboré un programme de duo à présenter pendant notre séjour de deux semaines et demie en Afrique. Finalement, en février 1994, nous avons pris un avion d’Air Afrique pour aller à Abidjan.
La musique de cour du Buganda
Ma connaissance de la musique africaine était à ce moment-là en grande partie basée sur le travail de Gerhard Kubik en Buganda, mais bien que cette musique expose très clairement et de façon particulièrement extrême certains concepts clés de la musique africaine, elle reste un cas très spécifique, unique, et elle a peu en commun avec les traditions de l’Afrique de l’Ouest, à quelques milliers de kilomètres de distance de l’Ouganda, là où je me trouve actuellement. Il reste que, pour mieux comprendre le fondement conceptuel que j’ai apporté dans la collaboration, des explications sont nécessaires.
La musique de cour du Buganda remonte à plusieurs centaines d’années, mais le royaume et ses traditions ont été tellement impactées par le régime totalitaire de Milton Obote dans les années 1970, qu’il avait laissé à son successeur, le particulièrement sanguinaire Idi Amin, peu de choses à détruire. Kubik est venu la première fois dans la région en 1959 et a appris à jouer la musique avant qu’elle ne disparaisse complètement, pour ne refaire surface qu’après que l’Ouganda eut retrouvé un état normal relatif pendant la dernière décade du XXème siècle.
La musique de cour du Buganda se joue avec des instruments variés, dont le xylophone amadinda et le ennanga, une harpe. L’amadinda se joue à trois personnes, la musique est pentatonique et l’amadinda dispose de douze lames, dix qui sont jouées par deux exécutants assis face-à-face de chaque côté de l’instrument, et ils couvrent la tessiture de deux octaves. Le troisième exécutant se limite à jouer sur les deux lames les plus aiguës qui ne sont pas jouées par les autres exécutants et qui sonnent deux octaves au-dessus des deux lames les plus graves. Une pièce commence avec le premier exécutant jouant une mélodie en octaves parallèles (avec les deux mains simultanément), dans un rythme de « noires » égales – très rapides, et d’habitude d’une longueur qui peut se diviser en deux ou trois parties, par exemple, douze ou vingt-quatre notes. La mélodie est répétée continuellement sans aucune variation. A un moment déterminé le deuxième exécutant qui fait face installe une contre-mélodie dont les caractéristiques sont assez similaires à la première. Les deux mélodies comportent des sauts et disjonctions ; pour des raisons qui vont bientôt s’éclaircir, on est loin ici des progressions en degrés conjoints des mélodies « vocales » européennes. Les deux mélodies sont jouées exactement à la même vitesse rapide, mais pas en unisson rythmique. Le deuxième exécutant joue sa mélodie exactement entre les notes du premier, s’imbriquant avec lui. Les deux mélodies jouées ensemble résultent en une pulsation très rapide de 500 ou plus à la minute. Comment le deuxième exécutant peut-il être capable de produire ces syncopes si rapidement pour jouer ses notes exactement entre celles du premier exécutant ? La réponse est qu’il ne produit pas du tout des syncopes. Essayez de jouer les contretemps à un tel tempo et de le maintenir continuellement à la même vitesse ; très vite vous allez « perdre le tempo » et ralentir pour vous aligner en un unisson rythmique avec les temps forts. Plutôt que d’adopter une telle méthode, le second exécutant écoute le premier et internalise le tempo. Il commence ensuite à jouer des quasi-syncopes pour se glisser entre les notes de son partenaire. Et à partir de ce moment, il inverse sa perception métrique, en se persuadant lui-même qu’il joue sur les temps et que c’est l’autre qui produit les syncopes. En considérant les temps comme se trouvant à des points différents, les deux exécutants sont capables de maintenir un équilibre et de jouer leurs structures imbriquées très rapides sans se désynchroniser.
L’idée – qu’il n’y a pas besoin d’avoir un concept unifié de la métrique dans un ensemble, que les exécutants d’un ensemble ont une notion relative de la pulsation des temps – est étrangère à la musique occidentale, et en réalité à la plupart des musiques du monde. En grande partie, elle reste l’exclusivité de certaines formes de musique dans le centre et le sud de l’Afrique ; on peut la trouver dans une certaine mesure dans le Gamelan, mais sans la même rigueur et nécessité structurelle existant dans la musique amadinda. Pour moi, j’ai été complètement fasciné, inspiré et libéré par ce concept et il est devenu depuis ce moment ce qui s’est trouvé à la base de beaucoup de mes expérimentations.
Mais il y a beaucoup plus d’ingénuité dans la théorie musicale bugandaise. Les exécutants un et deux jouent sur la même collection de lames, les dix plus graves de l’instrument, des deux côtés opposés. Les mélodies contiennent toutes les deux des sauts et des disjonctions et elles s’imbriquent dans un tempo extrêmement rapide. Le résultat de ces interactions est que l’oreille de l’auditeur perd rapidement la trace de quelles notes sont jouées par quel musicien. Une nouvelle image auditive émerge : une figure qui résulte de la combinaison des mélodies. Et c’est ainsi que votre cerveau crée de nouvelles subdivisions internes, en réorganisant ces nouvelles figures très rapides dans des manières différentes ; par exemple, par bande de fréquence. Rapidement on entend une mélodie dans le registre aigu, une autre dans le registre moyen et une autre dans le grave. Ces mélodies émergeantes ne sont pas jouées individuellement par un seul musicien ; elles sont incorporées dans la structure profonde de la musique, émergeant seulement lorsque le cerveau a réorganisé l’image auditive résultant de l’imbrication rapide des mélodies de base. Gerhard Kubik a appelé ces mélodies dérivées de « figures inhérentes » [« inherent patterns »].
Une de ces figures inhérentes se trouve sur les deux lames les plus graves de l’amadinda. C’est là où le troisième exécutant entre en jeu, en doublant cette mélodie sur les deux lames les plus aiguës, deux octaves plus haut. C’est ce qui peut s’avérer assez compliqué. Il faut imaginer que les mélodies des deux premiers exécutants ont, par exemple, trente-six et vingt-quatre notes respectivement ; cela produit une figure entière de 144 pulsations avant qu’elle puisse être répétée. Chaque figure inhérente est le résultat éclaté des sauts et disjonctions dans la composition des mélodies, la figure qui émerge avec les deux lames les plus graves est d’une grande longueur et rythmiquement irrégulière : elle est très difficile à mémoriser. Comment est-il possible de la reproduire exactement sur les lames aiguës ? Il se trouve que, tandis que la musique amadinda est instrumentale, il y a un élément vocal caché qui se manifeste. Les mêmes pièces peuvent être jouées sur une harpe appelée ennanga, et ici, les mains de l’exécutants sont imbriquées, une main représentant effectivement chacun des deux premiers exécutants sur l’amadinda. Et ensuite, le harpiste se met à chanter une mélodie avec des paroles, et la ligne de chant retrace une des figures inhérentes – la figure exacte qui, quand elle est jouée sur les xylophones, tombe sur les lames graves. Le rythme de cette mélodie correspond au rythme des paroles. Donc, pour pouvoir jouer cette figure sur l’amadinda, notre troisième exécutant doit connaître les paroles du chant et imaginer qu’il la chante. C’est parce qu’il commence à imaginer les paroles au bon moment, que la mélodie dérivée va correspondre à la figure inhérente jouée sur les lames les plus graves du xylophone.
La composition Pattern Transformation
Composer une pièce pour amadinda, c’est comme tenter de trouver son chemin dans un labyrinthe : il s’agit de construire des mélodies qui vont produire des figures inhérentes intéressantes, tout en s’assurant que les contours rythmiques des chants traditionnels sont bien présents. Mais la complexité est encore plus grande. Étant donné que la musique est pentatonique et que les degrés entre les hauteurs sont égaux dans toute la mesure du possible, une pièce peut être transposée quatre fois de sa forme originale sans perdre sa silhouette de sa composition d’intervalles. Mais pendant que les versions transposées sont jouées, l’amadinda, en tant qu’instrument, reste le même avec les mêmes hauteurs mise à disposition. C’est ainsi que alors que les relations d’intervalles entre les mélodies restent intactes, une figure inhérente différente sera associée aux lames graves à chaque transposition ; en conséquence, une figure différente devra être reproduite dans l’aigu. Et alors qu’on peut préférer une version particulière d’une pièce, toute transposition peut théoriquement être jouée à tout moment, et d’une façon ou d’une autre les figures correspondantes doivent pouvoir être mémorisées. C’est une technique de composition qui n’est absolument pas moins sophistiquée que l’écriture d’une fugue ; c’est une technique qui crée un équivalent sonore à une sculpture qui peut être regardée de tous côtés.
Ma réaction initiale à tout cela a été de deux natures. J’ai commencé à écrire Pattern Transformation, et en même temps, j’ai commencé à adapter ce que j’avais appris à mon jeu sur la batterie.
La pièce Pattern Transformation, pour quatre exécutants se faisant face deux à deux sur deux marimbas, est basée sur une pulsation excédant de beaucoup 400 par minute, en écriture de croches. La pièce commence sur un canon chromatique, le « thème » initial qui commence et finit par la note de « do » ; pour une densité maximum, toutes les croches sont jouées. La structure ensuite s’éclaircit ; le thème du canon est abandonné ; le chromatisme se transforme dans un environnement pentatonique (évidemment il ne s’agit pas d’un pentatonique équidistant comme sur l’amadinda ; il s’agit ici de marimbas occidentaux) et la musique devient moins dense. Éventuellement, les musiciens remplacent les croches par des noires, mais ils ne les jouent pas dans un unisson rythmique. Ils jouent en imbrication. Deux musiciens jouent les « temps forts », les deux autres sont sur les « contretemps », mais ceux qui jouent sur les contretemps perçoivent la musique comme si leurs notes étaient des temps forts. Et effectivement, la musique peut être perçue des deux façons. J’utilise une métrique conventionnelle et des barres de mesure, mais c’est juste pour faciliter la lecture. Les musiciens en réalité ne pensent pas aux barres de mesure, ils ressentent juste la pulsation de base et les éléments multiples qui l’accompagnent ; si la pulsation de base reste constante, des éléments multiples viennent s’y ajouter à plusieurs endroits. Parfois, un musicien va jouer chaque unité de pulsation pendant un peu de temps, et ensuite il va ralentir, ce qui veut dire en fait qu’il joue à la même vitesse mais en jouant une sur deux pulsations, puis une sur trois, puis une sur quatre, etc. Un autre musicien pourra faire la même chose mais exactement dans le mouvement contraire. Pour l’auditeur, cela va lui paraître une forme de rubato, mais, parce qu’à tout moment il existe sous-jacent un sens unifié du tempo, les exécutants restent complètement coordonnés. Toutes les relations métriques sont rigoureusement déterminées et lorsqu’elles se mettent à l’unisson, cet unisson est immédiatement ensemble d’une manière totale, parce que les musiciens ne se sont jamais réellement séparés, ils ne faisaient que semblant de l’être dans leur production sonore.
Peut-être que cela vient de l’influence de la pop-musique, mais cette rigueur, cet ordre sous-jacent même quand les choses paraissent chaotiques, est pour moi très importante. Cela ne veut pas dire que je rejette la métrique libre, le rubato ou l’absence de fondement métrique. Mais ce qui m’a toujours fasciné, c’est le contraste entre le chaos et l’ordre. Et j’aime les phrases qui sont totalement étranges, qui semblent chaotiques, mais qui peuvent être répétées de façon parfaite, ou des phrases qui sont jouées d’une manière très peu soignée et en même temps sont très précises, avec l’hétérophonie qui en résulte (ces idées m’ont conduit à développer quelques années après la pratique de ce j’appelle les « instruments secrets »). En tout cas, pour créer ces contrastes très distincts entre l’imprécision chaotique et la rigueur totale, la rigueur a intérêt à être complètement rigoureuse. Une méthode efficace pour y parvenir est d’avoir les sections désordonnées rigoureuses dans un sens subliminal, inaudibles pour l’auditeur mais toujours tangibles pour les musiciens.
Les imbrications les plus extrêmes dans Pattern Transformation se produisent lorsque les quatre musiciens jouent toutes les quatre unités de pulsation, mais à distance d’une pulsation par rapport à l’exécutant précédent. Chaque unité de pulsation est jouée, mais chaque pulsation n’est jouée que par un seul musicien, l’un après l’autre. J’ai réutilisé cette forme de hoquet quelques années après dans ma pièce Groove Magic, facilitée par mon dispositif instrumental secret.
Pour jouer Pattern Transformation, les percussionnistes doivent apprendre à s’imbriquer à des tempos très rapides, en renonçant au concept d’une métrique unique ou de battements de temps, tout en adhérant à un tempo unifié, comme c’est souvent le cas dans la musique d’amadinda. Pourtant il s’agit d’une musique écrite pour des musiciens formés à la musique occidentale. Il n’y a pas d’éléments parlés inhérents à cette musique et les relations rythmiques changent constamment, ce qui exige la lecture d’un écrit. Mon espoir dangereusement optimiste était que les musiciens soient capables de combiner les capacités traditionnelles africaines et traditionnelles européennes, mais à Vienne à la fin des années 1980, ce scénario ne pouvait pas être réalisé.
Cela a été plus qu’une petite surprise que l’ensemble qui avait les capacités de réaliser les premiers ce rêve provenait de Budapest. Alors que Vienne restait en quelque sorte assez conservatrice, c’était encore un des grands centres de pratique musicale en Europe, avec des musiciens du monde entier venant y étudier et en visite. C’était le dernier arrêt, la voie sans issue, avant le rideau de fer, pourtant cela faisait résolument partie de l’Occident libre européen, où l’information était facilement accessible. La Hongrie, d’autre part, se trouvait derrière le rideau de fer et si elle était la patrie de beaucoup de musiciens biens formés, elle n’était pas l’endroit idéal pour les études des traditions exotiques. Pourtant, c’est à Budapest, parmi toutes les villes, qu’un groupe de jeunes percussionnistes s’est réuni en 1984 pour former un quatuor et qui, pour une raison ou pour une autre, ont découvert l’amadinda, au point de donner le nom de cet instrument à leur ensemble. Ils ont été tout autant surpris de rencontrer un compositeur ouvert aux techniques de la musique des Baganda que je l’étais de trouver des musiciens capables de la jouer. Grâce aux nombreuses fois où ils ont joué Pattern Transformation, beaucoup d’ensembles l’ont aussi repris, et ainsi cette pièce a peut-être contribué un tout petit peu à étendre les possibilités des ensembles de percussion et la façon dont les musiciens en Europe et en Amérique envisageaient la métrique.
Lukas Ligeti, Pattern Transformation, Amadinda Percussion Group.
Approche personnelle au jeu sur la batterie
L’autre réaction immédiate à ma découverte de la musique amadinda a été la création d’une nouvelle approche personnelle au jeu sur la batterie. Je me suis demandé si je pouvais d’utiliser des figures d’imbrication pour créer l’impression de plusieurs mesures et tempos différents. Pour tout batteur de jazz, « l’indépendance » est un terme lourd de sens ; le batteur travaille l’indépendance entre ses membres, pour pouvoir exécuter plusieurs rythmes en même temps, par exemple une figure de swing sur la cymbale ride, la charleston marquant les deuxièmes et quatrièmes temps et différentes ponctuations polyrythmiques sur la grosse caisse et la caisse claire. Malgré tout, le grand batteur de jazz Bob Moses fait remarquer dans son livre Drum Vision (Modern Drummer Publications), que l’indépendance n’est en fait qu’une illusion. Les auditeurs sont amenés à penser que les batteurs sont capables de contrôler leurs membres individuellement, mais en fait ils sont en train de jouer un vocabulaire limité de licks contenant des relations rythmiques suffisamment complexes entre les membres pour donner l’impression de la maîtrise de l’indépendance. En effet, Moses explique aux lecteurs le principe d’un concept « hors indépendance », dans lequel le batteur dans sa pratique est bien conscient du fait que ses quatre membres sont interdépendants et cherchent un moyen de produire l’impression maximum d’une poly-métrique avec la quantité minimum d’indépendance.
Mais le jeu conventionnel sur la batterie, tout en étant dérivé d’une manière significative des rythmes ancestraux africains, n’inclut pas en son sein le concept d’une métrique relative. J’ai essayé de développer une technique de batterie en utilisant ce concept, en reprenant le jeu de la harpe ennanga, dans lequel les figures inhérentes sont produites par un seul exécutant. Je joue de ma main droite une figure répétitive, en décrivant un cercle autour des instruments de la batterie dans un mouvement constant de noires (par exemple). Je peux commencer par frapper la cymbale ride, puis le tom moyen qui se trouve immédiatement à gauche de la cymbale, puis je continue plus bas sur la cloche de vache attachée à la grosse caisse, puis je peux amener ma main dans un position encore plus basse, plus à droite, pour frapper le tom-basse. Ensuite, je peux retourner à la cymbale ride pour me retrouver au début de ma figure rythmique. J’ai maintenant réalisé une figure de quatre notes – quatre hauteurs, quatre timbres. Je peux ensuite construire une figure similaire pour ma main gauche ; allons au plus simple avec une figure de trois notes. Je commence avec le tom aigu sur la gauche par rapport au tom moyen mentionné ci-dessus. De là, je continue sur la cloche de vache attachée à la grosse caisse – la même cloche de vache qui avait été utilisée dans la figure précédente. Ensuite je continue sur la caisse claire, vers le bas et un peu à gauche, ce qui va former un miroir du mouvement vers le bas et la droite de ma main droite de la cloche de vache au tom-basse. Et de la caisse claire, je soulève mon bras et retrouve le tom aigu. Alors que cette figure n’est que de trois sons, le mouvement décrit par ma main gauche et relativement similaire à celui décrit par ma main droite. Maintenant j’ai donc deux figures, que je peux imbriquer. Un cycle métrique complet comporte 4 x 3, ou douze notes, mais les figures sont en imbrication, donc cela prend en réalité vingt-quatre unités de pulsation. Mais je n’ai pas encore utilisé mes pieds, qui peuvent être intégrés ou superposés de manière très efficace au-dessus des figures des mains. Par exemple, je pourrais jouer la grosse caisse toutes les cinq unités de pulsation. Une fois sur deux la grosse caisse serait en même temps que la main droite ; l’autre fois sur deux avec la main gauche. Le résultat serait une figure longue de 24 x 5 = 120 unités de pulsation, encore assez facile à produire. Je pourrais maintenant ajouter la charleston toutes les sept pulsations. Cela devient un défi, mais c’est encore possible de le faire en comparaison avec ce qui est techniquement exigé dans le jeu conventionnel de la batterie. Et maintenant j’ai une figure d’une durée de 120 x 7, soit 840 pulsations.
J’ai maintenant à ma disposition une manière très économique et sans problèmes insolubles de jouer des structures poly-métriques qui sont composées d’éléments simples et basiques mais qui rapidement explosent en une grande complexité. Mais comment puis-je savoir où je suis dans le cycle de ma figure rythmique ? Dans la plus grande part de la musique occidentale, cela se fait en comptant ; dans cette musique, cependant, alors qu’il y a définitivement un tempo, il n’y a pas de temps « fort » [one], pas de temps définis, ce qui rend l’idée de compter une activité schizophrène et vaine. Je n’utilise pas de mesure, de mélodie ou de timbre pour m’orienter dans les figures lorsque je joue ces structures ; j’utilise plutôt la position. Je conçois ce genre de jeu sur la batterie comme une chorégraphie, une sorte de danse sur les instruments, et en suivant les formes de mouvement qui sont décrites par mon corps, je peux ressentir mon parcours dans les figures, en utilisant les positions relatives de mes membres pour savoir où j’en suis à n’importe quel moment.
De cette manière, j’ai pu rapidement travailler avec des structures beaucoup plus longues que celles qui existent dans la musique Baganda, grâce surtout à l’usage de mes pieds pour créer des poly-métriques additionnelles. Il n’y a pas de problème à jouer des cycles plus longs, soit par l’utilisation de figures de mouvements plus complexes ou par d’autres moyens, par exemple, en additionnant la possibilité de varier les manières de frapper les instruments de la batterie et de superposer ce « paramètre » à une figure déjà en existence, une approche qui ressemble un peu à la musique sérielle. De toute manière, les mélodies inhérentes émergent rapidement ; la batterie étant un instrument à hauteurs indéfinies, il est plus approprié probablement de parler de mélodies de timbres, « Klangfarbenmelodien ». Dans l’exemple ci-dessus, les deux mains jouent la même cloche de vache, ce qui résulte en une figure évidente constituée par une seule note. Ou bien on peut porter son attention auditive aux relations entre les instruments ayant des timbres similaires : une relation de 4:3 émerge entre le tom aigu joué par la main gauche faisant partie d’un cycle de trois notes ou positions de la main, et le tom moyen frappé par la main droite faisant partie d’un cycle de quatre. Étant donné que les mains sont décalées par une unité de pulsation de base, l’émergence du 4:3 ne sonne pas comme le 4:3 auquel on est habitué, avec deux lignes se rencontrant sur chaque troisième frappe du tempo plus lent ou chaque quatrième frappe du tempo plus rapide. Les deux relations ne viennent jamais se rencontrer, et en effet, ce 4:3 n’est pas un 4:3 entre deux différentes vitesses. Les deux mains jouent à la même vitesse. Pourtant la durée entre deux frappes du tom gauche est toujours plus courte que celle entre deux frappes sur le tom droit. C’est un type d’illusion de poly-métriques, une structure poly-tempo qui ne résulte pas d’un réel jeu entre des mesures ou vitesses différentes mais d’une figure de mouvements de longueurs différentes à la même vitesse.
Après cela, j’ai commencé à chercher des notations pour ce style de jeu sur la batterie. La batterie est souvent utilisée dans la musique qui utilise peu la notation, et il n’y a pas d’orthographie unifiée pour la batterie, bien que la portée de cinq lignes soit souvent utilisée par commodité. Cette approche s’avère rapidement inadéquate ; les batteurs ont l’habitude de lire de simples rythmes qui contiennent des répétitions évidentes, avec une combinaison de mains immédiatement apparente. Ce que j’ai écrit est apparu plus mélodique et dans l’ensemble difficile à saisir au premier coup d’œil. L’utilisation de deux portées, une pour chaque main, a apporté une amélioration, mais la lecture à vue restait difficile à maîtriser. La solution à mes problèmes est venue lorsque j’ai réalisé que je jouais plus sur la base de la position des mains sur les instruments que celle des sons ou des hauteurs : une notation de tablature a paru en conséquence plus appropriée. J’ai dessiné une vue aérienne de ma batterie et j’ai commencé à dessiner des vecteurs pour représenter mes figures de mouvement. Ensuite, j’ai construit une petite étiquette collante représentant ma vue aérienne, et j’ai collé ces images de ma batterie sur le papier, en écrivant une frappe de la main droite et une frappe de la main gauche pour chaque image. À la même époque – à la fin du printemps 1988 – j’ai rencontré John Zorn, qui était venu enseigner à Vienne ses pièces basées sur des jeux dans un atelier ; j’avais juste commencé à prendre des leçons de batterie et à explorer le jazz et la scène de la New York Downtown. C’est Zorn lui-même qui m’a suggéré de n’utiliser qu’une seule image de ma batterie et d’y écrire la figure entière : R1, R2, R3, L1, L2, L3, etc. J’ai suivi sa proposition, ce qui m’a fait économiser beaucoup de collage d’étiquettes. En étant la seule tablature pour batterie que j’ai rencontrée jusqu’à ce jour, ma notation s’est avérée extrêmement efficace. Mais, comme pour toutes tablatures, alors qu’elle indiquait les positions de mes mains sur les instruments, elle ne montrait que peu de choses concernant le rythme. Pour le moment, ce n’était pas un problème, car je ne jouais que des « croches » égales et régulières.
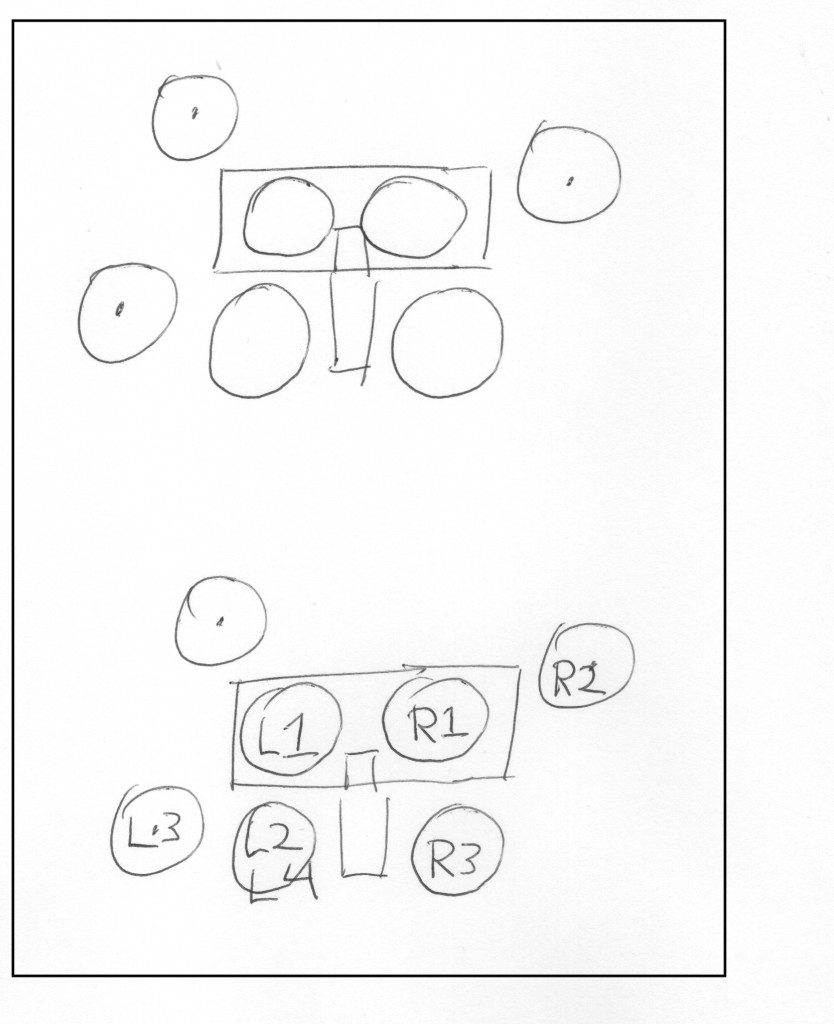
Quelques années après, j’ai commencé à développer une analogie de ce type de jeu en utilisant l’électronique, et j’ai aussi cherché à l’appliquer à différents contextes, allant des groupes d’improvisation libre à des collaborations africaines ; néanmoins, les changements que j’ai réalisés à cette technique ont été peu importants et graduels. Récemment, j’ai commencé à m’intéresser à pousser plus loin mes capacités à jouer la batterie de cette manière et à faire face aux défis techniques les plus extrêmes qui ont émergés peu de temps après que les applications faciles et sans problèmes aient été maîtrisés. J’ai commencé à altérer mes figures pour que mes pulsations de croches régulières soient interrompues ou changées, et je travaille actuellement sur les possibilités d’incorporer la notation rythmique dans ma tablature. J’ai aussi eu le désir d’inclure plus d’espace et de silences dans mes figures. Il s’est avéré assez difficile d’introduire des silences dans ce style : les membres sont en motion continuelle frappant les objets ; de leur donner l’instruction de s’arrêter à plusieurs endroits est un défi. Ma solution a été l’invention de ce que j’appelle « l’instrument de percussion sans son » ou bien le « bloc silencieux », un instrument construit pour ne produire que le minimum de son à l’impact. J’ai commencé avec un Jam Block, un temple block en plastique qui est fabriqué par la compagnie Latin Percussion et qui n’est relativement pas très cher ; il est très léger et comporte un mécanisme qui permet de l’attacher à la batterie ; sur le dessus sa surface est horizontale. J’ai ensuite cherché le type de mousse permettant de faire le strict minimum de son à la frappe de la baguette ; il fallait que ce soit suffisamment doux pour être quasi silencieux, mais suffisamment dur pour que je puisse ressentir l’impact quand je le jouerai. J’ai ensuite collé cette mousse sur la surface horizontale d’un Jam Block. Ça a marché. En plaçant plusieurs de ces blocs silencieux dans des positions stratégiques autour de ma batterie, j’ai pu incorporer des silences dans mon jeu tout en maintenant le ressenti de jouer des figures ininterrompues avec décontraction. En mars 2006, j’ai testé ce concept dans une séance d’enregistrement avec John Oswald, Henry Kaiser, Michael Snow et Casey Sokol à la Canadian Broadcasting Company à Toronto. Lors de cet enregistrement de musique improvisée libre, les micros étaient placés très près de ma batterie et de temps en temps je n’ai joué que de façon très espacée. Je savais déjà que mes Jam Blocks modifiés fonctionnaient convenablement quand je jouais fort et vite ; au milieu de tous les sons produits par les autres éléments de ma batterie, ils n’étaient pas perceptibles. Mais que se passerait-il si je jouais lentement et si les microphones n’étaient placés qu’à quelques centimètres des instruments – est-ce que le résultat serait un son ou une absence de son ? Il s’est avéré que même la résonance la plus discrète provenant d’autres parties de la batterie, et aussi les manifestations les plus pianissimo d’autres instruments couvraient suffisamment mes blocs silencieux pour les rendre non perceptibles. Mon invention avait passé l’épreuve de vérité.
Voici un exemple de polyrythmie par Lukas Ligeti sur la batterie.
La composition Groove Magic
A la fin de l’année 1992, j’ai obtenu ma première commande pour une composition, une pièce pour un petit ensemble de chambre pour être jouée par le London Sinfonietta lors d’un festival de musique contemporaine autrichienne à Londres en avril 1993. Après avoir écrit Pattern Transformation j’avais eu la chance de rencontrer le Amadinda Percussion Group, mais maintenant il s’agissait d’écrire pour des musiciens qui ne connaissaient pas les techniques des rythmes africains devenues pour moi si importantes. Pourtant, je voulais si possible utiliser des méthodes d’interactions dans un ensemble basées sur mes idées poly-métriques. Il m’a semblé que beaucoup de mes problèmes pourraient être résolus s’il était possible de « diriger » l’ensemble dans des tempos multiples mais en même temps synchronisés, ce qui semblait impossible à réaliser avec un seul chef d’orchestre, mais qui pourrait l’être en utilisant l’électronique. En tant que batteur, j’ai bien aimé jouer avec l’aide de pistes de clics (métronomes pré-enregistrés) dans les studios d’enregistrement ; peut-être était-il possible d’utiliser les pistes de clics multiples en concert. À peu près à ce moment-là, j’ai eu la chance de passer une journée au STEIM, un centre de recherche d’informatique musicale à Amsterdam et un de leurs programmes récemment développés s’appelait Polyrhythm. Ce programme avait été conçu pour le Den Haag Percussion Group pour les aider dans les passages rythmiquement complexes de la musique de Xenakis pendant les répétitions. Polyrhythm était à la base un séquenceur conçu exclusivement pour l’entrée de pistes métronomiques, chacune ayant sa propre mesure et son propre tempo, jusqu’au point de réaliser des niveaux de complexité invraisemblables, permettant des indications de mesure impossibles à noter d’une manière conventionnelle, des tempos déterminés à la décimale près et en particulier des changements illimités de tempo et de mesure sur une seule piste ; toutefois, chaque piste ne pouvait produire que deux sons, un pour le « 1 » de chaque mesure et un pour les autres temps. Polyrhythm n’avait pas été écrit pour n’importe quel système informatique, il avait été conçu pour Atari, l’ordinateur PC le plus populaire de l’époque. C’était exactement l’outil dont j’avais besoin, et l’idée de composer une pièce basée sur les capacités de ce logiciel – plutôt qu’une pièce pouvant idéalement être jouée sans son aide, pour laquelle le logiciel ne serait qu’une paire de béquilles – a été pour moi une source d’inspiration. J’ai acheté le programme malgré le fait que je ne possédais pas encore d’ordinateur, c’était au moment où j’ai commencé à travailler sur les percussions électroniques, et pour cela j’ai acheté un échantillonneur Akai S-1000, capable de mémoriser à peu près une demi-minute de son, c’était pas mal pour ce qu’on pouvait normalement trouver en 1992, et il disposait de huit sorties individuelles de son. J’ai conçu le système suivant :
- Ma pièce est prévue pour onze musiciens.
- Parfois, tous les musiciens peuvent jouer au même tempo, à d’autres moments les tempos vont diverger.
- On peut avoir onze tempos différents. Ou encore, tous les musiciens vont pouvoir jouer à la même vitesse, mais leurs rythmes pourront être décalés les uns par rapport aux autres par de petits incréments de temps.
- L’ordinateur va envoyer l’information à mon échantillonneur Akai, où chaque piste va être acheminée vers une sortie différente. Comme mon échantillonneur n’avait que huit sorties, il était nécessaire d’incorporer au système un deuxième échantillonneur pour prendre en charge les clics des trois musiciens qui restaient.
- Chaque musicien va suivre une piste de clics individuel dans un casque, mais tous les clics vont être toujours coordonnés avec précision, car ils seront joués par le logiciel Polyrhythm, qui va effectivement diriger l’ensemble.
- Des sorties d’échantillonneur, le son pouvait être envoyé aux casques portés par les musiciens.
L’idée d’avoir des musiciens jouant avec des casques pendant le concert provoque la controverse ; ils vont certainement se plaindre de ne pas pouvoir s’entendre eux-mêmes ou les uns par rapport aux autres et il y aura des problèmes de dynamiques, et d’intonation en particulier pour les cordes. Pour résoudre en partie ces problèmes, j’ai choisi des casques ouverts « type Walkman » et chaque musicien a eu à sa disposition un ampli individuel pour pouvoir régler individuellement le volume de leur casque. J’ai éventuellement pu trouver des petits amplis de casque à fixer à leurs vêtements, en leur donnant confortablement le contrôle du volume depuis leur placement dans l’espace. Et parce que chaque musicien avait une piste individuelle dans l’échantillonneur, il m’était possible de changer les sons de métronome par rapport aux préférences individuelles.
En écrivant la pièce, que j’ai appelée Groove Magic, j’ai choisi une notation proportionnelle, afin d’être capable de voir à tout moment comment les interactions entre différents musiciens se déroulaient exactement. Je ne suis pas le genre de compositeur capable d’écrire une pièce partie instrumentale par partie instrumentale. Lutosławski et bien d’autres ont été capables de le faire, mais c’est une approche qui m’est étrangère, car je porte toujours une extrême attention au son que va finalement produire la pièce. Je ne m’intéresse pas au hasard. Peut-être que cela vient du fait d’être un improvisateur ; bien sûr, l’improvisation est pour moi très éloignée du hasard ; elle est pourtant un exercice de perte de contrôle. J’aime l’improvisation, mais lorsque je compose, je veux exercer le maximum de contrôle ; je veux que ma musique sonne exactement comme je l’ai imaginée. Dans Groove Magic, j’étais intéressé par une coordination très exacte, une précision chirurgicale comme dans la musique pop. Mon approche était plus proche de Colin Nancarrow et j’avais à ma disposition l’ordinateur pour aider à réaliser les synchronisations strictes correspondant à mes désirs. Peu importe combien de tempos se superposaient simultanément, je gardais toujours la conscience de l’alignement des parties et j’avais exactement ces relations en considération pendant l’écriture de la composition. Et quand les musiciens se mettaient à jouer au même tempo, cela créait comme un « bang » supersonique – les parties tout à coup convergeaient sans latence ni hésitation.
Sans disposer d’un ordinateur, j’ai composé la pièce sur du papier. Ma notation m’a permis de suivre l’évolution de ce qui se passait d’une manière optique/acoustique, j’étais obligé de suivre mathématiquement la progression temporelle de chaque partie ; sinon je n’aurais jamais pu démêler le désordre et de remettre ensemble les parties. J’ai utilisé une calculette de poche et j’ai noté le temps accumulé de chaque partie dans la marge du papier à musique, une méthode un peu héritée de l’âge de pierre.

Extrait de la partition de Groove Magic de Lukas Ligeti
Cela a bien fonctionné, mais avant de savoir que tout allait bien, il y a eu une alerte. J’ai installé Polyrhythm sur l’Atari de mon ami Norbert Math et j’ai entré toutes les données. Mais quand j’ai rejoué les clics, les choses se sont rapidement mises à se désynchroniser.
Et il y avait un autre problème. Toutes les parties contenaient des silences à différents points dans la pièce. En même temps, j’avais à « composer en continu » [through compose] toutes les pistes de clics ; il n’y avait pas de moyen à ma disposition pour faire entrer une piste de clics au moment où j’en avait besoin après un silence. Mais je ne voulais pas que les métronomes continuent de produire des sons pendant les longues périodes de silence. Je ne voulais pas que mes instruments secrets contribuent à la pollution sonore. Ils devaient rester inaudibles pour les auditeurs ; seuls les musiciens, les initiés, les membres de la tribu en train d’exécuter le rituel, devaient être mis au courant des informations métronomiques, alors que le public ne devait entendre que la structure extérieure, la façade, et, tout en observant ce rituel étrange, pourrait se demander comment cette dualité de coordination exacte et de chaos apparent pouvait être réalisée. Malheureusement, Polyrhythm ne permettait pas de supprimer des clics et de les faire réapparaître ; il fallait qu’ils soient constamment présents.
Norbert et moi, nous nous sommes procuré un des premiers modèles de Apple PowerBook fonctionnant avec le logiciel séquenceur Cubase. Construire des pistes de rythme aussi complexes que celles que j’avais composées serait très difficile à réaliser avec un logiciel séquenceur du 21ème siècle, mais c’était quelque chose de tout à fait impossible dans la version de Cubase en 1992. Par contre, le processeur du Mac était beaucoup plus robuste que celui du Atari. Nous avons joué les onze pistes sur Atari, l’une après l’autre, en enregistrant chacune sur le Macintosh. Quand toutes les pistes ont été enregistrées, nous avons essayé de les jouer sur Cubase et nous avons été rassurés de constater que tout maintenant s’alignait exactement comme cela avait été prévu. Et maintenant il était facile de rendre silencieuses les informations des clics inutiles, car chaque pulsation du métronome constituait une donnée séparée sur Cubase et pouvait être éditée individuellement. Chaque musicien recevrait deux mesures de préparation avant de commencer à jouer. A la fin d’un passage, quand le musicien avait un silence, les clics s’arrêtaient pour ne recommencer que deux mesures avant la prochaine entrée pour lui laisser un temps de préparation. De cette manière les musiciens n’avaient à se concentrer que lorsqu’ils avaient à jouer ; il ne leur était pas nécessaire de compter les mesures pendant les longs intervalles de silence.
Au fil des nombreuses performances qui ont eu lieu, mon installation de pistes de clics s’est avérée très robuste. On m’a souvent demandé pourquoi je n’avais pas enregistré les clics sur une bande multipiste. Je n’ai jamais été attiré par la musique sur bande où il y a un élément d’interaction qui manque, même dans le cas d’un « chef d’orchestre secret » : en utilisant un ordinateur, les sonorités peuvent être changées, le tempo peut être ajusté pendant les répétitions, etc. La flexibilité dans le travail est juste beaucoup plus grande ; la mince possibilité que l’ordinateur se plante pendant l’exécution est un risque que je suis prêt à accepter.
Groove Magic a obtenu un grand succès, et je n’ai pas reçu de la part des musiciens de plaintes concernant le jeu avec des casques. Pourtant j’ai souvent entendu la phrase « C’est une très bonne pièce. Cela me ferait plaisir si vous étiez disposé à composer quelque chose pour moi ou pour mon groupe. Mais s’il vous plaît, pas de piste de clics ». Et mon jeu polyrythmique sur la batterie n’était pas facile à intégrer dans des situations qui demandaient au final des formes plus conventionnelles de groove. Peu à peu, mais sûrement, j’ai décidé qu’il me fallait créer mon propre groupe pour pouvoir continuer à développer ces approches. Aujourd’hui en 2007, habitant à New York, un endroit plein de musiciens ouverts aux nouvelles idées, le moment est enfin venu pour les réaliser. Mais entretemps ma vie a pris d’autres directions, me permettant de continuer mon parcours de découvertes des poly-métriques dans des manières que je n’avais pas anticipées.
Voyage en Côte d’Ivoire
L’Afrique m’appelait. Bernd Pirrung, le directeur du Goethe Institute à Abidjan en Côte d’Ivoire, avait publié un appel à la scène locale, invitant les musiciens à venir à mon atelier, 150 musiciens sont venus le premier jour ; cela rendait impossible pour Kurt et moi de travailler avec autant de monde ! Alors nous avons décidé de jouer quelques pièces en duo pour les faire entendre aux musiciens locaux – nos pièces sonores les plus étranges et les plus inaccessibles. La stratégie a fonctionné : le lendemain matin, quinze personnes sont venues pour travailler avec nous. Les objectifs de notre atelier n’étaient pas clairement articulés, mais j’ai insisté qu’il fallait qu’il y ait un concert à la fin ; je voulais mettre la pression pour la réalisation d’un résultat tangible. Pendant les premiers jours de l’atelier, il est apparu que cet objectif serait difficile à réaliser.
La plupart des gens qui viennent à Abidjan soit adorent cette ville ou la détestent. À part Lagos, Abidjan est la plus grande ville de l’Afrique de l’Ouest, et beaucoup de gens pensent naïvement que l’Afrique a quelque chose à voir avec la ruralité. Depuis l’indépendance jusqu’aux années 1990, la Côte d’Ivoire a été un des pays les plus stables et les plus développés d’Afrique, grâce en partie à Félix Houphouët Boigny qui a été pendant très longtemps le président du pays (jusqu’en 1993), en plaçant l’importance de l’économie sur l’agriculture plutôt que sur l’industrie, au moins jusqu’à ce que les prix des marchés pour les produits importants du pays – cacao, café et huile de palme – commencent à s’écrouler dans les années 1980. La Côte d’Ivoire certainement n’a pas été un modèle de démocratie – Houphouët était une sorte de dictateur bienveillant – mais l’atmosphère était remarquablement libre. Les relations avec la France et l’Occident sont restées toujours positives – pas de tâtonnement ruineux dans le marxisme ici, et pas de nationalisme romantique qui a causé des décades de misère au Ghana, Guinée et autres états voisins. La Côte d’Ivoire a été « mondialisée » avant l’existence de la mondialisation. Tout le monde était le bienvenu pour s’y installer ; les permis de résidence n’étaient pas nécessaires. (Cela s’est terminé, hélas, pendant les dernières années du règne de Houphouët, ouvrant la voie à un processus graduel sur la pente glissante qui a mené au chaos politique et l’impasse au bord de la guerre civile à partir de 1999, et qui n’a pas trouvé encore de solution.) Mais durant « l’âge d’or » du pays, il y a eu même une période où les résidents étrangers pouvaient voter aux élections locales – une idée novatrice à l’époque. L’économie de la Côte d’Ivoire a beaucoup bénéficié de cette ouverture et des gens originaires toute l’Afrique de l’Ouest sont venus s’y installer. Pendant les années 1990, peut-être jusqu’à vingt pour cent de tous les citoyens du Burkina Faso ont vécu en Côte d’Ivoire – Burkina était par rapport à la Côte d’Ivoire ce que le Mexique est par rapport aux Etats-Unis – et les communautés de maliens, guinéens et sénégalais étaient de taille extrêmement significative. Il faut additionner à cela les réfugiés libériens, plus de 100.000 libanais (qui sont pour l’Afrique de l’Ouest ce que les indiens sont pour l’Afrique de l’Est, en contrôlant la plupart du commerce depuis de longues années), des dizaines de milliers de français, un communauté visible de chinois et de vietnamiens et beaucoup d’autres, ce n’est donc pas une surprise si Abidjan était considérée comme le « Paris de l’Afrique » – bien que pour moi elle m’a toujours semblé plutôt comme le New York d’Afrique. Plateau, le district administratif du centre de la ville, comporte des gratte-ciels et est situé sur une péninsule étroite, un peu comme Manhattan ; en tant que ville portuaire importante (avec obligatoirement les zones de chargements des cargos, les marins et le commerce de la drogue), Abidjan est partout entourée d’eau, mais elle est construite autour d’un lagon ; comme à New York, l’Océan Atlantique est présent mais souvent oublié dans la périphérie. La comparaison avec les Etats-Unis peut être poussée plus loin. Il y a à peu près 400 ans, très peu de gens vivaient dans ce qu’est la Côte d’Ivoire. Puis, graduellement, les populations ont commencé à migrer en provenance des régions voisines – les Akan de l’est (Ghana), les Kru de l’ouest (Liberia), les tribus Mandingues et Voltaïques du nord. La Côte d’Ivoire n’a pas de majorité ethnique et se promener autour d’Abidjan est un moyen excellent pour faire l’expérience des traditions des différentes populations du pays, et aussi de celles de l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble. Mais c’est aussi un endroit très large, très chaotique, qui a construit beaucoup d’infrastructures technologiques par rapport à ce qu’on peut trouver en Afrique de l’Ouest (dans tous mes pérégrinations, je n’ai jamais rencontré une autre région qui manquait autant d’infrastructures que l’Afrique de l’Ouest), ce qui amène certains occidentaux à se plaindre que ce n’est pas « réellement » l’Afrique. Je trouve cette attitude condescendante. Si on vient en Afrique à la recherche des huttes traditionnelles, il n’y a pas de problème – on les trouvera dans les campagnes. Mais les africains ne sont pas différents d’autres peuples de monde entier ; ils veulent bien vivre, ils veulent avoir leur confort, ils veulent posséder des cassettes vidéo. De prétendre qu’un foyer à Abidjan est moins authentique parce qu’il y a une cassette vidéo dans la pièce de séjour est, en ce qui me concerne, franchement déplaisant.
Tout aussi déplaisant est le fait que beaucoup de fans de musique africaine qui lui sont « extérieurs » s’attendent à entendre quelque chose « d’authentique ». Qu’est-ce qui est authentique après tout ? J’ai un grand respect pour le travail des ethnomusicologues – après tout, la majeure partie de mon château de cartes est basée là-dessus. Pourtant les traditions émergent pour disparaître après un temps, en laissant la place à d’autres traditions nouvelles. Parler de musique traditionnelle ne me paraît pas particulièrement satisfaisant ; en l’absence d’un meilleur terme, je le fais malgré tout, et quand je le fais, je veux dire qu’il s’agit de musiciens dont la conception du monde et de ce qu’est la musique sont suffisamment enracinées dans une certaine tradition pour qu’ils puissent être identifiés comme faisant partie de cette culture en particulier. Cela ne veut pourtant pas dire qu’ils doivent se sentir nécessairement responsables de la protection de ces traditions contre les « attaques » des cultures « étrangères », ou qu’ils aient l’obligation de se confiner dans des formes d’expression déjà présentes dans leur environnement culturel. De plus, je ne crois pas non plus à l’affirmation d’un contexte culturel basé sur des origines ancestrales. Je n’ai jamais compris la phrase « ma propre culture ». Je suis le fils de Juifs hongrois qui, après avoir été presque tous tués par Hitler et Staline, ont émigrés vers l’Autriche. J’ai eu une éducation très internationale, j’ai fait mes études dans des écoles internationales, et maintenant je vis aux Etats-Unis. Je peux avec fierté dire que je n’ai pas « ma propre culture ». Même si mon cas est extrême, la pureté des cultures n’existe pas, et ceux qui ressentent que leur ethnicité ou leur lieu de naissance leur donne la « possession » d’une certaine culture devraient être bien avisés de considérer ce que cette fausse fierté et étroitesse d’esprit ont produit dans le passé historique. J’ai rencontré des Africains qui n’ont aucune idée de l’histoire de l’Afrique ; des Européens que n’ont aucune idée de ce qu’est l’Europe ; des Africains qui sont des experts accomplis dans, disons, la littérature italienne, et des Américains qui savent tout sur le Japon mais rien sur le football. La culture n’est pas dans votre sang, elle est située dans votre esprit et dans vos pensées, et chaque individu possède ses propres pensées et sa propre façon de comprendre le monde. Regrouper les gens par rapport à des caractéristiques superficielles n’a pas de sens. Il n’existe pas de majorité dans le monde ; chacun d’entre nous constitue une minorité d’une seule personne.
En tant que nouvel arrivant en Afrique, ne venant pas pour apprendre la musique de mes collègues ni de les convaincre d’apprendre la mienne, la question principale que je me suis posée était : Qu’est-on capable de créer, qu’est-on capable d’apprendre en mettant en commun nos pensées ? Qu’est-on capable, en tant que groupe d’individus, chacun/chacune ayant sa propre connaissance contextuelle de base, d’apprendre mutuellement les uns des autres, et comment pourrait-on être amené à puiser dans nos réservoirs intellectuels créatifs ? Évidemment, pour qu’une telle collaboration soit couronnée de succès, il faut que la composition du groupe soit appropriée. De réduire le groupe de participants en jouant de la musique inaccessible s’est avérée une approche utile ; ceux qui n’avaient pas l’ouverture d’esprit pour se confronter à quelque chose de nouveau se sont simplement évaporés. Les musiciens qui sont restés étaient motivés d’une manière ou d’une autre ; ils étaient curieux et n’avaient pas peur.
L’ensemble Beta Foly
Quels étaient les points communs entre ces musiciens ? D’une certaine manière, je dirais, assez peu. Ils étaient originaires de toute l’Afrique de l’Ouest. Certains jouaient pendant les mariages ou les cérémonies de circoncision dans leur communauté ; d’autres travaillaient dans les clubs de la ville où était à l’ordre du jour une forme commerciale de jazz-funk/fusion ; d’autres travaillaient dans les théâtres ou étaient déterminés à jouer leur propre musique, enracinée dans les traditions locales, mais ouverte à n’importe quelle influence. Sans surprise, il y avait autant de langues maternelles qu’il y avait de musiciens. Le dioula, une langue mandingue utilisée surtout dans le commerce, est la lingua franca de cette région africaine, mais finalement, la langue choisie était celle en usage à Abidjan : le français avec une certaine dose de dioula, plus à l’occasion des mots en wolof, malinké, balante, peul, crioulo, moré, baoulé, agni, etc. Beaucoup de participants appartenaient à de longues lignées de musiciens/conteurs, appelés griots ou djeliw en langue mandingue. Aucun d’eux n’avait passé beaucoup d’années à l’école, certains étaient complétement illettrés, alors que quelques-uns pouvaient lire et écrire correctement en français ; d’autres en étaient incapables, mais ils lisaient le Coran en arabe.
Rétrospectivement, et après avoir travaillé sur d’autres projets d’échanges culturels, je peux dire que ce groupe, qui à part quelques changements mineurs est devenu l’ensemble Beta Foly pendant les six années qui ont suivies, a été le résultat d’un très heureux concours de circonstances. C’étaient des musiciens accomplis dont la mission n’était pas de défendre « leur » culture contre les intrus venant de l’extérieur, mais de se confronter aux situations telles qu’elles se présentaient et d’essayer d’en tirer le meilleur de manière créative ; d’essayer tout ce qui se présentait, sans jamais perdre leurs identités. En 2000, j’ai composé une pièce pour des musiciens basés à Miami originaires de différentes îles des Caraïbes, et alors que cela a été une collaboration intéressante, j’ai ressenti une certaine rigidité et un certain degré de méfiance que j’ai attribué éventuellement à ce que j’appellerais le « syndrome de double diaspora ». Pour une grande partie, la culture des Caraïbes est basée sur des racines africaines, donc dans une certaine mesure, la musique cubaine, par exemple, est déjà la musique d’une diaspora. Par la suite, ces musiciens se sont retrouvés à Miami, avec la fonction principale de divertir une communauté d’autres personnes déplacées qui avaient la nostalgie de leur pays d’origine. Leurs missions étaient de rester simples et de cultiver leurs racines. L’apparition soudaine d’un personnage cosmopolite sans racines dont le rôle officiel était de mélanger les choses a été accueillie avec réserves et hésitations.
Cela n’a pas été le cas à Abidjan. Mais tandis que j’avais fortement envie d’interagir avec ces musiciens, il fallait auparavant développer quelque chose d’autre : dégager un consensus chez les musiciens africains. Au début, on a essayé de jouer un peu ensemble. On a improvisé et on s’est retrouvé à jouer un genre de rock « world music/ethno ». C’était sympa de faire ce genre de choses ; beaucoup de projets d’échanges prennent le chemin du plus petit dénominateur commun. Cela m’a paru superficiel, j’ai donc encouragé les musiciens à jouer ensemble et je me suis retiré dans une position d’observateur pour qu’ils ne se sentent pas obligés de me prendre en compte. Les musiciens partageaient une certaine approche de la musique, et même quelques mélodies, des chansons en commun, pourtant leurs intérêts et leurs priorités étaient différents, et il y avait des points d’achoppement – par exemple, l’accord de leurs instruments semblait de temps en temps incompatible. J’ai posé des questions, à la fois pour mieux comprendre et pour éviter que les choses ne s’installent dans le confort. Je leur ai demandé de répéter des sections pour que je puisse voir comment leurs parties s’entrelaçaient et comment ils s’y prenaient pour jouer leurs instruments. Je les ai aussi un peu provoqués. Il y avait deux joueurs de balafon (marimba traditionnel) dans l’atelier, Kaba Kouyaté de la Guinée-Conakry et Aly Keïta du sud du Mali ; leurs instruments étaient accordés différemment, en forçant l’un ou l’autre à ne pas jouer pendant la durée d’une pièce en particulier. Je les ai persuadés à jouer ensemble pour voir si, à travers le conflit de leurs accords, de nouvelles harmonies, de nouvelles compatibilités pouvaient se manifester. Après quelques jours, une dynamique de groupe a commencé à émerger parmi les musiciens et j’ai développé des idées de pièces et de manières de pouvoir m’intégrer à l’ensemble. En à peu près huit jours de travail intensif, nous avons composé et répété un répertoire collaboratif et nous l’avons présenté dans un concert devant un public nombreux qui s’est fort bien passé. Après cela, nous savions tous qu’on voulait continuer ; un ensemble s’est formé et il avait déjà un nom : Beta Foly, ce qui veut dire en malinké « la musique de chacun d’entre nous ». Au moment où j’ai quitté Abidjan, j’ai senti que j’avais trouvé un lieu d’accueil, avec une communauté de personnes avec qui on pouvait travailler et où on pouvait produire beaucoup de musique intéressante.
Voici un exemple d’une performance de Beta Foly:
Le CD Lukas Ligeti & Beta Foly
Je suis retourné à Abidjan l’année d’après pour enregistrer une cassette de démonstration ; en 1996 nous avons enregistré le CD Lukas Ligeti & Beta Foly. Sorti en 1997 par le label allemand Intuition Music, notre CD comportait des contributions compositionnelles de beaucoup de membres du groupe, et c’était essentiellement une compilation d’expérimentations que nous avions menées pour combiner les pratiques musicales africaines et occidentales.
Voici un premier exemple (audio) extrait du CD, Le Chant de tout le monde:
On a utilisé l’ordinateur comme outil de composition, car nous n’avions pas de notation ou de tradition commune pour construire quelque chose de tangible. Les instruments électroniques – en ce qui me concerne, le système de contrôle de percussion DrumKat, et dans celui du Pyrolator, les instruments construits par Don Buchla Thunder and Lightning – ont été utilisés à la fois dans les enregistrements et pendant les concerts. Certaines de mes pièces (Adjamé 220, Guinée imaginaire) ont été presque complètement écrites sur partition ; dans d’autres pièces, je n’avais donné qu’un concept de base.
Voici la pièce Guinée imaginaire :
L’escalier du temps et Langage en dessin étaient des improvisations poly-métriques dans lesquelles j’avais enregistré une partie de batterie dans mon style basé sur le mouvement avant que les autres musiciens contribuent leurs improvisations dans les prises suivantes de l’enregistrement. À cause de l’étroitesse du studio et le peu de microphones à disposition, la totalité de l’album a dû être réalisé par enregistrements en différé [overdubbing] avec pas plus de trois musiciens jouant en même temps. Langage en dessin a été enregistré en utilisant une piste de clics d’une manière similaire à celle utilisée dans Groove Magic ; j’avais introduit cette méthode pendant l’atelier initial à Abidjan. Dans beaucoup de cas, la musique africaine est basée sur le fait que les parties individuelles sont interactives et imbriquées ; c’est parfois difficile pour les musiciens de jouer leur partie de manière isolée. Parce que de jouer avec des écouteurs crée un certain isolement par rapport aux autres musiciens, cette méthode pouvait être perçue comme contrintuitive dans un contexte africain. J’étais curieux de voir ce qui allait se passer. J’ai commencé par donner à un ensemble de six musiciens une structure poly-métrique avec six pistes de clics différentes, mais les musiciens ont ignoré les clics et se sont retrouvés à produire un rythme commun en jouant ensemble. Je leur ai demandé de porter plus leur attention sur les clics, ils ont alors joué en s’isolant totalement les uns des autres, en écoutant seulement l’information secrète.
Voici un exemple d’un jeu avec des casques et la diffusion des pistes de clics:
Je leur ai alors demandé de trouver un compromis entre les deux extrêmes, et cela a fonctionné presque immédiatement. Les musiciens sont rapidement devenus très créatifs dans la façon de s’écouter mutuellement, mais en adhérant en même temps de manière élastique aux clics. J’ai aussi utilisé d’autres informations dans ce qui était diffusé dans les écouteurs, comme la parole. Par exemple, nous avons créé des structures de hoquet en utilisant le mot parlé comme « piste de clics », chaque syllabe constituant une « unité de pulsation ». Cela a produit des sons incroyablement irréguliers et étranges, et cela a été un travail très amusant à faire. J’ai par la suite développé cette approche avec d’autres groupes d’improvisation. Dans les pièces déterminées par la batterie poly-métrique sur le CD, j’ai demandé aux musiciens de se concentrer sur un élément de ma batterie et de construire les rythmes à partir de cet élément. Par exemple, Amadou Leye M’Baye, le joueur de sabar (tambour sénégalais), a pu se baser sur ma cymbale ride pour dériver un rythme et un tempo à partir de cette information, alors que le joueur de djembé Lassiné Koné s’est basé sur ma caisse claire et Tiémoko Kanté a joué son bolon (un instrument grave à cordes pincées liée à la kora) en s’accordant sur ma grosse caisse. De temps en temps je changeais de rythme, mettant les musiciens dans le chaos jusqu’à ce qu’ils réorientent leur jeu. Dans Sound of No Restraint, au contraire, nous avons essayé d’adapter l’approche des musiciens coréens à notre environnement africain. Nous avons écouté des enregistrements de p’ansori et d’autres musiques coréennes et on s’est inspiré de la flexibilité de tempo, en utilisant le souffle comme fondation plutôt que la pulsation strictement régulière. La majorité de la pièce a été improvisée librement, mais de temps en temps, chaque instrumentiste recevait le signal de six clics dans ses écouteurs ; sur le sixième clic ils avaient à jouer un accent fort suivi de quelques secondes de silence. Les différents exécutants pouvaient avoir à jouer leurs accents à différents moments, mais parfois la totalité du groupe les jouaient tous en même temps. Le résultat n’avait rien à voir avec de la musique coréenne, mais pas non plus avec quelque chose de connu dans la musique africaine.
Dans une autre pièce, Balarama, j’ai déjà mentionné la possibilité d’utiliser l’incompatibilité entre les deux balafons comme ligne directrice. J’ai échantillonné les deux instruments et j’ai désaccordé ces enregistrements de différentes façons. En jouant mes tambours électroniques, j’ai déclenché les sons de balafons et petit à petit, j’ai fait en sorte que leurs accords convergent sur une période de cinq minutes. Même quand ils étaient ajustés sur le même accord, une différence de timbre subsistait entre les deux échantillons de balafons. J’ai joué cette pièce en duo avec Aly Keïta, avec son balafon réel dont l’accord était bien évidemment stable. Les tensions causées par les différences d’intonation ont créé des possibilités harmoniques intéressantes. Par ailleurs, Pyrolator a joué un autre duo avec Aly sous le titre de Brontologik 3.44. Basé sur un synthétiseur qu’il avait aidé à créer quelques années auparavant, il a écrit un programme dans le langage d’ordinateur Max. Aly jouait son balafon ; un microphone l’enregistrait et entrait les sons dans l’ordinateur qui les analysait et les faisait correspondre aux hauteurs d’Aly. Sur la base des données ainsi générées, l’ordinateur composait des mélodies, en accompagnant Aly avec un son de piano dans une réponse différée [delayed response]. Pour African Loops, Pyrolator et moi-même ont échantillonné tous les musiciens jouant ou chantant des phrases courtes ; Pyrolator a ensuite assemblé ces fragments enregistrés et a composé une pièce dans le style de musique de danse électronique (techno ? house ?). Yero Bobo Bah, un chanteur, danseur et percussionniste guinéen a ajouté à cela une partie vocale. African Loops a été peut-être le premier essai de fusion entre la musique traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest avec la musique électronique club/danse ; ces dernières années, ce type de fusion est devenu assez populaire, en particulier au Mali et mon groupe actuel, Burkina Electric, fait aussi partie de ce mouvement.
Ces approches expérimentales se démarquent des pièces comme Tras di sol de Lamine Baldé, un exemple typique de musique d’auteur-compositeur-chanteur de la Guinée-Bissau, ou bien René de Tiémoko et Bobo accompagnés du flûtiste guinéen Babagalé Kanté dans un style traditionnel du plateau Fouta Djalon de la Guinée. Mais l’atmosphère n’a jamais été complètement traditionnelle, car il y a toujours eu quelque chose de l’ordre de la mise en jeu expérimentale – ne serait-ce qu’un solo présentant une version inhabituelle de la mélodie du morceau.
Voyage au Zimbabwe et en Mozambique
Beta Foly est venu en tournée en Europe chaque année entre 1996 et 1999 ; depuis, le groupe a été mis « en veilleuse » – une tournée avec un ensemble aussi grand coûte beaucoup d’argent ; la situation politique qui s’est détériorée en Côte d’Ivoire n’a pas arrangé les choses. Mais l’Afrique est restée une dimension importante de ma vie musicale. En 1997, j’ai participé à un projet au Zimbabwe et j’ai rencontré des musiciens de la tribu des Batonga vivant près du lac Kariba. Leur musique « Ngoma Buntibe », à l’origine utilisée dans les cérémonies d’enterrement, est joué par un grand ensemble de cornes et de tambours ; chaque corne contribue une seule hauteur à la fabrique de la musique et les arrangements contiennent des hoquets incroyablement complexes. Alors que cette approche existe dans plusieurs cultures de l’Afrique centrale et du sud, l’écoute de Ngoma Buntibe s’avère être la source de confusions particulièrement décourageantes, et cette musique n’a pas été documentée ou analysée par les musicologues. Le compositeur zimbabwéen Keith Goddard a trouvé que cette musique faisait penser à la musique classique d’avant-garde de l’Europe des années 1950 et suivantes ; en même temps la musique, bien qu’elle soit totalement déterminée, donne l’impression de liberté et évoque des images du free jazz. Mon court séjour chez les Tonga ne m’a pas permis de comprendre la structure de cette musique, mais j’ai pu avoir accès à une idée importante : que la possibilité de danser sur une musique dépend de l’environnement culturel du danseur. Les villageois n’avaient pas de problème pour danser sur le Ngoma Buntibe, alors que moi-même j’en étais incapable. Je pouvais suivre les parties individuelles des tambours, mais savoir comment ils fonctionnaient ensemble, surtout savoir comment identifier une quelconque régularité métrique, restait pour moi un mystère. Je pense que, pour pouvoir danser sur une musique, on doit pouvoir identifier les sons ou les parties – les tambours ou n’importe quoi d’autre – qui constituent l’ossature du rythme. À peu près toutes les musiques peuvent être dansées, à condition d’avoir la clé de son « code secret ». On pourrait même inclure les musiques non-métriques, si l’on disposait d’une connexion câblée avec la tête de leurs concepteurs ! Après tout, la grande majorité de la musique est produite par des mouvements ; même les doigts d’un hautboïste qui joue rubato constituent un type de danse.
Mon voyage au Zimbabwe m’a conduit à faire un bref séjour au Mozambique, où j’ai eu la chance d’entendre le virtuose du timbila Chopi (marimba) Venancio Mbande qui jouait avec son ensemble (plus d’une douzaine de timbilas de tailles différentes) dans sa résidence. Mon imagination mélodique s’est beaucoup inspirée de la musique du peuple Mandé depuis ma première visite à Abidjan ; dès lors la musique Chopi venait s’y joindre, qui malgré le fait d’être complètement différente, m’a aussi procuré beaucoup d’émotions. Beaucoup de mes compositions jusqu’à aujourd’hui ont été influencées par cette musique. En 1999, j’ai eu le privilège de passer plusieurs semaines au Caire, en Égypte, pour collaborer avec des musiciens de l’orchestre de l’Opéra et avec des musiciens traditionnels nubiens, ce qui m’a fait découvrir la musique de la région où l’Afrique et l’Arabie se rencontrent.
Burkina Faso
À peu près à la même époque, Beta Foly est allé à Ouagadougou, Burkina Faso, pour donner quelques concerts. Plusieurs membres du groupe étaient originaires du Burkina et Maï Lingani, une chanteuse qui avait participé à notre enregistrement CD, y vivait alors. À Ouaga, j’ai trouvé une scène musicale extrêmement vivante, avec des groupes jouant dans des clubs en plein air au milieu de la nuit. Ils semblaient tous jouer un répertoire similaire de standards pop africains mélangés avec des éléments de pop et de jazz américains. Allongé sur mon lit à 3 heures du matin dans le centre de la ville, je pouvais entendre quatre groupes jouant à quatre différents endroits, provenant de quatre différentes directions par rapport à moi, jouant When the Saints Come Marching In dans quatre tonalités différentes, dans quatre tempos différents. Il suffisait de marcher autour d’Ouaga avec un microphone la nuit pendant le weekend pour être capable de créer de manière effective une pièce d’art sonore magnifique. Maï avait fait beaucoup de progrès en tant que chanteuse pendant les deux années depuis que je l’avais vue la dernière fois à Abidjan ; elle s’était installée à Ouaga et avait reçu le prix de musique le plus important du pays. Par la suite, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets, dont son premier album solo, Entrons dans la danse, des duos voix et électronique et même un concert ensemble par l’entremise d’une ligne téléphonique avec elle au Burkina et moi en Autriche. Pour certaines personnes qui ne sont pas allées en Afrique de l’Ouest, dans cette partie du monde il y a un manque d’infrastructures difficile à imaginer, alors que d’autres présument que les conditions y sont totalement primitives. Ni dans l’un, ni dans l’autre ce n’est le cas. Il est tout à fait possible de travailler avec la technologie en Afrique, même si c’est toujours une aventure. Je suis fasciné par la possibilité de travailler dans le domaine de la musique électronique en Afrique, car je vois que la culture africaine présente de nombreux aspects qui la rendent particulièrement adaptée à l’expérimentation électronique.
Lors des deux ou trois dernières années, depuis qu’une ONG autrichienne m’a demandé de « donner des concerts avec des musiciens du Burkina Faso avec de l’électronique », le groupe Burkina Electric est devenu mon projet principal dans le domaine de ce qui relève de l’Afrique. J’ai invité à me joindre Maï, le guitariste burkinabé Wende K. Blass, Pyrolator et le compositeur autrichien Rupert Huber, bien connu pour être une des moitiés du duo Tosca de la scène downtempo electronica à Vienne. Burkina Electric a continué ce qui avait été commencé des années auparavant avec African Loops – de la musique électronique de dance club, en relation avec la culture occidentale des DJs, mais utilisant des éléments de la musique traditionnelle, dans ce cas-ci du Burkina Faso. Le groupe est composé de voix, guitare, batterie et électronique ; un danseur de Ouaga, As Zoko, s’est aussi joint à notre groupe, et aussi un deuxième danseur et un chanteur de soutien. Notre musique, composée en collaboration, inclut des sons de nombreux instruments traditionnels, mais seulement dans leur version échantillonnée, et toujours traités et transformés de manières inhabituelles. On a utilisé des paysages sonores enregistrés au Burkina ; en fait, beaucoup de nos pièces ont leur origine dans des enregistrements réalisés en marchant dans Ouaga. Nos pièces sont ancrées soit dans des rythmes traditionnels du Burkina, ou des rythmes de notre propre invention, inspiré par ces traditions. Des rythmes tels que le waraba ou l’ouennenga, des traditions du peuple Mossi, sont relativement simples, pourtant ils sont sans aucun doute extérieurs à ce qui est considéré comme « dansable » dans l’environnement d’un club occidental. On espère donner aux auditeurs le « code secret » nécessaire à susciter la danse sur ces rythmes ; les danseurs peuvent aider dans les présentations publiques. Notre expérience a été que les auditeurs sont peut-être confus au départ ; après vingt minutes ils se lèvent et se mettent à danser. La chose la plus significative au sujet de certains de ces rythmes que nous avons utilisés c’est qu’ils peuvent être perçus à la fois à deux et trois temps, ce qui est le cas de beaucoup de rythmes africains. Dès que cette dualité est acceptée et la simultanéité est ressentie d’une manière physique et viscérale, se mettre à danser n’est plus un problème. Alors que ces rythmes marquent un « temps fort » évident de temps en temps, il y a encore une très grande liberté dans la manière de les percevoir, et d’en profiter. Je joue la batterie et le Marimba Lumina, un instrument de percussion conçu par Buchla similaire à un marimba électronique ; Pyrolator de nouveaux jouait sur Lightning. Toutes nos pièces contenaient beaucoup de liberté pour improviser ; en concert, on a surtout utilisé le logiciel Ableton Live, qui permet de beaucoup modifier les pièces d’une performance à une autre. Pyrolator avait écrit un logiciel en langage d’ordinateur Max/MSP’s Jitter pour pouvoir manipuler les vidéos qu’on avait filmées au Burkina Faso. Bien que Burkina Electric soit clairement un groupe pop, on a essayé de développer nos propres valeurs de production en combinant les esthétiques de la musique traditionnelle africaine avec une approche assez expérimentale de la pop électronique.
La batterie et les moyens électroniques –
La musique électronique et l’Afrique
Beaucoup de ces mêmes idées ont été incorporées parallèlement à ma façon de jouer en solo avec des moyens électroniques. En utilisant l’électronique, je voulais préserver l’idée de jouer de la percussion. La préoccupation principale du batteur est d’initialiser des sons ; ensuite ils tendent à s’estomper rapidement, donc savoir comment les terminer n’est pas normalement un souci. Avec l’électronique, cela peut être assez différent ; une des nombreuses questions que je me suis posé, à peu près à la même époque de mon premier voyage en Afrique, était de savoir dans quelle mesure ma technique allait évoluer. Le DrumKat avait été conçu plus ou moins pour reproduire la batterie standard. Ce n’était pas du tout ce que je voulais faire, mais l’instrument s’est avéré pourtant très utile. Beaucoup de mon travail initial sur la percussion électronique s’est basé sur une expansion de mes figures de mouvement sur la batterie, allant vers ce que je ne pouvais pas faire avec une batterie normale. Je pouvais programmer un des pads du DrumKat de manière à ce qu’un son différent puisse être déclenché chaque fois que je le frappais. En utilisant des figures similaires à celles que j’utilisais sur la batterie, j’étais bientôt en mesure de créer des structures qui allaient prendre des milliers de pulsations avant de se retrouver au début du cycle. En effet, il y avait une pièce dans mon répertoire qui aurait nécessité un cycle de 75.000 années ! Un désir de pouvoir improviser plus de manière mélodique m’a conduit, en 2005, à me concentrer sur le Marimba Lumina comme axe électronique principal de ma recherche. Il s’agit d’un instrument extrêmement sophistiqué qui permet une grande flexibilité de programmation. Par exemple, il est joué avec quatre baguettes codées dans des couleurs différentes et l’instrument reconnait quelle baguette est en train de frapper, donc il est possible de le programmer complètement différemment en fonction de quelle baguette est utilisée. Mon premier concert avec le Lumina a eu lieu en septembre 2005 au Festival Unyazi à Johannesburg, Afrique du Sud, le tout premier festival de musique électronique expérimentale sur le continent africain. En 2006, j’ai eu la possibilité de passer plus de temps à travailler à Johannesburg et j’ai apprécié son atmosphère particulière, qui simultanément est ressentie comme un mélange d’Atlanta et de Lagos et cela m’a incité de me demander pourquoi je suis autant attiré par la combinaison de la musique africaine et celle produite avec les moyens électroniques.
Dans beaucoup de langues africaines, les mots de « jouer » et « danser » de la musique sont identiques. La musique électronique a introduit une séparation sans précédent entre le geste et le son dans la pratique musicale ; les auditeurs ne peuvent plus suivre la plus grande partie des gestes des interprètes de la musique électronique, sans parler de la difficulté de les connecter avec les sons qu’ils entendent. Pourtant je pense que la musique électronique vivante possède un immense potentiel par son utilisation dans la musique vivante de la totalité des sens kinétiques et l’Afrique devrait être un terrain fertile dans ces perspectives. La musique en Afrique n’est pas enseignée exclusivement à travers les sons, mais aussi par les mouvements du corps. Les musiciens traditionnels africains pourraient trouver de nouvelles manières de jouer la musique électronique sur scène, et en le faisant, de trouver des moyens de rendre la musique électronique bien plus intéressante pour le public du spectacle vivant. Tout aussi remarquable est le lien qui existe en Afrique entre la musique et la langue, les inflexions rythmiques et tonales de la poésie étant incorporées dans de nombreuses mélodies, comme le décrit l’exemple ci-dessus de la musique amadinda. L’électronique est un environnement idéal pour la combinaison de médias ; tout comme pour la danse, la proximité de la musique et de la poésie peut ouvrir des voies artistiques inconnues, et le fait que des structures similaires soient souvent explorées dans la musique et les arts visuels en Afrique peut permettre de créer de nouvelles analogies entre le son électronique et les arts visuels, en proposant de nouvelles approches du VJ-ing.
Beaucoup de musiques africaines sont cycliques et basées sur des structures « additives » ; à bien des égards, c’est de la musique « digitale », ayant au cœur de sa pratique un réseau d’unités élémentaires de pulsations rapides. C’est une pensée qui est assez proche non seulement des idées fondamentales en architecture informatique, mais aussi, de manière plus pratique, de comment beaucoup de logiciels de séquençage sont conceptualisées (bien que beaucoup de logiciels utilisent aussi des mesures et des barres de mesure, un concept complètement européen). La grande majorité des logiciels en musique sont conçus pour l’écriture des chansons de la pop, qui évidemment dérive beaucoup des modèles africains. Une grande part de la musique électronique aujourd’hui peut-elle donc être considérée comme de la musique africaine ? Et est-il possible de conceptualiser un programme de séquençage conçu spécifiquement pour correspondre à la pensée musicale africaine ?
L’esthétique du timbre est encore un autre domaine des différences entre l’Afrique et l’Occident. En Europe, les musiciens et les constructeurs d’instruments ont recherché depuis longtemps la « clarté » et la « pureté » du son, alors que dans beaucoup de régions de l’Afrique un instrument est incomplet s’il n’a pas des objets qui lui sont attachés – que ce soient des spiderwebs (membranes vibrantes associées aux résonateurs), des capsules de bouteille ou d’autres choses – qui créent un effet de mirliton. D’une certaine façon, les instruments africains ont déjà « leurs pédales d’effets incorporées » ; le traitement du son, une partie essentielle de la musique électronique a été présent dans la musique africaine depuis très longtemps. Peut-on utiliser cela à des fins créatives dans la musique électronique ?
De plus, alors que les instruments de l’orchestre occidental sont largement identiques dans le monde entier, la construction d’instrument et leur accord varient en Afrique de village en village, comme c’est beaucoup le cas en musique électronique où différents artistes peuvent bien travailler avec des plateformes de hardware et de software similaires (bois du même arbre ; les mêmes airs traditionnels) mais ils adaptent ces environnements de façon à ce qu’il n’y ait pas deux qui soient semblables, en rendant difficile pour un musicien l’utilisation de l’ordinateur d’un collègue. Comme les musiciens informaticiens construisent leurs propres environnements, beaucoup de musiciens africains construisent leurs propres instruments ; pour eux, cet aspect de la musique électronique devrait être un quelque chose de naturel, tandis que les non-africains qui travaillent l’électronique peuvent chercher leur inspiration de l’extrême multitude en Afrique des systèmes d’accord, des variations de timbre, etc., et utiliser l’électronique pour trouver de nouvelles voies dans l’harmonie et le timbre peu compatibles avec les instruments conventionnels occidentaux.
Ensuite il y a ma fascination personnelle pour les structures d’imbrication et la création de consonances, dissonances et harmonies produites non pas par une multitude de mélodies simultanées mais par une simultanéité de rythmes et de tempos. Tandis que les éléments acoustiques de la musique restent constants quelque soit la culture, les manières de les utiliser dans la conception de la musique varient beaucoup d’une culture à une autre. Une analogie appropriée se trouve dans le domaine des ethnomathématiques : alors que les lois fondamentales des mathématiques sont les mêmes partout, la façon d’exploiter ces connaissances ne l’est pas. Le livre Ethnomathematik, dargestellt am Beispiel der Sona-Geometric (Spektrum akademischer Verlag, Allemagne, 1997), par le mathématicien mozambiquain Paulus Gerdes, a été pour moi un très bon exemple dans cette catégorie. En utilisant l’analyse géométrique des dessins sur le sable au sud de l’Afrique, Gerdes met l’accent sur l’utilisation d’un artisanat traditionnel que les enfants acquièrent à un très jeune âge, pour élaborer les programmes des écoles élémentaires en Afrique ; par exemple, comment le tressage des paniers peut mener à des nouvelles manières d’enseigner la géométrie. Tout autant intéressant est le livre du mathématicien américain Ron Eglash, African Fractals: Modern Computing and Indigenous Design (Rutgers University Press, U.S., 1999) dans lequel il développe l’idée que l’art africain implique l’utilisation directe et claire de la géométrie fractale, ou dans une moindre mesure dans le design textile, ou, dans une dimension encore plus confinée, dans le tressage des cheveux.
Et bien sûr il y a une infinité de questions et implications sociales et sociologiques, et les possibilités et promesses extraordinaires que la technologie, en particulier Internet, peut offrir à l’Afrique, un continent qui souffre d’un manque chronique d’accès à l’information. Le fait de mettre à disposition les technologies électroniques dans les contrées éloignées de l’Afrique peut motiver les personnes, peu importe la distance qui les sépare des sentiers battus, à trouver des moyen pour accéder à l’information ; de jouer de la musique non conventionnelle peut inciter les gens à penser en dehors des cadres et leur donner les moyens de résoudre des problèmes qui se sont avérés particulièrement résistants à toute approche classique. Une des expériences les plus émouvantes que j’ai vécu a été de jouer un solo électronique dans le pub d’un village au Zimbabwe où l’électricité n’avait été installée que trois semaines avant. Le public, à peu près 200 enfants des écoles élémentaires, ont été les auditeurs les plus attentifs que j’ai jamais eu. Ils ont dû penser que je venais directement de Mars. Quand tout était fini, ils sont restés assis là en silence. J’ai été étonné par leur attitude et je suis resté assis aussi. Finalement, un enfant a brisé le silence : « Est-ce que je peux aller aux toilettes ? »
Conclusion
Je pense que j’ai encore beaucoup de choses à accomplir dans le domaine de l’Africana expérimentale et électronique. Cela a été pour moi une route extrêmement satisfaisante à emprunter, à la fois du point de vue artistique et personnel. Largement hors des sentiers battus pour les musiciens expérimentaux, c’est encore dans une grande mesure un territoire vierge pour la musique d’avant-garde. D’avoir pu passer du temps sur ce continent si extraordinaire pour la richesse et la diversité de ses cultures a changé ma façon de penser, et en écoutant la musique qui s’y fait a réchauffé mon cœur et stimulé mon esprit. Cela m’a procuré des amitiés durables et une inspiration sans fin. L’Afrique s’est imposée dans toutes mes œuvres, et je suis content qu’elle y soit.
1. Nous remercions John Zorn qui a accepté la publication de la traduction française de l’article de Lukas Ligeti dans le site paalabres.org..
2. Gehrard Kubik (né en 1934) est un éthnomusicologue autrichien. Il a étudié l’éthnologie, la musicologie et les langues africaines à l’Université de Vienne. (…) Sa recherche porte sur l’Afrique. Il a puiblié plus de 300 articles et de livres sur l’Afrique et les Afro-Américains, basés sur ses travaux de terrain dans quinze pays africains, au Vénézuela et au Brésil. Voir Wikipedia, Gerhard Kubik.
Nomadic Collective Creation
Nomadic Collective Creation
As part of the “Biennale Hors Norme”, Lyon
September 15-23
At the Grandes Voisines,
Lyon Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse,
and Lyon II « Lumière » University,
Review of observations from workshops organized by
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
Texts by Joris Cintéro, Jean-Charles François
and
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne for Cra.p
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
and
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne for Cra.p
Translation from French by Jean-Charles François.
Summary :
Part I: The Projet of the Orchestre National Urbain « Nomadic Collective Creation »
1.1 The project of the Orchestre National Urbain
1.2 Period of Preparation of the Project
Part II : The Grandes Voisines
2.1 Workshops at the Grandes Voisines
2.2 The Collective Workshop « Sound Laboratory » at the Grandes Voisines
2.3 Cello/Painting Workshop at the Grandes Voisines
2.4 Trombone Workshop at the Grandes Voisines
Part III : The Project at the Lyon CNSMD
3.1 Meetings during the Project
3.2 The « Sound Laboratory » Workshop at the CNSMDL
3.3 The Human Beat-Box Workshop
3.4 Public Presentation of the Work in the Conservatorium Court yard.
3.5 Reviewing the project on October 10, 2023 at the Lyon CNSMD
Part IV : The Projet at Lyon II « Lumière » University
4.1 Morning of September 31 at Lyon II University
4.2 The Workshops at Lyon II University
4.3 The Workshop « Sound Laboratory » in the Lyon II University Amphitheatre
4.4 The Public Presentation of the Work at Lyon II « Lumière » University
Part V : The Aesthetic Framework of the Idea of Collective Creation
Conclusion
Part I : The projet of the Orchestre National Urbain,
“Nomadic Collective Creation”
In the following article, we describe in a deliberately personal account of how we perceived the process during the workshops organized by the “Orchestre National Urbain/Cra.p as part of the “Nomadic Collective Creation” project. This project took place on September 15-21, 2023, as part of the “Biennale Hors Norme” at the Grandes Voisines in Francheville near Lyon, the Lyon Conservatoire National Sipérieur de Musique et de Danse (CNSMD) and the Lyon II « Lumière » University. The Biennale Hors Norme takes place in Lyon every 2 years. The philosophy of that event is “to do with the other”.
Joris Cintéro’s account covers the period of preparation for the project and the day of September 15 at the Grandes Voisines. He describes his way of proceeding in this way:
As I took hardly any note that day (I attended explicitly in the spirit of participating), the following report is based essentially on my memories. Writing in this way allowed me to dig up these memories, alongside the photos and videos I took during the day – which also helped me to ‘recover’ my memory. This report therefore alternates between descriptions, contextualisation and snippets of analysis that need to be explored in greater depth.
Jean-Charles François’ report is based on a day spent at the Lyon CNSMD, on September 19 and two days at the Lyon II University, on September 21 and 22. It was compiled from observations (without participation in the activities) and note-taking.
In both cases, the reports alternate descriptions, contextualizations and analytical fragments that need to be explored in greater depth.
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne, members of the Orchestre National Urbain/Cra.p, provide some essential background information for understanding their approach.
Interspersed with the texts are extracts from a video realized by the Orchestre National Urbain/Cra.p team, featuring interviews with diverse participants and segments of the workshop proceedings.
1.1 The project of the Orchestre National Urbain
Jean-Charles François :
The “Nomadic Collective Creation” project was developed by Giacomo Spica Capobianco, for the Hors Norme 2023 Biennial. Giacomo is the artistic director of Centre d’art – Musiques urbaines – Musiques électroniques (Cra.p) [Art center – Urban Music – Electronic Music], which he founded over thirty years ago. According to its website “The CRA.P team aims to exchange knowledge and know-how in the domain of urban and electro music, to cross aesthetics and practices, to generate encounters, to invent new forms, to create artistic clashes, and to give people means to express themselves.” (Cra.p). The project has been developed in collaboration with the members of the Orchestre National Urbain, the FEM team directed by Karine Hahn, “Formation à l’Enseignement de la Musique” (Music teachers training) as part of the Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL – FEM), and with visual artist Guy Dallevet for the Hors Norme Biennial.(BHN).
The description of the project by its organizers can be summarized in several elements regrouped in a scheme aimed in a general way at getting very different groups of people to work collectively to produce music, dance and painting:
- Three axes of mediation are here combined: a) invite in the same space very different social groups; b) invite in the same space people who can be qualified to call themselves “artists” (conservatory students) with people who, a priori, have no recognized skills in this domain; c) invite in the same space practices in different artistic domains (music, dance, theatre, visual arts, poetry).
- The encounters are based on immediate artistic practices, making music, making dance, making painting. To ensure that this common practice does not give one group an advantage over another, the encounters are organized in such a way that everyone will have to be confronted with tasks that are completely new to them, as for example playing trombone for the first time in your life, or dancing if you’re a musician.
- The project is structured in a series of workshops led by members of the Orchestre National Urbain:
Sébastien Leborgne (Lucien 16’s), beat box and spoken voice.
Rudy Badstuber Rodriguez, MAO and percussion elements.
Selim Penaranda, cello.
Odenson Laurent, trombone.
Sabrina Boukhenous, body movements.
Clément Bres, drums.
Giacomo Spica Capobianco, Sound Laboratoire, a workshop regrouping after the other workshops all their activities, in the perspectives of collective creation.
The painting workshop are led by Guy Dallevet for the Hors Norme Biennial.
The common thread running through these very different workshops (except painting) in terms of material manipulations, is made of a series of color codes defining playing modes:
a) orange = strong wind ;
b) white = gradual slowing down ;
c) red = repeated rhythm (three quarter notes and a rest);
d) brown = 8 regular pulsations;
e) black = freeze, silence;
f) blue = fear, shivering, energy;
g) green = free improvisation.
The various effective practices in different workshops are all based on the exploration of these color codes.
- Another important activity initiated by the Orchestre National Urbain, is the writing of personal texts to be spoken (in precise rhythms or freely) when all the elements from the workshops meet on stage.
- All participants follow all the workshops one after another, and then everybody meet in a general ensemble with the following stations: trombone, cello, amplified voice, drum set, various suspended sounding objects, 2 electronic stations (loops, playing with fingers on a pad), a “spicaphone” (a kind of electric guitar with a single string built by Giacomo Spica), an instrument with strings stretched on a metal frame (called « sound mirror »), an electric guitar set up horizontally to be played like a percussion instrument, a space for dance. A conductor is chosen among the participants to organize the performance, showing along the way color-coded cards. In Giacomo’s mind, this is not the equivalent of “sound painting”, the conductor must only show the color without imposing any particular energy. Experience with the set-up has shown that, in practice, the people conducting (members of the Orchestre National Urbain as well as any other participants) often exert a “particular energy” – bending down to embody a soft intensity, to play at changing the color-code cartons very quickly, ensuring that only one part of the ensemble be concerned with a color-code, etc.)
- At a given moment, in the institution where the workshops take place, a general restitution of the work accomplished is presented to an outside audience (this happened at the CNSMDL at the end of two days of work, and at the Lyon II University also after two days of work). At the university, this restitution was followed by a concert by the Orchestre National Urbain.
The specific project linked to the Hors Norme Biennial took place at three different sites:
- September 15-16, 2023, at the Grandes Voisines, in Francheville near Lyon. This institution described itself on its website as “a social, interactive and solidarity-based place where you can sleep, eat, work, paint, discover an art exhibition, take part in a choir… and experience encounters.” (Les Grandes Voisines). This accommodation facility is a place where refugees can stay awaiting regularization. It’s this particular group of people that was targeted during these two days of practice.
- September 18-19, 2023, at the Lyon CNSMD, department of the music teachers training program [FEM: Formation à l’Enseignement de la Musique]. Two days of workshops designed as encounters through practices between the Conservatory students and the refugees staying at Grandes Voisines, with a public presentation of the work at the end of the second day.
- September 20-21, 2003, at University Lumière Lyon II, workshops with refugees, and students from the university and the conservatory (on a voluntary basis), with a public presentation of the work at the end of the second day, followed by a concert by the Orchestre National Urbain.
1.2 Period of Preparation of the Project
Joris Cintéro :
As I write these lines, I can’t quite remember clearly the circumstances in which I was first introduced to the device. All I remember is a few snippets of discussion with Karine Hahn describing a « project we’re involved in with the CRA.P », the first stage of which is taking place « in Francheville [a suburb of Lyon], in a refugee home center », and that « the students have been kept informed » for a long time. I have memories of the objectives that were set for students through a device like this, particularly at Grandes-Voisines.
I remember the objectives that were set for the students through such a device, particularly at Les Grandes-Voisines: meeting with an otherness that we assume is not common in the ordinary course of their work as teacher-musicians, creating musical moments designed to invite an audience unfamiliar with the traditions of so-called Western art music, adapting to circumstances that are hardly conducive to artistic education, and, of course, taking a step back from social and political issues involved in artistic education.
A few days before the first session at Les Grandes Voisines [GV], Karine reminded the students of the Education Department about the project. After a group discussion in class with the students, we asked them about the possibility of going to Les Grandes Voisines on Friday and/or Saturday, we realised that very few of them were available/motivated to come with us on those days. Only one first-year student (Grégoire) was available, whom we didn’t know very well at the time – the course had only been running for a week. Almost all of the other students told us that they were busy or that they would have liked to come but hadn’t received the information in time.
We also stressed the need for students wishing to come to bring instruments that could be handled by children – I remember awkwardly insisting on this, suggesting that it was only a question of working with children and that they would be particularly careless. The students’ answers led us to discover that very few of them had several musical instruments.
Part II : The Nomadic Collective Creation at the Grandes Voisines
2.1 Workshops at the Grandes Voisines
Joris Cintéro :
On Saturday September 16, 2023, after collecting an old classical guitar at home and Karine’s electric harp from Villeurbanne School of Music, we both drove to the Grandes Voisines, arriving mid-afternoon, around 3.30 pm. Karine parked in the entrance car park, a stone’s throw from a sort of faded (empty?) gatehouse used to monitor comings and goings at the home centre. It’s a bit far from where the workshops are taking place (it has to be said that the signage wasn’t very clear and there’s nothing on the outside to announce the Biennale Hors-Normes). After a short phone call, Giacomo beckons us to approach from afar and welcomed us.
I meet the various members of the Orchestre National Urbain for the first time, as they emerge from a room housing various instruments. Giacomo takes us on a quick ‘critical’ tour of the premises. We discover a maze of rooms, doors and corridors, and are quickly briefed on the organization of the premises. Indeed, Giacomo is already familiar with the place (the Orchestre National Urbain has already been involved in the premises) and has experienced tensions with some of the people working there. During the visit, I quickly understand that there are communication difficulties between the protagonists (and their respective institutions) regarding the management of the site, and that some of the artists present at the Biennale Hors-Normes [BHN] are not ‘on the same wavelength’ as Giacomo.
I have the impression of a labyrinthine place that struggles to hide the stigma of its former use (as a hospital for the elderly). Although some corridors are lined with paintings and works of art of all kinds, and some exterior points suggest artistic activity (sculptures etc.), the place exudes a certain coldness (neon lights, false ceilings, greyish paint, cracked tiles etc.) typical of administrative buildings, retirement homes or even hospitals. Some rooms appear a little gloomy and smell of damp – such as the concert hall on the building’s first floor, which stands in place of the building’s former chapel. To add to this impression, Giacomo will add during the visit that autopsy tables are still present in the building’s basements. In the distance, we see a soccer stadium, the use of which in a geriatric hospital is hard to understand, and posters showing an installation to be held there. I’m struck at this point by the ‘waltz’ of keys that accompanies this visit, a sensation probably due to Giacomo’s annoyance at the need to lock up behind oneself “just in case”, “because some refugees don’t hesitate to help themselves”, or because the equipment cannot be supervised in our absence (and that of the Orchestre National Urbain members running the workshops).
After a good fifteen minutes’ walk around the site to find out where the various workshops were taking place, we’re back to where we started, under the sort of Barnum where the Orchestre National Urbain team had welcomed us earlier. It was quite warm, and Grégoire, the only student from the CNSMDL that day, had just arrived.
Once the visit was over, in the middle of a sentence, Giacomo mentioned the major difficulty of the afternoon, which we soon noticed: no one had signed up to take part in the workshops. According to him, this was due to the fact that the social workers working at the venue had not passed on the information to the venue’s users (we didn’t see any posters during the visit and we met people working at the venue who weren’t aware that music workshops were being held), a lack of communication that could itself be explained by a falling out between the BHN’s project leaders and the venue’s organisation – the details of which we would later learn. So the day began without any children or adults, apart from Omet – a user of the venue who was not initially presented/categorised as a beneficiary of the device but rather as a full member of the activity.
In the absence of an audience, the members of the Orchestre National Urbain don’t give up and invited Karine, Grégoire, Omet and myself to start playing with them in the collective sound workshop.
2.2 The Collective Workshop « Sound Laboratory » at the Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Giacomo presents a collective musical workshop similar to the group workshops later offered at the CNSMDL and the Lyon II “Lumière” University. It consists of a collective improvisation directed by a conductor, officiating only through a set of coloured cards indicating particular musical intentions to guide the improvising group.
The instruments are as follow:
– ‘Urban lutherie’ instruments : Spicaphone / Mirror-Harp [amplified]
– Electronic Instruments: (Korg monotribe/Kaosspad/Roland SP 404SX/MicroKorg)
– Effect pedals (Whammy with Spicaphone)
– Microphone [amplified]
– Acoustic instruments (Snare drum, electric guitar, “Chinese chopsticks” as drumsticks)
The console and the various cables used to amplify the instruments are not used as playing aids in the system.
The set of cards includes 7 colours associated with the conventions already mentioned above: In addition to this ‘colour coding’, the sound volume of the improvising group can be varied by means of a signal.
On this day, the instruments are arranged around the conductor (he or she). The workshop took place in a large room with green linoleum and several bay windows (some blacked out with curtains), giving direct access to the outside – allowing passers-by to see (and incidentally hear) what was going on. Although it is not, so to speak, central to the architecture of the home centre, this room is nevertheless in the path of pedestrians and cars and overlooks several other buildings – which will be important for the rest of the day.
The workshop began with an explanation from Giacomo, who presented the various aspects, emphasising the colour code and the objectives (working on the sound, freeing up any inhibitions, creating a space of equality between musicians and non-musicians, etc.). As I was involved throughout, I don’t know exactly how long each improvisation lasted. The only thing I do know is that the improvisation rounds stopped once everyone had conducted at least once – some repeating the exercise several times.
The workshop begins. Everyone seemed to enjoy playing the game. The comments made by those attending related mainly to the difficulty of remembering in the moment the conventions associated with the coloured cards (I had to wait until the 4th or 5th round to align myself ‘correctly’ with the cards), the nuances suggested by the conductor and the pleasure of playing on ‘exotic’ instruments (the mirror harp and the spicaphone in particular). Almost every workshop ‘round’ ended with a discussion of what had just taken place, mainly on musical issues (the conductor’s intention, nuances, etc.). The first few workshops went ‘very well’ insofar as it seemed to me that most of the participants were used to the exercise.
During the improvisations, we can see some groups of adults, children and parents, sometimes pass by, some discreetly approaching the auditorium – most pretending not to be seen. It was amid this flow of passers-by that a man in his early forties joined us, accompanied by his 5-year-old daughter. Rather reserved, he said from the start that he had come ‘for his daughter’, who seemed particularly happy and cheerful when the members of the Orchestre National Urbain invited him to join in the collective improvisation. The child took part in several ‘rounds’ of the workshop accompanied by various participants (who sat her on a chair so that she could play on the Microkorg, for example, or reframed her game in relation to the coloured cards) and the father took on the role of leader once – as well as taking part in a few rounds of the workshop himself. Initially reluctant to take part (he was only going to watch his daughter), he joined us at Giacomo’s request and gradually ‘relaxed’, without showing however any sign of letting go (which I interpreted as the fact that the participants were fully committed to the game and were sometimes overwhelmed by it). Both left the room after several rounds of workshops, clearly happy to have been there.
Once the auditorium was closed, we moved on to the adjacent room, where a cello improvisation and painting workshop was being held.
2.3 Cello/Painting Workshop at the Grandes Voisines
Karine Hahn, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (11’19”- 11’44”)
Joris Cintéro :
The cello-painting workshop was run by Selim Penaranda (cello) and a person (painting) whose name I have forgotten (I would later learn that she was replacing Guy Dallevet, who was absent that day). It takes place in a room that is large but rather cluttered with cardboard boxes, paintings, sculptures and various objects.
The workshop was organized quite simply. On one side we have Selim with 3 cellos (1 acoustic and two amplified electric) and on the other the painter with a set of sheets of paper, acrylic paint, cardboard boxes to spread it out on and protective clothing that is visibly worn – the room seems to be used very often for activities of this kind, as can be seen from the numerous paintings on the walls and the paint stains in the sink. In the same spirit as the productions that would follow for the rest of the week, this device involved interaction between the groups who were painting and the groups who were playing the cello. The workshop ends with individual cello improvisations based on a support painted by the performer.
Lucien 16’s (Sébastien Leborgne) on the relationships between music and painting, extract from video “Biennale Hors Normes” (3’48”-4’48”)
The cello activity led by Selim is always organised in the same way.
1. Presentation of the instrument and the device.
2. Experimenting with the instrument.
3. Directed improvisation with color code. This activity requires at least two people
to play (sometimes including Selim) and one to conduct.
Selim first introduces the cello by playing a few notes and repeatedly stressing that there is no one right position for playing it, that the most important thing is to feel at ease while playing. In this sense, he does not hesitate to show positions that could be described as heterodox in relation to the common representation of cello playing, which is associated with a so-called ‘classical’ position (the instrument is held between the legs, the feet on the ground, the neck of the instrument resting on the shoulder). He deliberately places his feet on the edges of the cello, showing that it is possible to play it in this way. The same goes for the bow, which he suggests holding in several different ways, emphasizing, as he would later do at the CNSMDL, that “it can be held like a doorknob”. He did not, however, prevent participants from holding the instrument and the bow in the ‘conventional’ way. Once this introductory ‘ritual’ has been completed, he lets the participants explore on the cello while introducing the rest of the workshop, which consists of an improvisation with another participant.
The person ‘conducting’ during the workshop changes as the workshop progresses. The code used is the same as in the previous workshop.
On the other side of the studio, the painting is organised in an equally recurring fashion. The supervisor presents the task in hand, i.e. to paint a canvas while soaking up the sounds created by the cellists, using a piece of cardboard to create, as the supervisor shows, multi-colored circular shapes. Basically, you pour a few drops of paint (one or more colors) onto the canvas and use the cardboard support to spread the paint over a sheet of paper, creating spirals of some kind.
The link between the two parts of the workshop doesn’t seem to be obvious to everyone, as evidenced by the fact that during a break in the cello when I was looking at the other part of the studio, some of the painters paid no attention to the music (which isn’t always true, since overly long silences sometimes lead painters to grumble gently about the absence of music for painting). I take a few photos of the studio.
The workshop ends with a series of individual improvisations on the cello, based on a visual support, i.e. the painting created earlier in the workshop. None of the local residents will be joining us during the workshop. We decided to take a break after a short hour of collective work.
Cello and painting workshop at the Grandes Voisines, extract from video “Biennale Hors Normes” (5’45”-12’28”)
2.4 Trombone Workshop at the Grandes Voisines
Joris Cintéro :
The break offers an opportunity for some of us to light up a cigarette, drink a little water and have a general discussion about the facilities on offer and the lack of an audience. Although the atmosphere is very friendly, I can still feel some disappointment among some Orchestre National Urbain members. I also said to myself at the time that mobilizing so many people over two days for such a small audience was a considerable waste of time and money. We talked a bit about the venue, its shortcomings (the inhabitants are said to be housed by ‘ethnic group’) and the fact that, apart from its hospitable aesthetic, they don’t seem to be all that badly received. Mention was made of the existence of a building dedicated to single women, a group that, according to Giacomo, is difficult to invite to activities because they have been through traumatic migratory experiences. Everyone had their own little anecdote, especially those who already knew the place.
As the afternoon wore on, Odenson Laurent, a young member of the Orchestre National Urbain, played a few notes on his trombone. These notes had the effect of a call. Several children approached us, shyly at first and then more directly. They want to play and let us know. Giacomo and Sébastien rush to retrieve the trombones they had stored in a room in the building. The scene gives the impression that we’ve been taken by surprise, that the ‘public’ is finally pouring in, and that we mustn’t miss the boat.
The trombone cases arrive and are hastily placed on the floor. It’s an interesting moment in that we all (the participants from the previous workshops) gradually begin to ‘frame’ the workshop as it takes shape. Here we disinfect the trombone mouthpieces with alcohol, there we show a child how to grab and hold a trombone, and next door we keep those waiting for their turn waiting.
Trombone workshop at the Grandes Voisines, extract from video « Biennale Hors Normes » (0’23”-0’56”)
Odenson takes control of the workshop, spoke loudly (it had to be said that the children were numerous and in a hurry to play) and showed them how to blow into the mouthpiece of the trombone. Most of the children succeed. He suggested a series of exercises/games where the first thing to do was to blow hard once. The children did this successfully, laughing and trying again without waiting for Odenson’s invitation. The volume increased rapidly, and the children seemed to enjoy the activity. Odenson then suggested playing with the slide. Some of the children dropped the slide (it must be said that in some cases the trombones were as big as those playing them), which led to laughter from the others and impatience from those waiting their turn – some then came to the aid of their friends by holding the slide. The children clearly seem very happy with the experience they have just had. New faces appear: several women start to arrive, some leaning over the balconies to see what’s going on.
Same again, the mouthpieces are cleaned, the children are given a few pointers on how to hold the trombone (each one offers a bit of advice), those who will be coming next are made to wait, and the women who have just arrived are invited to try out the experiment. Karine, for example, was asked to convince a local woman to join in the exercise, which she managed to do.
It’s interesting to note that although, apart from Odenson, no one ‘plays’ the trombone (or at least no one categorizes themselves as a ‘trombonist’), everyone takes the liberty of showing the children how to blow into the mouthpiece, how to make the lip movement that allows them to do so, or how to hold the instrument – for example in the interval to those who are waiting or directly to those who are taking part in the workshop.
After several rounds, the workshop stops, and the Orchestre National Urbain members talk to the women and children present to tell them about the next day and the continuation of the workshops.
Photos of Grandes Voisines, extract from video “Biennale Hors Normes” (2’37”-3’33”)
Part III : The Project at the Lyon CNSMD
3.1 Meetings during the Project
Jean-Charles François :
The staff of the Orchestre National Urbain usually meets in the morning before the start of the workshops in order to (re-)define the content of the day, taking into account precedent actions.
Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne :
First phase, “Team meeting”:
The artistic director (Giacomo Spica Capobianco) reviews the current project with all the artists working with the Orchestre National Urbain. These meetings are an opportunity to evaluate the workshops as a group, in order to ensure that the project continues to evolve. These moments of discussion allow us to exchange on evolutions, constraints and difficulties encountered.
Preliminary to a program proposition for the day, a discussion takes place to enable us to adapt to situations encountered on a day-to-day basis.
Second phase: “Meeting of the team with workshop participants”:
Each morning, a time is scheduled for discussion with all workshop participants.
Obviously, this moment is important, given that no prior selection level is required, both technically and socially, the participants are expected to work collectively.
It’s important that the ones go towards the others for a more constructive encounter leading to elaborating an improbable creation.
The point is to convey to participants that they are at the service of the project within of a collective creation.
All the workshops are filmed.
It’s important to have a video support of each workshop so that all members of the Orchestre national Urbain team can discover each other’s work. This allows the project to evolve.
Jean-Charles François :
For example, here’s the description of such a meeting, which took place on the second day of workshops at the CNSMDL, the morning of September 19, 2023. This meeting brought together the Orchestre National Urbain team, and the CNSMDL-FEM team.
Giacomo Spica Capobianco reports on problems encountered at the Grandes Voisines. The venue of the Orchestre National Urbain had not been properly prepared by the supervising staff of the center. It seems that no information reached the intended public, therefore it was necessary for the members of the orchestra to start playing in the courtyard, to welcome the people passing by and invite them to participate. During this process, it was mainly children and mothers of these children who participated. As a result, only one refugee was allowed to come to encounter the CNSMD students. Giacomo sums up the objectives of the day, which are to give the students the opportunity to take charge on their own with working elements that are new to them. This is why they are not allowed to use their own instruments. For Giacomo, we’re not there to dictate behavior, but to create situations of collegial research with a view to projecting ourselves in practices accessible to any audience.
3.2 The « Sound Laboratory » Workshop at the CNSMDLL
Jean-Charles François :
The morning session (September 19) takes place in a large chamber music space with a stage. The stage is organized with a series of instrumental stations (standard instruments, simple built instruments, electronic instruments, amplified voice) as describe above. A floor space outside the stage is devoted to dance. Students are divided in three groups. The people who don’t participate to the performance of a group, are sitting on the floor or on chairs outside the two performance spaces.
The session starts by a 10-minute body warm-up led by Sabrina Boukhenous. She is a member of the Orchestre National Urbain, an actress, stage director, and sound and lighting technician. Her role in the Orchestre is to take charge of body movement and spoken word. The warm-up takes place for everyone in an atmosphere of good humor and pleasure of doing: rubbing hands, breathing exercises, activating different parts of the body, jumping, etc.
Concerning Sabrina Boukhenous’s “Body and movements” workshops, here is an extract taken during a similar project of the Orchestre National Urbain that tool place at the University Lyon III in 2024: valid.
Sound Laboratory at the CNSMDL, extract from video “Biennale Hors Normes” (17’25”-18’42”)
One of the specific aspects of the setup is the presence of texts written during the workshops and read aloud by each student through a microphone placed on stage. According to the instructions given by Giacomo, the voice doesn’t have to follow the color codes, but unfolds its flow as a solo, according to the choice made by the person who speaks. The main difficulty is for the audience to be able to hear the spoken voice clearly, whether the protagonists are unfamiliar with the microphone, lack confidence or energy, or whether the sound level of the ensemble is too loud, since looking at the code-colored cards may not allow immediate listening of what others are doing. Giacomo, fairly early during the session, demonstrated with the microphone how the voice can be used more effectively. During the performance period of the third group, at one point, it was decided not to use the code-colored cards, but to rely solely on the solo voice with the need to be able to understand the text: the voice here replaces the conductor. After trying out this idea, a short discussion took place on improvisation notions: the necessity of listening to others, the question of reacting to ongoing energies and to other proposals, the idea to let others be at the forefront, especially in case of the presence of a text. At the end of this first part of the morning, a situation was experimented involving three vocalists reading their text.
The presence of texts give raise several times (notably on the part of Giacomo) the question of physical commitment and the meaning you have to convey reading the text. Of course, it’s difficult to make an immediate engagement in an activity you’re doing for the first time, when you don’t know where it’s going to lead. But the difficulty of commitment on the part of the students also stems from the fact that they don’t automatically (yet) subscribe to something too far removed from the aesthetic values that are promoted on a daily basis at the conservatory. The behaviors induced by European high art music written on scores imply on the one hand, a deep commitment on the part of the composers in their aesthetic projects, and on the other hand, an assumed detachment on the part of the performers who should be ready to play a diversity of aesthetics. We could say that, in this context, the performer’s engagement is only manifest when playing in public, in an attitude close to the theatre actor where the proper commitment is “played”. In this context, you are not accustomed to throwing yourselves heart and soul into any type of activity, without taking time to reflect on the matter, the aesthetic content is therefore not a commitment but a play. The commitment of the performers of the so-called “classical” sector is turned above all towards the manner to approach sound production, and in this way their principal identity is focused on their own instrument or voice. The body of the Western human being tends to be disconnected from meaning, having to construct meaning according to contexts, with the risk therefore of missing out on a more fundamental state in which the body assumes and believes in its own production of meaning. As it happens, there exist a great deal of musical (and dance) practices where the performers’ commitment is not separated from conditions of production, and where meaning is fundamental from the outset, that is at every level of ability. This is particularly the case with the musical practices of the Orchestre National Urbain and within the actions that it carries out in underprivileged neighborhoods.
Some students have decided to be present to the sessions, but not to take part in the proposed practices, and to be there as observers. This is a tiny minority, 2 or 3 among the 50 or so persons present. Giacomo had made it clear that this attitude was possible, that there was no obligation to participate in the action. Yet, one of them decided suddenly to join the active group, when improvisations without conductor and coded colors were tried, with the text or the dance now the elements to be followed. He took the electric guitar (that was set-up horizontally), tuned it in the standard way, and played it with the usual guitar-playing position.
For dance, the term of “body movements” is often used to emphasize that on the one hand, these are free movements in space, and, on the other hand, that there is no artistic ambition with technical implications that could prevent the immediate participation of any person present. At the beginning of the group 1 performance, there is no dance, then gradually it takes greater importance. It soon became clear that the conductor needed to see the dance (as well as listen to the instruments) to influence the decisions on color changes. With the group 3 (after the experimentation to follow the text) it was decided that the musicians should be influenced by the dance rather than following the color codes. As in the case of the text, this trial provoked a discussion on the relationships between dance and music, raising questions on mirror imitation, on the conditions for the musicians to follow collectively the dance, on the risk of of one artistic domain dominating another, and on the need for communication to circulate. An idea is proposed: an improvisation in which all these working axes are mingled.
Concerning the presence of a conductor with the color-coded cards, the reality of actual practice raises a number of questions. One important aspect is that, for each new sequence of play, there is a new conductor, therefore there is no danger of developing conducting “specialists”, and there is a democratic distribution of the different roles. But it is precisely this particular set-up that tends to reinforce the general representation that the people present have of the dominating power of the orchestra conductor. Therefore, the who assume this role have a tendency to over-invest the power that is given to them: it’s not just a question of showing color-coded cards, and indicating loudness levels, but it involves exaggerated body attitudes to pass on information to the instrumentalists to ensure that they are respected, and we soon find ourselves in a situation similar to “sound painting”. This over-investment on and of the conductor results in the domination of the eye over the ear: having to look constantly at the conductor prevents the focus on listening to both one’s own sound production and that of the others.
The oral-written duality is a very important element at play in the context of the CNSMD and the musical forms that define its contours. But what is at stake in this context is very different when it comes to immediate access to musical artistic practices for anyone (whatever their skill level and social background). In this case, very precise mechanisms need to be invented in order to achieve convincing results. Towards the end of the first part of the morning, Giacomo reminded us the pedagogical nature of the work in progress: the difficulty lies in doing things in depressed cultural contexts or when people of different cultures meet. How to build activities that from the beginning offer the possibility of confronting fundamental issues, but in accessible manner, how allowing people to construct their own meaningful situations. Accessing active participation comes first at the outset takes precedence over any consideration of artistic quality or of standardized behavior. The coded-color cards and the presence of a conductor that manipulate them to give form to the performance ensure in all contexts a rapid access to an effective practice, in which the artistic stakes are not at all resolved yet are already inscribed in the content of the action.
3.3 The Human Beat-Box Workshop
Joris Cintéro :
The day of September 16 (at the Grades Voisines) ends with the workshop let by Sebastien Leborgne (Lucien 16), which focuses on « Human Beatbox ». Sébastien is a member of the Orchestre National Urbain, and a rap, spoken word artist.
The workshop takes place in a room inside the building. The room is particularly small and is in the passageway of a corridor, opposite several lifts: there is quite a bit of traffic.
The workshop requires very little equipment: a few sheets of paper, a console, a looper, a microphone and a loudspeaker to amplify it all.
Sébastien describes his workshop. He begins by explaining the principle of Human Beatbox. To do this, he draws several instruments on a sheet of paper. We see a bass drum, a snare drum and a hi-hat cymbal. He directly demonstrates the sound that can be associated with each of the elements drawn on the sheet. He then puts his words into practice by recording a beatbox loop.
He then asked the workshop participants (who were mainly members of the Orchestre National Urbain and the CNSMDL) to make a loop themselves. During the workshops, a group of 3 children stopped to listen to what was going on. Sébastien invites them to give a try themselves at producing a loop with the looper. The children laughed, seemed embarrassed, but went ahead nonetheless. He took the opportunity to ask them if they were available the next day to take part in the workshop. This workshop took place in a particularly limited amount of time compared to the preceding ones. It shows the versatility of the system put together by the members of the Orchestre National Urbain – as well as explicitly the difficulties to which the collective has to face on a regular basis.
Jean-Charles François :
During the second part of the morning of September 19 (at the CNSMDL), I attended a “Human Beatbox” workshop led by Sébastien Leborgne (Lucien 16’s).
The technical set-up of the CNSMD studio consists in a microphone to amplify the soloist’s voice, with a sampling machine for making loops of vocal sounds, to create repetitive rhythms with the possibility of superimposing vocal sound samples. Several microphones are available to record several voices at the same time.
The introduction by Sébastien defines the context of rhythm production through vocal imitation of drum set sounds (beat box) over which a text can be spoken.
The first experimentation concerns the imitation of bass drum sounds, of charley, of snare drum with the voice, and to record them to form a loop. A loop is created over which the participants can add another vocal production to form a new composite loop.
The following situation, as defined by Sébastien, involves a) creating a rhythmic loop with 4 vocalists; b) then the soloist places the text on this rhythmic structure. Sébastien says that the students should do this task on their own autonomous way, he is only there to answer questions they might have. Creating the loop is quite easy, without much time at hand to try several examples. Adding a text to the invented loop poses more of a problem, as the participants read their text without any rhythmic inflections, independently to the content of the rhythmic loop. Sébastien suggests that the loop accompanying the Human Beat box should fit the text and not the other way round: “since this text is a dream,” the loop should reflect this mood.
A new attempt to create a beat box loop with five superimposed voices is made. A student speaks her text over the loop. She tries to connect her text to the rhythm character of the beat box. Sébastien remarks that what is principally at stake is not for the spoken voice to correspond to the rhythm of the loop, but to “impose yourself on the rhythm of the loop”. The spoken word doesn’t have to comply to the basic rhythm but should be guided by the right and true emotion. The student tries again to read her text over the loop but stops fairly quickly.
Someone asks if it’s possible to sing the text. Sébastien answers: “you can do what you want.” A student tries then to speak her text and to sing part of it.
Observing this workshop, it appears clearly that the main challenge that the students of the CNSMD have to face in this project lies in this very new activity for them of having to write a text and, above all, speak it with a rhythmic accompaniment.
Human beat box workshop at the CNSMDL, extract from video “Biennale Hors Normes” (13’25”-14’29”)
3.4 Public Presentation of the Work in the Conservatorium Courtyard.
Jean-Charles François :
In the afternoon of September 19, a public presentation of what had been done in the workshops was proposed to the CNSMD community at large in the courtyard next to the main concert hall. An amplification system had been installed and the space was organized in the same way as in the Chamber Music space, a combination of instruments grouped around a solo voice, a space for the dance, and the paintings exhibited on the floor. The public (sparse, apart from the participants themselves) was sitting on the steps leading to the concert hall building.
The three groups of the workshops present performances in which there are musicians and dancers, often with a change of role in the middle. In the attitude of the performers, there’s a compensatory effect, since the production, still too experimental doesn’t correspond to the criteria of artistic excellence prevailing at the CNSMD. Seemingly, they have to show, a) the pleasure of doing an unconventional activity; b) stressing the energetic aspect of the experience; c) showing that it’s an entertainment situation in which one can be content to be only half committed; and d) sometimes bringing out the ironic character in relation to an uncomfortable situation. However, there is no aggressivity in these attitudes towards what has been proposed, but rather a problem of positioning towards the community in which the public presentation is offered.
In the Group 2, a conductor, very much like a “composer”, develops a form that stages elements in a sort of narrative that allows the text to emerge. Thanks to this “in house” know-how, we’re closer to what might eventually be accepted by the institution as artistically valid.
Public presentation in the CNSMDL courtyard, extract from video “Biennale Hors Normes” (20’35”-22’46”)
At one point during the performance, a CNSMD professor came in the courtyard to demonstrate her vehement disagreement with what was going on, and in particular with the sound level of the amplification, which prevented her from teaching.
Outside the FEM staff as partners of the project, no representatives of the CNSMD directorate were present during this presentation. Yet, the director is very much in favor of the development of this type of projects.
3.5 Reviewing the project on October 10, 2023 at the Lyon CNSMD
Jean-Charles François :
Une journée de bilan du projet a été organisée au CNSMD de Lyon avec les personnes qui ont participé en tant qu’encadrants du projet et les étudiants de la FEM.
A) Réunion de bilan des encadrants de l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et du CNSMD de Lyon
The morning started with a meeting of the Cra.p and CNSMD staff, during which the students met separately in small groups of 4 or 5 to prepare what they wanted to convey at the general assessment session that followed. Were present at the staff meeting: for the Cra.p, Giacomo Spica Capobianco and Sébastien Leborgne; for the FEM (CNSMDL), Karine Hahn, Joris Cintero and Guillaume Le Dréau; and myself, Jean-Charles François as outside observer.
Here are some of the ideas expressed at the meeting:
- What are the formative aspects for the students and through what issues?
- What is at stake in this project?
- Thinking the aftermath of the project: other types of collaborations between the orchestre National Urbain/Cra.p and the FEM?
The students had to confront musical issues in a practical way, thought out in continuity with social and political contexts. They had to manipulate and fabricate sounds in transversal and transdisciplinary situations, that is confront unknown musical materials, consider practices involving simultaneously several artistic domains, and encounter cultures different from their social and artistic environment. Their aesthetic concepts were challenged by these various approaches. The pedagogical aspects of the project emphasized on experimentating with musical practices open to all whatever their skill level, and on the inventing ways designed to encounter otherness. The two essential questions were: how to make music together with any public? And what is exactly involved in developing projects in specific places and circumstances?
Two critical reflections emerge during the meeting:
- The problem of the plethora of labels prevalent in each cultural milieu, which classify any practices once and for all, either to acclaim them, or more often to consider them as unworthy of interest, or else to rationalize them in order to better control them in the dominant order of things. How in transversal and trans-aesthetics encounters can we envision situations in which a certain indeterminacy of materials will enable new aesthetic grounds to emerge, common to the diversities present?
- The problem of the intellectual and artistic tourism is prevalent today in many higher education programs in the name of access to the world’s diversity. Experiences giving access to this diversity are multiplying in study programs with not enough time at hand to go in-depth into each of them. Cultural enrichment often goes hand in hand with a misunderstanding of the major issues at stake in the various practices. How within the limited time allotted to face this difficulty?
The Orchestre National Urbain offers the permanent possibility for anyone to follow a “tutoring program”, open to particular requests for training and project development.
B) Assessment with the CNSMD students
Each group of students presents their conclusions in turn. The group of students who also attended the Lyon II University sessions will speak last. In general, the feedback is for a large majority very positive: the artistic, social, and political objectives of this kind of action are well understood and the practices have been experienced in meaningful ways. Here are the different elements that were expressed:
- The idea of desacralizing the musical instrument. The instrument is no longer considered as a specialized entity, but rather as an object like any other capable of producing sounds. The fact that everyone has immediate access of to sound production means that all the issues at stake in musical practice can be put into practice, whether in terms of technical modes of production or of artistic issues. The need to make music with materials that are not mastered at first, enables to break away from the logic of expertise and puts all participants at the same level of competency. For one of the students, this approach is close to the Art Brut and Fluxus. This should enable effective encounters between participants of different cultural backgrounds. The tinkered instruments (or tinkering instruments) opens up a different way of considering sound matter, timbre, and the use of sounds generally considered as outside the musical realm.
- The declamation of a text accompanied by instruments. This aspect is certainly the most difficult to achieve for specialists of instrumental music. The “Human Beatbox” workshop was experienced as the activity that best opened the way to inventing sound materials through the realization of simple rhythms.
- Improvisation stemming from guidelines easy to follow. This is what makes it possible to become master of one’s own production. It’s an effective way to approach improvisation in an uninhibited manner. It opens the way to a dynamic of immediate sound production separated from preoccupations with playing only what is completely mastered.
- The realm of amplification is what the CNSMDL students are least familiar with. This first approach is much appreciated.
- The role of conductor: you have to dare to assume this role in order to control the general form of an improvisation, from the perspective of building an instant composition. For some students the presence of a conductor is an obstacle to improvisation, which implies individual responsibility and requires a less urgent temporality for dialogs to take place, without relying on the authority of a conductor.
- The idea of doing things immediately before any reflection is an important element of the practices proposed. There’s an urgency to do things without asking questions, to do what is not yet mastered before considering the means to achieve it.
- An important aspect of the project is to encourage audience participation, as happened at the end of the concert by the Orchestre National Urbain when everyone started dancing in the University amphitheater.
Among the problems raised by the project, some students noted a time organization that sometimes seemed too slow, and at other times too short. Boredom or frustration are at the root of a certain fatigue. There is a concern about the notion of “work”, induced by immediacy of doing, which may imply a strong devaluation of the notion of art. One of the students expressed her frustration at the excessive amplification levels and absence of consonant sounds, which made her very tired. Several people noted the absence of relationships between the painting workshop and the musical ones.
The issue of the public presentation of the work in the Conservatory courtyard was the subject of a lively debate. The situation ran completely counter to the dominant culture of an institution requiring a high level of excellence in any performance. In addition, the public presentation used means of musical production rarely in use in the institution, in a undefined style in relation to the prevailing contexts. The amplification levels made it impossible to ignore this event in every corner of the Conservatory. The students were therefore obliged to do something that was in direct conflict with the surrounding community and that puts them at risk to be disqualified. Many wondered whether this idea of presentation of the work was really necessary to the overall conduct of the project. The students had to face numerous ironic comments from their colleagues present at the performance. One particular phrase stuck out: “the slobs in the courtyard!” Other expletives were used, such as “degenerates” with more disturbing historical connotations. Perhaps the audience needed to be better informed about the situation and its pedagogical context before the event.
Joris Cintéro, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (22’50”-23’44”)
In the answers to this debate by the members of the project teaching team, the need to make public an activity that is unusual in Conservatory practices remains of great importance. It’s not just a general question that could be swept under the carpet of anonymity, but something that needs to be put “on the table” of today’s reflections on art and its transmission to all.
For Giacomo the public performance at the CNSMDL was not initially planned, but the impossibility of having all the students present at the Lyon II University for the general public performance of the project changed the situation. He understands the frustration of people present concerning “art”, but the issue should be shifted to the legitimacy of the proposed activities. For him, the issue is how music teaching institutions are going to put in place some mechanisms to open up their activities to people who have no access to practices. He points out that the most obvious problem in his work with the various institutions in which he develops his projects, is the often negative attitude of the leadership staff, teachers, animators, social workers, and so on. They defend their territory, and often feel that those under their authority must conform to their own way of thinking. If they are not directly involved in the project, its course is seriously jeopardized. Effective knowledge of a project by the host institution as a whole is an essential element in getting the idea off the ground.
When the cultural animators are favorably inclined towards the Orchestre National Urbain’s projects, things happen in a very positive way. Here is an example of a commentary by Khadra Hamyani, an educational helper at the “Forum Réfugié”, during another project developed by Cra.p at the Lyon III University in 2024, involving young refugees, « From Body to Movements, From Gesture to Sounds”:
Khadra Hamyani, extract from video « Du corps aux mots, du geste aux sons » (2’37”-5’34”).
Karine Hahn reminds the students that on the one hand, Giacomo came one year before to present the detail of his project, its outlines and challenges, and on the other hand, a text of presentation of the project and its objectives was distributed to all shortly before its realization. In a context where often the people involved don’t have the same understanding of the terms of a project or may even understand exactly the opposite of what is proposed, any mediation seems of little use in avoiding conflictual expression. What counts however is the affirmation of legitimacy through action.
Joris Cintero underlines the difficulty that the institutions have in using surveys to question their own ways of operating, especially on the subject of recruitment of people present. The last formal enquiry on the social makeup of the student population at the Lyon CNSMD was done in 1983, [1] it showed that only 1% of farmers children were present, and only 2.8% of blue collar workers chidren, and so on.
The issue of the public performance must stems from the various difficulties encountered with the general administration of the institutions and the people who work in them. One student who was present at the Lyon II University noted that, at the beginning of the first day, no one was present ready to work with the Orchestre National Urbain, no advertisement had been made by the host institution, no support provided. Immense efforts had to be done to get 5 people willing to get involved. For Giacomo, the resistance of the University towards this project is obvious, there are no professors involved, nothing had been done to facilitate things. The feeling is that because it didn’t cost any money, it would have to fall apart. At the end of the first day, the question arose as to whether to continue on the following day. The answer is definitely that you have to keep going, you have to persist and play with the situation. For Joris 5 or 6 participants out of 29500 students, it’s a long way to go in the cultural domain.
Sébastien Leborgne describes in detail what happened at the Grandes Voisines, with the presence of 415 refugees accommodated, many of them women and children. Karine describes the start-up at the Grande Voisines: everything is ready to go at 10 in the morning, the technical setup is in place, the teaching team is ready to work, but nobody is there to participate. But this preparation is a guarantee to be taken seriously, the team is there in front of no one, with the same seriousness as if there were people present. Little by little people pass nearby, it’s on the move, it exists, it works no matter what.
At a certain point in the afternoon, a 11-minute video shows in fragmented form what happened at the Grandes Voisines. One of the most striking segments is a trombone quartet made up of three children and a mother, all playing together accompanied by body movements of great collective coherence.
In the diverse answers to the students’ preoccupations by the teaching staff, the following could be noted:
- Concerning the question of the need to do thing in an immediate manner at the cost of quality control, Giacomo points out that most of the time, the projects he leads in different contexts take place within very limited timeframes, the passage of the group is often ephemeral. Here, doing must absolutely precede theory.
- The question of long-time involvement is addressed by emphasizing on the role of Cra.p as a center of practices, as a place for continuing education, with also the objective to allow people living in deprived neighborhood to access higher education degree programs.
- The choice of instruments works on two levels: on the one hand, you have to enable a first practical approach to playing instruments well-known to require years of work; playing trombone or cello immediately can arouse the desire to learn to play these instruments seriously. On the other hand, you have also to give access to sound materials that are easy to handle at first. Giacomo gives the example of the six-string electric guitar that requires demonstrating how to play it, whereas the “spicaphone”, an instrument he built with just a single string gives a more immediate access to actual practice.
On the subject of the access for all to musical practices, Giacomo tells of a story of a mother, following a performance given by her son, who is crying while saying: “I didn’t know that my son could have the right to make music.” In many quarters, people think that the access to musical practices is completely forbidden to them. The issue of cultural rights is essential. Karine remarks on the lack of places open to practices: where are the spaces existing outside the limited access specialized “schools”? Outside the Cra.p, there’s a crucial lack.
Photos of the project at the CNSMDL, extract from video “Biennale Hors Normes” (13’08-13’56”)
Part IV : The Projet at Lyon II « Lumière » University
4.1 Morning of September 21 at the University “Lumière”, Lyon II
Jean-Charles François :
The morning session of September 21, 2023, takes place at the University “Lumière”, Lyon II (on the banks of the Rhône), in the space where art works are exhibited as part of the Hors Norme Biennial, and in the large amphitheater.
Given the difficulties encountered at the Grandes Voisines, at the last minute 20 teenage refugees (all male) of the “Centre d’hébergement” of the Lyon 1st arrondissement were able to come and to take part in this morning session and to the next day’s public presentation at the end of the afternoon. They could only be there during the morning of September 21 for one hour and a half (10:00-11:30 am) because the Center that housed them strict rules on meals. Four students from the CNSMD were present on a voluntary basis. Lyon II University students, and visitors to the BHN exhibition could take part in the workshops, but this was a very marginal phenomenon. Giacomo told me what had happened on the previous day (September 20) when a small number of students of the Lyon II University participated in the workshops as they passed through the exhibition hall. This happened although no advertisement of the event had been provided by the University towards the student population. Their participation depended only on their passing through the space where the activity took place, and their eventual interest in what was being proposed.
This is a frequent aspect of the actions carried out by Giacomo and the Orchestre National Urbain: although they are often officially invited to develop their projects in an institution, obstacles are bound to arise on the part of the staff of the institution. The reasons for this lack of cooperation can be found either because what is proposed comes to encroaches established prerogatives, or by the presence of people from outside the institution (or its usual audience) is not viewed favorably. In all cases, the attitude of the Orchestre National Urbain is to settle into a given space, and to raise the interest of persons lingering there or passing by.
Here are some comments from a Lyon CNSMD student who participated to a similar project by the Orchestre National Urbain at Lyon III University in 2024, “From Body to Movements, From Gesture to Sounds”:
Marie Le Guern, FEM student at the Lyon CNSMD, extract from video “Du corps aux mouvements, du geste aux sons” (8’47”-9’07”)
4.2 The Workshops in Lyon II University
Jean-Charles François:
Given the limited time available due to the presence of the young refugees, the organization of the workshops was limited to 15 minutes. This allowed 5 groups to participate in 5 workshops one after another, followed by a session regrouping all five groups for 15 minutes in the large amphitheater. This schedule was not completely realized within the allotted time, with each group actually taking part in only 4 workshops (out of the 6 proposed) before the session in the amphitheater.
The proposed 6 workshops were (as in the CNSMD):
a. Dance.
b. Cello.
c. Trombone.
d. Human beatbox.
e. MAO.
f. Sound laboratory
g. Painting.
Workshops at Lyon II University (MAO, Human beat box, cello, trombone), extract from video “Biennale Hors Normes” (23’58”-26’10”)
The workshops were held in the large exhibition space of the Hors Norme Biennial, and in two adjacent rooms. The principles were exactly the same as the ones described above, with immediate practice on sound materials, and the use of colored-code cards. The situations were the same as in the CNSMD, so, there’s no need to describe them in detail.
Because of the limited time, and the imbalance in numbers between the refugees and the other participants, few interactions between the different publics could really take place during that morning. Some of the groups were made up entirely of members from the refugee group. In the case of the painting workshop, I observed a situation with two large sheets of paper side by side, on which two completely separate groups were drawing: the first group was made up solely of black African male refugees, the second one only of white French female students.
The limited availability of the refugee group meant that the morning had to be focused primarily on welcoming them and organizing their activities, while the other participants had other opportunities to take part to all the workshops and performing situations. From this point of view, what was proposed to this particular audience was extremely successful: the refugees demonstrated a total commitment of their energy in the proposed practices and showed great interest in all the various aspects of the workshops. One of the strengths of the Orchestre National Urbain/Cra.p team is its capacity to adapt in an immediate way to all possible situations, to cope with all the hazards of technical, institutional, and human realities, to overcome any obstacles without getting people in the position of not abiding by the rules clearly established by the institutions and without compromising the manner in which they envision their own practices.
Trombone workshop at Lyon II University, extract from video “Biennale Hors Normes” (26’52”-27’54”)
4.3 The Workshop « Sound Laboratory » in the Lyon II University Amphitheatre
Jean-Charles François :
The last workshop of the morning, “Sound Laboratory”, led by Giacomo Spica Capobianco, bringing everyone together in the performing space of the amphitheater, in a situation quite similar to that described on the CNSMDL day, provided an opportunity to observe several new phenomena. While the system of color-coded cards worked very well as a common element in all workshops, its use in the large group performance regrouping all the activities in the amphitheater was less obvious. One is dealing here with differences of cultural conceptions: in the case of the young Africans, one can imagine that contrary to the CNSMD students, they rarely had the experience of working with a conductor. Most of them were playing without taking notice of the indications given by the conductor, the pleasure of a very new activity meant that they were more focused on their own sound production. On the other hand, some of them took great pleasure in assuming the role of conductor, with the idea of being in power to sculpt the sound matter. In the case of a very young refugee who conducted on two occasion (during the two days), we could observe a real progress in his way of determining the performance. The visual practices of respecting written organizations are not necessarily present in the conceptions that one can have of musical practices. How can we resolve the meeting of a diversity of conceptions of oral (aural) communication and their eventual structuration by visual representations?
Sound laboratory at Lyon II University, extract from video “Biennale Hors Normes” (34’55”-35’15”)
At the end of the morning, Giacomo invites the refugees to come back the next day for playing in the public presentation at 5 pm (they won’t be able to stay for the concert by the Orchestre National Urbain, as they must imperatively be back at the Refugee Accommodation Center before 8 pm). Giacomo, seeing the positive aspects of the morning, expressed in private the idea to propose to the Accommodation Center to continue to work with young residents on a regular basis, even if the stay for anyone in these centers is only for a very short time.
Guy Dallevet, visual artist, « La Sauce Singulière », Biennale Hors Normes, extract from video “Biennale Hors Normes” (26’11”-26’50”)
4.4 The Public Presentation of the Work at Lyon II « Lumière » University
Jean-Charles François :
This public presentation of the work of the various workshops took place on September 22 at 5 pm, in the large amphitheater of the Lyon II University.
Most of the refugees from the Lyon 1 Center have returned, but they have imperatively to be back there before 8 pm. The same four CNSMDL students are actively present. An indeterminate number of other Lyon University students, visitors or observers are also there, not necessarily as participants in the performance. The members of the Orchestre National Urbain are also there: Giacomo Spica Capobianco, Lucien 16s, Sabrina Boukhenous, Selim Penaranda, Odenson Laurent, and David Marduel. Karine Hahn, Joris Cintero, Noémi Lefebvre, and Guillaume Le Dréau are present representing the FEM at the CNSMD. Some of these members of the project team also take part in the performance from time to time. Guy Dallevet is present as he led the painting workshops, as representing the Hors Norme Biennial, and as president of the organizing association La Sauce Singulière.
8 different groups present 8 performances based on the same organization of instrumental stations representing the various workshops, the conductors change each time and use the color-coded cards principle.
Several questions come to mind when observing this public presentation taking place. One wonders whether there is any point in staging such an event in front of an audience. It’s the same questions that were raised in the CNSMD courtyard, presenting imperfect things in progress, and at odds with the requirements of professional performing arts. Yet there are important reasons for publishing, for reporting on what is being done: not only the main objective of the workshops is directly linked to a practice that only make sense in a public presentation, but the act of making a given activity public determines that it is not let in the secrecy of the workshop spaces, that it is offered to the critical scrutiny of all, it’s a question of laying the cards on the table. This is what differentiates the ethical idea of public education from the possible sectarian tendencies of the private sector.
The public presentation is not the simple repetition of the workshop situation. Other issues come to the fore on this occasion:
- The perspectives of a public presentation refocus the performers’ attention on the need for personal commitment and for particular presence on stage.
- To repeat the same but in a different context with additional challenges, changes the performance conditions and enriches it considerably..
- This situation also in a subtle way encourages encounters and exchanges between the diverse groups present, because the performers pay less attention to the material contingencies and have more freedom of expression.
Two questions remain in relation to the color-coded cards:
- Is the situation of an ensemble or orchestra that follows the instruction given by a conductor encouraging personal commitment, or on the contrary gives way to the possibility to hide within the mass.
- The color-coded cards can prevent the search for other temporal and organizational solutions, particularly in trying out textures and micro-variations.
These questions are important but may not automatically apply to a kind of project that is so limited in duration and involving such radically different groups.
Here are comments from a young refugee, Bouhé Adama Traoré, who participated to the Orchestre National Urbain’s project in 2024 at the Lyon III University:
Bouhé Adama Traoré, extract from video “Du corps aux mouvements, du geste aux sons” (21’31”-22’12”)
After this public performance and before the concert by the Orchestre National Urbain, refreshments were served in the BHN exhibition hall, unfortunately without the presence of the young Africans.
Part V : The Aesthetic Framework of the Idea of Collective Creation
Karine Hahn, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (18’43”-20’07”)
Jean-Charles François :
The idea of collective creation is at the core of the Orchestre national Urbain project: for collective creation to become a reality in groups that are heterogeneous in terms of geographical, social, and cultural origins, it is absolutely essential to avoid one particular group dictating its own rules and aesthetic conceptions to others. For example, accomplished musicians (as is the case with CNSMDL students) should not use their own instruments, in order to put themselves in a position of equality with those who never practiced music. And to give another example, people coming from other extra-European geographical spheres should not use songs or playing techniques issued from their own tradition.
Joris Cintéro, Lyon CNSMD, extract from video “Biennale Hors Normes” (28’50”-30’28”)
Joris Cintéro :
Several observations can be formulated concerning these issues. The first one relates to the many ‘holds’[2] offered by the device (or set-up, or agencement)[dispositif][3] to the participants, particularly when they are not musicians. In the context of an intervention like that of the Orchestre National Urbain and in these circumstances, we can consider that what is initially planned, in particular the workshops, is constantly put to the test[4] of what happens (unsuitable venues, reluctant protagonists already present and, of course, people wanting to participate when they feel like it). In this respect, this brief moment shows the extent to which this device manages to overcome the ‘test’ of its audience. In fact, the nature of the instrumentarium (which has little to do with previous ‘familiarity’ and the symbolic effects it can convey), the absence of prior aesthetic codes (which presupposes knowledge and/or mastery), of prescribed ways of doing things (holding the instrument in such and such a way) and the simplicity of a colour code that is accessible to all sighted people means that participants can expand their numbers as much as possible, along the way and simply by presenting the colour code. In the circumstances of a place where the passage of people seems to be the norm (apart from children, few people seem to stand outside), the plasticity of the system is its main strength.
Another comment concerns the ‘framing’ of the dispositif by les Orchestre National Urbain members. I hypothesise here that one of the conditions for the success of the members of this ensemble success is that it has a major role to play in distinguishing itself from the other protagonists involved. This seems to be an important issue insofar as, if there really are tensions between the residents of the Grandes Voisines and the social workers working there (as we will learn on several occasions during the day), it is in the Orchestre National Urbain’s interest to mark its distance from the latter, and to do so in several ways. It seemed to me, at least in the speeches and in the way they acted, that there was a desire to set themselves apart through the type of ‘culture’ they were promoting (which was opposed to the French chanson promoted by the Grandes Voisines representatives), in the way they took over the premises (without much success), and in the way they addressed others (by showing a form of friendliness, which, without being overdone, was a way of doing things for all the members of the Orchestre National Urbain that I was able to observe).
Jean-Charles François :
An interesting event took place in the BHN exhibition space, at a certain informal point in the morning:
A sound sculpture was exhibited in the space made of percussion instruments and various metal objects, driven by an automatic mechanical system. The sculpture was capable of developing highly rhythmic music for 45 minutes without any repeating sequences. A group of 5 or 6 refugees stood in front of this sound sculpture, and as the music of the machine was playing, they started to sing and dance music that they knew, for about ten minutes.
This situation leads to me to make three comments relating to the idea of avoiding one’s own cultural habits in the perspectives of being able to work with anyone else in constructing a collective artistic act:
- This is a spontaneous situation that must not be prevented.
- The situation involves the confrontation in equal terms between two different aesthetical practices (music produced by a machine and traditional music of African refugees) to produce a new aesthetic object proceeding from the two and combining them.
- The principle of situations that avoid institutionalized practices in different groups to create a context of equality in the face of the discomfort of the unknown applies to initial encounters between heterogeneous groups, but it doesn’t necessarily exclude other practical situations that may develop in the long run.
Jean-Charles François, percussionist, extract from video “Biennale Hors Normes” (31’10”-34’54”)
Conclusion
Jean-Charles François :
In a society increasingly fragmented into microgroups that affirm strongly their identities, often through the disqualification of others, any attempt to find mediations between seemingly incompatible universes faces considerable difficulties. Yet the key to social peace lies in actions that bring together in the same place, same time and same task, groups whose differences are radically opposed. In this kind of situation, it’s not a question of denying identities, but of opening them up to the possibility of welcoming outsiders by recognizing the terms of their mode of existence and finding work situations that bring differences together. Nor is it about creating all-purpose artistic forms, keys in hand, that would satisfy the demands of any audience, in a Olympic universal bliss. On the contrary, it’s about confronting fundamental conflicts in rituals to make them explicit and to deal with them in shared practices that don’t pretend to resolve them, but rather peacefully bring them into play (into interplay).
The actions carried out during autumn 2023 jointly by Cra.p and the Orchestre National Urbain, the FEM department within the CNSMD, and the Lyon II University within the framework of the Hors Norme Biennial correspond perfectly to this ideal of bringing different worlds together. The ways imagined to achieve this are based on three conditions that combine together: firstly, a way of structuring practices that enable the immediate functioning common to all present: instruments, materials, fields of action, color-coded cards; secondly, this structuring allows for the opening up of individual freedom: improvisation, texts; and thirdly, the practices are conceived to put everyone on an equal footing: situations designed outside specialized roles, with the impossibility of using acquired technical know-how.
Giacomo Spica Capobianco, musician, artistic director of Cra.p, extract from video “Biennale Hors Normes” (36’48”-41’10”)
Those who brazenly dare to embark on the adventure of establishing encounters between human groups who meticulously avoid rubbing shoulders with one another are being foolhardy. They have to invent ways means of implementing practices involving consideration of others, avoiding any violence, but without watering down the reality of the tensions that are in play. So often, they have often to contend with the inertia of established professionals and sometimes with intolerable refusals. Their admirable presence in the cultural and artistic landscape, too rarely recognized, is of the utmost importance.
1.Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
2. This concept, borrowed from the sociologists Christian Bessy and Francis Chateauraynaud, describes ‘the encounter between a set of categories and material properties, that can be identified by the (supposedly) common senses or by instruments of objectification’ (1992, p.105). It was initially used to study the valuation work of auctioneers, whose task can be reduced to looking for clues that make it possible to articulate the perception of the material properties of objects and the evaluation of their qualities by reference to a space of circulation – in this case, the second-hand market. Applied to the situation at stake here, it enables us to understand how certain material properties of the set-up (instrumentarium, colour code, layout of the room, quality of the materials, etc.) encourage the participants’ involvement in the sense that they do not hinder their physical and perceptive dispositions – and this helps to explain, at least initially, the difficulties encountered by the “musicians” with regard to these same material properties.
3. Considering the device as a ‘composed-object’ (concept expressed by Didier and Stavrianakis in their book Les objets composés. Agencements, dispositifs, assemblages, EHESS edition, 2018), the term here describes not only the material arrangement of the device but also the network of individuals, norms and social roles attached to it (the participants are thus an integral part of the device).
4. While the use of the term ‘test’ may well refer to the common usage we make of it, I use it here in the sense invested in it by so-called pragmatic sociology (Lemieux, 2018), which defines it as ‘a moment during which people demonstrate their skills either to act, or to designate, qualify, judge or justify something or someone’ (Nachi, 2015, p.57). Here, I consider that what is engaged by the device (the credibility of the Orchestre National Urbain, the artistic and social stakes carried by the workshops etc…) is put to the test of its realization, even if we can just as well consider the device as a test allowing to (re-) qualify the individuals who participate in it.
Quoted references:
Bessy, C., & Chateauraynaud, F. (1992). Le savoir-prendre. Enquête sur l’estimation des objets. Techniques & Culture, 20, 105 134. https://doi.org/10.4000/tc.5029
Dodier, N., & Stavrianakis, A. (Éds.). (2018). Les objets composés : Agencements, dispositifs, assemblages. Éditions de l’EHESS.
Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
Nachi, M (2015). Introduction à la sociologie pragmatique. Dunod.
Création collective nomade
Création collective nomade
Dans le cadre de la Biennale Hors Norme, Lyon.
15-23 septembre 2023
Aux Grandes voisines,
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
et Université Lumière Lyon II
Bilan sur les observations des ateliers organisés par
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
Comptes-rendus de Joris Cintéro, Jean-Charles François
et
de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p
l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et
de Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne pour le Cra.p
Sommaire :
Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain « Création collective nomade »
1.1 Le projet de l’Orchestre National Urbain
1.2 Période de préparation du projet
Partie II : Les Grandes Voisines
2.1 Ateliers aux Grandes Voisines
2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines
2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines
2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines
Partie III : Le projet au CNSMD de Lyon
3.1 Les réunions dans le cadre du projet
3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMD
3.3 L’atelier Human Beat-Box
3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.
3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon
Partie IV : Le projet à l’Université « Lumière » Lyon II
4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II
4.2 Les ateliers à L’Université Lyon II
4.3 L’atelier Laboratoire sonore dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II
4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II
Partie V : Le cadre esthétique de l’idée de création collective
Conclusion
Partie I : Le projet de l’Orchestre National Urbain,
« Création collective nomade »
Dans cet article, nous racontons sur un mode volontairement personnel la manière dont nous avons perçu le déroulement des ateliers organisés par l’Orchestre National Urbain/Cra.p dans le cadre du projet de Création Collective Nomade. Ce projet s’est déroulé du 15 au 21 septembre 2023 dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023, aux Grandes Voisines à Francheville, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMD) et à l’Université Lumière Lyon II.
Le compte-rendu de Joris Cintéro porte sur la période de préparation du projet et la journée du 15 septembre aux Grandes Voisines. Il décrit sa façon de procéder de la manière suivante :
N’ayant quasiment pas pris de notes ce jour-là (j’y allais explicitement dans l’esprit de participer), le CR suivant s’appuie essentiellement sur mes souvenirs. Ce mode d’écriture m’a justement permis de creuser ces souvenirs, à côté de photos et de vidéos que j’ai pris durant la journée – et qui m’ont également permis de « retrouver » la mémoire.
Celui de Jean-Charles François est basé sur une journée passée au CNSMD de Lyon, le 19 septembre et de deux journées à l’Université Lyon II, les 21 et 22 septembre. Il a été élaboré à partir d’observations (sans participation) et de prises de note.
Dans les deux cas, les comptes-rendus alternent descriptions, contextualisations et bribes d’analyse qui demandent à être approfondies.
Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne, membres de l’Orchestre National Urbain/Cra.p, apportent quelques éléments d’information essentiels à la compréhension de leur démarche.
Les textes sont entrecoupés d’extrait d’une vidéo réalisée par l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p qui contient des interviews de divers participants et des segments du déroulé des ateliers.
1.1 Le Projet de l’Orchestre National Urbain – Cra.p
Jean-Charles François :
Le projet de Création Collective Nomade a été élaboré par Giacomo Spica Capobianco dans le cadre de la Biennale Hors Norme 2023. Giacomo est directeur artistique de l’Orchestre National Urbain et de CRA.P qu’il a créé il y a plus de trente ans. Selon son site « L’équipe du Cra.p a pour objectif d’échanger des savoirs et savoirs-faire dans le domaine des musiques urbaines électro, croiser les esthétiques et les pratiques, susciter les rencontres, inventer des nouvelles formes, créer des chocs artistiques, donner les moyens de s’exprimer » (Cra.p). Le projet a été développé avec les membres de l’Orchestre National Urbain, l’équipe de la FEM [Formation à l’Enseignement de la Musique] du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL – FEM), autour de Karine Hahn, et avec l’artiste plasticien Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme (BHN).
La description du projet par ses organisateurs peut se résumer à plusieurs éléments dans un dispositif visant d’une manière générale à amener des publics très diversifiés à travailler ensemble pour produire collectivement de la musique, de la danse et de la peinture :
- Trois axes de médiation se combinent ici : a) mettre en présence des groupes sociaux très différents ; b) mettre en présence des personnes qualifiées à se nommer « artistes » (étudiants, étudiantes du CNSMD) avec des personnes a priori sans compétences reconnues dans ce domaine ; c) mettre en présence des pratiques dans des domaines artistiques différents (musique, danse, théâtre, arts plastiques, poésie).
- Les rencontres se basent sur des pratiques artistiques immédiates, faire de la musique, faire de la danse, faire de la peinture. Pour que cette mise en pratique commune n’avantage pas un groupe sur un autre elles sont organisées en sorte que toutes les personnes présentes soient mises devant des tâches qui sont nouvelles pour elles, comme par exemple jouer du trombone alors qu’on n’en a jamais fait l’expérience ou se mettre à danser si on est musicien.
- Le dispositif est structuré dans une série d’ateliers animés par les membres de l’Orchestre National Urbain :
Sébastien Leborgne (Lucien 16’s), beat box and spoken voice.
Rudy Badstuber Rodriguez, MAO et éléments de percussion.
Selim Penaranda, violoncelle.
Odenson Laurent, trombone.
Sabrina Boukhenous, mouvements corporels.
Clément Bres, batterie.
Giacomo Spica Capobianco, Laboratoire sonore, un atelier regroupant après coup toutes les activités des autres ateliers, dans des perspectives de création collective.
Les ateliers peinture sont animés par Guy Dallevet pour la Biennale Hors Norme.
Le point commun à ces ateliers (sauf pour la peinture) très différents en termes de manipulation de matériaux, est constitué d’une série de codes couleurs définissant des modes de jeu :
a) orange = vent soutenu ;
b) blanc = ralenti graduel ;
c) rouge = rythme répété (trois noires et un soupir) ;
d) marron = 8 pulsations régulières ;
e) noir = arrêt au sol, silence ;
f) bleu = peur, tremblement, énergie ;
g) vert = improvisation libre.
Les diverses mises en pratique des différents ateliers sont toutes basées sur l’exploration de ces codes couleurs.
- Une autre activité importante initiée par les membres de l’Orchestre National Urbain, c’est l’élaboration personnelle de textes appelés à être parlés (en rythmes précis ou librement) lors de la rencontre sur la scène de tous les éléments des ateliers.
- Les personnes présentes suivent chaque atelier l’un après l’autre dans des groupes d’une dizaine de personnes. À la suite de cela tout le monde se retrouve dans un ensemble général – Le Laboratoire Sonore – composé de diverses stations : trombone, violoncelle, voix (microphone), batterie, des objets divers suspendus à un portique, 2 stations « electro » (loops, jeu avec les doigts sur un pad), un spicaphone (genre de guitare électrique à une corde construite par Giacomo Spica), un instrument à cordes tendues sur un cadre en métal (dénommé miroir sonore), une guitare électrique posée horizontalement pour être jouée comme un instrument de percussion, un espace pour la danse. Un chef ou une cheffe est désignée parmi les participants pour organiser la performance en montrant au fur et à mesure les cartons de codes couleur. Dans l’esprit de Giacomo, il ne s’agit pas là de « sound painting », celui ou celle qui dirige doit seulement montrer des couleurs et indiquer un niveau sonore général, sans imposer une énergie particulière. L’expérience du dispositif à montré que dans la pratique les personnes qui participent au dispositif (dans et en dehors des membres de l’Orchestre National Urbain) mettent souvent une « énergie particulière » dans la direction – se baisser pour incarner une nuance, jouer à échanger rapidement les cartons, faire en sorte qu’une partie seulement de l’ensemble soit concernée par un carton, etc…).
- A un moment donné, dans l’institution où se passe les ateliers, une restitution générale du travail réalisé est présentée en présence d’un public extérieur (c’est ce qui s’est passé au CNSMDL à l’issu de deux jours de travail, et à l’Université Lyon II à l’issue de deux journées de travail). A l’université, cette restitution a été suivie d’un concert par l’Orchestre National Urbain.
Le projet lié à la Biennale Hors Norme s’est déroulé dans trois lieux différents :
- Les 15 et 16 septembre au Grandes Voisines, à Francheville près de Lyon, qui se décrivent dans leur site comme « un tiers-lieu social et solidaire où il est possible de dormir, manger, travailler, peindre, découvrir une exposition, participer à une chorale… et vivre des rencontres » (Les Grandes Voisines). Ce lieu d’hébergement accueille des réfugiés en attente de régulation. C’est ce public particulier qui a été visé pendant les deux journées de pratique.
- Les 18 et 19 septembre au CNSMD de Lyon, dans le cadre du programme de la Formation à l’Enseignement en Musique (FEM). Deux journées d’atelier, occasion d’une rencontre autour de pratiques entre les étudiants de la FEM et les réfugiés hébergés aux Grandes Voisines, avec une présentation publique du travail à la fin de la deuxième journée.
- Les 20 et 21 septembre, à l’Université Lumière, Lyon II, ateliers avec les réfugiés et les étudiants de l’université et du conservatoire (sur la base du volontariat) avec une restitution du travail en fin de journée du 21 septembre, suivie le soir d’un concert de l’Orchestre National Urbain.
1.2 Période de préparation du projet
Joris Cintéro :
Au moment où j’écris ces lignes, je ne me souviens pas tout à fait clairement des circonstances dans lesquelles on m’a présenté le dispositif pour la première fois. Je me souviens seulement de plusieurs bribes de discussion avec Karine me décrivant un « projet auquel on participe avec le Cra.p » dont la première étape se déroule « à Francheville, dans un centre d’accueil pour réfugiés », et que « les étudiants et les étudiantes ont été tenu·e·s au courant » de longue date. J’ai des souvenirs quant aux objectifs que l’on fixait pour les étudiantes et étudiants à travers un dispositif comme celui-ci, particulièrement aux Grandes-Voisines : rencontre avec une altérité dont nous supposons qu’elle n’est pas fréquente dans l’ordinaire de leur travail de pédagogues, création de moments musicaux pensés pour inviter un public non rompu aux traditions de ladite musique savante occidentale, adaptation dans des circonstances peu propices à l’enseignement artistique et bien entendu, prise de recul sur les enjeux sociaux et politiques de l’enseignement artistique.
Quelques jours avant la première séance aux Grandes Voisines [GV], Karine rappelle aux étudiants et aux étudiantes de la formation CA la teneur du projet. Après les avoir interrogés pendant un moment collectif sur la possibilité de se rendre aux Grandes Voisines le vendredi et/ou le samedi, nous nous rendons compte que très peu d’entre elles et eux se trouvent être disponibles pour venir avec nous ces jours-là. C’est le cas d’un seul étudiant en première année (Grégoire), que nous connaissons à ce moment-là, assez mal – la formation n’ayant démarré que depuis une semaine. Le groupe dans sa quasi-totalité nous a fait savoir de leur souhait de pouvoir venir, mais de leur impossibilité à participer à cause d’un manque de temps ou n’ayant pas reçu l’information à temps.
Nous soulignons également la nécessité, pour celles et ceux souhaitant venir, d’apporter des instruments qui soient susceptibles d’être manipulés par des enfants – je me souviens d’ailleurs avoir maladroitement insisté là-dessus, laissant penser qu’il ne s’agissait de travailler qu’avec des enfants et que ces derniers seraient particulièrement peu soigneux. Les réponses des étudiant et des étudiantes nous amènent à découvrir que très peu disposent de plusieurs instruments de musique.
Partie II. La Création collective nomade aux Grandes Voisines
2.1 Ateliers aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Le samedi 16 septembre 2023, après avoir récupéré une vieille guitare classique chez moi et la harpe électrique de Karine à Villeurbanne, nous nous rendons tous deux aux Grandes Voisines en voiture et arrivons en milieu d’après-midi, aux alentours de 15h30. Karine se gare sur le parking de l’entrée, à deux pas d’une sorte de guérite défraichie (vide ?) permettant de surveiller les allées et venues au centre d’accueil. C’est un peu loin du lieu où se déroulent les ateliers (il faut dire que la signalétique n’était pas très claire et que rien de l’extérieur n’annonce la Biennale Hors-Normes). Après un court appel téléphonique, Giacomo nous fait signe au loin de nous approcher et nous accueille.
Je rencontre pour la première fois les membres de l’Orchestre National Urbain, qui sortent alors d’une salle dans laquelle sont entreposés différents instruments. S’ensuit une visite « critique » rapide des lieux en compagnie de Giacomo. Nous découvrons un dédale de pièces, de portes, de couloirs et sommes informés rapidement de l’organisation du lieu. En effet, Giacomo connaît déjà bien l’endroit (l’Orchestre National Urbain est déjà intervenu dans les lieux) et a connu des tensions avec certains des acteurs et actrices qui y travaillent. Au cours de la visite, je comprends assez rapidement qu’il y a des difficultés de communication entre les acteurs (et leurs institutions respectives) quant à la gestion du lieu et qu’une partie des artistes présentes et présents dans le cadre de la Biennale Hors-Normes [BHN] ne sont pas « sur la même longueur d’ondes » que Giacomo.
J’ai l’impression d’un lieu labyrinthique qui peine à cacher les stigmates de son ancien usage (hôpital pour personnes âgées). Bien que certains couloirs soient bardés de peintures et d’œuvres en tous genres, que certains points extérieurs laissent percevoir une activité artistique (sculptures etc…), le lieu dégage une certaine froideur (néons, faux-plafond, peintures grisâtres, dalles fendues, etc…) typique des bâtiments administratifs, des maisons de retraite ou encore des hôpitaux. Certaines pièces paraissent un peu glauques et sentent l’humidité – c’est le cas de la salle de concert au rez-de-chaussée du bâtiment, qui se tient en lieu et place de l’ancienne chapelle du bâtiment. Pour ajouter à cette impression, Giacomo ajoutera durant la visite que les tables d’autopsie sont toujours présentes dans les sous-sols du bâtiment. On aperçoit au loin un stade de foot dont on peine à comprendre l’usage dans un hôpital gériatrique et des affiches présentant une installation qui doit s’y tenir. Je suis frappé à ce moment-là par la « valse » des clés qui accompagne cette visite, sensation probablement due à l’agacement dont fait part Giacomo vis-à-vis du fait qu’il soit nécessaire de fermer derrière soi « au cas où », « parce que certains réfugiés n’hésitent pas à se servir » ou parce que le matériel ne peut être surveillé en notre absence (et celle des membres de l’Orchestre National Urbain qui animent les ateliers).
Après un tour d’une bonne quinzaine de minutes où nous repérons où se déroulent les différents ateliers nous revenons au point de départ sous la sorte de barnum où l’équipe de l’Orchestre National Urbain nous avait accueilli un peu plus tôt. Il fait assez chaud, et Grégoire, le seul étudiant du CNSMDL ce jour-là, vient d’arriver.
Une fois la visite terminée, Giacomo souligne au détour d’une phrase la difficulté majeure de l’après-midi, difficulté que nous ne tardons pas à observer : personne ne s’est inscrit pour participer aux ateliers. Cette situation s’explique d’après lui du fait que les travailleuse et travailleurs sociaux intervenant sur le lieu n’ont pas relayé l’information aux usagers du lieu (en effet on n’a pas vu d’affiches pendant la visite et nous croisons des personnes travaillant sur le lieu qui ne sont pas au courant de la tenue d’ateliers musicaux), manque de communication s’expliquant lui-même par une brouille entre les porteurs de projet de la BHN et l’organisation du lieu – dont on apprendra un peu plus précisément, par la suite, la teneur. C’est donc sans aucun enfant/adulte, en dehors d’Omet – un usager du lieu qui n’est d’ailleurs pas initialement présenté/catégorisé comme un bénéficiaire du dispositif mais plutôt comme un membre à part entière de l’activité – que commence la journée.
En l’absence de public, les membres de l’Orchestre National Urbain ne se démontent pas et nous invitent à commencer à jouer, Karine, Grégoire, Omet et moi-même, en leur compagnie dans l’atelier sonore collectif (le laboratoire sonore de Giacomo).
2.2 L’atelier collectif « Laboratoire sonore » aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
Giacomo nous présente un atelier musical collectif similaire aux ateliers de groupe qui seront proposés par la suite au CNSMDL et à l’Université Lumière Lyon 2. Il s’agit d’une improvisation collective dirigée par un chef, officiant seulement par le biais d’un jeu de cartons colorés indiquant des intentions musicales particulières devant orienter le groupe improvisateur.
L’instrumentarium est le suivant :
– Instruments de « lutherie urbaine » : Spicaphone / Harpe-miroir [amplifiés]
– Instruments électroniques : (Korg monotribe/Kaosspad/Roland SP 404SX/MicroKorg)
– Pédales d’effet (Whammy avec Spicaphone)
– Microphone [amplifié]
– Instruments acoustiques (Caisse claire, guitare électrique, « baguettes chinoises » en guise de baguettes de batterie)
La console et les différents câbles qui permettent l’amplification des instruments ne sont pas utilisés comme moyens de jeu dans le dispositif.
Le jeu de cartons comprend 7 couleurs associées aux conventions décrites ci-dessus. À ce jeu de « code-couleur » s’ajoute la possibilité de faire varier le volume sonore du groupe improvisateur en signalant avec la main plus ou moins haute.
L’instrumentarium est ce jour-là disposé tout autour du chef ou de la cheffe. L’atelier se déroule dans une grande salle au lino vert, dotée de plusieurs baies vitrées (certaines occultées par des rideaux), donnant directement sur l’extérieur – permettant ainsi aux personnes qui passent de voir (et accessoirement d’entendre) ce qu’il s’y passe. Si elle n’est pas pour ainsi dire centrale dans l’architecture du centre d’accueil, cette salle se trouve néanmoins dans le passage des piétons et des voitures et donne sur plusieurs autres bâtiments – ce qui aura son importance pour la suite de la journée.
L’atelier démarre donc par le biais d’une explication de Giacomo qui en présente les différents aspects, mettant notamment l’accent sur le code couleur et les objectifs visés (travailler sur la matière sonore, libérer les éventuelles inhibitions de chacun, créer un espace d’égalité entre musicien·ne·s et non musicien·ne·s, etc…). Étant moi-même impliqué tout au long du dispositif, je ne sais pas tout à fait combien de temps chaque improvisation a duré. La seule chose que je sais c’est que les tours d’improvisation ont cessé une fois que tout le monde avait « cheffé » au moins une fois – certain·e·s répétant l’exercice plusieurs fois.
L’atelier débute. Tout le monde semble prendre beaucoup de plaisir à jouer de la sorte. Les remarques des personnes présentes tiennent essentiellement à la difficulté de se remémorer dans l’instant des conventions associées aux cartons colorés (j’ai dû attendre le 4ème ou 5ème tour pour m’aligner « correctement » sur les cartons), aux nuances proposées par le/la cheffe ainsi qu’au plaisir de jouer sur des instruments « exotiques » (la harpe-miroir et le spicaphone particulièrement). Presque chaque « tour » d’atelier se clôt par une discussion sur ce qui vient de se passer, discussion portant essentiellement sur des questions musicales (l’intention des chefs, les nuances etc…). Les premiers ateliers se passent « très bien » dans la mesure où il me semble que la majorité des personnes présentes sont rompues à l’exercice.
Durant les improvisations on voit parfois passer des groupes d’adultes, d’enfants, de parents qui pour certains s’approchent discrètement de la salle – feignant pour la plupart ne pas être vus. C’est au gré de ce flux qu’un homme d’une petite quarantaine d’années, accompagné de sa fille d’environ 5 ans se joignent à nous. Assez réservé, il déclare dès le début venir « pour sa fille », qui semble particulièrement heureuse et enjouée au moment où les membres de l’Orchestre National Urbain l’invitent à se joindre à l’improvisation collective. L’enfant participe à plusieurs « tours » d’atelier accompagnée par différentes personnes (qui la mettront sur un fauteuil pour qu’elle puisse jouer sur le Microkorg par exemple ou recadreront son jeu vis-à-vis des cartons colorés) et le père endossera le rôle du chef une fois – en plus de participer à quelques tours d’atelier lui-aussi. D’abord réticent au fait-même de participer (il comptait seulement regarder sa fille), il se joint à nous à la demande de Giacomo et se « détend » peu à peu, sans qu’il témoigne pour autant d’une forme de lâcher prise (que j’interprète par le fait que les participants se prêtent totalement au jeu et qu’ils se trouvent par moments dépassés par celui-ci). Le père et sa fille quittent la pièce après plusieurs tours d’ateliers, visiblement heureux d’y être passés.
Une fois la salle fermée nous passons dans la pièce adjacente dans laquelle se tient un atelier d’improvisation au violoncelle et de peinture.
2.3 Atelier violoncelle peinture aux Grandes Voisines
Karine Hahn, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (11’19”- 11’44”)
Joris Cintéro :
L’atelier violoncelle-peinture est dirigé par Selim Penaranda (pour le violoncelle) et une personne (pour la peinture) dont j’ai oublié le nom (dont j’apprendrais par la suite qu’elle remplaçait Guy Dallevet, absent ce jour-là). Il se déroule dans une salle, grande mais assez encombrée de cartons, de peintures, de sculptures et d’objets divers.
L’organisation de l’atelier est assez simple. On a d’un côté Selim avec 3 violoncelles (un acoustique et deux électriques amplifiés) et de l’autre l’intervenante peinture avec un ensemble de feuilles, de peinture acrylique, de cartons pour l’étaler et de tenues de protection qui sont visiblement usées – la pièce semble utilisée très souvent pour réaliser des activités de ce genre, en témoignent les nombreuses peintures affichées aux murs et les tâches de peinture dans l’évier. Dans le même esprit que les productions qui suivront le reste de la semaine, ce dispositif consiste dans une interaction entre les groupes qui peignent et les groupes qui font du violoncelle. L’atelier se termine par des improvisations individuelles au violoncelle au départ d’un support peint par l’interprète.
Lucien 16’s (Sébastien Leborgne) sur les relations musique et peinture, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (3’48”-4’48”)
L’activité violoncelle dirigée par Selim s’organise toujours de la même manière.
1. Présentation de l’instrument et du dispositif.
2. « Tâtonnement » à l’instrument.
3. Improvisation dirigée avec code couleur. Cette activité nécessite au moins deux personnes
qui jouent, (dont Selim parfois) et une personne qui dirige.
Selim présente dans un premier temps le violoncelle en jouant quelques notes et soulignant de façon récurrente qu’il n’y a pas de bonne position pour en jouer, que l’essentiel c’est d’être à l’aise en jouant. Dans ce sens, il n’hésite pas à montrer des positions que l’on pourrait qualifier d’hétérodoxes vis-à-vis de la représentation commune du jeu au violoncelle qui est associée à une position dite « classique » (l’instrument se tient entre les jambes, les pieds à terre, le manche de l’instrument reposant sur l’épaule). Il met, à dessein, les pieds sur les bords du violoncelle, montrant qu’il est possible de procéder ainsi pour en jouer. Même chose du côté de l’archet qu’il propose de tenir de plusieurs manières différentes soulignant, comme il le fera plus tard au CNSMDL, que « ça peut se tenir comme une poignée de porte ». Il n’empêche pas, toutefois, les personnes présentes de tenir l’instrument et l’archet de façon « conventionnelle ». Une fois ce « rituel » de présentation accompli, il laisse les participants explorer sur le violoncelle tout en présentant la suite de l’atelier qui consiste en une improvisation avec une autre personne.
La personne qui « cheffe » durant l’atelier alterne au fur et à mesure de l’avancement de ce dernier. Le code utilisé est le même que dans l’atelier précédent.
De l’autre côté de l’atelier, on trouve la peinture, qui s’organise de façon tout aussi récurrente. L’encadrante présente la tâche à réaliser, c’est-à-dire peindre une toile en s’imprégnant de l’ambiance sonore créée du côté des violoncellistes et ceci à l’aide d’un bout de carton, permettant de réaliser, comme le montre l’encadrante, des formes circulaires pluri-colores. En somme il s’agit de verser quelques gouttes de peinture (une ou plusieurs couleurs) sur la toile, et d’étaler avec le support cartonné la peinture sur une feuille en réalisant des sortes de spirales.
Le lien entre les deux parties de l’atelier ne semble pas évident pour tout le monde, en témoignent, lors d’une pause dans le violoncelle où je jette un œil à l’autre partie de l’atelier, certain·e·s peintres ne prêtant aucun cas à la musique (ce qui n’est pas tout le temps vrai puisque les silences trop longs amènent les peintres à parfois gentiment râler de l’absence de musique pour peindre). Je prends quelques photos de l’atelier.
L’atelier se termine par une série d’improvisations individuelles sur le violoncelle, réalisées à partir d’un support visuel, c’est-à-dire la peinture réalisée plus tôt dans l’atelier. Personne parmi ceux et celles habitant le lieu ne viendra nous rejoindre durant le dispositif. Nous décidons de faire une pause après une petite heure de travail collectif.
Atelier violoncelle et peinture aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (5’45”-12’28”)
2.4 Atelier trombone aux Grandes Voisines
Joris Cintéro :
La pause est l’occasion de s’allumer une cigarette, de boire un peu d’eau et de discuter plus généralement des dispositifs proposés et de l’absence de public. Si l’ambiance est très amicale, je sens tout de même une forme de déception chez les membres de l’Orchestre National Urbain. Je me dis aussi à ce moment-là qu’en effet, mobiliser autant de monde sur deux jours pour si peu de public constitue une perte de temps et d’argent considérable. On disserte un peu sur le lieu, ses défauts (on y serait logé par « ethnie ») et sur le fait qu’en dehors de son esthétique hospitalière, on n’y semble pas si mal accueilli que ça. On mentionne l’existence d’un bâtiment dédié aux femmes seules, public difficile à convier aux activités selon Giacomo, ces dernières ayant vécu des parcours migratoires traumatiques. Tout le monde y va de sa petite anecdote, surtout celles et ceux qui connaissent déjà le lieu.
L’après-midi avançant, Odenson Laurent, jeune membre de l’Orchestre National Urbain joue quelques notes au trombone. Ces notes ont l’effet d’un appel. Plusieurs enfants se rapprochent, timidement d’abord puis de façon plus directe ensuite. Ils et elles veulent jouer et nous le font savoir. Giacomo et Sébastien se précipitent pour récupérer les trombones qui avaient été entreposés dans une pièce du bâtiment. La scène donne l’impression qu’on est pris de court, le « public » afflue enfin, il s’agirait de ne pas louper le coche.
Les étuis des trombones arrivent et sont posés à la va-vite à terre. Le moment est assez intéressant dans la mesure où nous nous mettons toutes et tous (qui ont participé des ateliers précédents) progressivement à « cadrer » cet atelier qui prend forme. Ici on désinfecte les embouchures à l’alcool, là on montre à un enfant comment s’attrape et se tient le trombone, à côté on fait patienter celles et ceux qui attendent leur tour.
Atelier de trombone aux Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (0’23”-0’56”)
Odenson prend la main de l’atelier, parle fort (il faut dire que les enfants sont nombreux et pressés de jouer) et donne à voir comment on souffle dans l’embouchure du trombone. La majorité des enfants y arrivent. Il propose une série d’exercices/jeux où il s’agit d’abord de souffler fort une fois. Les enfants s’exécutent avec succès, rient et réessaient sans attendre l’invitation d’Odenson. Le volume sonore augmente rapidement, les enfants semblent emballés par l’activité. Odenson propose ensuite de jouer avec la coulisse. Certains enfants font tomber la coulisse (il faut dire que dans certains cas, les trombones sont aussi grands que celles et ceux qui les jouent), ce qui entraîne les rires des autres et l’impatience de ceux qui attendent leur tour – certains viennent alors en aide à leurs camarades en tenant la coulisse. Les enfants semblent visiblement très heureux de l’expérience qu’ils viennent de vivre. De nouvelles têtes qui font leur apparition : plusieurs femmes commencent à arriver et certaines se penchent aux balcons pour voir ce qu’il se passe.
Rebelote, on nettoie les embouchures, on donne quelques informations aux enfants sur la façon de tenir le trombone (chacun y va un peu de son conseil), on fait patienter celles et ceux qui passeront après, on invite les femmes qui viennent d’arriver à tenter l’expérience. On se partage les rôles pour y arriver : Karine est par exemple invitée à convaincre une habitante des lieux de se joindre à l’exercice, ce qu’elle parvient à faire.
Il est intéressant de noter que si en dehors d’Odenson, personne ne « joue » du trombone (du moins personne ne se catégorise comme étant « tromboniste ») tout le monde s’autorise le fait de montrer aux enfants comment on souffle dans l’embouchure, comment réaliser le mouvement des lèvres permettant d’y arriver ou de montrer comment se tient l’instrument – par exemple dans l’entre deux à celles et ceux qui attendent ou directement à celles et ceux qui sont en train de participer à l’atelier.
Après plusieurs passages, l’atelier s’arrête et les membres de l’Orchestre National Urbain échangent avec les femmes et les enfants présents pour les prévenir de la journée du lendemain et de la poursuite des ateliers.
Photos des Grandes Voisines, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (2’37”-3’33”)
Partie III : le projet de Création Collective Nomade au CNSMD de Lyon
3.1 Les réunions dans le cadre du projet
Jean-Charles François :
Avant de commencer les ateliers de chaque journée, l’équipe de L’Orcherstre National Urbain a l’habitude de se réunir afin de (re-)définir le contenu de la journée à venir, à partir d’un bilan des actions qui ont directement précédées.
Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne :
Premier temps, « Réunion d’équipe » :
Le directeur artistique (Giacomo Spica Capobianco) fait un point avec tous les artistes intervenants de l’Orchestre National Urbain. Ces réunions permettent d’évaluer les ateliers collégialement afin de faire évoluer le projet. Ces moments de discussion permettent d’échanger sur les évolutions, les contraintes, les difficultés rencontrées.
Afin de proposer le programme de la journée, un point préalable est prévu et permet de s’adapter aux situations vécues au jour le jour.
Deuxième temps, « Réunion d’équipe avec les stagiaires » :
Chaque matin un moment de discussion est programmé avec tous les stagiaires.
Ce moment et évidemment important étant donné qu’aucun niveau de sélection n’est requis au préalable, autant sur un plan technique que sur un plan social, les stagiaires vont être sujet à travailler collectivement.
Il est important que les uns aillent vers les autres pour une rencontre plus constructive vers une réflexion de création improbable.
L’intérêt est de faire comprendre au stagiaire qu’il est au service du projet au sein d’une création collective.
Tous les ateliers sont filmés.
Il est important d’avoir un support vidéo de chaque atelier afin que tous les membres de l’équipe de l’Orchestre National Urbain découvrent le travail de l’autre. Cela permet de faire évoluer le projet.
Jean-Charles François :
Par exemple, voici la description d’une telle réunion qui s’est déroulée lors de la deuxième journée d’ateliers au CNSMDL, le matin du 19 septembre 2023. Cette réunion regroupe l’équipe de l’Orchestre National Urbain et celle de la Formation à l’Enseignement de la Musique du CNSMDL.
Giacomo fait part des problèmes rencontrés au Centre d’accueil des Grandes Voisines. Il semble que les personnels encadrants du centre n’ont pas très bien organisé la venue du l’Orchestre National Urbain. Apparemment peu d’information a été donnée aux réfugiés, en conséquence il a fallu que les membres de l’orchestre se mettent à jouer dans la cour pour accueillir les personnes qui passaient et les inviter à participer. Ce sont surtout des enfants et les mères de ces enfants qui ont participé. En conséquence seulement un réfugié a pu venir participer aux journées de rencontre au CNSMDL. Giacomo résume les objectifs de la journée qui consiste à la possibilité de se prendre en main à partir d’éléments à travailler qui sont nouveaux pour les étudiants. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas le droit d’utiliser leur propre instrument. Pour Giacomo, on n’est pas là pour dicter des comportements mais pour se mettre en situation d’une recherche collégiale en vue de se projeter dans des pratiques à faire avec tout public.
3.2 L’atelier « laboratoire sonore » au CNSMDL
Jean-Charles François :
La séance du matin du 19 septembre 2023 se déroule dans la salle de musique d’ensemble qui comporte une estrade. Un large espace sur la scène est organisé avec une série de stations instrumentales (instruments traditionnels, simples instruments construits, instruments électroniques, voix amplifiée) comme décrit ci-dessus. Un espace en dehors de cette estrade est réservé à la danse. Les étudiants sont partagés en trois groupes. Ceux ou celles qui ne participent pas à la performance d’un groupe sont assis par terre ou sur des chaises en dehors de ces deux espaces.
La séance commence par un échauffement du corps de 10 minutes animé par Sabrina Boukhenous. Elle est membre de l’Orchestre National Urbain, comédienne, directrice d’acteur et technicienne son-lumière. Son rôle dans l’Orchestre est de prendre en charge le corps en mouvement et le spoken word. L’échauffement se déroule dans la bonne humeur et le plaisir de faire : frottements de mains, exercices de respiration, mettre en action les différentes parties du corps, sauter, etc.
Concernant le travail d’atelier de Sabrina Boukhenous, voici un extrait d’un atelier qui s’est tenu dans le cadre d’un projet similaire à celui qui est décrit dans ce document: « Du corps aux mouvements, du geste aux sons », Université Lyon III, 2024 :
Atelier de Sabrina Boukhenous. Extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (9’30”-10’50”)
La première partie du matin (9h20-10h45) se déroule dans la salle d’ensemble, dans la configuration décrite ci-dessus. Les activités expérimentées lors des différents ateliers qui se sont tenus la veille (le 18 septembre) et qui ont été suivis par toutes et tous, sont maintenant regroupées dans un seul ensemble : jeu sur divers instruments, voix amplifiée et corps en mouvement. Il y a trois groupes d’une quinzaine de personnes qui se succèdent sur l’espace de l’estrade et utilisant aussi l’espace de la danse, pour expérimenter des situations avec une personne dirigeant à l’aide des cartons de couleur. Les temps de séquences de performance varient de 2 minutes à 4 minutes. Elles sont suivies à chaque fois d’une courte période (entre 4 et 10 minutes) pour exprimer des réactions, des sentiments ou proposer des actions, parfois soulever des questions importantes. À chaque fois la direction de l’ensemble et les différents rôles changent librement, les danseurs devenant instrumentistes, la voix parlée est assumée par quelqu’un d’autre, etc.
Laboratoire sonore au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (17’25”-18’42”)
Un des aspects spécifiques du dispositif est la présence des textes écrits lors des ateliers, lus à haute voix à travers le microphone placé sur scène à cet usage. Selon les consignes données par Giacomo, la voix n’a pas à suivre les codes couleur, mais déroule son débit en solo, selon le choix de celle ou celui qui le lit. La difficulté principale est de pouvoir entendre clairement la voix parlée, soit que les protagonistes n’ont pas l’habitude du micro, soit qu’ils manquent d’assurance ou d’énergie, soit encore que le niveau sonore des instruments reste trop fort, le regard porté sur les cartons de couleurs ne permettant peut-être pas une écoute immédiate de ce que font les autres. Giacomo assez tôt dans la séance montre au micro comment la voix doit s’engager plus franchement. Lors de la période de jeu du groupe 3, à un moment donné, il est décidé de ne pas utiliser les codes couleur, mais de se baser uniquement sur la voix avec la nécessité de pouvoir comprendre le texte, la voix devenant le chef d’orchestre. Après avoir essayé cette idée, un court débat a lieu sur des notions d’improvisation : la nécessité de l’écoute, la question des réactions par rapport aux énergies en présence, par rapport aux propositions, l’idée de laisser la place aux autres, notamment au texte. À la fin de cette première partie de matinée, une situation est expérimentée avec 3 personnes à la voix lisant leur texte.
La présence des textes, donne à plusieurs reprises l’occasion de soulever la question de l’engagement physique (notamment par Giacomo) et vis-à-vis du sens qu’on met dans le texte. Il est bien sûr très difficile de s’engager de manière immédiate dans une activité qu’on fait pour la première fois, lorsqu’on ne sait pas où cela va mener. Mais la difficulté de l’engagement chez les étudiants provient aussi du fait qu’on n’adhère pas (encore) à quelque chose trop éloigné des valeurs esthétiques qu’on défend au quotidien dans le conservatoire. Les comportements induits par la musique savante européenne écrite sur partition impliquent à la fois un engagement profond des compositeurs dans leurs projets esthétiques, et au contraire un détachement assumé des interprètes appelés à jouer une diversité d’esthétiques. On pourrait dire que dans ce contexte, l’engagement de l’interprète ne se fait qu’au moment de prestation en public, dans une posture où, comme chez les acteurs de théâtre, l’engagement approprié est « joué ». Dans ce contexte, on n’a pas l’habitude de se lancer corps et âme dans n’importe quelle activité sans auparavant avoir pu mener une réflexion à son sujet, l’esthétique n’est donc pas un engagement mais un jeu. L’engagement des interprètes du secteur qu’on appelle « classique » se manifeste surtout vis-à-vis de la manière d’envisager la production sonore et par là, leur identité principale est tournée vers leur instrument ou leur voix. Le corps de l’être humain occidental tend à être déconnecté de la signification, le corps doit construire la signification par le biais de contextes particuliers, avec le risque de ne pas accéder à un état plus fondamental dans lequel le corps assume et croit en sa propre production de signification. Or il existe beaucoup de pratiques musicales (et de danse) où l’engagement des performers n’est pas séparé des conditions de production et où la signification est fondamentale dès le départ, c’est-à-dire à tous les niveaux de compétence. C’est le cas notamment des pratiques musicales de l’Orchestre National Urbain et au sein des actions qu’il mène dans les quartiers défavorisés.
Certains étudiants ont décidé d’être présents aux séances, mais de ne pas participer aux pratiques proposées et d’être là en observateurs. C’est une infime minorité, 2 ou 3 parmi la cinquantaine de présents. Giacomo avait bien spécifié qu’il était permis d’avoir cette attitude, qu’il n’y avait pas d’obligation à participer à l’action. Pourtant l’un d’entre eux a rejoint le groupe actif au moment où ont été essayées des improvisations non basées sur les codes couleur et sans la présence d’un chef, en suivant les évolutions d’un texte ou en se laissant influencer par la danse. Il a pris la guitare électrique posée à l’horizontal, l’a accordée selon la norme et s’est mis à la jouer dans la position habituelle du jeu à la guitare.
Pour la danse, les termes de « mouvements du corps » sont souvent utilisés pour bien marquer qu’il s’agit d’une part de déplacements libres dans l’espace et d’autre part qu’il n’y a pas une ambition artistique à caractère technique qui empêcherait la participation immédiate de toute personne présente. La danse n’est pas utilisée pendant la première partie du groupe 1, puis petit à petit prend plus d’importance. Très vite on voit la nécessité pour le chef ou cheffe de voir la danse (autant que d’écouter les instruments) pour influencer les décisions de changement de couleur. Avec le groupe 3 (après l’expérimentation de suivre le texte) il est décidé que la musique soit influencée par la danse plutôt que de suivre les codes couleur. Comme dans le cas du texte, cet essai suscite un débat sur les rapports danse-musique : sont abordées les questions de l’imitation en miroir, des conditions de suivi collectif des musiciens, du risque de l’empire d’un domaine artistique sur un autre et de la nécessité d’une communication qui circule. Une idée est proposée : une improvisation où tous ces axes de travail se mélangent.
Concernant la présence d’une personne qui dirige avec les cartons de couleur, la pratique effective soulève au fur et à mesure plusieurs questions. Un des aspects importants est qu’à chaque séquence de jeu, il y a une nouvelle personne qui dirige, il n’y a donc pas l’écueil du développement de « spécialistes » de cette activité, et il y a une distribution démocratique des différents rôles. Mais ce dispositif précisément tend à renforcer la représentation générale qu’ont les personnes présentes du pouvoir dominateur du chef d’orchestre. Aussi, ceux et celles qui en assument le rôle, ont tendance à surinvestir le pouvoir qui leur est donné : il ne s’agit pas seulement de montrer des codes couleur et d’indiquer des niveaux d’intensité sonore, il s’agit par des attitudes corporelles exagérées de faire passer des informations aux instrumentistes pour qu’elles soient respectées, on est rapidement dans une situation similaire au « sound painting ». Ce surinvestissement de et sur la personne du chef, résulte dans la domination de l’œil sur l’oreille, avoir à regarder constamment le chef empêche de se concentrer à la fois sur sa propre production et sur l’écoute de la production des autres.
La dualité oralité-écriture est un élément très important qui se joue dans le contexte du CNSMD et des formes musicales qui en définissent les contours. Mais l’enjeu paraît tout à fait différent s’agissant de contextes dans lesquels toute personne (quel que soit son niveau de compétences et son origine sociale) peut accéder de manière quasiment immédiate à des pratiques musicales artistiques. Dans ce cas, il convient pour y parvenir de manière convaincante d’inventer des mécanismes très précis. Vers la fin de cette première partie de matinée, Giacomo rappelle le contexte pédagogique du travail en cours : la difficulté est de faire des choses dans des contextes de culture défavorisés, ou dans le cas de la rencontre entre différentes cultures. Comment construire des activités qui dès le début offrent la possibilité de se confronter à des enjeux fondamentaux mais de manière accessible, comment faire construire par celles et ceux qui participent leurs propres situations significatives. L’accès à des comportements actifs priment au début sur toute considération de qualité artistique ou de comportements normalisés. Les codes couleur et la présence d’une personne qui les manipule pour donner une forme à la performance assurent dans tous les contextes un accès rapide à une pratique effective, dans laquelle les enjeux artistiques ne sont pas du tout réglés, mais qui pourtant sont déjà inscrits dans le contenu de l’action.
3.3 L’atelier Human Beat-Box
Joris Cintéro :
La journée du 16 septembre (aux grandes Voisines) se clôt par le biais de l’atelier de Sébastien Leborgne (Lucien16), centré sur le Human beat-box. Sébastien est membre de l’Orchestre National Urbain et artiste rap, spoken word.
L’atelier se déroule dans une salle à l’intérieur du bâtiment. La salle est particulièrement petite et se trouve dans le passage d’un couloir, en face de plusieurs ascenseurs : il y a un peu de passage.
L’atelier mobilise assez peu de matériel : quelques feuilles de papier, une console, un looper, un micro ainsi qu’une enceinte permettant d’amplifier le tout.
Sébastien décrit le déroulement de son atelier. Il commence par expliquer le principe du Human beat-box. Pour ce faire, il dessine sur une feuille plusieurs instruments. On voit une grosse caisse, une caisse claire ainsi qu’une cymbale charleston. Il montre directement le son qui peut être associé à chacun des éléments dessinés sur la feuille en les pointant du doigt. Il met ensuite en pratique ce qu’il dit en enregistrant une boucle de beat-box.
Par la suite il demande aux participants de l’atelier (qui sont essentiellement des membres de l’Orchestre National Urbain et du CNSMDL) de réaliser une boucle eux-mêmes. Durant les ateliers un groupe de 3 enfants s’arrête pour écouter ce qu’il se passe. Sébastien les invite à essayer à leur tour de produire une boucle avec le looper. Les enfants rient semblent gênés mais s’exécutent néanmoins. Il en profite pour leur demander s’ils sont disponibles le lendemain pour participer à l’atelier. Cet atelier se déroule dans un temps particulièrement limité au regard des précédents, donnant à voir la plasticité du dispositif mis en œuvre par les membres de l’Orchestre National Urbain – ainsi que les difficultés, visiblement, régulières auxquelles se heurte le collectif.
Jean-Charles François :
Pendant la deuxième partie de la matinée du 19 septembre (au CNSMDL), j’ai assisté à un atelier de « Human beat-box » animé par Sébastien Leborgne (Lucien 16’s).
L’agencement technique du studio au CNSMDL consiste en un micro pour amplifier la voix du soliste, avec une machine qui permet l’échantillonnage des sons produits et la mise en boucle, pour créer des rythmes répétitifs, avec possibilité de superposer les échantillonnages de productions vocales. Plusieurs micros sont à disposition pour pouvoir enregistrer plusieurs voix en même temps.
L’introduction par Sébastien définit le contexte de production de rythmes par l’imitation vocale de sons de batterie (beat box) sur lesquels on va pouvoir parler un texte.
La première expérimentation concerne l’imitation à la voix de sons de grosse caisse, de charley, de caisse claire, et de les enregistrer pour les mettre en boucle. On crée une boucle sur laquelle les participants peuvent ajouter une autre production vocale pour former une nouvelle boucle.
La situation suivante décrite par Sébastien concerne a) l’élaboration d’une boucle rythmique avec 4 vocalistes ; b) puis le placement du texte sur cette structure rythmique. Sébastien dit que les étudiants doivent réaliser cette tâche en complète autonomie, il n’est là que pour répondre à des questions éventuelles. La réalisation de la boucle se fait assez facilement sans qu’il y ait beaucoup de temps pour essayer plusieurs exemples. L’ajout du texte sur la boucle inventée pose plus de problème, car les participants lisent leur texte sans inflexions rythmiques, indépendamment du contenu de la boucle. Sébastien suggère que la boucle qui accompagne le rythme du Human Beat box corresponde au caractère du texte et non l’inverse : « vu que ce texte est un rêve », la boucle doit refléter cette atmosphère.
Nouvel essai d’élaboration d’une boucle beat box à cinq voix superposées. Une étudiante dit son texte sur la boucle. Elle tente de faire corresponde son texte au caractère rythmique de la beat box. Sébastien fait remarquer que l’enjeux principal n’est pas de correspondre au rythme de la boucle, mais de « s’imposer sur le rythme ». Le spoken word consiste à ne pas se soumettre au rythme de base, mais d’être guidé par l’émotion juste et vraie. L’étudiante refait la lecture de son texte sur la boucle, mais s’arrête assez vite.
Quelqu’un demande s’il est possible de chanter le texte. Réponse de Sébastien : « tu peux faire ce que tu veux ». Une étudiante essaie alors de parler son texte et de le chanter en partie.
En observant cet atelier, il apparaît clairement que le problème principal des étudiants du CNSMDL dans ce projet se trouve dans cette activité très nouvelle pour eux et elles d’avoir à écrire un texte et surtout de le parler avec un accompagnement rythmique.
Atelier Human beat box au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes »(13’25”-14’29”)
3.4 Restitution du travail des ateliers dans la cour du Conservatoire.
Jean-Charles François :
Dans l’après-midi du 19 septembre, une restitution du travail réalisé dans les ateliers a été proposée à l’ensemble de la communauté du CNSMDL, dans la cour intérieure juxtaposant la salle de concert. Un dispositif de diffusion des sons amplifiés avait été installé et l’espace était organisé de manière similaire à ce qu’on avait eu dans la salle de musique d’ensemble, une combinaison regroupée d’instruments autour d’une voix, un espace pour les mouvements de danse et les productions de peinture exposées à même le sol. Le public (peu nombreux en dehors des participants eux-mêmes) était assis sur les marches devant le bâtiment de la salle de concert.
Les trois groupes proposent des performances dans lesquelles il y a des musiciens, des danseurs et des « déclameurs » de texte avec souvent un changement de rôle au milieu. Dans l’attitude des performers, il y a un effet de compensation du fait que la production encore trop expérimentale ne correspond pas aux critères d’excellence artistiques en usage au CNSMD. Il s’agit semble-t-il de montrer a) le plaisir de faire une activité non conventionnelle, b) d’accentuer le côté énergique de l’expérience, c) de montrer qu’on est dans une situation de divertissement dans laquelle on peut se contenter de n’être engagé qu’à moitié et d) parfois de faire ressortir le caractère ironique par rapport à cette situation d’inconfort. Il n’y a pourtant aucune agressivité dans ces attitudes vis-à-vis de ce qui a été proposé, mais plutôt un problème de positionnement vis-à-vis de la communauté dans laquelle la restitution est proposée.
Dans le groupe 2, un chef très « compositeur » développe une forme qui met en scène des éléments dans une sorte de narration qui permet au texte d’émerger. Grâce à ce savoir-faire « maison », on se rapproche plus de ce qui pourrait éventuellement être accepté par l’institution comme artistiquement valable.
Restitution dans la cour du CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (20’35”-22’46”)
Lors de cette restitution, à un moment donné, une professeure du CNSMD est venue dans la cour pour manifester avec véhémence son désaccord avec ce qui était proposé et notamment le niveau sonore de l’amplification qui l’empêchait de faire cours.
En dehors de l’équipe de la FEM, partenaire du projet, aucune représentation de la direction du CNSMD n’était présente lors de cette restitution. Le directeur est pourtant très favorable au développement de ce type de projet.
3.5 Journée de bilan du projet le 10 octobre au CNSMD de Lyon
Jean-Charles François :
Une journée de bilan du projet a été organisée au CNSMD de Lyon avec les personnes qui ont participé en tant qu’encadrants du projet et les étudiants de la FEM.
A) Réunion de bilan des encadrants de l’Orchestre National Urbain/Cra.p
et du CNSMD de Lyon
La matinée a commencé avec une réunion de l’équipe d’encadrants, pendant que les étudiants et étudiantes se sont réunies séparément dans des petits groupes 4 ou 5 pour préparer ce qu’ils allaient dire lors de la séance générale de retour d’expérience. Étaient présents à la réunion de l’équipe : pour le Cra.p, Giacomo Spica Capobianco et Sébastien Leborgne ; pour le CNSMD Karine Hahn, Joris Cintéro, Guillaume Le Dréau ; et moi-même, Jean-Charles François en tant qu’observateur extérieur pour PaaLabRes.
Voici en vrac les questions posées lors de la réunion :
- Quels sont les aspects formatifs du projet pour les étudiants et à travers quelles problématiques ?
- Quels sont les enjeux du projet ?
- Penser l’après projet : d’autres partenariats avec l’Orchestre National Urbain ou d’autres cadres ?
Les étudiantes et étudiants ont eu à se confronter de manière pratique à des enjeux musicaux pensés dans une continuité avec des contextes sociaux et politiques. Ils et elles ont dû manipuler, fabriquer des sons dans des situations de transversalité et de transdisciplinarité, c’est-à-dire en se confrontant à des matériaux musicaux inconnus, à envisager des pratiques impliquant plusieurs domaines artistiques simultanément, et à rencontrer des cultures différentes de leur environnement social et artistique. Leurs représentations esthétiques ont été remises en question par ces diverses approches. Les aspects pédagogiques du projet étaient centrés sur l’expérimentation de pratiques musicales ouvertes à tous et toutes quelles que soient les capacités, sur l’invention de dispositifs en vue de la rencontre avec l’altérité. Les deux questions essentielles ont été : comment faire faire de la musique ensemble avec tout public ? Et qu’est-ce que c’est exactement de monter un projet dans des lieux et des circonstances déterminés ?
Deux réflexions critiques apparaissent dans le cours de cette réunion :
- Le problème de la valse des étiquettes prévalentes dans chaque milieu culturel qui classifient une fois pour toute les pratiques, soit pour les porter aux nues, soit plus souvent pour les considérer comme non digne d’intérêt, soit encore pour les rationnaliser pour mieux les contrôler dans l’ordre dominant des choses. Comment dans les rencontres transversales, trans-esthétiques, envisager des situations où une certaine indétermination des matériaux va pourvoir faire émerger des terrains esthétiques nouveaux et communs aux diversités en présence ?
- Le problème du tourisme intellectuel et artistique est prévalent aujourd’hui dans beaucoup de programmes d’enseignement supérieur au nom de l’accès à la diversité du monde. Les expériences de cette diversité se multiplient dans le cours d’une formation sans qu’il y ait assez de temps pour approfondir les contours d’une seule situation. L’enrichissement culturel va souvent de pair avec une incompréhension des enjeux majeurs des diverses pratiques. Comment dans des situations de temps limités sortir de cette difficulté ?
L’Orchestre National Urbain a comme cahier des charges le « tutorat », il est ouvert en permanence à des demandes de formation et de développement de projets ou de lieux.
B) Bilan avec les étudiantes et étudiants du CNSMD
Chaque groupe d’étudiants présente tour à tour les conclusions de leur réflexion. Le groupe d’étudiantes et étudiants ayant été présent aussi à l’Université Lyon II prendra la parole en dernier. Dans l’ensemble la tonalité des retours est en très grande majorité très positive, les objectifs artistiques, sociaux et politiques d’une telle action sont bien compris et les mises en pratiques ont été vécues de manière significative. Voici les différents éléments qui ont été exprimés :
- L’idée de désacraliser l’instrument de musique. L’instrument n’est plus considéré comme une entité spécialisée, mais plutôt comme un objet comme un autre susceptible de produire des sons. L’accès immédiat de tous à la production sonore permet une mise en situation de tous les enjeux présents dans la pratique musicale, que ce soit du côté des techniques de production que des questions artistiques. La nécessité de produire une musique à partir de matériaux qu’on ne maîtrise pas au premier abord permet de sortir des logiques d’expertise et met tous les participants à un niveau égal de compétences. Pour un des étudiants, on est proche des démarches de l’art brut et de Fluxus. Cela devrait permettre les rencontres effectives entre participants d’origine différente. Les instruments bricolés (ou le bricolage des instruments) permettent d’envisager une façon différente de considérer la matière sonore, le timbre, l’utilisation de sons généralement considérés comme étrangers au monde de la musique.
- Déclamer un texte avec les instruments. Cet aspect est sans doute l’élément le plus difficile à réaliser pour des spécialistes de musique instrumentale. Le « Human beat-box » est vécu comme l’activité qui suscite le plus l’invention de matières sonores par le biais de simples rythmes.
- L’improvisation à partir de consignes simples à réaliser. C’est ce qui rend possible d’être maître de sa propre production. C’est un moyen de s’approprier l’improvisation de manière décomplexée. Cela crée une dynamique de la production immédiate découplée des préoccupations de ne jouer que ce qui est complètement maîtrisé.
- Les logiques de l’amplification sont ce qui est le plus mal connu des étudiants du CNSMDL, cette première approche a été très appréciée.
- Le rôle de la direction d’orchestre : il faut oser assumer ce rôle pour contrôler la forme générale d’une improvisation, dans les perspectives de construire une composition instantanée. Pour une partie des étudiants/étudiantes, la présence du chef est un obstacle à l’improvisation qui implique une responsabilité individuelle et demande à être abordée de manière moins urgente pour permettre l’établissement de dialogues sans passer par l’autorité du chef ou de la cheffe.
- L’idée de faire des choses immédiatement avant toute réflexion est un élément important des pratiques qui ont été proposées. Il y a l’urgence de se mettre à faire des choses sans se poser de questions, de faire ce qu’on ne maîtrise pas encore avant d’envisager les moyens à employer pour y arriver.
- Un aspect important du projet est d’encourager la participation du public, comme ce qui s’est passé à la fin du concert de l’Orchestre National Urbain (à l’Université Lyon II) où tout le monde s’est mis à danser dans l’amphithéâtre de l’Université.
Parmi les problèmes soulevés par le projet, certains ont noté une organisation du temps qui a paru parfois trop lente et parfois trop courte. L’ennui ou la frustration est à l’origine d’une certaine fatigue. Il y a une inquiétude au sujet de la notion de « travail », induit par cette situation d’immédiateté du faire qui peut instiller l’idée d’une dévaluation très forte de la notion d’art. Une étudiante fait part de sa frustration devant les niveaux d’amplification trop forts et l’absence de sons consonants, qui résultent en une grande fatigue chez elle. Plusieurs personnes ont noté l’absence de relations entre l’atelier de peinture et la musique.
Le problème de la restitution dans la cour du Conservatoire a fait l’objet d’un vif débat. La situation allait complètement à l’encontre de la culture dominante de l’institution vis-à-vis d’une grande exigence d’excellence dans toute prestation. En plus la restitution utilisait des moyens de production musicale très peu en usage au sein de l’institution, dans un style indéfini par rapport aux contextes en vigueur. Les niveaux d’amplification rendaient impossible d’ignorer cet évènement dans les moindres contours du Conservatoire. Les étudiants étaient donc placés devant l’obligation de faire quelque chose qui allait entrer directement en conflit avec la communauté alentour et qui risquait de les disqualifier. Beaucoup des participants se demandent si cette idée de restitution était vraiment nécessaire à la conduite générale du projet. Les étudiants ont dû faire face aux nombreux commentaires ironiques de leurs collègues présents à la restitution. Une phrase a été retenue à ce sujet : « Les ploucs de la cour ! ». D’autre termes avaient été prononcés comme celui de « dégénérés » aux connotations historiques plus inquiétantes. Une médiation était peut-être nécessaire auprès du public avant la restitution en vue d’expliquer la situation et son contexte pédagogique.
Joris Cintéro, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (22’50”-23’44”)
Dans les réponses apportées par les membres de l’encadrement du projet la nécessité de rendre public une activité peu commune dans les pratiques du Conservatoire reste d’une importance capitale, ce n’est pas une question générale qu’il conviendrait de balayer sous les tapis de l’anonymat, mais quelque chose qui a besoin d’être mise « sur la table » des réflexions actuelles sur l’art et de sa transmission à tous les publics.
Pour Giacomo la restitution au CNSMD n’était pas prévue au départ, mais l’impossibilité d’avoir tous les étudiants présents à Lyon II pour la restitution générale du projet a changé la donne. Il comprend la frustration des personnes présentes au niveau « art », mais il convient de déplacer le problème du côté de la légitimité des activités proposées. Pour lui, la question est de savoir comment les institutions d’enseignement de la musique vont mettre en place des dispositifs en vue d’ouvrir leurs activités à des personnes n’ayant aucun accès aux pratiques. Il fait remarquer que le problème le plus évident dans son travail au sein des diverses institutions dans lesquelles il développe ses projets, c’est l’attitude souvent négative des personnels de l’encadrement, professeurs, animateurs, travailleurs sociaux, etc. Ceux-ci défendent leur pré carré et ont souvent une attitude qui consiste à penser que les personnes placées sous leur autorité doivent se plier à leur propre mode de pensée. S’ils ne sont pas impliqués directement dans le projet, le déroulement du projet est fortement menacé. La connaissance effective d’un projet par l’institution d’accueil dans sa totalité est un élément essentiel pour commencer à faire vivre une idée.
Lorsque les animareurs culturels sont bien disposés envers les projets de l’Orchestre National Urbain, les choses se passent de manières très positives. Voici un exemple d’un commentaire de Khadra Hamyani, aide éducatrice au « Forum Réfugié », lors de la participation de jeunes réfugiés à un projet développé par le Cra.p à l’Université Lyon III en 2024 intitulé « Du Corps aux mouvements, du geste aux sons »:
Khadra Hamyani, extrait de la vidéo « Du corps aux mots, du geste aux sons » (2’37”-5’34”).
Karine Hahn rappelle qu’il y eu d’une part une visite de Giacomo l’année d’avant la réalisation du projet a été l’occasion de présenter en détail les contours et enjeux du projet, d’autre part une page de présentation du projet et de ses objectifs a été distribuée peu de temps avant sa réalisation. Dans un contexte où souvent les personnes impliquées ne comprennent pas de la même manière les termes d’un projet, ou même il peut arriver qu’elles comprennent exactement le contraire de ce qui est proposé, toute médiation semble peu utile pour éviter l’expression conflictuelle. Ce qui compte par contre, c’est l’affirmation par l’action d’une légitimité.
Joris Cintéro souligne la difficulté qu’ont les institutions à questionner par des enquêtes leurs propres manières de fonctionner, notamment en matière de recrutement des personnes présentes. La dernière enquête sur la composition sociale des étudiants du CNSMD de Lyon date de 1983[1], elle a montré qu’il y avait la présence de 1% d’enfants d’agriculteurs et 2,8% d’ouvriers, etc.
La question de la restitution s’inscrit dans les divers contextes de difficultés par rapport à l’administration générale des institutions et aux personnes qui y travaillent.
Une étudiante présente à l’Université Lyon II note qu’au début du premier jour, personne n’était présent disposé à travailler avec l’Orchestre National Urbain, il n’y avait pas eu de publicité de la part de l’institution d’accueil, pas de soutien. Il a fallu faire des efforts immenses pour rameuter 5 personnes disposées à s’impliquer.
Pour Giacomo, la résistance de l’Université dans ce projet est évidente, il n’y a pas de professeurs impliqués, rien n’avait été fait pour faciliter les choses. On a l’impression que parce que ça ne coûte pas d’argent, il faut que ça se casse la gueule. Le soir du premier jour se pose la question de savoir s’il convient de continuer le lendemain. La réponse est définitivement qu’il faut absolument continuer, il faut persister et jouer avec la situation.
Pour Joris, 5 ou 6 participants sur 29500 étudiants on est loin du compte dans le domaine de la culture.
Sébastien Leborgne décrit en détail le fonctionnement des Grandes Voisines, avec la présence de 415 réfugiés hébergés, beaucoup de femmes et d’enfants.
Karine décrit le démarrage aux Grandes Voisines : tout est prêt à 10 heures du matin, le setup technique est en place, l’équipe prête à travailler, mais personne n’est là pour participer. Mais cette préparation garantit d’être pris au sérieux, l’équipe est là, devant personne, avec le même sérieux que s’il y avait des gens présents. Petit à petit les gens passent par là, ça se met en branle, ça existe, ça marche de toute façon.
Dans le courant de l’après-midi, une vidéo de 11 minutes montre de manière fragmentée ce qui s’est passé aux Grandes voisines. Un des segments qui frappe particulièrement est un quatuor de trombones composé de trois enfants et une mère jouant et en même temps évoluant dans des mouvements corporels d’une grande cohérence collective.
Dans les diverses réponses aux préoccupations des étudiants par les personnes de l’encadrement du projet, on notera les choses suivantes :
- Concernant la question de la nécessité d’un faire immédiat rapidement mis en place, au prix d’un contrôle de qualité, Giacomo souligne que la plupart du temps, les projets qu’il mène dans les différents contextes se déroulent dans des temporalités très limitées, le passage du groupe est souvent éphémère. Ici le faire doit absolument précéder la théorie.
- La question du long terme est abordée en mettant l’accent sur l’existence du Cra.p comme centre de pratiques, comme lieu de formation permanente, avec aussi l’objectif de permettre à des personnes issues des quartiers défavorisés d’accéder à des programmes diplômants d’enseignement supérieur.
- Le choix des instruments utilisés fonctionne sur deux plans : d’une part, il faut permettre une première approche pratique de jeu sur des instruments réputés pour demander des années de travail ; jouer de manière immédiate du trombone et du violoncelle peut susciter l’envie d’apprendre à jouer ces instruments sérieusement. Et d’autre part donner aussi accès à des matériaux qu’on peut manipuler facilement au premier abord. Giacomo donne l’exemple de la guitare électrique à six cordes qui nécessite de montrer comment on en joue, alors que le « spicaphone », instrument qu’il a construit avec une seule corde donne un accès plus immédiat à une pratique effective.
Au sujet de l’accès de tout public aux pratiques musicales, Giacomo rapporte l’histoire d’une mère, lors d’une performance donnée par son fils, qui pleure en disant « je ne savais pas que mon fils pouvait avoir le droit de faire de la musique ». Dans des pans entiers de population, les gens pensent que l’accès à des pratiques artistiques leur est complètement interdit. La question des droits culturels est essentielle. Karine remarque le manque de lieux ouverts aux pratiques : où sont les espaces existant hors « formations structurées » ou écoles spécialisées dont l’accès est limité ? En dehors du Cra.p, il y a un manque crucial.
Photos du projet au CNSMDL, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (13’08-13’56”)
Partie IV : Le projet de Création Collective Nomade
à l’Université Lumière Lyon II
4.1 Matinée du 21 septembre à L’Université Lyon II
Jean-Charles François :
La session du matin du 21 septembre 2023, se déroule au sein de l’Université Lumière Lyon II (sur les quais du Rhône) dans l’espace où sont exposées des œuvres d’art dans le cadre de la Biennale Hors Norme et dans le grand amphithéâtre.
Étant donné les difficultés rencontrées aux Grandes voisines, au dernier moment 20 réfugiés adolescents (tous masculins) du Centre d’hébergement du 1er arrondissement de Lyon ont pu venir participer à cette matinée et à la restitution du lendemain en fin d’après-midi. Ils ne pouvaient être là que pendant une heure et demie (10h.-11h.30) étant donné les règles strictes du Centre concernant les repas. Trois étudiantes et un étudiant du CNSMD étaient présents de manière volontaire. Des étudiants de Lyon II et des visiteurs de l’exposition de la BHN pouvaient participer aux ateliers, mais cela a été un phénomène très marginal. Giacomo m’a fait part de ce qui s’était passé la veille (le 20 septembre), où un certain nombre d’étudiants de l’Université Lyon II avaient participé aux ateliers, au gré de leur passage dans la salle d’exposition. Ceci malgré le fait qu’aucune publicité n’avait été faite auprès des étudiants. Leur participation dépendant de leur passage dans l’espace des activités et de leur intérêt éventuel pour ce qui était proposé.
C’est un aspect qui arrive souvent aux actions menées par Giacomo et l’Orchestre National Urbain : s’ils sont souvent invités officiellement à développer leurs projets dans une institution, des obstacles ne manquent pas de se manifester de la part des personnels internes à l’institution. Les raisons de ce manque de coopération s’expliquent soit parce que ce qui est proposé vient empiéter sur des prérogatives installées, soit qu’on ne voit pas d’un bon œil la présence de personnes étrangères à l’institution (ou à son public habituel). Dans tous les cas, l’attitude de l’Orchestre National Urbain est de s’installer dans un espace donné et de susciter l’intérêt des personnes qui s’y trouvent ou qui passent par là.
Voici les commentaires d’une étudiante de la Formation à l’Enseignement du CNSMD de Lyon qui a particpé à un projet similaire de l’Orchestre National Urbain en 2024 à l’Université Lyon III intitulé « Du corps aux mouvements, du geste aux sons »:
Marie Le Guern, étudiante en formation à l’enseignement, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (8’47”-9’07”)
4.2 Les ateliers
Jean-Charles François :
Étant donné le temps limité par la présence des jeunes réfugiés, l’organisation des ateliers a été limitée à 15 minutes. Cela permettait à 5 groupes de participer à 5 ateliers l’un après l’autre, puis un regroupement général des participants dans l’amphithéâtre de 15 minutes. Cette organisation n’a pas été complètement réalisée dans le temps imparti, chaque groupe n’a participer en fait qu’à 4 ateliers (parmi les 6 proposés) avant la séance dans l’amphithéâtre.
6 ateliers proposés étaient (comme au CNSMD):
a. Danse.
b. Violoncelle.
c. Trombone.
d. Beat box.
e. MAO.
f. Laboratoire sonore.
g. Peinture.
Ateliers à l’Université Lyon II (MAO, Human beat box, violoncelle, trombone), extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (23’58”-26’10”)
Les ateliers se déroulaient dans le grand espace de l’exposition BHN et dans deux espaces adjacents. Le principe était exactement le même que celui décrit plus haut, avec pratique immédiate des matériaux et utilisation des codes couleur. Il s’agit des mêmes mises en situation déjà décrites auparavant, inutile donc de les décrire en détail.
Du fait du temps limité et du nombre déséquilibré entre le groupe du Centre d’hébergement et les autres participants, peu d’interactions entre les différents publics ne pouvaient avoir lieu lors de cette matinée. Certains groupes n’étaient composés que de membres du groupe de réfugiés. Dans le cas de l’atelier peinture, j’ai pu observer une situation de deux grandes feuilles de papiers juxtaposées sur lesquelles dessinaient deux groupes complètement séparés : le premier groupe n’était composé que de réfugiés masculins noirs Africains, le deuxième seulement d’étudiantes blanches Françaises.
La situation de disponibilité limitée du groupe du Centre d’hébergement demandait absolument que la matinée soit centrée principalement sur l’accueil approprié et l’organisation des activités des réfugiés, les autres participants ayant eu d’autres opportunités de participer dans des temps plus longs à tous les ateliers et situations de performance en grand groupe. De ce point de vue, le dispositif proposé a remporté un très grand succès auprès du public visé. Les réfugiés se sont engagés dans les diverses mises en pratique proposées dans les ateliers avec un grand intérêt et une énergie considérable. Une des forces de l’équipe de l’Orchestre National Urbain/Cra.p est la capacité à s’adapter de manière immédiate à toutes les situations possibles, à faire face aux aléas des réalités techniques, institutionnelles, humaines, à contourner tous les obstacles sans pour autant mettre les personnes dans la situation de ne pas respecter les règles clairement établies et sans compromettre la façon d’envisager leurs propres pratiques.
Atelier trombone à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’52”-27’54”)
4.3 L’atelier « Laboratoire sonore » dans l’amphithéâtre à l’Université Lyon II
Jean-Charles François :
Le regroupement de tout le monde dans l’atelier « Laboratoire sonore » animé par Giacomo Spica Capobianco dans le grand Amphithéâtre, dans une situation tout à fait similaire à celle décrite dans la journée du CNSMDL, a été l’occasion d’observer plusieurs nouveaux phénomènes. Si le système des codes couleur a très bien fonctionné pendant cette matinée comme élément commun à tous les ateliers, son utilisation dans le regroupement des diverses activités dans l’amphithéâtre a été moins évidente. On avait là affaire à des représentations culturelles différentes : on peut spéculer que contrairement aux étudiants du CNSMDL, les jeunes Africains avaient rarement fait l’expérience d’un travail avec un chef d’orchestre. La plupart d’entre eux jouaient sans prendre en compte les indications données par les codes couleur, le plaisir d’une activité très nouvelle les centrait sur leur propre production. Par contre, certains d’entre eux ont éprouvé un grand plaisir à se trouver dans le rôle du chef, dans l’idée de pouvoir en quelque sorte sculpter la pâte sonore. Dans le cas d’un très jeune réfugié qui a dirigé à deux occasions (sur les deux jours), on a pu observer un progrès certain dans sa manière de déterminer la forme de la prestation. Les pratiques visuelles de respect d’une organisation écrite ne sont pas forcément présentes dans les représentations qu’on peut avoir des pratiques musicales. Comment résoudre la rencontre de la diversité des conceptions de la communication orale (aurale) et de sa structuration éventuelle par des représentations visuelles ?
Laboratoire sonore à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (34’55”-35’15”)
A l’issue de cette matinée, Giacomo invite les réfugiés à revenir le lendemain pour la restitution à 17 heures (ils ne pourront rester au concert de l’Orchestre National Urbain car ils doivent impérativement être rentrés dans le Centre à 20 heures). Giacomo au vu des aspects très positifs de la matinée exprime en privé, l’idée qu’il faut absolument proposer au Centre d’hébergement de continuer à faire un travail régulier avec les jeunes résidents, même si le temps de résidence de toutes personnes dans ces centres reste très limité.
Guy Dallevet, Artiste plasticien, « La Sauce Singulière », Biennale Hors Normes, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (26’11”-26’50”)
4.4 La restitution à l’Université Lumière Lyon II
Jean-Charles François :
La restitution du travail des divers ateliers a eu lieu le 22 septembre à 17 heures, dans le grand amphithéâtre de l’Université « Lumière », Lyon II.
La grande majorité des jeunes du Centre d’hébergement sont revenus, mais ils doivent impérativement être de retour avant 20 heures. Les mêmes 3 étudiantes et 1 étudiant du CNSMD sont activement présents. Un nombre indéterminé d’autres participants, étudiants de Lyon II ou visiteurs, observateurs sont aussi là, pas forcément en tant que participants aux performances. L’équipe de l’Orchestre National Urbain est là : Giacomo Spica Capobianco, Lucien 16s, Sabrina Boukhenous, Selim Penaranda, Odenson Laurent et David Marduel. Karine Hahn, Joris Cintero, Noémi Lefebvre et Guillaume Le Dréau sont présents représentant l’équipe de la FEM du CNSMD. Certaines de ces personnes faisant partie de l’encadrement du projet participent aussi de temps en temps aux performances. Guy Dallevet est présent en tant qu’animateur des ateliers de peinture et représentant la Biennale Hors Norme en tant que président de l’association organisatrice La Sauce Singulière.
8 groupes différents présentes 8 performances selon la même organisation de stations instrumentales des ateliers regroupés, la présence de chefs et cheffes qui tournent constamment, et le principe des codes couleur.
En observant le déroulement de cette restitution, plusieurs questions viennent à l’esprit. On peut se demander si une telle mise en situation devant un public a sa raison d’être ? Et ceci à la suite aussi de la restitution des ateliers dans la cour du CNSMD et de la question de présenter des choses imparfaites en gestation, de se mettre en porte-à-faux par rapport aux exigences du spectacle vivant professionnel. Il y a pourtant des raisons importantes à publier, à rendre compte ce qu’on fait : non seulement l’objectif principal des ateliers est directement lié à une pratique qui n’a de sens que dans une présentation publique, mais l’acte de rendre public une activité donnée détermine qu’elle n’est pas laissée dans le secret des salles d’atelier, qu’elle est offerte au regard critique de tous, il s’agit de mettre cartes sur table. C’est ce qui différencie l’éthique de l’enseignement du service public des possibles dérives sectaires du privé.
La restitution n’est pas la simple répétition du travail d’atelier. D’autres enjeux se font jour à cette occasion :
- L’idée même de présenter quelque chose en public recentre l’attention des participants sur la nécessité d’un engagement et d’une présence particulière sur scène.
- La répétition du même mais dans un contexte différent avec des enjeux plus étoffés change les conditions de la prestation et l’enrichit considérablement.
- La situation favorise aussi de manière subtile les rencontres et échanges entre les divers groupes en présence, parce que l’attention des performers est partiellement libérée des contingences purement matérielles.
Restent deux questions liées au dispositif des codes couleur :
- Est-ce que la situation d’un ensemble (orchestre ?) dépendant des instructions d’un chef est favorable à l’engagement personnel, ou bien est-elle l’occasion au contraire de se cacher dans la masse ?
- Les codes couleur peuvent empêcher la recherche d’autres solutions temporelles et organisationnelles, notamment dans la recherche de continuités de textures et de micro-variations.
Ces questions sont générales et ne s’appliquent peut-être pas de manière immédiate à un projet aussi limité dans le temps et impliquant des groupes aussi radicalement différents.
Voici un commentaire d’un jeune réfugié, Bouhé Adama Traoré, qui a participé au projet de l’Orchestre National Urbain en 2024 à l’Université Lyon III:
Bouhé Adama Traoré, extrait de la vidéo « Du corps aux mouvements, du geste aux sons » (21’31”-22’12”)
Après la restitution et avant le concert de l’Orchestre National Urbain, un pot a été offert dans la salle d’exposition de la BHN, malheureusement sans la présence des jeunes réfugiés.
Partie V : Le cadre esthétique de l’idée de création collective
Karine Hahn, CNSMDL de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (18’43”-20’07”)
Jean-Charles François :
L’idée de création collective est au centre du projet de l’Orchestre National Urbain : pour que la création collective puisse devenir une réalité dans les groupes hétérogènes en termes d’origines géographiques, sociales et culturelles, il faut absolument éviter qu’un groupe particulier dicte aux autres ses propres règles et conceptions esthétiques. Il convient plutôt de trouver des contextes dans lesquels les différentes personnes présentes ne puissent pas se baser exclusivement sur leurs pratiques usuelles. Par exemple, les musiciens ou musiciennes accomplies (comme dans le cas des étudiants du CNSMDL) ne doivent pas utiliser leurs propres instruments, afin de se mettre dans une situation d’égalité vis-à-vis de celles et ceux qui n’ont jamais fait de musique. Et pour donner un autre exemple, les personnes issues d’autres sphères géographiques extra-européennes ne doivent pas utiliser des chants ou des modes de jeu provenant de leur propre tradition.
Joris Cintéro, CNSMD de Lyon, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (28’50”-30’28”)
Joris Cintéro :
Plusieurs remarques peuvent être formulées à ce sujet. Tout d’abord, une première liée aux nombreuses « prises »[2] qu’offre le dispositif[3] aux participants et participantes particulièrement lorsqu’ils et elles n’ont pas l’habitude de jouer de la musique. Dans le cadre d’une intervention comme celle de l’Orchestre National Urbain et dans ces circonstances, on peut considérer que ce qui est prévu initialement, et notamment les ateliers, est constamment mis à l’épreuve[4] de ce qui arrive (des lieux peu adaptés, des personnes déjà présentes réticentes et bien entendu des personnes souhaitant participer quand ça leur chante). À ce titre, ce court moment montre à quel point ce dispositif parvient à surmonter l’« épreuve » de son public. En effet, la nature de l’instrumentarium (qui renvoie difficilement à un « connu » antérieur et aux effets symboliques qu’il peut véhiculer), l’absence de codes esthétiques préalables (qui suppose leur connaissance et/ou leur maîtrise), de manières de faire prescrites (tenir son instrument de telle ou telle manière) et la simplicité d’un code couleur accessible aux personnes voyantes permet à celles et ceux qui participent d’élargir, autant que possible, leur nombre, en cours de route et moyennant seulement la présentation du code couleur. Dans les circonstances d’un lieu où le passage des personnes semble être la norme (en dehors des enfants, peu de personnes semblent stationner à l’extérieur), la plasticité du dispositif constitue sa force principale.
Autre remarque, celle du « cadrage » du dispositif par les membres de l’Orchestre National Urbain. Je fais ici l’hypothèse qu’une des conditions de félicité de l’action des membres de cet ensemble repose sur un enjeu majeur de distinction vis-à-vis des autres acteurs en présence. Cet enjeu semble important dans la mesure où, s’il existe véritablement des tensions entre les résidents d’un lieu tel que les Grandes Voisines et les travailleuses et travailleurs sociaux y officiant (comme on l’apprendra à plusieurs reprises pendant la journée), l’Orchestre National Urbain a tout intérêt à marquer sa distance vis-à-vis des dernier.es, et ceci de plusieurs manières. Il m’a semblé, au moins dans les discours et dans les manières d’agir une volonté de se singulariser via le type de « culture » dont il est fait la promotion (qui s’oppose à la chanson française promue par le personnel des Grandes Voisines), dans les manières d’investir les lieux (sans grand succès), dans les manières de s’adresser à autrui (en manifestant une forme de convivialité, qui sans être surjouée, constitue une manière de faire de la totalité des membres de l’Orchestre National Urbain que j’ai pu observer).
Jean-Charles François :
Pourtant, dans l’espace d’exposition de la BHN à l’Université Lyon II, à un moment donné informel du matin s’est déroulé un évènement intéressant :
Était exposée dans cet espace une sculpture sonore fait d’instruments de percussion et d’objets métalliques divers actionnés par un système mécanique automatisé. La sculpture était capable de développer une musique très rythmée d’une durée de 45 minutes sans répétitions de séquences. Un groupe de 5 ou 6 réfugiés s’est placé devant cette sculpture et en même temps que la musique qu’elle déroulait ils se sont mis à chanter et danser des musiques qu’ils connaissaient de leur tradition, pendant une séquence d’une dizaine de minutes.
Cette situation suscite trois commentaires par rapport à l’idée d’éviter ses propres habitudes culturelles dans des perspectives de pouvoir travailler avec n’importe qui d’autres dans l’élaboration collective d’un acte artistique :
- Il s’agit d’une situation spontanée qu’il ne faut surtout pas empêcher.
- La situation implique la confrontation à égalité de deux pratiques esthétiques différentes (la musique produite par une machine, la musique traditionnelle des réfugiés Africains) pour produire un nouvel objet esthétique qui procède des deux et qui les combinent.
- Le principe de situations évitant les pratiques instituées dans différents groupes pour créer un contexte d’égalité devant l’inconfort de l’inconnu s’applique aux rencontres initiales entre groupes hétérogènes, mais n’exclut pas forcément d’autres situations pratiques qui peuvent se développer par la suite.
Jean-Charles François, percussionniste, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (31’10”-34’54”)
Conclusion
Jean-Charles François :
Dans une société de plus en plus fragmentée en microgroupes qui affirment leur identité de manière forte, souvent à travers la disqualification des autres, toute tentative de trouver des médiations entre des univers apparaissant comme incompatibles doit faire face à des difficultés assez considérables. Pourtant la clé de la paix sociale se trouve dans les actions qui mettent en présence dans un même lieu, dans une même temporalité, et dans la même tâche à réaliser, des groupes dont les différences sont radicalement opposées. Dans ce genre de situation, il ne s’agit pas de nier les identités, mais de les ouvrir à la possibilité d’accueillir des personnes extérieures en reconnaissant les termes de leur mode d’existence, de trouver les situations de travail qui réunissent les différences. Il ne s’agit pas non plus de créer des formes artistiques passe-partout, clé en main, qui contenteraient les exigences de tout public, dans un bonheur olympique universel. Il s’agit au contraire de confronter dans des rituels les conflits fondamentaux pour les rendre manifestes et les traiter dans des pratiques communes qui ne prétendent pas les résoudre, mais qui les mettent en jeu (en entrejeu) pacifiquement.
Les actions menées durant l’automne 2023 conjointement par le Cra.p et l’Orchestre National Urbain, le département de la FEM au sein du CNSMD de Lyon, et l’Université Lyon II dans le cadre de la Biennale Hors Norme, correspondent tout à fait à cet idéal de faire se rencontrer des mondes différents. Le dispositif imaginé pour y parvenir se base sur trois conditions qui se combinent : premièrement une manière de structurer les pratiques permettant un fonctionnement immédiat commun à toute personne présente : instruments, matériaux, domaines d’action, codes-couleurs ; deuxièmement, cette structuration permet l’ouverture sur une liberté individuelle : improvisation, textes ; et troisièmement les mises en pratique sont conçues en vue de mettre tout le monde sur un plan d’égalité : situations pensées hors des rôles spécialisés, avec l’impossibilité d’utiliser les savoir-faire techniques acquis.
Giacomo Spica Capobianco, artiste musicien, directeur artistique du Cra.p, extrait de la vidéo « Biennale Hors Normes » (36’48”-41’10”)
Ceux et celles qui se lancent effrontément dans l’aventure d’établir des points de rencontre entre des groupes humains qui soigneusement évitent de se côtoyer sont bien téméraires. Ils doivent inventer des moyens de mettre en œuvre des pratiques impliquant la prise en considération d’autrui en évitant toute violence, mais sans édulcorer la réalité des tensions qui sont en jeu. Ils doivent si souvent faire face à l’inertie des professionnels installés et parfois à des refus intolérables. Leur présence admirable dans le paysage culturel et artistique, trop rarement reconnue, est d’une très grande importance.
Restitution à l’Université Lyon II, extrait de la vidéo (41’11”-46’10”)
1.Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
2. Cette notion, empruntée aux sociologues Christian Bessy et Francis Chateauraynaud décrit « la rencontre entre un jeu de catégories et des propriétés matérielles, identifiables par les sens (supposés) communs ou par des instruments d’objectivation » (1992, p.105). Elle est initialement utilisée pour étudier le travail d’estimation des commissaires-priseurs dont la tâche peut être réduite au fait de rechercher des indices permettant d’articuler la perception des propriétés matérielles des objets et l’évaluation de leurs qualités par référence à un espace de circulation – en l’occurrence le marché de l’occasion. Ramenée à la situation dont il est ici question elle permet de comprendre en quoi certaines propriétés matérielles du dispositif (instrumentarium, code couleur, disposition de la salle, qualité des matériaux etc…) favorisent l’engagement des participant·e·s dans le sens où elles ne font pas obstacle à leurs dispositions physiques et perceptives – et qui permet d’expliquer, au moins dans un premier temps, les difficultés que rencontrent les « musicien·ne·s » vis-à-vis de ces mêmes propriétés matérielles.
3. Considérant le dispositif comme un « objet-composé » (Dodier et Stavrianakis, 2018), le terme ne décrit pas seulement ici l’agencement matériel du dispositif mais également le réseau d’individus, de normes et de rôles sociaux qui y sont attachés (les participant·e·s font ainsi partie intégrante du dispositif).
4. Si l’usage du terme « épreuve » peut tout à fait renvoyer à l’usage commun que l’on en fait, je l’utilise ici dans le sens qu’y investit la sociologie dite pragmatique (Lemieux, 2018), qui la définit comme « un moment au cours duquel les personnes font preuve de leurs compétences soit pour agir, soit pour désigner, qualifier, juger ou justifier quelque chose ou quelqu’un » (Nachi, 2015, p.57). Ici, je considère que ce qui est engagé par le dispositif (la crédibilité de l’Orchestre National Urbain, les enjeux artistiques et sociaux portés par les ateliers etc…) est mis à l’épreuve de sa réalisation, même si l’on peut tout autant considérer le dispositif comme une épreuve permettant de (re-) qualifier les individus qui y participent.
Références citées :
Bessy, C., & Chateauraynaud, F. (1992). Le savoir-prendre. Enquête sur l’estimation des objets. Techniques & Culture, 20, 105 134. https://doi.org/10.4000/tc.5029
Dodier, N., & Stavrianakis, A. (Éds.). (2018). Les objets composés : Agencements, dispositifs, assemblages. Éditions de l’EHESS.
Antoine Hennion, Les Conservatoires et leurs élèves (avec F. Martinat & J.-P. Vignolle), Paris, Ministère de la Culture/La Documentation française, 1983.
Nachi, M (2015). Introduction à la sociologie pragmatique. Dunod.
Emmanuelle Pépin – Lionel Garcin
LE SON – l’écoute – LE GESTE
dans l’Improvisation
Emmanuelle Pépin, danse et textes,
Lionel Garcin, musique
Cefedem AuRA, Lyon, le 24 janvier 2023
Le 24 janvier 2023, Emmanuelle Pépin et Lionel Garcin ont présenté une conférence/performance au Cefedem AuRA à Lyon. Cet évènement a donné lieu à cinq documents que nous publions dans la quatrième édition de PaaLabRes:
- La vidéo de la conférence/performance: Vidéo
- Le texte qui a été prononcé lors de la conférence/performance : Texte « dit »
- Le texte complet d’Emmanuelle Pépin qui a servi de base à celui prononcé durant la conférence/performance : LE SON – l’écoute – LE GESTE
- La vidéo de l’introduction à la conférence/performance par Philippe Genet (Directeur du Cefedem AuRA) et Jean-Charles François (PaaLabRes) : Vidéo Introduction
- La transcription des dialogues avec les étudiants après la conférence/performance : Dialogues
Emmanuelle Pépin est une improvisatrice-performeuse, chercheuse et pédagogue dans les arts du mouvements et de la musique.
Un long chemin en tant qu’interprète et un parcours de chorégraphe et de pédagogue, l’a guidé jusqu’à la composition instantanée et l’art de la performance.
Artiste associée de l’espace de développement artistique et pédagogique 7Pépinière avec Pierre Vion. Voir 7Pépinière
Elle reste nomade dans l’âme et le monde est son territoire de jeu. Elle place l’humain au centre de sa démarche artistique et pédagogique. Elle croit profondément en la beauté que peut porter chaque personne, et comment le langage du corps peut dévoiler l’être.
Lionel Garcin est un musicien improvisateur : « La matière sonore, c’est un peu sa matière première, sa glaise, son bloc de marbre… Son instrument, c’est le saxophone. Un instrument à vent, soi disant. Mais dont il sait exploiter toutes les facettes sonores. Certaines, parfois même assez inattendues… Le saxophone l’emmène le plus souvent sur le versant jazz de la musique; les sons qu’il tire de ses instruments et ses rythmiques si particulières le situeraient plutôt du côté des recherches acoustiques chères à la musique contemporaine. »
(JM Lecarpentier). Voir Le Grand Chahut.
Texte « dit » de la conférence/performance d’Emanuelle Pépin
Retour à la page d’accueil : Emmanuelle Pépin et Lionel Garcin
Texte « dit » de la conférence/performance
par Emmanuelle Pépin
LE SON – l’écoute – LE GESTE
Dans l’Improvisation
Emmanuelle Pépin, danse et textes, Lionel Garcin, musique
Cefedem AuRA, Lyon, le 24 janvier 2023
Transcription à partir de la vidéo de la conférence/performance :
Jean-Charles François.
Vidéo à 8’59”
Le son
Le geste
Danse et musique sont reliés indéniablement.
Plus précisément mouvement et son, ou plutôt musicien et danseur.
Chacun d’eux tire leur origine du corps, d’un corps conscient, d’un corps vivant.
Sons et mouvements jaillissent à partir d’un acte de présence, d’un acte d’écoute.
Tout est là, au creux de soi. À portée.
La danse crée du son, naît du son même – un lointain au-dedans de soi, souffle, un battement, un élan vital.
Le son vient d’un instrument qu’une personne joue, il provient du corps, d’un mouvement, le son est mouvement. Mouvement « résonnement » visible.
Dans une pièce improvisée, danse et musique jouent ensemble dans le même espace, l’espace invite, l’espace écoute.
Il est évident que des composantes comme le rythme, la durée, la texture, les hauteurs, volumes, notes, silence, mélodies, point d’attaque, contre-temps, impact, résonance, arrêt, saccade, pré-mouvement, énergie, pulsation, tempo, sources sonores, propagation, direction du don dans l’espace, partitions, scores, entrées-sorties, superpositions, entrelacements sont des éléments avec le danseur joue. Le musicien aussi.
Le musicien peut aussi accompagner le danseur, le danseur peut accompagner le musicien, musiciens et danseurs peuvent s’accompagner ensemble, ou pas.
Attention portée, avec ce regard d’enfant, sur les phénomènes.
Contemplation.
Qu’est-ce que le son change ?
Qu’est-ce que le geste change ?
Comment l’espace change ?
État des lieux.
Le lieu. L’architecture.
Dans le lieu.
Imaginaire.
Le temps des mouvements avec lesquels on joue…
Vidéo à 15’03”
La danse, c’est l’art du mouvement en silence
La musique, c’est l’art du silence en vibrations audibles
La danse est l’art sonore inaudible
La musique est l’art du mouvement sonore, de la modulation visible et audible en même temps
La danse est l’art du geste de l’écoute
La musique est l’art de l’écriture de l’écoute
La danse est la musique de l’élan intérieur
La musique est la voix de l’élan intérieur
La danse est la calligraphie de l’espace, dessinant et sculptant des paysages invisibles.
La musique est cette respiration large calligraphiant l’air, dansant avec lui, dessinant des paysages sonores et invisibles
La musique s’écrit dans l’espace elle le sculpte
La danse, en composition instantanée, c’est comme se laisser vivre par l’espace du vide
Danse et musique se situent là
ensemble, ou plutôt en même temps
sans pour autant « jouer harmonieusement ensemble ».
Danse et musique, sons et mouvements, jouent ici de l’évidence
non rationnelle, intuitive, sensible,
imaginaire, poétique,
absurde
Vidéo à 19’06”
Le son touche l’espace
La peau est touchée par l’espace
Double mouvement
Toucher
Être touché en même temps
La vibration du son voyage dans l’air
La peau, membrane flexible, poreuse qui sépare le monde intérieur, qui le relie au monde extérieur
La peau écoute
reçoit
la température, la lumière, l’humeur
Le mouvement déplace l’air,
le frictionne, le traverse, s’appuie sur l’air
Le geste transforme l’espace
Le son transforme l’espace
Le son touche l’espace
La peau touche le son
Le son touche la voix
C’est physiologique
élasticité, intensité
Milliards de petits trous constituent ma peau
Dès lors que mon corps est touché
tout le reste est touché
Écouter par la peau est subtile, global, inhérent
Le danseur sait cela
le corps du danseur, le corps aussi du musicien
Vidéo à 23’12”
Couches superposées en termes d’espace,
L’écoute est changeante, les pensées bougent
la perception du son est bougée
C‘est évident
on n’écoute pas de la même manière
Ma peau écoute, mon oreille écoute
Entonnoir, en forme de spirale qui laisse passer les vibrations
Petits récipients …
En équilibre
ou en déséquilibre…
Souffles, battements, pulsations
Le corps à nu, le corps est son, vivant
Impact
Ligne de son
Vidéo à 26’10”
Le silence entre les sons
La durée des sons
La durée d’un geste
Cette temporalité
Sentir, saisir, construire,
déconstruire
imaginer, réinventer
Une poétique de l’instant
Être là
Sous nos yeux
Écoutons cet espace, écoutons cet espace sans bouger
assis, debout, dans l’immobilité
Écoutons le phénomène
Écoutons notre respiration
Nos battements
Écoutons nos rythmes au milieu des sons de l’espace tout autour
Écoutons l’espace en train d’écouter
Écoutons le tout comme une large partition de sons qui cohabitent ensemble
qui participent ensemble
Notre présence au cœur
L’improvisation est l’expérience de la découverte.
Nous découvrons la découverte en même temps que nous nous découvrons. L’improvisation est l’expérience du dévoilement.
Une embarquée
Un voyage, une écriture
Des migrations de mémoires-vivantielles qui nous deviennent, nous animent, nous ramènent l’ailleurs dans les tissus de nos corps, nous déshabillent et nous rhabillent.
Car n’est-il pas une mise à nue si nue que de se dépouiller de ce qui nous fait, pour nous laisser « porositer » d’un mystère innommable, nous laisser bouger par ce qui échappe, nous saisit ? Nous laisser devenir un autre-soi sans se perdre non plus,
Sans perdre pied, mais toujours en laissant frôler-frolattrer en nous cette folie, cette fantaisie irrationnelle permise ici dans le maintenant de l’écoute large, dans ce jeu d’enfant grand.
L’écoute est un acte
L’écoute est au milieu
Tout réside dans l’attention portée
Le moindre mouvement
Le moindre son proche ou lointain
Au-delà de l’espace-même
Vidéo à 37’09”
La gravité, squelette, matières spongieuses
Travail sur l’état des vibrations
Le squelette résonne
Les vibrations du son traversent la peau, traversent l’épiderme, glissent sur les fascias, glissent sur les muscles, suivent les stries, les ligaments et les tendons.
Les vibrations descendent ou plutôt voyagent, traversent, se faufilent dans les liquides, la lymphe.
Les filaments, les réseaux de communication
Les sons traversent les couches, percutent, sont bousculés, massés.
C’est physiologique
Les articulations laissent passer les informations
Circulation du son, de l’énergie, du mouvement dans les moindres recoins.
Vidéo à 39’36”
Le corps est touché par le son
L’énergie du corps échauffe le corps
La température enfle
La peau transmet à l’air l’énergie du mouvement, le mouvement invisible au-delà du corps
Particules
De la matière se dégage de l’air, c’est physique, physiologique
L’air est brassé par le mouvement, par les sons
Sons et mouvements sont reliés indéniablement
Vidéo à 42’48”
Lignes de son
Danse comme une manifestation dynamique du vide
L’essence du son, l’essence du geste
Le vide immense, chaos phénoménal qui a donné la vie
Colonne vertébrale, oreille, ramifications, articulations
Liberté
L’espace à l’écoute, un lieu d’écoute
Les sons sont entraînés dans un flux, ils jouent dans l’attente joyeuse du mouvement suivant, ils jouent dans les articulations juste le temps de trouver une nouvelle voie
Les liquides, un océan en soi
Des méandres incandescentes, phosphorescentes, lumineuses
L’écoute par les liquides est une écoute mouvante
(…)
… déséquilibre…
…écoute… …maintenant…
…battements…
…pulsations…
Le corps…
(…)
L’espace du rien
Le sourd retentissement
Dialogues après la conférence-performance
Après la conférence-performance
d’Emmanuelle Pépin et de Lionel Garcin
LE SON – l’écoute – LE GESTE
Dans l’Improvisation
Cefedem AuRA, le 24 janvier 2023
Dialogues avec les étudiants
et
Pour le Cefedem : Philippe Genet, Gwénaël Dubois, Nicolas Sidoroff
Pour PaaLabRes : Jean-Charles François
Transcription à partir de l’enregistrement audio :
Samuel Chagnard
Summary :
1. L’improvisation dans l’instant et par rapport à autrui
2. L’expérience comme préparation à l’improvisation
3. L’improvisation comme écriture
4. Le corps support de l’improvisation
5. Le texte et l’improvisation
6. La technique par/pour l’improvisation
7. Improviser pour apprendre
1. L’improvisation dans l’instant et par rapport à autrui
Emanuelle Pépin :
Comme le dit Barre Phillips après un temps d’improvisation : « ben ça y est, c’est fait ! » Ça n’existe qu’une seule fois : c’est le fruit de ce qui s’est passé maintenant, avec vous. Rien n’était prévu, sauf un texte, quelque part, issu du corps… et de notre rencontre ! Merci beaucoup, parce que dans un travail d’improvisation, le public, et son écoute, participent complètement à ce qui se trame, là. Vous êtes vraiment des partenaires. Et même si, parfois, cela peut échapper aux spectateurs, vous êtes des « participateurs », des « particip’acteurs » de ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup de m’avoir offert cet espace. Merci à toi, Jean-Charles, et aussi à toute l’équipe du Cefedem.
Nicolas Sidoroff (Cefedem et PaaLabRes) :
Merci. La tradition veut qu’on enchaine avec des questions, à poser à Lionel et Emmanuelle.
Étudiant·e :
La vitesse de réaction de l’une et l’autre aux propositions étant assez impressionnante, est-ce que vous avez des automatismes, comme un jazzman peut avoir des phrases dans son vocabulaire, dans son improvisation ? Par exemple, quand tu fais un appel, est-ce que tu sais que tel son va finir à tel moment ? Est-ce que tu le conscientises ou pas du tout ?
Lionel Garcin :
Il y a du vocabulaire, c’est sûr, et des textures, etc., mais au niveau de la forme, il n’y a pas d’appel : on ne sait pas combien de temps cela va durer, c’est vraiment dans l’instant que ça se joue. Et c’est parce qu’on est dans l’écoute au niveau global et énergétique qu’on est au même endroit. En fait, ce n’est pas qu’on réagit. Peut-être qu’on réagit vite, mais ce n’est pas vraiment ça : c’est plutôt parce qu’on est au même endroit que cela se passe, parce qu’on se comprend.
Emanuelle Pépin :
Sans se comprendre ! On ne comprend rien du tout !
Lionel Garcin:
Sans se comprendre, oui ! On peut être complètement surpris, mais on respire ensemble, il y a une évidence qui nait de l’écoute.
2. L’expérience comme préparation à l’improvisation
Jean-Charles François (PaaLabRes) :
Est-ce que cela veut dire qu’il n’y a aucune préparation entre vous ?
Lionel Garcin:
Si, il y a une préparation : on a mangé ensemble, on a discuté, etc. ! [rires] En fait, il n’y a pas de préparation autre que d’être en connexion.
Emanuelle Pépin :
Après, c’est plus un état de disponibilité pour accueillir ce qui est en train de se manifester dans l’air, dans l’atmosphère. Ça va très vite en fait. C’est justement parce qu’il n’y a pas de préméditation, pas d’attente particulière, qu’il y a une fulgurance. C’est presque à la vitesse de la lumière, ce n’est pas de la réaction. C’est tellement plus vaste : par exemple là, c’est un duo son et mouvement, mais il y a tout l’espace qui va complètement modifier cette relation, qui va faire que le son résonne différemment ici et que le corps va bouger différemment ici. Ce n’est pas une réaction : à un moment donné, c’est être en effet au même endroit d’écoute comme tu le disais. À l’origine c’est cela, un état d’écoute. Après, oui c’est du travail, c’est énormément de travail !
Étudiant·e :
Mais ce n’est pas du temps de répétition ?
Emanuelle Pépin :
Pas du tout de préparation, pas de répétition. On ne répète pas, mais on consacre du temps. On consacre plutôt notre vie à tenter mettre à jour nos techniques, nos outils et les transformations dans le corps selon nos humeurs et notre état. On travaille vraiment sur l’instant : la « composition instantanée », c’est là, et après le « là », c’est trop tard ! Ce laps de temps, si fugace en fait, contient toutes nos expériences. Pour cela, oui, il y a des outils : j’ai travaillé des heures dans des studios de danse, le placement par exemple. J’ai travaillé jusqu’à 8 heures par jour. Maintenant, ce sont encore des heures de travail, mais différentes, comme apprécier la texture et se demander ce que je peux faire avec, déconstruire presque la technique, ce qui m’a formatée, pour tenter de trouver et re-trouver, c’est-à-dire trouver à chaque fois, nouvellement, dans cette fraîcheur-là, comment tout cela arrive, sans surtout vouloir reproduire une forme. Pour répondre à ta question plus précisément, c’est « non ». J’ai une manière de faire, Lionel a une manière de faire, je reconnais sa sonorité, sa patte, son geste artistique, ce que tout cela contient. C’est une signature, on est tous uniques. Il s’agit de la rencontre d’une singularité avec d’autres singularités qui crée quelque chose d’autre, justement, que ce que l’on sait faire. C’est un mélange de connu et d’inconnu, de familier et de complètement étranger. Si tu commences à te dire « je vais faire une arabesque », c’est fichu parce que cela veut dire que tu es dans la pensée : tu prémédites et cela ne fonctionne plus.
Lionel Garcin :
Oui, ce n’est pas du travail de formes préétablies, c’est du travail d’être, au lieu de l’écoute : c’est du lieu de l’écoute que naissent les formes. La pensée est là, pas en tant que productrice, mais en tant que lectrice. On lit les formes qui sont en train d’advenir. Tout le travail qu’il peut y avoir dans la composition de forme est là, mais pas préalablement, il arrive après l’écoute.
Étudiant·e :
De quand date la formation de ce duo ?
Emanuelle Pépin :
C’était lors des Rencontres du CEPI (Centre Européen Pour l’Improvisation) en septembre 2020 à Valcivières dont Jean-Charles a parlé tout à l’heure. À cette occasion, la personne qui accueillait la rencontre m’avait demandé, sachant que j’écrivais, si je n’avais pas quelque chose à proposer. Lionel était là et j’ai proposé une performance avec lui, comme ça, parce qu’on se connaît bien. On peut appeler ça une conférence-performance. Je ne sais pas du tout ce que cela a donné, mais c’est né là-bas, et voilà ! Depuis on n’a jamais retravaillé dessus. Pour aujourd’hui, on s’est seulement vus, on en a parlé et c’est toujours là, c’est dans le corps et dans la communication : hier on a consacré un temps, il faisait d’ailleurs super froid et ce n’était pas dans le corps, mais c’était déjà un acte en soi. C’est aussi ce qui est arrivé aujourd’hui : je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Je ne voulais surtout pas savoir ce que cela allait donner. Nous ne voulions pas savoir, parce que, sinon, c’est cuit !
Lionel Garcin :
Mais cela fait 20 ans qu’on se connaît, 15 ou 18 ans qu’on pratique ensemble, pas forcément en duo. Parfois on est 12, ou 20, enfin je ne sais pas. En duo, on a peut-être dû jouer 3 fois, en comptant aujourd’hui.
Emanuelle Pépin :
Tous les deux, 3 ou 4 fois, oui.
3. L’improvisation comme écriture
Étudiant·e :
Tout à l’heure, quand cela s’est terminé, vous n’avez eu aucun doute sur le fait que c’était la fin ?
Emanuelle Pépin :
Non! [rires] [à Lionel] Tu as eu des doutes ?
Lionel Garcin :
Non ! Mais la fin, c’est important. Le début, la fin, tout cela, c’est fractal : il y a la grande forme à chaque fois, à chaque souffle, à chaque phrase, chaque période, il y a la naissance et la mort, et l’acceptation de cela qui tisse l’ensemble. Il y a comme une évidence. On peut avoir des doutes parfois, mais aujourd’hui ce n’était pas le cas.
Emanuelle Pépin :
C’est une écriture en fait : c’est une autre forme de composition, mais c’est de la composition, ce n’est pas du n’importe quoi. On ne se lance pas comme ça, en gesticulant, « je peux, il peut, nous pouvons, poutt, poutt ! » — je caricature un peu. Il s’agit d’autre chose. À ce moment-là, c’est une conscience en mouvement. Ce n’est pas une analyse de ce qui est en train de se faire, on n’est pas en train de se dire « ah oui ! là, c’est le début, là, etc. » En étant totalement « avec », on a la conscience du présent, de ce qui s’est passé : les mémoires, au fur et à mesure de la pièce, s’agencent, s’accumulent, créent en soi une organicité de la durée.
Lionel Garcin :
C’est organique, oui.
Emanuelle Pépin :
Il y a une conscience, que j’appelle la contemplation : à un moment donné, notre habilité c’est de pouvoir contempler ce qui est en train de se passer. Créer de l’espace suffisant permet de sentir, écouter, mesurer ce qui est en train de se passer pour avoir cette conscience de l’écriture, mais ce n’est pas intellectuel.
Lionel Garcin :
Non, c’est l’habilité du corps, c’est vivant. En fait, c’est juste simple, juste organique. Comme c’est le vivant, c’est déjà donné.
Étudiant·e :
Même dans l’introduction ! Il y a eu un grand moment de silence, et en fait ça avait déjà commencé. Je ne sais pas comment les autres l’ont perçu, mais chaque petit bruit, chaque petit son… J’ai vu que vous réagissiez à tout : à un moment j’ai bougé mon pied et il y a eu un regard comme s’il y a eu un son. Le plancher a grincé, dans la salle du dessus des tables bougeaient, etc. chaque son prend une importance différente. En tant que spectateur, on se disait « ah, il s’est passé ci, il s’est passé ça, ça a réagi ». C’est vrai que c’est spontané : là on est dans une pièce à un temps T, et c’est déjà passé ! Demain si vous faites dans le même lieu avec le même public, ça sera encore autre chose. J’ai beaucoup aimé le moment de silence au début parce que je trouve que parfois on ne prend pas assez le temps : il y a un public, on doit performer, et point ! Là, le silence, c’était comme pour inviter des enfants « chut, écoutez ! »
Emanuelle Pépin :
C’est prendre en compte, prendre en considération l’espace dans lequel la pièce va avoir lieu. C’est l’espace qui nous « invite à ». L’espace est constitué d’éléments, comme des végétaux en extérieur, ou vous ici en intérieur, qui créent le « décor » entre guillemets. Comme tout se joue à partir de cet acte d’écoute, ce n’est pas une volonté de vouloir à tout prix vous mettre dans une situation d’écoute, mais le silence offre ça — même si le silence, en quelque sorte, n’existe pas parce qu’il y a tout le temps des bruissements, même notre corps est résonnant. Et ça, ça se sent dans l’air. C’est une activité, une « tension vers » et c’est avec ça qu’on crée aussi, ce qui vaut aussi pour l’écriture.
Étudiant·e :
Et dans le choix du costume ? Il me semble que vous n’êtes pas arrivée habillée par hasard. Est-ce que cela fait partie d’une improvisation ? C’est un choix ?
Emanuelle Pépin :
Oui, c’est un choix pratique. Je n’ai pas beaucoup de pantalons avec lesquels je peux, par exemple, faire un mouvement brusque sans le déchirer de devant jusque derrière ! Ça m’est déjà arrivé, donc j’essaie de trouver des matières assez solides. Mais cela dépend : aujourd’hui j’ai deux autres pantalons, mais j’ai vu que le sol aurait pu m’accrocher. Ce n’est pas que j’ai peur pour mon pantalon, mais cela aurait parasité le mouvement, ou alors j’aurais pu en jouer, mais bon…
Lionel Garcin :
J’avais l’impression que le sens de ta question était que ce n’était pas complètement improvisé parce qu’on avait déjà choisi le costume ?
Étudiant·e :
C’est ça. Est-ce que c’était au-delà d’un choix de confort ?
Lionel Garcin :
Moi je ne me suis pas posé la question, je prends un truc que j’ai d’habitude. En même temps, l’improvisation, ce n’est que des choix. Il y a quand même une écriture qui est donnée, l’instrument est une écriture, il a des contraintes, il a des limites. Le corps et l’espace aussi. On écrit avec ce qui est là, on n’est pas dans l’indéfini total, donc ça fait partie de ce qui nous est donné.
Emanuelle Pépin :
Et puis tout dépend de la situation. Là, c’est un travail spécifique avec le son. C’est ce que je disais tout à l’heure, je peux avoir une perception du son au travers de la peau et au travers des tissus du corps. Mais, il y a quand même des matières par-dessus la peau, et si ces matières ne sont pas respirantes, poreuses, ça coupe l’écoute. Une autre fois, j’ai travaillé avec un plasticien qui calligraphiait sur de grands pans de soie sauvage. Je ne le connaissais pas, mais j’avais regardé son travail à l’avance. J’ai donc choisi spécialement un costume qui était dans une fluidité, avec des coloris qui ne venaient pas trop trancher avec sa matière. Oui, il y a des scénographies parfois pour lesquelles j’amène des matériaux, des objets.
Étudiant·e :
Tout à l’heure vous avez parlé de simplicité. Je ne sais pas trop pour la danse, mais musicalement j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de complexité : des souffles continus, des recherches sur les timbres, des sons avec ou sans anche, etc. Est-ce que c’étaient des capacités que tu avais avant ou est-ce que c’est le fait d’être dans la recherche qui t’a amené à aller dans ces cas de figure ?
Lionel Garcin :
C’est peut-être par goût que d’être attiré par cela, mais c’est surtout venu de la pratique. Ce ne sont pas des trucs que j’avais appris avant. Tout ce vocabulaire est né de la pratique de l’improvisation, notamment l’improvisation en orchestre, avec plusieurs musiciens qui jouent d’autres instruments. Il y a l’envie d’aller vers eux, de composer avec eux : tu trouves des thèmes qui s’agencent et toute la mise en jeu du corps fait aussi trouver des choses. C’est donc plutôt l’improvisation qui a nourri ce vocabulaire.
Étudiant·e :
Pour moi, certaines choses me paraissent compliquées, mais ça devient simple en fait, c’est comme ça que vous le voyez ?
Lionel Garcin :
Oui, quand je parle de simplicité, ce n’est pas une complexité de la musique… La simplicité c’est la base, c’est ce sur quoi on est basé dans le corps, comme la simplicité de l’écoute. Après, ce qui se construit dessus, c’est autre chose, oui.
4. Le corps support de l’improvisation
Étudiant·e :
J’ai une question pour vous, saxophoniste. En musique, on est un peu éduqué dans une logique de statisme corporel : on ne sait parfois pas trop quoi faire de notre corps sur scène, voire on voudrait même le cacher. Mais vous, vous avez bougé partout, vous étiez en mouvement, vous avez dansé aussi ?
Lionel Garcin :
Non. Je pratique beaucoup avec de la danse donc ça arrive qu’au bout d’un moment on en ait marre de l’instrument, qu’on le lâche pendant trois jours et qu’on ne passe que par le corps. Parce que parfois l’instrument est tellement encombrant ! Quand on veut retrouver cette simplicité de se relier à des choses simples et organiques, l’instrument gène parfois. Il faut tellement de technicité pour retrouver l’organique, qu’on peut développer d’autres techniques qui sont tout de suite organiques : repasser par le corps aide à retrouver cette organicité qu’on essaie de prolonger avec l’instrument. Mais quand je fais des concerts, je ne bouge pas, j’adore être uniquement dans le son, avec le ressenti dans le corps, mais dans le corps immobile, enfin immobile… il faut bien bouger, mais ça ne fait pas la même chose. Aujourd’hui, j’ai pris plus en compte l’espace, mais des fois je vais préférer être plus simple et me focaliser sur la musique.
Étudiant·e
Comme un lâcher-prise ?
Lionel Garcin :
Oui, un lâcher-prise dans le sens qu’une fois qu’on a donné toute sa place à l’espace et au son, on disparaît en tant que personne séparée et on se libère de soi-même en donnant la place au reste. Ça ne dure pas forcément longtemps, mais…
Étudiant·e
Tout ce que vous évoquez là, parler d’espace, de vie, de composer à partir de ce qui est déjà là, du moment présent, j’ai l’impression que c’est lié à des préceptes comme le bouddhisme, le développement personnel, une sorte de sagesse ancestrale. Je voulais savoir si vous aviez infusé un peu dans ces sciences-là parce que le champ lexical du ressenti et des émotions revient souvent. Est-ce que vous vous en nourrissez, ou est-ce que vous avez développé ces sensibilités-là avec le temps ?
Lionel Garcin :
Oui, je pense que c’est relié. Pour moi, les traditions dont tu parles sont aussi dans notre culture dans la poésie, par l’art, même si parfois on l’a peut-être perdu par ailleurs. Je suis venu à la musique parce que, sans le savoir, j’avais un manque de cette dimension-là. J’étais parti pour faire de la recherche académique en sciences quand j’ai rencontré Barre Phillips avec qui j’ai ressenti qu’il y avait une autre dimension qui me manquait. Et puis par le corps aussi, parce que tout cela fonctionne par rapport à des sensations. Dans la danse, ils ont une connaissance phénoménale du corps conscient, donc c’est relié forcément.
Emanuelle Pépin :
Et puis toutes les approches de techniques somatiques. Pour ma part, je ne suis pas allée chercher à l’extérieur de l’institution. Je viens du Conservatoire et du Centre National Chorégraphique, avec une réelle discipline de différentes techniques de danse. À un moment donné, je me sentais limitée dans l’expression du vivant, du geste, de la relation. Quand j’ai rencontré des chorégraphes de la ligne américaine en France qui développaient cette approche-là, je me suis dit « c’est là ! ». C’est par le travail que les choses se sont éclairées. Je lis beaucoup et j’écoute aussi comment les gens fonctionnent. Dans ces pratiques, c’est ce qui est développé, affiné, pour tenter d’aller à la source de l’écoute et de créer l’espace de relation entre notre monde intérieur et le monde extérieur.
Même étudiant·e
Ce qui revient c’est qu’à chaque fois, artistiquement, on a un background et une éducation, et on doit se déformater. Pour aller plus loin, on se dirige toujours vers ces grandes expressions, parce qu’elles sont plus libres et qu’elles permettent de ressentir plus en profondeur, comme une certaine forme de liberté. Beaucoup de musiciens et de danseurs se dirigent vers l’improvisation, parce qu’apparemment ça libère et ça relie à la fois. Est-ce que c’est le chemin de tout le monde ?
Lionel Garcin :
Pour moi, l’improvisation est comme une pratique philosophique et poétique de découverte du réel, par la pratique, reliée à notre histoire et celle des autres civilisations, qui se situe en dehors de la production consumériste de l’industrie artistique. C’est une autre chose.
5. Le texte et l’improvisation
Jean-Charles François :
Pourriez-vous dire quelques mots sur le rapport entre le texte et l’improvisation ? Parce que c’est aussi ce qui est intéressant dans cette histoire, la tension entre l’improvisation et un texte prédéterminé : il y a l’intégration de la fixité du texte dans l’improvisation, le texte écrit qu’on lit à un moment donné et le texte en dehors de l’écrit qui est peut-être improvisé. Ce rapport au texte me paraît très intéressant.
Emanuelle Pépin :
Je crois qu’il me faudrait du temps pour répondre. Comme c’est arrivé il y a trois ans, c’est encore tout nouveau et je n’ai pas de distance. Ce que je peux juste dire, c’est que le texte est issu de la pratique et de l’expérience. C’est devenu une forme de partition. Mais en venant ici en voiture, je me disais : « Comment je vais m’y prendre ? Je vais suivre, lire ? » sachant que j’ai du mal à sortir la voix comme ça, dans la performance. Et en fait, j’ai considéré les textes comme une pièce improvisée dans laquelle on pouvait peut-être — cela me rassurait de dire « peut-être » — laisser arriver le mot. C’est comme si, en tout cas dans le mouvement, le texte et les mots étaient tout le temps là.
Lionel Garcin :
Hier, quand tu me lisais le texte, il était clair que cela ne pouvait pas marcher comme ça, juste en le lisant. Même s’il est issu de la pratique, il faudrait l’actualiser au temps présent et qu’il soit réincarné. C’est le fait que tu le réimprovises sur le moment en ayant la base des notes, c’est cela qui se passe.
Emanuelle Pépin :
Oui. En fait, cela n’aurait pas été juste, d’aller le lire.
Lionel Garcin :
Cela serait de l’illustration.
Emanuelle Pépin :
Même si par moment, le geste appelait le mot ou le mot appelait le geste — le geste au sens large : le geste dansé ou sonore.
Lionel Garcin :
Quand j’entends ces phrases, c’est comme si cela me plaçait à un endroit d’écoute, que cela me donnait un éclairage. Peut-être que je n’étais pas en train d’écouter de cette façon-là, mais cela me fait lire ce qui est en train de se passer d’un autre point de vue. Il ne s’agit pas forcément de changer ce qui se passe, mais de le lire d’un autre point de vue. Je ne sais pas si cela va changer le cours des choses, mais cela change la lecture.
Emanuelle Pépin :
Oui, cela change l’écoute, et cela change le son.
La technique par/pour l’improvisation
Philippe Genet (Directeur du Cefedem AuRA) :
Je voulais revenir sur le formatage et puis sur la libération. La plupart des étudiants ici, qui enseigneront ou enseignent déjà, se posent la question de la transmission de ces formes de pratique. Parfois, aujourd’hui, pour pouvoir se libérer d’un enseignement académique, on parle beaucoup d’improvisation dans les cours pour pouvoir justement apporter à la fois une forme de liberté et un langage nouveau. Je voulais savoir si vous étiez confrontés parfois à la transmission, à des stages, ou à des cours si vous en avez déjà donné et comment vous pouvez appréhender ce type de démarche. Est-ce qu’il faudrait attendre d’avoir une technique poussée ou est-ce que tout de suite, de façon très intuitive, on peut avoir une approche qui permet peut-être aussi de prendre conscience de son corps, du geste, de l’instrument ? Est-ce que cela ne pourrait pas être une entrée en pratique musicale ou dansée pour de jeunes enfants qui débutent ?
Lionel Garcin :
Oui, cela peut être direct, tout de suite, c’est sûr. Mais on peut aussi se libérer sans faire d’improvisation. Un interprète au sommet de son art n’a pas besoin d’improviser. Je ne sais pas, c’est une large question en fait. Oui, on anime des stages de temps en temps, mais je suis toujours un peu gêné quand cela s’enseigne, comme si c’était une forme qu’on puisse enseigner alors que c’est assez anarchique comme pratique en réalité.
Emanuelle Pépin :
Oui, mais en même temps, il y a énormément d’outils, des portes d’entrée très concrètes. Que ce soit pour les danseurs ou les musiciens, le rapport au corps est déjà quelque chose d’énorme. Et cela représente des heures et des heures de pratique, de travail : on peut rentrer par la conscience du squelette, le rapport à la gravité, les déplacements, l’architecture, se placer à la situation du corps dans l’espace, le geste sonore, le geste du musicien avec son instrument, le corps de l’instrument dans l’espace, le corps de l’instrument avec le musicien, les textures du son, les hauteurs, et effectivement comment le vivre aussi. L’approche du travail d’improvisation consiste à repasser par le corps, mais cela ne veut pas dire qu’on se met à danser.
Lionel Garcin :
Et passer par le non-savoir aussi.
Emanuelle Pépin :
Et ne pas du tout rejeter la technique, au contraire, c’est fabuleux ! Cela dit, quand on a un public de personnes qui n’ont jamais pratiqué la danse, on observe un étonnement, comme un état d’enfant, avec une générosité, sans a priori, un « oser y aller ». Avec même, souvent, beaucoup de maladresse, mais une certaine sensibilité aussi. Parfois, avec des personnes qui arrivent avec un background vraiment très solide, il s’agit de trouver une manière d’aborder différemment son rapport à l’instrument, son rapport à l’espace, son rapport à l’autre, son rapport à l’écriture, comme simplement le prendre d’un autre point de vue. L’improvisation n’est pas forcément une porte pour se libérer.
Lionel Garcin :
On peut s’y enfermer aussi.
Emanuelle Pépin :
Oui, complètement. C’est juste « être là » et cela représente un sacré travail qui passe par les sensations, la perception, la conscience de l’espace, la conscience de comment un son voyage, comment on compose, etc. C’est immense les outils avec lesquels on peut jouer.
Lionel Garcin :
Par rapport à l’enseignement, on retrouve dans le milieu musical de l’improvisation quelque chose qui est très proche dans la structure sociale des sociétés traditionnelles, dans le sens qu’on est tous mélangés, de celui qui débute à celui qui a passé sa vie à en faire, ce qui ne pose pas de problème. Il existe de nombreuses sessions de pratiques collectives où tout le monde est ensemble, comme dans un village où il y a des percussionnistes, les vieux et les jeunes, tous mis ensemble pour trouver un agencement. On apprend aussi comme ça, par la pratique. Il n’y a donc pas forcément besoin d’avoir une technique au départ, elle va se créer aussi. Cette dialectique avec la technique et le savoir constitué est hyper importante. On peut avancer comme ça.
Philippe Genet :
Dans l’enseignement académique, ce n’est pas le cas : on doit d’abord asseoir une technique pour pouvoir ensuite aller plus loin. On voit très bien que l’improvisation arrive à un moment donné, comme une porte qui s’ouvre et qui vous ramène d’un coup à un autre univers, à d’autres espaces. Ma question portait sur le fait de savoir comment on articule cela. Je le dis spécifiquement ici au Cefedem où les questions de pédagogie se posent : comment articule-t-on cette entrée sachant que cela modifie le rapport à l’écrit ? Vous n’aviez aucune partition, seulement du texte par terre. Comment fait-on lorsque l’écrit est déjà très présent dans les pratiques ?
Lionel Garcin :
Cela pose la question du rapport au désir. Pourquoi est-ce qu’il faudrait acquérir d’abord telle ou telle technique ? Par l’improvisation, on se rend compte qu’on est déjà dans une pratique vivante, ou qu’on est dans le réel comme dans un combat en art martial. On est dedans, ce n’est pas une théorie qui mènera à une pratique dans 10 ans. On est confronté au réel. Et quand on sent par exemple qu’on ne peut pas y aller et qu’on n’a pas la technique, c’est à ce moment-là qu’on se tourne vers l’académisme (ou pas). Il faut développer cette technique parce qu’on sent dans le corps qu’on a besoin d’en passer par là parce qu’on est coincé. Donc là, ça peut être quelque chose qui réveille le désir en fait, ou plutôt la nécessité de le faire.
Emanuelle Pépin :
Je travaille beaucoup dans un centre de formation professionnelle des arts du cirque. J’ai été engagé pour donner des cours techniques à la condition que, dans le même temps, je propose des ateliers d’improvisation. Cela se fait ensemble. On le voit très bien, par exemple faire un triple saut périlleux avec les agrès de cirque présente une grande prise de risque en raison du volume, de la masse. Cela nécessite de l’habilité et génère beaucoup de peur en fait : certains ne dépassent pas le fait de se jeter comme ça, en arrière, même si on a un harnais, et du coup vont plutôt faire de la jonglerie. Pourtant, si on fait un travail sur l’état de déséquilibre, aller un petit peu loin dans la chute, sentir le sol, travailler sur la gravité, le rebond et la confiance avec les autres, alors tout d’un coup il sera possible de monter à 4 mètres de haut, sur une petite plateforme et de se jeter en arrière. Alors qu’en passant uniquement par la technique, en visant une figure — on s’appelle ça une figure à exécuter — il y en a beaucoup qui se perdent en cours de route. C’est dommage, parce qu’en fait par d’autres biais, que ce soit dans les sensations, la perception, l’imaginaire ou la créativité, la technique peut être nourrie de toutes ces expériences et permettre de dépasser nos propres capacités de manière insoupçonnée, c’est très net ! Je trouve que dans l’enseignement, dans les formations, c’est assez bien de le mettre tout de suite au même niveau, même si c’est pour approfondir une technique, quelle qu’elle soit, pour la raffiner, la maîtriser, mais aussi avoir une approche plus « ouverte », si on peut l’appeler ainsi.
Nicolas Sidoroff :
J’aurais une intervention à faire sur deux plans :
a. Lors d’une vidéo Ted-talk de 6 minutes, une trapéziste, Adie Delaney, explique comment elle a changé sa méthode d’enseignement du trapèze. Elle explique qu’en général, on dit « tu vas mettre ton pied là, et après il faut que ta main elle grimpe le long de la corde » etc. Or il y a des gens qui ont extrêmement peur, même quand le trapèze est relativement bas : il y a un moment où il faut que tu t’assoies sur la barre, tenir tout seul ce n’est pas du tout si évident que ça. Elle dit qu’elle essaye maintenant d’accompagner le corps progressivement pour inclure les gens dans cet apprentissage-là. Si tu mets trois mois pour oser enlever une main d’une corde, et bien tu prends trois mois, ce n’est pas grave, parce que cela t’apprend à lire les signaux du corps, à avoir un rapport au corps vraiment spécifique et savoir l’écouter. Je le mets en regard avec tout un background de l’école, notamment artistique qui reste hyper excluante : « si tu n’arrives pas à faire ce qu’on te demande, tu te casses ! De toute façon, on n’a pas besoin de beaucoup de musiciens d’orchestre, encore moins de solistes ! » Et si tu ne le comprends pas, on te le fait sentir avec deux ou trois petites évaluations bien cassantes, etc., et alors tu as du mal à recommencer, ou alors tu recommences ailleurs que dans une école artistique. (Je le dis comme ça, mais ce n’est pas ce qu’elle explique !). Je pense que là il y a un rapport à l’école assez intéressant, à creuser, en tout cas d’inclusion des gens dans ce processus-là d’apprentissage.
b. Et le deuxième point c’est au sujet de l’espèce d’idéal que Lionel a présenté avec les rencontres entre des gens très expérimentés, et des gens qui ne le sont pas. J’ai vécu plein de discussions après les sessions d’improvisation dans lesquelles certains participants n’avaient plus envie de bosser ensemble, où les gens s’agaçaient. En réalité, cet espace accueillant que vous avez décrit vis-à-vis du corps, vis-à-vis de l’espace, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de vous, est un rapport qui se construit. Ce n’est pas inné et il y a des gens qui sont passés par des écoles qui les ont empêchés de développer ce genre de choses. Comment faire en sorte que dans l’espace qu’on crée, dans la pratique qu’on arrive à créer, les gens pas très outillés puissent trouver des outils, et que les gens un peu plus outillés puissent inclure ces gens ? C’est ce que j’appelle la « participation légitime périphérique », qu’on peut retrouver dans certaines pratiques traditionnelles. Une chercheuse, Jean Lave, l’a mise en évidence dans des tribus africaines sur la fabrication des sacs ou des paniers : on retrouve les experts au centre, qui les font hyper vite, et à côté ceux qui savent un peu moins, qui regardent un peu et qui mettent plus de temps, et après ceux qui savent encore moins, qui regardent… et qui galèrent ! Ce qui n’est pas grave parce qu’en fait les sacs et les paniers sont déjà faits. Et autour tous les gamins circulent, regardent, touchent, etc. et développent un apprentissage périphérique qui devient de plus en plus central. Ce type d’apprentissage n’est pas du tout si évident que ça à mettre en place dans nos sociétés.
Lionel Garcin :
Non, mais ça existe par petites touches.
Nicolas Sidoroff :
Je ne dis pas que ça n’existe pas, mais qu’il faut y prêter un peu attention pour que cela puisse exister.
7. Improviser pour apprendre
Gwénaël Dubois, Enseignant au Cefedem AuRA :
Je voudrais revenir sur le rapport entre interprétation et improvisation, sur la question de la technique aussi, qui est alimentée par l’improvisation, et tout le rapport académique qu’on a au patrimoine. Je pense par exemple au répertoire classique du 19ème, où des compositeurs comme Chopin ou Liszt ont fondé toute la technique pianistique jouée aujourd’hui. Il n’y a pas un endroit dans l’enseignement supérieur où on ne demande pas aux pianistes de jouer une étude de Chopin en concours d’entrée alors qu’en fait ces pièces ont été composées en improvisant. C’est assez intéressant à soulever : les deux volumes d’Études publiées par Chopin avant l’âge de 25 ans ont été construits par l’improvisation. Ces pièces sont effectivement très difficiles à jouer dans une approche où on veut jouer du répertoire. On doit travailler comme si on pouvait arriver à ça, ce qui est extrêmement difficile parce qu’on ne passe pas par les procédés créatifs qu’il a utilisés, dans lesquels sans doute il s’est senti super bien. Il y a le fameux exemple qui a été relevé dans un mémoire d’étudiant au Cefedem : Chopin disait à ses élèves de jouer ses Études « avec facilité » ! alors que ce sont des trucs qui sont horriblement durs. Chaque Étude, comme leur nom l’indique, va se concentrer sur un point particulier. Mais dans l’enseignement aujourd’hui, il me semble qu’on peut peut-être réfléchir à comment est-ce qu’on réaborde le patrimoine d’une façon d’improviser. Comment est-ce qu’on travaille du Mozart, sans jouer du Mozart, mais en l’improvisant, et en essayant d’utiliser la même procédure d’improvisation. L’idée du désir que tu as soulevée est aussi très importante : est-ce qu’il faut partir d’une impro plus ou moins libre, pour voir où cela nous mène, puis quel compositeur on aborde à partir de là ? Il n’y a pas de recette magique, mais il faut vraiment reréfléchir à ces éléments-là. Parce que ces compositeurs qui ont composé des pièces incroyablement dures à jouer qui aujourd’hui enferment dans un académisme un peu minable, en fait, ils improvisaient.
Tout à l’heure tu disais : « si je pense à faire une arabesque, c’est foutu ». On retrouve ça aussi dans l’interprétation : quand on est en train de jouer un truc qui nous pose un peu problème, si on se dit « y a un mi bémol », c’est foutu, on se casse la figure, si on se dit « c’est chaud, ce passage », c’est foutu aussi. En fait, ce n’est pas parce qu’on pense qu’on se plante, mais il y a un peu de cette espèce de fil où il faut lâcher prise, mais pas complètement parce que sinon on n’y arrive plus, on n’a plus conscience de notre corps. Je trouve qu’il y a une dualité qui est assez complexe. Est-ce que c’est un peu ce qui nous réunit, quelle que soit la pratique ? Que ce soit de l’improvisation complètement libre ou de l’académisme complètement académique, j’ai l’impression que finalement, ce qui rassemble les pratiques, c’est cette espèce de fil qu’il faut arriver à lâcher pendant qu’on est en train de jouer. Il y aurait certainement à travailler de ce point de vue-là.
Lionel Garcin :
Ce sont des questionnements super intéressants. Je n’ai pas de réponse, mais ce sont des questionnements que je mets en pratique dans ma pratique même. Concernant ce dont tu parles, ce fil-là, j’ai l’impression que la pensée nous sort du truc en fait. Si elle est là en commentaire, on sort du truc. Ce n’est pas avec le lâcher-prise qu’on sera plus dans son corps, c’est le contraire : c’est quand on est dans son corps qu’on va lâcher prise, lâcher cette façon de commenter. Il faut que la pensée soit là, mais transparente, en tant que lectrice de ce qui se passe, comme une lectrice silencieuse.
Gwénaël Dubois :
D’un point de vue de l’enseignement, je me dis que cela peut s’enseigner, en tout cas se partager. On est en train d’en parler donc c’est bien que cela représente quand même quelque chose de tangible. Peut-être qu’il ne faut pas viser systématiquement des pièces toujours plus dures, mais que cela aiderait à le travailler avec des pièces plus faciles.
Lionel Garcin :
Je ne suis pas interprète, mais à un moment donné j’ai voulu savoir ce que c’était de se sentir interprète. Je n’ai pas fait du saxophone, mais j’ai travaillé des pièces de piano pour rentrer dedans, et j’ai l’impression effectivement que c’est important de ne pas aller vers des choses plus complexes que ce qu’on peut faire, mais au contraire choisir ce qu’on peut appréhender dans son ensemble et creuser les états d’être à partir de cela, avoir un point d’accroche, une pièce, et puis par exemple l’aborder de plein de manières différentes. À partir d’un support qu’on connaît, on peut se concentrer sur l’origine du rythme dans le corps. C’est-à-dire avoir différents niveaux de lecture qu’on peut nommer et se donner la possibilité de creuser la sensation, mais avec une forme définie qu’on connaît de mieux en mieux, plutôt que « ça y est, on l’a mise en place au niveau extérieur, et on passe à une plus difficile ».
Les compositeurs comme Chopin ont créé leur propre technique, par l’improvisation. C’est intéressant d’ouvrir la possibilité d’avoir sa propre individualité, au sein d’un collectif, d’une culture. Par exemple, si je devais jouer les études des trucs que je fais en improvisant, non seulement je n’en serais pas capable, mais surtout je m’emmerderais vraiment !
Gwénaël Dubois :
Dans la même logique, des recherches montrent que les pièces de Czerny, qui sont données à tous les mômes dans les conservatoires, sont initialement des supports pour improviser. Depuis c’est devenu des pièces assez horribles ! Czerny les utilisait comme base d’improvisation en reprenant des motifs et les développant dans plein de combinaisons. C’est un peu comme si tu transformais les techniques de jeu que tu utilises en études pour des étudiants.
Lionel Garcin :
On m’a déjà demandé ! Ça me fait penser à la flûte classique indienne que je suis allé un peu étudier là-bas. C’est hyper codifié, mais c’est étonnant comment ça fonctionne. Il y a justement une forme, là, avec différents niveaux de travail de cette forme : le niveau technique, le niveau émotionnel, le niveau spirituel, etc. Quand on apprend un raga, c’est comme un mode lydien on va dire, mais si on joue un mode lydien, ça ne va pas forcément faire un raga parce qu’il y a des intonations, des augmentations qui font qu’on a la sensation émotionnelle de ce raga. Tout ça est nommé et travaillé et tous les jours c’est refondu. Le jour 1, on va apprendre l’échelle et un ou deux petits motifs, et on a l’impression que le jour 2 on va recommencer ça, et que ça va être la même chose, mais non, le jour 2 est complètement différent, improvisé en fait : le professeur rentre dans une improvisation avec l’élève, à un certain niveau, et lui transmet des petits bouts de phrases. Chaque jour c’est nouveau, ce n’est jamais deux fois le même. Et au bout d’un moment il y a comme un champ qui se crée, un champ mélodique, un champ comme en physique là, qui est clair, mais qui n’est jamais fixé complètement.
Étudiant·e :
Ce que vous faites est quelque chose de difficile à écouter sûrement pour la plupart des gens. Est-ce que vous arrivez à en vivre et que ce genre de performances soit plutôt pérenne ?
Lionel Garcin :
On a essayé de faire la manche avec et ça n’a pas trop marché ! Tu vois, aujourd’hui c’est la deuxième fois qu’on l’a fait en 3 ans, donc…
Même étudiant·e :
Mais vous parliez aussi d’autres groupes…
Lionel Garcin :
Oui, moi je vis plus ou moins de l’improvisation, après je fais parfois aussi d’autres trucs en plus. L’improvisation a très peu de visibilité dans les endroits institutionnels, et donc c’est très souvent de l’underground et des économies pauvres.
Emanuelle Pépin :
Moi je ne dis plus que j’improvise ! Par exemple, je suis programmée dans un musée d’art contemporain, ils savent que je travaille en improvisation, mais… ce n’est pas dit. Évidemment, je suis allée plusieurs fois visiter le musée, j’ai fait plein de recherches, il y aura une trame, mais quoi qu’il en soit, j’improviserai à ce moment-là. Il faut aussi réfléchir à comment ça peut franchir des lieux qui au départ ne programment pas ce qu’on fait. Par exemple je vis de ça depuis plus de 30 ans. Je donne pas mal de workshops et pour moi ça va ensemble, la pédagogie est très nourricière du travail de la création. Quand j’interviens dans des centres de formation professionnelle, c’est par le biais de l’improvisation. Quand je joue avec des groupes, j’improvise. Quand je joue seule, quand je fais des performances, que ce soit dans des musées, des théâtres nationaux, ils ne savent pas forcément que je vais improviser, et quand je le dis, ils ne me croient pas de toute manière ! Après la performance, un grand nombre de fois, on me dit : « mais ça c’était écrit ! » Oui, c’est écrit sur l’instant, mais ça prend des formes à chaque fois différentes.
Lionel Garcin :
Et après, il y a des dispositifs — tu aimes bien ce mot-là — qui font que ça peut passer dans d’autres endroits. Par exemple, je propose un travail autour du chant des oiseaux dans lequel il y a beaucoup d’improvisation, c’est quasiment tout improvisé même. Mais le dispositif fait que c’est comme une écriture, et qu’il y a quelque chose qui attire : on est cinq saxophonistes soprano qui jouons à 20 mètres chacun dans son arbre. En fait, c’est le même travail qu’aujourd’hui avec en plus un travail sur le langage des oiseaux. Donc on peut élargir et développer les pratiques d’improvisation avec plein de dispositifs.